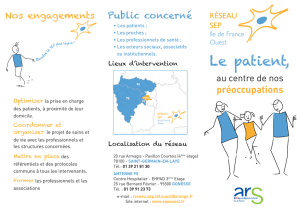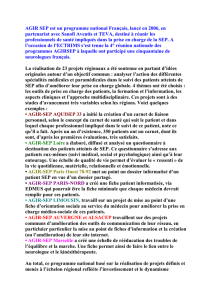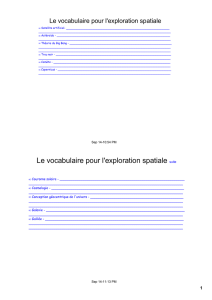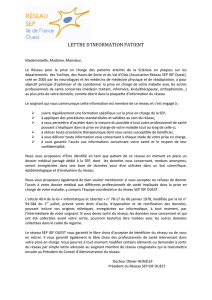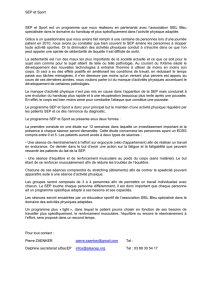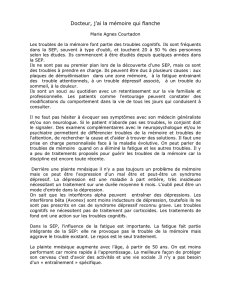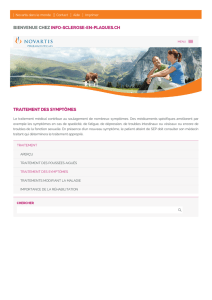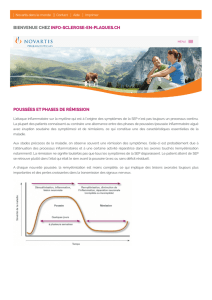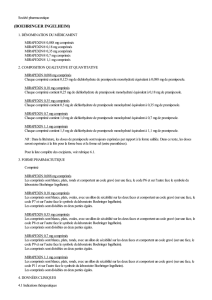Lire l'article complet

REVUE DE PRESSE
La Lettre du Neurologue • Vol. XVIII - no 4 - avril 2014 | 137
Étude AMANDYSK : effet de l’arrêt de l’amantadine
chez des patients parkinsoniens dyskinétiques
La physiopathologie des dyskinésies induites par la lévodopa dans la maladie de Parkinson
implique des mécanismes dopaminergiques et non dopaminergiques. L’amantadine est le
seul traitement ayant montré son utilité dans la prise en charge des dyskinésies de milieu de
dose (LID). Néanmoins, certaines études ont suggéré que le bénéfi ce de l’amantadine ne se
maintenait que pendant quelques mois et d’autres, que ce traitement n’avait pas démontré
sa supériorité sur le placebo dans un essai de sevrage en amantadine.
L’objectif de cette étude française était d’évaluer le bénéfi ce à long terme d’un traitement
par amantadine sur les LID. Il s’agit d’une étude de wash-out, réalisée sur 3mois, multicen-
trique, randomisée, en double aveugle contre placebo et en groupes parallèles, ayant inclus
56patients parkinsoniens traités depuis au moins 6mois par amantadine(200mg/j). Selon
une randomisation centralisée, un groupe “poursuivant” (n=27) continuait l’amantadine
à la même dose, et l’autre groupe “arrêt” (n=29) stoppait progressivement l’amantadine
(réduction de 100mg tous les 2jours) et passait sous placebo.
Les résultats montrent que 29patients ont terminé l’étude avant les 3mois, 21 en raison
d’une aggravation majeure des dyskinésies ; la plupart de ces patients appartenaient au
groupe “arrêt”(18 sur 21). Cinquante-deux pour cent ont arrêté au cours de la première
semaine et 28 % durant la deuxième semaine de l’étude. Le sous-score des items 32 et
33 de la sous-partie IV de l’UPDRS (critère principal de jugement) augmente davantage et
signifi cativement dans le groupe “arrêt” comparativement au groupe “poursuivant” (+1,7
versus +0,2, respectivement [p=0,003]). Cette différence reste signifi cative après ajustement
pour la sévérité des dyskinésies, l’âge et la dose du traitement dopaminergique. Par ailleurs,
138événements indésirables sont rapportés, la plupart liés à l’aggravation des dyskinésies.
Les autres événements indésirables sont une aggravation du syndrome parkinsonien (n=5)
dans le groupe “arrêt” et des troubles du contrôle des impulsions (n=1) ainsi qu’une
aggravation de la marche (n=1) dans le groupe “poursuivant”.
Cette étude montre que l’arrêt de l’amantadine s’accompagne dans les jours qui suivent
d’une aggravation majeure des dyskinésies, et supporte ainsi l’hypothèse que le bénéfi ce
de l’amantadine sur les LID se maintient après plusieurs années de traitement.
I. Benatru, Poitiers
Commentaire
L’amantadine est parfois mal tolérée par certains
patients en raison d’œdèmes des membres infé-
rieurs, d’un livedo reticularis ou de troubles
psychiques. Les résultats de cette étude ne sont
donc adaptés que pour des patients ayant un
bénéfi ce suffi sant de l’amantadine pour le pour-
suivre à long terme, sans problème de tolérance.
L’absence d’aggravation des symptômes moteurs
à l’arrêt de l’amantadine laisse suggérer que ce
traitement n’aurait pas d’effet majeur sur les
signes cardinaux de la maladie à un stade évolué
(la durée moyenne d’évolution de la maladie des
patients inclus est de 13,6ans), mais il est possible
qu’un effet symptomatique soit présent à un stade
plus précoce ou bien que cet effet soit plus long à
disparaître que la réponse antidyskinétique. Enfi n,
il est possible que l’amantadine ait un bénéfi ce sur
des symptômes non moteurs comme l’apathie ou
la fatigue mais cela nécessitera d’autres études.
Référence bibliographique
Ory-Magne F, Corvol JC, Azulay JP et al. Withdrawing aman-
tadine in dyskinetic patients with Parkinson disease: the
AMANDYSK trial. Neurology 2014;82(4):300-7.
Du nouveau dans le syndrome
des jambes sans repos ?
Les agonistes dopaminergiques sont le traitement de référence dans le syndrome des
jambes sans repos (SJSR), affection touchant 2 à 3 % de la population. Néanmoins, sous ce
traitement, peut survenir une aggravation des symptômes qui deviennent plus intenses et
plus fréquents y compris au cours de la journée. Ce phénomène est appelé le “syndrome
d’augmentation”, dont l’origine semble être plutôt iatrogène que liée à l’évolution naturelle
de l’affection.
Cette étude avait pour objectif de répondre aux questions concernant l’efficacité d’une
alternative thérapeutique par un traitement non dopaminergique (la prégabaline dont
l’efficacité a récemment été montrée dans le SJSR), et le mécanisme iatrogénique ou

REVUE DE PRESSE dirigée par le Pr T. Moreau
138 | La Lettre du Neurologue • Vol. XVIII - no 4 - avril 2014
non du syndrome d’augmentation. Il s’agit d’une étude randomisée en double aveugle,
sur 52semaines, ayant inclus 719patients présentant un SJSR modéré à sévère, et
randomisés pour recevoir pendant 12semaines soit 0,25mg/j de pramipexole, soit
0,5mg/j de pramipexole, soit 300mg/j de prégabaline, soit un placebo. Au terme de
ces 12semaines, les patients sous placebo étaient randomisés dans l’un des 3bras de
traitements actifs pour les 40semaines restantes. Après la période de 12semaines et
par rapport au placebo, les patients sous prégabaline et pramipexole 0,5mg/j avaient
une réduction significative de la sévérité du SJSR. Dans une évaluation de non-infériorité,
une amélioration plus importante a été observée sous prégabaline que sous prami-
pexole 0,25mg/j et 0,5mg/j, à 12 et à 52semaines de suivi. Sur la période de 40 ou
52semaines de traitement, le syndrome d’augmentation a été significativement moins
fréquent sous prégabaline que sous pramipexole à la dose de 0,5mg/j(2,1 % versus
7,7 % [p=0,001]), mais pas à la dose de 0,25mg/j(2,1 % versus 5,3 % [p=0,08]).
Ainsi, plus la durée d’exposition au traitement dopaminergique est prolongée, plus la
fréquence du syndrome d’augmentation augmente. Les effets indésirables sont pour la
plupart légers à modérés : sous prégabaline, vertiges, somnolence, fatigue, céphalées ;
sous pramipexole, nausées, céphalées et fatigue. Onze cas d’idées suicidaires ont été
rapportés : 6 sous prégabaline, 3 sous pramipexole 0,25mg et 2 sous pramipexole
0,5mg.
I. Benatru, Poitiers
Commentaire
Cette étude montre que le syndrome d’augmenta-
tion semble plutôt d’origine iatrogénique, s’aggra-
vant avec les traitements dopaminergiques (une
aggravation liée à l’évolution naturelle du SJSR
devrait survenir à la même fréquence dans tous
les groupes de traitement, ce qui n’est pas le cas
dans cette étude). D’autre part, plus le traitement
dopaminergique est prolongé et à forte dose,
plus la fréquence du syndrome d’augmentation
augmente. La prégabaline semble être une alter-
native thérapeutique effi cace, mais il faut rester
prudent vis-à-vis de ses effets indésirables éven-
tuels, en particulier le risque suicidaire. Enfi n, l’effi -
cacité de la prégabaline laisse suggérer que des
mécanismes autres que dopaminergiques semblent
impliqués dans la physiopathologie du SJSR.
Référence bibliographique
Allen RP, Chen C, Garcia-Borreguero D et al. Comparison
of pregabalin with pramipexole for restless legs syndrome.
N Engl J Med 2014;370(7):621-31.
Risque familial de SEP à partir des registres suédois
Cette étude a été menée à partir de plusieurs registres suédois : le registre multigénération
comprenant les parents biologiques et adoptifs de toute personne née en Suède depuis
1932 et résidant en Suède depuis 1961 ; le registre des jumeaux suédois ; le registre des
SEP suédoises(11 949SEP) ; le registre national des hospitalisations(27 078SEP). Afi n de
calculer des risques relatifs (RR), chaque patient atteint de SEP a été apparié à 10sujets
témoins sur l’âge et le sexe. Les apparentés des sujets témoins étaient appariés sur ceux
du patient atteint de SEP selon l’âge et le sexe et, si possible, selon la relation maternelle/
paternelle avec le sujet index. Le RR de SEP était estimé par un modèle de Cox. Le risque
de SEP ajusté sur l’âge le plus important était pour les sœurs de frères atteints de SEP.
Pour les demi-frères et sœurs, les demi-sœurs maternelles avaient le risque de SEP le plus
élevé. Parmi les apparentés de second degré et cousins, le risque était inférieur à 1 %, à
l’exception des tantes maternelles. Par rapport à des sujets témoins appariés pour lesquels
la prévalence de la SEP est plus faible chez les hommes, des estimations similaires de risque
entre les apparentés femmes et hommes du sujet index ont été trouvées. Parmi les enfants
de patients malades, les fi lles avaient un risque légèrement plus faible que les fi ls ; pour les
pères, les risques des fi lles et des fi ls étaient différents avec un risque plus important pour
ces derniers. Le risque global plus élevé était pour les paires frère/frère sans chevauche-
ment avec les paires mère/fi lle ou père/fi lle qui avaient toutes 2 un risque plus faible. Parmi
les cousins, la seule relation signifi cative était avec les cousines du côté paternel. Parmi
les enfants adoptés, le faible effectif(2SEP parmi les 497enfants adoptés et 1jumeau
atteint de SEP parmi les 65jumeaux adoptés) conduisait à des résultats non signifi catifs
par manque de puissance. L’héritabilité de la SEP était estimée en utilisant 74 757paires
de jumeaux dont la zygotie était connue, dont 315paires affectées par la SEP. L’héritabilité
estimée était de 0,64 (IC95 :0,36-0,76) et le composant environnemental commun estimé
était de 0,01 (IC95 : 0,00-0,18).
A. Fromont, Dijon
Commentaire
Cette étude trouve un risque de récurrence fami-
liale de SEP plus faible qu’habituellement rapporté
dans la littérature. La mise en évidence d’une
transmission père/fi ls plus forte que celle mère/
fi ls suggère une plus forte transmission du sexe
le moins prévalent à sa descendance. Un effet
“Carter” − selon lequel le sexe le moins prévalent a
besoin d’un plus grand nombre de gènes de prédis-
position pour développer la maladie − est évoqué.
Référence bibliographique
Westerlind H, Ramanujam R, Uvehag D et al. Modest fami-
lial risks for multiple sclerosis: a registry-based study of the
population of Sweden. Brain 2014;137(Pt 3):770-8.

REVUE DE PRESSE
La Lettre du Neurologue • Vol. XVIII - no 4 - avril 2014 | 139
Le citalopram calme l’agitation dans la maladie
d’Alzheimer
L’agitation est un symptôme fréquent dans la maladie d’Alzheimer (MA) au stade démentiel.
Les antipsychotiques atypiques sont effi caces, mais ils peuvent engendrer des effets secon-
daires. Cet essai thérapeutique avait pour objectif de tester l’effi cacité du citalopram, un
inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, sur l’agitation chez des patients atteints
de MA. En tout, 186malades ont été inclus et randomisés entre 1groupe sous placebo
et 1groupe sous citalopram à la dose initiale de 10mg/j, progressivement augmentée
jusqu’à 30mg/j selon la tolérance et la réponse au traitement. Un bénéfi ce du traitement
a été observé sur l’agitation après 9semaines, ainsi que sur le stress des accompagnants.
Le bénéfi ce pharmacologique était meilleur que l’approche psychosociale seule. À partir
de la dose de 30mg/j, un allongement de l’intervalle QT sur l’ECG a été observé pour les
doses élevées.
M. Sarazin, Paris
Commentaire
Le citalopram améliore l’agitation des patients
souffrant de MA. Il est recommandé de rester à une
dose de 20mg/j pour éviter les risques cardiaques
(allongement du QT).
Référence bibliographique
Porsteinsson AP, Drye LT, Pollock BG et al. Effect of citalo-
pram on agitation in Alzheimer disease: the CitAD rando-
mized clinical trial. JAMA 2014;311(7):682-91.
Trial registration: clinicaltrials.gov
Identifi er: NCT00898807.
À lire
Dans ce livre, Philippe Damier (service de neuro-
logie, CHU de Nantes) a voulu explorer les bases
neuronales de la décision. C’est un domaine dans
lequel les connaissances se sont considérablement
développées ces 10 dernières années. Ce champ
de recherche intéresse les neuroscientifi ques mais
aussi de plus en plus les décideurs économiques
ou politiques. De nombreux biais de jugement ont
été identifi és : stéréotypes, excès de confi ance,
biais de disponibilité pour citer les plus fréquents.
Leurs bases commencent à être comprises. Il en
est de même pour les décisions prises par un
groupe, même si, dans ce domaine, les données
sont encore souvent balbutiantes. Des conseils
concrets concluent chaque chapitre pour aider à
optimiser ses propres prises de décision.
Réponse:
4 et 5 : Il s’agit d’une malformation de Chiari type II. Le clivus est de petite taille et le foramen magnum large. Il existe une anomalie
de la charnière cervico-occipitale, avec une descente du bulbe, des amygdales cérébelleuses et du IVe ventricule dans le foramen
magnum. Il faut réaliser rapidement une IRM pan-médullaire à la recherche d’une syringomyélie, complication fréquente de cette
malformation.
IMAGE TESTIMAGE TEST
Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.
1
/
3
100%