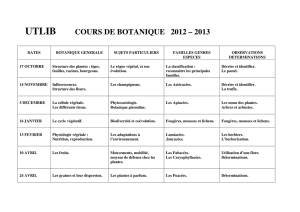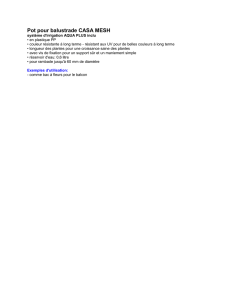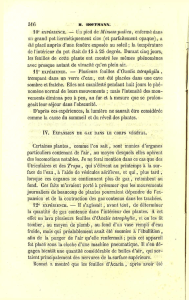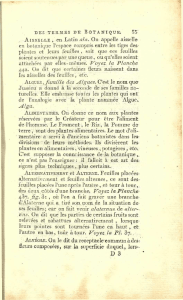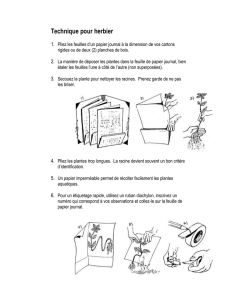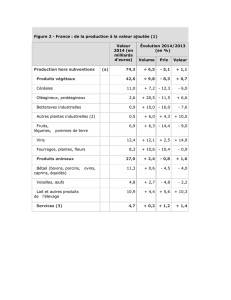Introduction - Fondation La main à la pâte

Published on Le site de la Fondation La main à la pâte (http://www.fondation-lamap.org)
Accueil > Biodiversité
Auteurs : Didier Pol(plus d'infos)
Résumé :
Le terme « biosphère » qualifie l’ensemble des êtres vivants qui peuplent
actuellement notre planète et l’ensemble des milieux qu’ils occupent. Avec
plus de 1 800 000 espèces différentes identifiées et nommées à ce jour, la
diversité des espèces qui constituent la biosphère - ou biodiversité - est
considérable.
Publication : 1 Juin 2000
Copyright : Creative Commons France. Certains droits réservés.
.Biodiversité
Nomenclature, évolution et classification
Diversité des animaux
Diversité des végétaux
Végétaux verts
Mousses
Fougères
Plantes à graine
Évolution des plantes
Diversité des microorganismes
Echelle des temps géologiques
Introduction
Le terme « biosphère » qualifie l’ensemble des êtres vivants qui peuplent actuellement notre
planète et l’ensemble des milieux qu’ils occupent. Avec plus de 1 800 000 espèces différentes
identifiées et nommées à ce jour, la diversité des espèces qui constituent la biosphère - ou
biodiversité - est considérable. On suppose, cependant, que la biodiversité est bien plus
considérable encore puisque le nombre réel d’espèces vivantes pourrait être au moins cinq à
dix fois plus important, selon les estimations. On peut noter, en outre, que le nombre
d’espèces vivantes qui ont été présentes à un moment ou à un autre sur notre planète est
d’un ordre de grandeur bien supérieur, si l’on tient compte des espèces disparues au cours
des temps géologiques, sachant que les scientifiques font remonter l’origine de la vie à
environ 3,5 milliards d’années. En effet, au cours des temps géologiques, de nouvelles
espèces apparaissent, se répandent dans un environnement donné, puis disparaissent.

Trilobite fossile Ammonite fossile
Brachiopode fossile
Au cours des temps géologiques, des espèces disparaissent et de nouvelles espèces se
forment.
Les trilobites étaient des arthropodes qui ont tous disparu à la fin de l'ère primaire.
Les ammonites étaient des mollusques qui ont tous disparu à la fin de l'ère secondaire.
De nombreuses espèces de brachiopodes ont également disparu à la fin des ères
primaire et secondaire mais il en existe encore quelques espèces dans la nature
actuelle. Les brachiopodes constituent un groupe dont l'aspect extérieur ressemble à
celui de certains coquillages mais ils n'appartiennent pas à l'embranchement des
mollusques.
Le terme « biodiversité » ne fait pas seulement référence à la variété des êtres vivants
présents sur la Terre mais aussi aux communautés qu’ils constituent et aux habitats dans
lesquels ils vivent. Ainsi, l’Article 2 de la Convention sur la diversité biologique, signée par 188
pays en 1992 au Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro (Brésil), en donne la définition
suivante : Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes
écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre
espèces ainsi que celle des écosystèmes.

Pucerons et fourmis
La biodiversité comprend aussi les communautés d'êtres vivants. Ainsi, les pucerons
dépendent des plantes dont ils sucent la sève et certaines fourmis dépendent des pucerons
dont elles consomment le miellat, une sécrétion sucrée qui sourd de leur abdomen
Une espèce vivante est constituée de l’ensemble des organismes qui descendent les uns des
autres et, pour les espèces à reproduction sexuée, l’ensemble des organismes susceptibles
de se reproduire entre eux et d’avoir des descendants interféconds. Si les membres d’une
même espèce se ressemblent le plus souvent, cela n’a rien d’une règle absolue. Ainsi, dans
certaines espèces, les différences morphologiques entre mâles et femelles, ce que l’on
appelle dimorphisme sexuel, sont telles que la simple observation peut laisser croire qu’ils
appartiennent à des espèces différentes.
De même, chez les espèces dont le cycle de développement comporte une métamorphose,
comme chez beaucoup d’insectes et chez les amphibiens, les différences morphologiques
entre l’adulte et le ou les stades larvaires peuvent être telles que seul un spécialiste est
capable de reconnaître qu’ils appartiennent à la même espèce.
Deux stades du développement de la grenouille
Au cours de son développement, la grenouille passe par un stade larvaire, le têtard, dont
l'anatomie, la physiologie et le mode de vie sont très différents de ceux de l'adulte
Depuis la fin du dix-neuvième siècle, un faisceau d’arguments nombreux et variés issus de
toutes les disciplines de la biologie et de la paléontologie a convaincu les biologistes que
toutes les espèces vivantes, disparues et actuelles, descendent d’un même ancêtre commun
et sont donc toutes apparentées. C’est ce qu’exprime la notion d’évolution. Une des
conséquences en est que les espèces actuelles sont d’autant plus apparentées entre elles
qu’elles ont un ancêtre commun plus récent. C’est pourquoi la classification du vivant est
désormais établie sur des bases phylogénétiques, c’est-à-dire qu’elle classe les organismes
en fonction de leurs relations de parenté évolutive. La notion d’évolution est devenue
tellement centrale pour la biologie que Theodosius Dobzhansky, un des grands spécialistes
de l’évolution, a pu écrire : « rien n’a de sens en biologie, si ce n’est à la lumière de l’évolution
».
Les biologistes s’accordent également pour regrouper les êtres vivants en trois grands
ensembles : les eubactéries (bactéries ordinaires), les archébactéries (bactéries
"archaïques") et les eucaryotes (organismes formés de cellules comportant un véritable
noyau). Ces trois ensembles, issus d’un même ancêtre commun, constituent les trois

branches de l’arbre généalogique du vivant. Les eucaryotes comprennent les animaux, les
champignons, les algues et les plantes ainsi qu’une multitude d’espèces d’organismes
unicellulaires appartenant à différents groupes. Toutes les bactéries et tous les organismes
unicellulaires sont invisibles à l’œil nu et sont donc qualifiés de microorganismes. Malgré leur
taille microscopique, ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et
on estime qu’ils constituent environ la moitié de la masse totale des êtres vivants, ce qu’il est
convenu d’appeler biomasse.
Nomenclature, évolution et classification
La diversité considérable présentée par la biosphère nécessite de classer les espèces. Dès le
dix-huitième siècle, alors que seules 4 000 espèces différentes avaient été décrites, le
botaniste suédois, Carl von Linné (1707-1778), a inventé une méthode de classification des
plantes qui se basait sur les différences morphologiques de leurs organes sexuels.
La classification des plantes à fleur de Linné se fondait sur l'extrême diversité de leurs
organes sexuels, les fleurs.
Il a également introduit la nomenclature binominale pour identifier les êtres vivants. Dans ce
système de nomenclature, encore utilisé aujourd’hui par les scientifiques, chaque être vivant
est désigné par deux noms latins, qu’il est d’usage d’écrire en italiques : un nom de genre,
commençant par une majuscule, et un nom d’espèce, commençant par une minuscule. Par
exemple, le nom scientifique du chat domestique est Felis catus, celui du lombric, Lumbricus
terrestris. Aujourd’hui, le genre regroupe les espèces ayant la relation de parenté la plus
proche, c’est-à-dire celles qui descendent de l’ancêtre commun le plus récent, alors que, par

le passé, les regroupements étaient établis sur la base de ressemblances morphologiques.
Par exemple, dans le genre Lumbricus, cinq espèces différentes ont été décrites, ce qui
signifie que ces cinq espèces de vers de terre sont plus proches parentes entre elles qu’avec
tous les autres genres de vers de terre, comme les Eisenia ou les Allolobophora, dont la
morphologie est pourtant très semblable mais qui sont plus éloignés sur le plan de la parenté
évolutive.
Tous les éléments de la classification, qu’il s’agisse de l’espèce, du genre ou des
regroupements de niveaux supérieurs, familles, ordres, etc. constituent des unités
taxonomiques appelées également taxons dont les relations reflètent la phylogénie. Ainsi, les
différentes espèces appartenant à un même genre descendent d’un même ancêtre commun
plus récent que celui à l’origine de ce genre et des autres genres de la même famille. C’est
pourquoi chaque taxon est emboîté dans un taxon d’ordre supérieur. Ainsi, comme on l’a vu
ci-dessus, les espèces sont regroupées en genres et les unités taxonomiques d’ordre
supérieur sont, dans l’ordre croissant, les familles, les ordres, les classes, les
embranchements (ou phylums, caractérisés par un plan d’organisation commun), les règnes.
Si l’on reprend l’exemple du chat, il appartient à l’espèce catus du genre Felis, appartenant à
la famille des félidés de l’ordre des carnivores inclus dans la classe des mammifères, elle-
même appartenant à l’embranchement des chordés, du règne des métazoaires. Notons que
ce règne appartient à la lignée des eucaryotes, l’une des trois branches primordiales de
l’arbre du vivant. La lignée des eucaryotes comporte actuellement une soixantaine de
phylums différents. La classification des êtres vivants constitue ainsi un arbre "généalogique"
reflétant leurs relations phylogénétiques.
Il importe de préciser que le nom courant des animaux, en français, ne désigne que rarement
une seule espèce. Ainsi, le nom « ver de terre » désigne plusieurs espèces différentes,
appartenant même à des genres différents, comme Lumbricus, Eisenia et Allolobophora.
Eisenia foetida (ver de terre ou ver du fumier)
De même, le nom « grenouille » désigne aussi bien la grenouille verte, Rana esculenta que la
grenouille rousse, Rana temporaria.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%