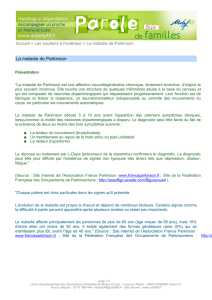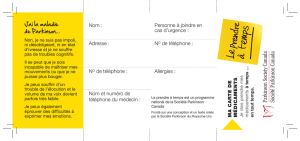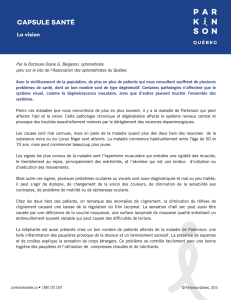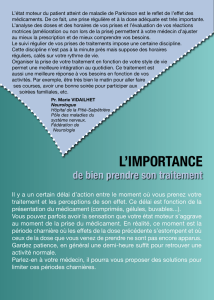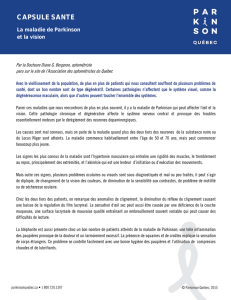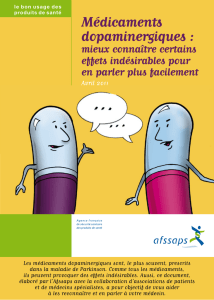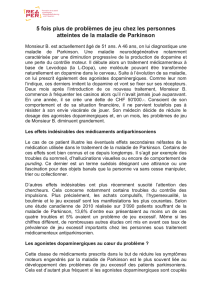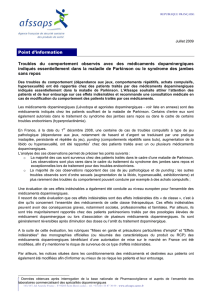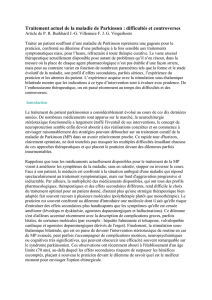Lire l'article complet

Sommaire
Vol. XII - n° 10 - décembre 2008
ÉDITORIAL
ÉDITORIAL 311
Traitement de la maladie de Parkinson, rien ne va plus !
Treatment of Parkinson’s disease: game is over?
J.P. Azulay
MISES AU POINT 315
Diagnostic et traitement des neuroborrélioses de Lyme
Diagnosis and treatment of Lyme neuroborreliosis
F. Blanc, J. de Seze
Maladie de Wilson : avancées récentes
Recent advances in Wilson’s disease
J.M. Trocello, P. Chaine, P. Rémy et al.
Les tumeurs intramédullaires de l’adulte
Intramedullary spinal cord tumors in adult
C. Campello
REVUE DE PRESSE 336
Revue critique de la littérature
C. Dallière, E. Lesburguères, A. San-Galli, A. Fromont, S. Valerio
FICHE I-II
Démence d’évolution rapide
M. Sarazin
CAS CLINIQUE 339
Neuropathie douloureuse
et œdème des membres inférieurs
A. Wacongne
VIE PROFESSIONNELLE 344
L’éducation et la prise en charge multidisciplinaire
des enfants épileptiques
N. de Grissac-Moriez
Traitement de la maladie
de Parkinson,
rien ne va plus !
Treatment of Parkinson’s disease:
game is over?
J.P. Azulay*
Depuis 2 ans, les neurologues, et en parti-
culier les neurologues spécialisés dans la
prise en charge de la maladie de Parkinson,
ont curieusement l’impression que plus rien de
nouveau ne se passe dans le domaine concret de
l’innovation thérapeutique. Ils restent ainsi un peu
évasifs lorsqu’il s’agit de répondre à la question clas-
sique que posent les malades : “Alors, docteur, rien
de nouveau ?” Du nouveau, non, mais échecs des
essais thérapeutiques de neuroprotection ; blocage
institutionnel franco-français à la commercialisation
de deux nouvelles molécules – un nouvel IMAO-B
(la rasagiline) et un agoniste en patch (la rotigotine)
déjà largement diffusés dans le monde – ; doutes sur
l’intérêt des nouvelles techniques de stimulation,
qu’il s’agisse de la stimulation du cortex moteur
ou de celle du noyau pédonculopontin ; et encore
échecs des greffes de neurones fœtaux et absence
de perspectives cliniques humaines à court terme
pour les cellules souches.
En fait de nouveautés, il s’agissait essentielle-
ment des moyens déjà existants, et les nouvelles
étaient plutôt mauvaises : toxicité putative de
la lévodopa, un peu gommée par les vagues
de complications qui ont déferlé sur les diffé-
rents agonistes dopaminergiques ces dernières
années. En 1999, S. Frucht et al. avaient rapporté
des attaques de sommeil sous pramipexole et
ropinirole pouvant provoquer des accidents de
voiture (1). Les travaux ultérieurs démontrè-
rent que tous les traitements dopaminergiques
pouvaient en être responsables.
* Service de neurologie et de pathologie du mouvement,
hôpital de la Timone, Marseille.
SEEYOUSOONONTHEMOON - EBIX/08/041/AP - Juin 2008

312 | La Lettre du Neurologue • Vol. XII - n° 10 - décembre 2008
ÉDITORIAL
En 2003-2004, G. Van Camp et al. (2, 3) rappor-
tent 33 % de valvulopathie dans un groupe
comprenant 78 parkinsoniens traités par pergo-
lide contre aucun cas chez les 18 sujets contrôles.
Les risques de fi brose des dérivés ergotés étaient
connus depuis toujours, mais cette étude,
confi rmée par la suite, a brisé net la carrière
du pergolide. Et en 2000 (4), le syndrome de
dysrégulation dopaminergique a été isolé par
V. Voon et al. Ce syndrome comprend les trou-
bles du contrôle des impulsivités, c’est-à-dire des
comportements pathologiques de jeux, d’achats
ou de sexe, qui semblent être déclenchés ou
majorés en particulier par les agonistes dopa-
minergiques (5). Ces troubles du comportement
sont particulièrement fréquents chez les hommes
jeunes, candidats désignés à la prescription des
agonistes dopaminergiques en monothérapie.
Même la stimulation cérébrale profonde des
noyaux sous-thalamiques, qui a bouleversé la
prise en charge des patients parkinsoniens et qui
a provisoirement donné aux cliniciens l’illusion
enivrante d’un pouvoir de guérison miraculeuse
tant l’amélioration peut être spectaculaire, a été
passée au crible des critiques : effet négatif sur
la voix, l’équilibre, la marche, le moral, la moti-
vation, les pulsions suicidaires, etc.
La problématique est en fait à la fois simple et
complexe et correspond essentiellement aux
manifestations non motrices de la maladie de
Parkinson, et en particulier aux manifestations
cognitivopsychiatriques : troubles du contrôle
de l’impulsivité, accès de sommeil et acci-
dents de voiture, troubles de l’humeur, anxiété,
insomnie, apathie, démence. Ces manifesta-
tions constituent l’essentiel des complications
des traitements et la principale perspective des
innovations thérapeutiques. Mais gardons-nous
des visions trop radicales et des attitudes trop
rigides : les traitements dont nous disposons
n’ont pas d’action univoque, et on doit savoir
les utiliser ou les éviter selon le contexte : la
stimulation des noyaux sous-thalamiques peut
majorer anxiété et dépression, mais elle permet
de résoudre d’épineux syndromes de dysrégula-
tion dopaminergique. Elle a amélioré de façon
spectaculaire des tocs ou des tics sévères, qui
sont devenus une indication potentielle. Enfi n,
elle améliore souvent rapidement les troubles
du sommeil nocturne.
Les agonistes dopaminergiques, et particulière-
ment ceux ayant une forte affi nité pour les récep-
teurs D3 mésolimbiques, induisent des troubles
comportementaux mais améliorent (et certaine-
ment mieux encore que la lévodopa) la dépres-
sion ou l’apathie, ce qui explique dans certaines
études l’effet équivalent des deux classes théra-
peutiques sur les activités de la vie quotidienne,
alors que l’amélioration du score moteur est
plus nette avec la lévodopa. Il faudrait donc,
prudemment, les prescrire chez des malades
plus âgés, les reprendre de façon plus systéma-
tique à bonnes doses chez le patient stimulé
apathique et attendre les résultats d’une large
étude multicentrique sur la dépression réalisée
avec le pramipexole. Les agonistes à demi-vie
longue sont peut-être également à privilégier
en cas de syndrome des jambes sans repos, une
cause parmi d’autres d’insomnie chez le malade.
L’arrivée des formes LP pour le ropinirole, puis le
pramipexole, et peut-être la rotigotine permettra
d’aller un peu plus loin dans la direction d’une
stimulation dopaminergique continue.
Le choix d’un traitement doit donc être moins
radical que ce qui avait été proposé il y a quelques
années par la conférence de consensus, qui
devrait réactualiser ses propositions à la lumière
de toutes ces nouvelles données. La lévodopa à
bonnes doses peut être le bon traitement chez
un sujet jeune dysrégulateur, et les agonistes
seraient à privilégier chez les patients plus âgés
même après 60, voire 70 ans, lorsque le sujet est
en bon état général mais déprimé ou apathique.
Il reste également à développer des traitements
spécifi ques pour limiter ces complications. La
clozapine a permis un bouleversement specta-
culaire de la prise en charge des patients ayant
des troubles confuso-hallucinatoires, et on
attend beaucoup d’une nouvelle molécule en
cours d’évaluation, la rivastigmine en comprimés,
qui ne nécessiterait pas une surveillance héma-
tologique aussi contraignante, et améliore les
troubles cognitifs. Un essai thérapeutique évalue
l’intérêt du patch dans cette indication, et une
molécule pour lutter contre la somnolence
excessive est en développement.
L’avenir de la maladie de Parkinson se situe
donc, au moins à court terme, dans la gestion
et la prise en charge des aspects non moteurs,
en particulier psychocomportementaux, mais
aussi dans celle d’autres manifestations non
motrices invalidantes, comme les manifestations
dysauto nomiques ou sensitivo-douloureuses, qui
sont souvent la première cause de plainte des
patients, avant les signes moteurs.
Rouge, impair et passe… la partie continue, on se
découvre joueur à soigner cette maladie qui fi na-
lement laisse le neurologue dans des situations
bien plus imprévues et bien moins ennuyeuses
que l’image de vieille femme courbée en deux,
fi gée et misérable qui représente l’archétype de
cette maladie. ◾
Références
bibliographiques
1. Frucht S, Rogers JD, Greene PE
et al. Falling asleep at the wheel:
motor vehicle mishaps in persons
taking pramipexole and ropi-
nirole.Neurology 1999;52(9):
1908-10.
2. Van Camp G, Flamez A, Cosyns B
et al. Heart valvular disease in
patients with Parkinson’s disease
treated with high-dose pergolide.
Neurology 2003;61(6):859-61.
3. Van Camp G, Flamez A, Cosyns
B et al. Treatment of Parkinson’s
disease with pergolide and rela-
tion to restrictive valvular heart
disease. Lancet 2004;363(9416):
1179-83.
4. Giovannoni G, O’Sullivan JD,
Turner K et al. Hedonistic homeos-
tatic dysregulation in patients
with Parkinson’s disease on dopa-
mine replacement therapies. J
Neurol Neurosurg Psychiatry
2000;68(4):423-8.
5. Voon V, Fox SH. Medication-
related impulse control and
repetitive behaviors in Parkinson
disease. Arch Neurol 2007;64(8):
1089-96.
R
1
/
2
100%