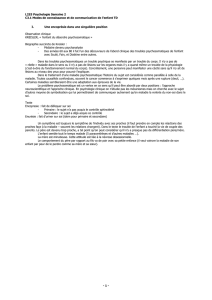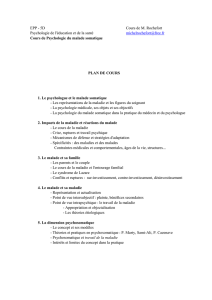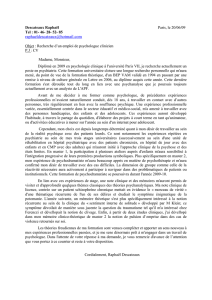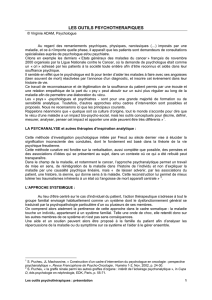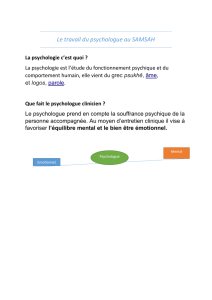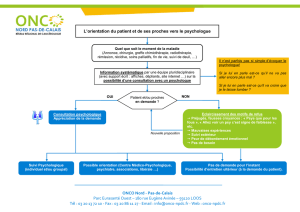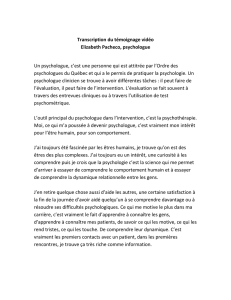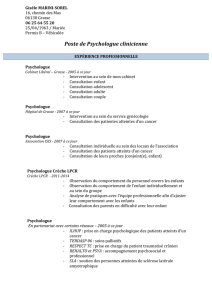Mise au point

Le Courrier de l’algologie (5), n° 2-3, avril-septembre 2006 45
Mise au point
Mise au point
Pour les soignants, le terme de “iatro-
génie” renvoie le plus souvent aux
possibles effets néfastes de leur prati-
que. Or, ce terme signifie littéralement
“produit par la médecine” (ou “produit
par un médecin”) et regroupe, en fait,
l’ensemble des conséquences d’un acte
médical, que celles-ci possèdent une
valence positive ou négative. Si certai-
nes hypothèses permettent d’expliquer
les motifs de cette restriction du sens du
terme “iatrogène” (1), on peut en tout
cas retenir que, pour beaucoup, celui-ci
opère un glissement habile qui permet de
donner un nom, et donc une justification,
à ce qui semblerait, sans cela, échapper à
la pratique médicale. Surtout, dire qu’un
fait est “iatrogène” permet de ne plus
voir telle douleur provoquée par un soin
comme une transgression du primum
non nocere, mais bien comme un fait à
part, qui échappe au bon vouloir du pra-
ticien, et donc à sa responsabilité. Ainsi,
on explique avec force détails qu’il est
inévitable que telle réfection de panse-
ment provoque de la douleur et qu’il faut
“serrer les dents”, ou que des douleurs
du membre fantôme sont non seulement
inéluctables, mais attendues.
Le terme “iatrogénie”, lorsqu’il est
employé pour désigner uniquement un
effet néfaste du soin, masque donc une
pratique à laquelle on voudrait donner
une unique justification : celle de l’inévi-
table du soin, mais prodigué malgré tout
pour le bien des patients. Cette assertion
peut paraître péremptoire, mais elle s’ap-
puie sur l’observation que, lorsqu’une
douleur devient jugulable par des voies
médicales, curieusement le terme qui
la désignait (“iatrogène”) disparaît du
discours et devient une banale pratique.
Ainsi, la douleur des prélèvements n’est
plus qualifée de “iatrogène” dès lors
qu’elle est précédée de l’application
d’une pommade anesthésiante. On est
donc bien là face à l’utilisation d’un
terme commode pour masquer ce qui
échappe encore à la technique médicale,
amené à disparaître à terme, mais auquel
on voudrait quand même donner une
justification jusque-là, même si celle-ci
s’enracine dans quelque chose de l’ordre
de la fatalité.
Il apparaît donc comme nécessaire de
redonner au terme “iatrogénie” son vrai
sens, “produit par la médecine”, pour,
d’une part, effacer l’usage fallacieux qui
en est fait, et, d’autre part, mieux penser
les soins prodigués, de façon plus glo-
bale. Entre autres, nous pourrions dans
ce cadre penser un fait médical à part
entière qui, justement, peut avoir une
valence positive ou négative selon son
contexte d’apparition : il s’agit de l’ef-
fet produit par la parole médicale sur
un patient. Spécifiquement, une parole
nous intéresse ici, celle qui énonce au
patient que ses troubles sont “psycho-
somatiques”.
Le choix de cette thématique pourrait
paraître arbitraire. Il n’en est rien car on
observe que, à bien des égards, ce terme
a connu le même destin que celui de
“iatrogène”. En effet, de l’intuition glo-
bale d’un lien existant intriquant soma
et psyché (2), il a été fait un diagnostic
à part entière, totalement réducteur, qui
est censé désigner des troubles dont la
nature serait somatiquement inconnue
ou improbable (3). Autrement dit, on est
passé d’un terme, “psychosomatique”,
désignant la façon de penser l’unité
corps-psyché, à une façon de scinder ces
deux notions et de désigner le mouve-
ment qui unirait le premier (la psyché) au
second (le soma) par un lien de causalité
(un trouble psychique entraînerait des
dérèglements organiques de façon uni-
latérale), car c’est bien dans ce sens que
les choses sont souvent envisagées. Et le
fait que, parfois, le terme “psychosoma-
tique” se mue en une autre terminologie
(“douleur psychogène”, “troubles soma-
toformes”…) ne change rien à l’affaire.
On est bien devant une pensée qui réduit
son objet en instaurant un lien arbitraire,
causal et partiel, en lieu et place d’une
autre pensée, elle, beaucoup plus globale
et unifiante (4).
Psychosomatique
Les “troubles psychosomatiques” :
un conflit d’intérêt entre médecin et psychologue ?
Antoine Bioy*
Mots-clés : Iatrogénie - Psychosomatique - Diagnostic - Psychologue - Médecin.
* Maître de conférence à l’université de
Bourgogne, psychologue clinicien et hyp-
nothérapeute au CHU du Kremlin-Bicêtre.
L
orsque les douleurs présentées par un patient semblent relever
davantage de la psychologie que de la médecine, on parle de
“psychosomatique”. Pourtant, ce diagnostic aux effets iatrogènes est
souvent mal utilisé. Quelques repères permettent de mieux appréhen-
der la façon dont il peut se comprendre en clinique. Cela nécessite tou-
tefois une parfaite connaissance du travail du médecin, bien sûr, mais
aussi du rôle des psychologues dans la prise en charge des patients, rôle
souvent mal compris ou perçu.

Le Courrier de l’algologie (5), n° 2-3, avril-septembre 200646
Mise au point
Mise au point
Il en va donc de même de la psycho-
somatique comme de la iatrogénie :
un glissement de sens qui réduit une
pensée holistique à sa portion congrue,
permettant ainsi de mettre des mots sur
ce que l’on ne contrôle pas, voire sur
ce que l’on ne comprend pas, et ce en
dépit des études démontrant que cette
réduction conduit à des contresens théo-
riques (5), mais aussi à des absurdités
cliniques (6).
Il résulte de cette réduction de sens que
lorsque la parole médicale désigne un
trouble comme étant psychosomatique,
cette parole prononcée a des répercus-
sions sur le patient et son entourage
(les parents lorsqu’il s’agit d’un enfant
ou d’un adolescent). La iatrogénie qui
en résulte (l’effet produit) peut être de
nature variable, allant d’un soulagement
(“On a enfin trouvé !”) à l’agression
du personnel (“Ils pensent que mon
enfant n’a rien alors qu’il souffre...”) ou
encore à la suspicion concernant l’en-
fant (“Pourquoi fait-il semblant d’avoir
mal ?”) quand ce n’est pas une réelle
stigmatisation. Ainsi, la parole médicale
utilisant le terme “psychosomatique”
dans un contexte diagnostique et non
pour ce qu’il est réellement, une façon
de penser le psychisme d’un individu,
a des répercussions importantes sur la
dynamique psychologique et compor-
tementale de celui qu’elle désigne de la
sorte, et sur celle de ses proches.
En effet, d’apparence banale, l’an-
nonce d’un tel diagnostic se produit
en fait dans le cadre d’une rencontre
entre une personne en souffrance pour
soi ou pour un proche, et d’un savoir
établi ou perçu comme tel par celui qui
souffre et qui demande éclaircissement
et aide sur la situation de soin et sur
ses raisons. Cette relation connue pour
son inégalité depuis fort longtemps
(7) augmente en substance le pouvoir
de suggestion du médecin vis-à-vis
de son ou ses interlocuteurs. Ce qui
est suggéré ici, c’est que le trouble
échappe à la médecine somaticienne,
traditionnelle mais, et là est le hiatus, il
prend toutes les formes d’un diagnos-
tic “qui sait”, qui nomme malgré tout
dans le champ de la médecine, puis-
que c’est ce médecin, ce “sachant”,
qui l’énonce. Et pourtant, derrière le
“savoir” ou ce qui est perçu comme
tel, se cache une ignorance fondamen-
tale :celle qui mènerait à comprendre
le trouble au sein de la construction
soma et psyché non démantelés, mais
bien unifiés et interagissant constam-
ment (8). La seule personne pouvant
penser ce fonctionnement est le psy-
chologue, du fait de sa formation, dans
un contexte de lien étroit avec ses col-
lègues somaticiens, avec lesquels les
échanges sont impératifs, ne serait-ce
que pour mieux cerner les mouvements
psychiques croisés en jeu.
Or, encore trop souvent, comme le
montre une récente étude (6), le psy-
chologue n’intervient que lorsque le
soi-disant diagnostic de trouble psy-
chosomatique est porté. C’est là que
le piège se referme : appelé pour gérer
un conflit psychique désigné comme
relevant de cette seule instance, il ne
pourra y parvenir puisque, précisé-
ment, la psychosomatique n’est pas
la réduction qui en a été faite, et que
seule la confluence des deux spécialités
(somaticienne et psychologique) peut
parvenir à approcher cette notion, dans
un contexte non seulement de confiance
réciproque, mais aussi de dialogue
constant et dynamique, comme l’est
l’objet de l’étude : les liens entre soma
et psyché qui interagissent sans que l’on
puisse, à l’heure actuelle, les scinder
arbitrairement.
Bien sûr, ce dialogue salutaire pour le
patient et son évolution, tant physique
que psychique a lieu dans certaines
équipes de soins. Mais force est de
constater qu’il n’a pas lieu dans la
majorité d’entre elles. Ce que l’on
observe le plus souvent prend la forme
d’un non-dit : l’existence supposée au
moins chez le médecin (mais parfois
aussi chez certains psychologues) d’un
conflit d’intérêts portant sur le symp-
tôme présenté. Ainsi, dans l’imaginaire
(ou le fantasme) des personnes hésitant
à mener honnêtement et sincèrement
cette double réflexion médicale et
psychologique, on trouve bien sou-
vent la pensée qu’un symptôme est
soit majoritairement physique, soit
majoritairement psychique et relève-
rait donc soit d’un médecin, soit d’un
psychologue.
Or, cette pensée méconnaît les réel-
les prérogatives d’un psychologue,
et particulièrement d’un psychologue
clinicien. Un flou, d’ailleurs parfois
entretenu par certains psychologues
eux-mêmes, tellement fascinés par la
méthodologie médicale et son pouvoir
notamment guérisseur qu’ils en vien-
nent à entrevoir leur fonction comme
relevant également de ladite méthodolo-
gie médicale. On observe alors une psy-
chologie qui s’écarte de ses prérogatives
pour établir des systèmes d’évaluation
donnant naissance à des diagnostics
médicaux (notamment relevant de la
psychiatrie) sans avoir les compétences
d’un médecin, ou encore approchant le
patient par son symptôme et se fixant
comme objectif son éradication, sans
considération globale de celui qui en
est porteur. Bien sûr, rien n’interdit à
un psychologue de mettre en place un
mode de prise en charge psychothé-
rapeutique dont l’objectif suivrait la
demande et donc le désir du patient :
le soulagement. Mais alors ce mode ne
peut exclure une pensée et une appré-
hension “méta” du problème présenté,
à distance de la parole telle que pro-
noncée, pour en saisir les déterminants
inconscients (que l’on donne à ce terme
un sens psychanalytique ou cognitif,
selon l’école de pensée à laquelle le
psychologue adhère préférentielle-
ment). Car le fondement même du tra-
vail du psychologue, et notamment du
psychologue clinicien, est de ne pas “se
saisir” du symptôme du patient comme
le ferait, dans ce cas à bon escient, un
médecin. Son intérêt se porte avant tout
sur la façon dont le patient appréhende
son symptôme au regard de sa réalité
psychique, autrement dit dans sa sub-
jectivité la plus pure et totale. Aider le
patient à mieux comprendre et assumer
ce que ce symptôme modifie dans sa vie
psychique, ses relations à son entourage
et notamment familial et amical, là est
le vrai travail du psychologue clini-
cien. Cela distingue radicalement cette
approche de celle, médicale, y compris
psychiatrique, qui vise l’objectivation
des troubles souvent (mais pas unique-
ment) à visée de prescription. Les deux
approches sont néanmoins complémen-
taires puisque psychologue clinicien et

Le Courrier de l’algologie (5), n° 2-3, avril-septembre 2006 47
Mise au point
Mise au point
médecin vont partager en partie, mais
de façon différente, les mêmes objets
d’attention.
Il en est ainsi du corps du patient. Dans
l’approche médicale, il est le lieu du
symptôme et le ressenti corporel va
aider, via l’examen clinique et une mise
en mots par le patient de son mal, à
optimiser la prise en charge, les traite-
ments et, au-delà, à améliorer le devenir
du patient. C’est à ce même corps que
le psychologue va prêter une oreille
attentive puisque ce corps, partenaire
du patient depuis sa naissance, est aussi
le lieu d’expression de la subjectivité
de l’individu, le lieu d’enracinement
de ses pulsions, et le substrat de sa vie
affective et émotionnelle en lien avec
les troubles présentés et auquel ils vont
donner une connotation particulière,
au moins pour ledit patient. La façon
dont ce dernier vit son corps va avoir
des répercussions bien au-delà du seul
temps du soin. Cette écoute complémen-
taire du corps, puisque c’est l’exemple
que nous avons choisi, participera à une
éventuelle restauration psychique (par-
ticulièrement narcissique) du patient,
mais elle peut également concourir à
son avenir somatique, notamment lors-
que cette écoute éloigne les risques de
chronicisation des troubles, risques liés
aux résistances psychiques à son sou-
lagement et qui ne relève que peu des
traitements médicaux en cours.
Ainsi donc, et bien au-delà de la ques-
tion du corps que nous avons esquissée
pour illustrer notre propos, le travail du
psychologue et celui du médecin sont
clairement différents, tout en restant
parfaitement complémentaires (9). L’un
(le psychologue) travaille avec la sub-
jectivité du patient et reste totalement
incompétent pour le reste alors que
l’autre (le médecin) travaille à rendre
objectif ce qui peut l’être pour trouver
des traitements adéquats, tout en res-
tant ignorant des processus inconscients
qui viennent relativiser cette recherche
d’objectivité. Mais chacun peut, d’une
part, être sensible au travail de l’autre
et, d’autre part, apprendre de son collè-
gue au sein d’échanges croisés, car tous
deux, à leur manière, s’inscrivent dans
une relation d’aide auprès du même être
humain, le patient.
Seule cette absence de dichotomie peut
éloigner l’aberration de diagnostics tels
que “trouble psychosomatique”, qui
sclérose la pensée plus qu’elle ne l’épa-
nouit lorsqu’elle est enfermée comme
une sentence différenciant soma et psy-
ché. Car alors cette sentence engage
vers une prise en charge qui, également,
continue à scinder deux spécialités, la
médecine et la psychologie, pourtant
partenaires et amies lorsque chacune
reste dans son domaine de compéten-
ces et n’interprète pas ce qui est pré-
senté par le patient (un symptôme, une
parole) autrement qu’en fonction de ses
prérogatives propres.
Un effort dans ce sens doit sans doute
être fait de part et d’autre, pour le bien
de nos patients communs. Cela prend
notamment la forme d’une implication
du psychologue le plus tôt possible dans
la prise en charge et non celle d’une
décharge future d’un accompagnement
lorsque l’on estime que le cas ne relève
plus de la médecine somaticienne. Du
côté des psychologues, cet effort passe
également par une implication pleine
et entière au sein d’une équipe, avec
une préférence pour la notion de secret
partagé plutôt que pour celle de secret
professionnel et individuel, tout en
respectant la confiance du patient et
le cadre des échanges intersubjectifs
avec lui. Des propositions souvent bien
connues intellectuellement, mais qui
restent dans une large part à appliquer
réellement sur le terrain pour donner
un véritable sens au terme de “prise
en charge pluridisciplinaire”, désignant
celle-ci désignant encore trop fréquem-
ment la présence conjointe de diverses
spécialités dans un lieu de consultation,
sans échanges véritables.
Peut-être sommes-nous en train de
formuler une évidence ? Et pourtant,
c’est ce chemin qui “clive” le travail
du psychologue et celui du somaticien
que prend encore, actuellement au
moins, la compréhension des actuel-
les recommandations du plan cancer.
Alors même que les effets iatrogènes de
l’annonce du diagnostic sur les patients
et leur entourage semblent dans la plu-
part des cas éminemment traumatiques
(10), le travail du psychologue n’est
pas pensé conjointement à celui du
médecin, mais en aval. Une fois cette
expérience potentiellement traumatique
faite, le psychologue clinicien n’a plus
qu’à recoller les morceaux ! Personne
ne sort gagnant de cette situation : ni
les soignants, que la douleur morale
et la souffrance psychique du patient
vont désorganiser et mettre en diffi-
culté, ni le psychologue, qui travaille
“à l’aveugle” et se trouve bien en mal
de dénouer les nœuds qui se sont tis-
sés en son absence, au moment crucial
de l’annonce du cancer, ni bien sûr le
patient et son entourage, que l’angoisse
dévore et qui “éclatent” bien souvent
psychiquement (11).
De même, et toujours dans le cadre
du cancer, on observe en France le
développement des soins de support.
Ils viennent de façon théorique pallier
notamment les difficultés liées à la prise
en charge psychologique des patients et
de leur entourage (12). Mais là égale-
ment, les choses sont “clivées” : sépa-
ration entre équipes de soins en salle et
équipes de soins de support, séparation
du travail des médecins et de celui des
psychologues (qui, encore une fois,
interviennent en aval, bien après la pre-
mière consultation médicale) comme le
montre le programme des 2es Journées
nationales de soins de support en onco-
logie (Paris, mai 2005). Le programme
y fut organisé en deux journées pour
les médecins, suivies d’une journée
pour les aspects psychologiques, bien
distincte, et d’ailleurs en partie animée
par des médecins !
Nous ne remettons pas en cause ici
les bonnes volontés qui participent à
la mise en place de ces projets, mais
l’on ne peut que constater que ce qui
résonne intellectuellement comme une
évidence, l’intrication entre psyché et
soma, ne donne pas lieu sur le terrain
à des politiques de développement
qui y répondent. On suit toujours un
modèle de pratique qui cloisonne les
deux approches, au-delà des appels au
changement de nombreux médecins et
psychologues et du simple bon sens que
vient nourrir l’expérience clinique.
Notamment la douleur, qui est un symp-
tôme répondant à la définition globale
de “psychosomatique” telle que nous
l’avons envisagée (une façon de penser,

Le Courrier de l’algologie (5), n° 2-3, avril-septembre 200648
Mise au point
Mise au point
non un diagnostic), trouve un écho tota-
lement inadapté sur un plan clinique,
dans tous les domaines que nous avons
cités. L’on pourrait alors se demander
“à qui profite le crime” ? Le plus triste
est peut-être là : à personne…
En conclusion, l’on pourrait dire que
le terme “psychosomatique”, lorsqu’il
est prononcé par un médecin, et ses
conséquences iatrogènes (positives ou
négatives) est souvent mal utilisé et
mène à des approches du patient dans
lesquelles vie psychique et vie physique
sont séparées et ce même s’il est rare
actuellement de croiser un soignant ou
un psychologue qui nie ne pas connaître
l’importance d’une prise en charge glo-
bale. Cependant, entre les déclarations
rassurantes et la réalité effective sur le
terrain, un fossé s’observe dans bien
des unités de soins. Il ne tient qu’à la
volonté de chacun de changer les cho-
ses, et de se prouver ainsi combien l’in-
trication soma-psyché prend un autre
sens, plus fécond cliniquement, lorsque
dans l’organisation même d’un service,
elle trouve une réponse (13). Souhaitons
que quelques bonnes volontés, intel-
ligemment sensibles à la souffrance
globale du patient, y pourvoiront. ■
Références bibliographiques
1. Keller PH, 2004, Iatrogénie de la parole. Le
Concours médical 2004;14:780-3.
2. Ferragut E (coord.). Le corps dans la prise en
charge psychosomatique. Paris : Masson, 2003.
3. Bioy A, Fouques D. Manuel de psychologie du
soin. Rosny-sous-Bois : Bréal, 2001.
4. Contant M, Calza A. Le symptôme psychoso-
matique. Paris : Ellipses, 2002.
5. Keller PH. La médecine psychosomatique en
question. Paris : Odile Jacob, 1997.
6. Konijnenberg AY, De Graeff-Meeder ER, Kim-
pen JLL, Van der Hoeven J, Buitelaar JK, Uite-
rwaal CSP. Group children with unexplained
chronic pain: do pediatricians agree regarding
the diagnostic approach and presumed primary
cause? Pediatrics 2004;114:1220-6.
7. Jeammet P, Reynaud M, Consoli SM. (1979)
Psychologie médicale. Paris : Masson Abrégés,
1996.
8. Ferragut E (coord.). Dimension de la souffrance
en psychosomatique. Paris : Masson, 2000.
9. Keller PH. Cohabitation entre médecine et psycho-
logie : les exigences du soin et de la parole. Annales
médico-psychologiques 2003; 161:152-8.
10. Brocq H. Collomp R. Bioy A. Ferragut E,
Raucoules M. Compte rendu de la commission
Informations/Douleur morale du CLUD du CHU
de Nice. Douleurs 2005;6(4);197-224.
11. Bioy A. Aspects psychologiques de l’événement
“cancer”. Pratique soignante 2005;6:87-96.
12. Fondras JC. Soins palliatifs et soins de support
en oncologie. Définitions, présupposés et enjeux.
Médecine palliative 2003;2:159-67.
13. Brocq H. Douleur chronique : plaidoyer pour
une prise en charge pluridisciplinaire. Objectif
soins 2000;84:IV-VIII.
Les “troubles psychosomatiques” : un conflit d’intérêt entre médecin et psychologue ?
Le terme de iatrogénie possède en médecine un sens restreint, celui de ne désigner que
l’élément fâcheux mais supposé inévitable du soin (comme une douleur produite par
un soin). Pourtant, son sens étymologique est plus complet et complexe, désignant tout
ce qui est produit par la médecine (ou par le médecin). Ainsi, l’annonce d’un diagnostic
va avoir des répercussions iatrogènes sur le patient et son entourage, c’est-à-dire une
répercussion particulière notamment psychique. Nous étudions ici ces notions au regard
de ce que l’on nomme les “troubles psychosomatiques”, un diagnostic particulier qui,
parfois, cache un pseudo-conflit d’intérêt entre médecin et psychologue, tous deux
semblant se battre pour défendre la paternité de l’origine du trouble présenté. Et si
les choses étaient plus simples à concevoir ?
Psychosomatic disorders: a conflict of interests between the physician and the psychologist?
Iatrogenic, in medecine, has a restricted signification, that of designing the unfortunate
and inevitable aspect of care like the pain secondary to care). And yet, it’s etymological
meaning is more complete and complex, designing all that is produced by medicine (or
by the physician). Thus, announcing a diagnosis will have iatrogenic repercussions on
the patient and his family circle, a particular repercussion which is psychological. These
aspects are developed here from the point of view of what is called “psychosomatic
disorders”, a particular diagnosis hiding a pseudo conflict of interests between the
physician and the psychologist, both wanting to defend the paternity of the origin of
the complaint. And if things were more simple?
Keywords: Iatrogenic - Psychosomatic - Diagnosis - Psychologist - Physician.
Résumé/Summary
1
/
4
100%