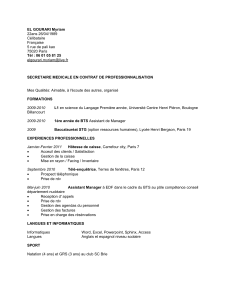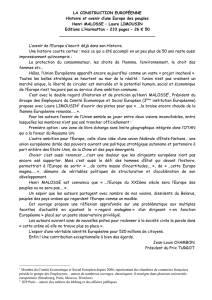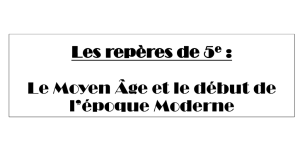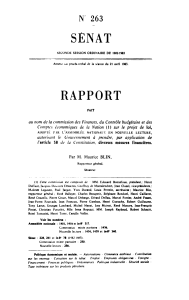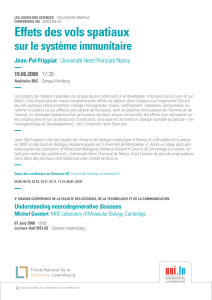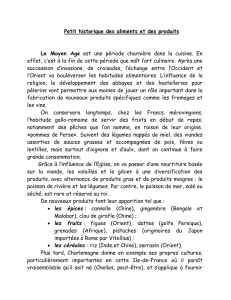La chronologie politique - Capes

1
La chronologie politique :
l’avènement de royaumes « nationaux » et l’hégémonie germanique
Ce premier chapitre de cadrage est strictement événementiel, volontairement plat et se
place du point de vue des souverains et des questions de succession au trône, anticipant sans
doute des points qui seront repris dans le chapitre sur la royauté, mais partant de l’idée que
beaucoup de candidats n’auront rien lu avant et qu’il est peut-être bon de leur en parler. On y
insiste particulièrement sur les débuts de la période (de 888 à Otton Ier) et résume davantage
pour la fin, surtout pour la réforme et la lutte sacerdoce-empire, à partir d’un manuel
commode : Ludger Körntgen, Ottonen und Salier, Darmstadt, 2002 (coll. « Geschichte
Kompakt ») [n° 145 de la biblio], en l’enrichissant pour les années 888-920 par Hagen Keller
et Gerd Althoff, Die Zeit der späten Karolinger und der Ottonen 888-1024, Stuttgart, 2008.
En français, on dispose de Francis Rapp, Le Saint-Empire romain germanique et/ou du Carré
Histoire de Michel Parisse (p. 34 et 44-102), c’est largement suffisant quoique parfois difficile
parce que très comprimé + la New Cambridge Medieval History, en attendant le manuel
annoncé de P. Depreux.
____________________________________
En Francie orientale/Germanie, la période correspond à la succession de peu de
familles, ce qui fait peu de noms à retenir, tout au moins pour les rois et empereurs : a) les
derniers Carolingiens, Arnulf (888-899) et Louis l’Enfant (900-911) ; b) Conrad (911-918) ;
c) les Liudolfingiens/Ottoniens, Henri Ier (919-936), Otton Ier (936-973), Otton II (973-983),
Otton III (983-1002), Henri II (1002-1024) ; c) les Saliens, Conrad II (1024-1039), Henri III
(1039-1056), Henri IV (1056-1106), Henri V (1106-1125). Quant à l’espace considéré, il est
en expansion tantôt par l’annexion territoriale tantôt par le tutorat politique : à l’ouest vers la
Lotharingie dont on tâchera de suivre les démêlés dans le détail, et la Bourgogne ; au sud vers
l’Italie ; à l’est vers la Hongrie, la Pologne et la Bohême ; au nord, entre autres, vers le
Danemark. On signale d’entrée de jeu les principales entités régionales : outre la Lotharingie
comme pièce rapportée, la Saxe, la Franconie, la Bavière, la Souabe (les 4 duchés, même s’ils
n’existent pas institutionnellement de toute éternité), la Thuringe, la Carinthie, la Marche de
l’Est.
I. La Francie orientale, grande puissance des derniers temps de l’Europe
carolingienne, 888-918
Rappel de l’évolution territoriale antérieure : 843, partage de Verdun ; 855, à la mort
de Lothaire Ier, la Francie médiane est à son tour partagée en trois entre ses fils, Louis II qui
obtient l’Italie et le titre impérial, Lothaire II qui obtient la partie nord, dite depuis lors
« royaume de Lothaire » puis « Lotharingie » (cette dernière expression à partir des années
970), Charles qui obtient la Provence ; 863, Charles meurt, la Provence est partagée entre ses
deux frères ; 869, Lothaire II meurt, son royaume ne revient pas à Louis mais est envahi par
Charles le Chauve puis fait l’objet d’un partage entre ce dernier et Louis le Germanique (traité
de Meersen 870 : Aix-la-Chapelle et Metz passent alors du côté oriental). La Lotharingie
passe ensuite complètement à l’est selon le processus suivant : à la mort de Louis le
Germanique en 876, la partie orientale détenue depuis Meersen échoit au deuxième fils de L.
le G., Louis le Jeune ; au traité de Ribemont en 880, le même Louis le Jeune reçoit des
héritiers de Charles le Chauve la partie occidentale, ce qui réunifie l’ancien royaume de
Lothaire sous la houlette germanique ; 882, mort de Louis le Jeune et récupération de ses
possessions par son frère Charles le Gros.

2
Charles III le Gros, l’un des fils de Louis le Germanique, roi depuis 876, empereur
depuis 881, avait été le dernier souverain à régner sur un Empire réunifié (à partir de 884),
plus par le hasard des disparitions dynastiques que par réelle volonté politique. Malade, il est
destitué en novembre 887 puis meurt le 13 janvier 888. Le coup d’État est mené par un fils
illégitime de son frère aîné Carloman, Arnulf de Carinthie (Charles III avait lui-même un
fils illégitime, Bernard, pour lequel il voulut un temps assurer sa succession, mais il est écarté,
mineur). Celui-ci lui succède donc pour ce qui est de l’espace germanique, tandis que les
autres régions de l’Empire se choisissent des rois non-carolingiens, faute de candidats dans la
famille, ou tout au moins de candidats susceptibles d’être pris en considération (en Francie
occidentale, le dernier fils de Louis le Bègue, futur Charles le Simple, né en 879 et seul vrai
légitime sur le marché, est jugé trop jeune) : pour les contemporains, il s’agit d’un événement
d’importance, cf. le récit de Réginon (« les royaumes qui lui avaient été soumis se trouvent
pour ainsi dire sans héritier légitime ; ils se séparent de l’assemblage et ne trouvent plus de
seigneur naturel, chacun se donne un roi tiré de son sein ») ; importance confirmée pour nous
par le fait que les royaumes qui se choisissent alors un roi ont formé les unités politiques du
Moyen Âge central. Ceux qui sont alors élus ou qui tentent de se faire élire avaient déjà des
positions reconnues sous Charles III : Bérenger de Frioul en Italie (Carolingien par sa mère),
Rodolphe (apparenté aux Carolingiens par sa mère) en Bourgogne, Eudes en Francie
occidentale, Gui de Spolète candidat malheureux face à Eudes mais qui prit sa revanche en
Italie contre Bérenger. Cependant, tout en ne manifestant apparemment pas d’autre ambition
que sur la partie orientale de l’Empire, Arnulf s’impose très vite « naturellement » comme
l’homme fort (dominus naturalis, écrit Réginon). D’abord, il considère comme allant de soi
que la Lotharingie et la Francie orientale ne font qu’une, sans rencontrer d’opposition malgré
les velléités des uns et des autres (Rodolphe s’était fait couronner à Toul, Gui de Spolète tente
de se faire couronner à Metz). Surtout, le fait d’être le seul Carolingien en ligne masculine,
succédant à l’empereur qui plus est, semble lui avoir donné d’entrée de jeu une prééminence
reconnue. Les reguli viennent les uns après les autres reconnaître son autorité : en juin 888,
Eudes va chercher à Worms la reconnaissance de son titre royal et c’est avec une couronne
envoyée par Arnulf qu’il est couronné une deuxième fois à Reims au mois d’octobre ;
Rodolphe, qu’Arnulf aurait bien voulu éliminer, est à son tour reconnu par lui à Ratisbonne en
octobre 888 ; en décembre, c’est le tour de Bérenger, à Trente. En quelques mois, Arnulf a
ainsi stabilisé à son profit une situation qui avait pu paraître explosive au début de l’année
888, en « sacrifiant » d’éventuelles ambitions territoriales à la reconnaissance de son autorité
personnelle, obtenue sans difficulté majeure. On trouve une manifestation supplémentaire de
l’acceptation de sa domination par les contemporains dans le fait que, en juin 890, c’est
encore avec des insignes envoyés par lui qu’est couronné roi Louis III en Provence ; de
même, à partir de 893, l’archevêque de Reims Foulque sollicite son soutien pour promouvoir
Charles le Simple face à Eudes. Le corollaire de cette supériorité était l’accession à l’Empire :
après avoir laissé sans suite une première invitation du pape à se rendre à Rome en 890 et,
partant, laissé une possibilité de s’emparer de l’Empire qu’a saisie Gui de Spolète (empereur
en 891 ; lui succède son fils Lambert en 894), Arnulf obtient la dignité suprême de la part du
pape Formose à Rome en février 896. Même s’il n’en tire personnellement aucun bénéfice car
il tombe gravement malade peu après et ne se rétablit pas jusqu’à sa mort (8 déc. 899),
l’événement n’est pas sans importance, puisqu’il marque la dernière tentative de
recomposition en un ensemble intégré et hiérarchisé des éléments de l’ancien empire
carolingien.
Sur le plan intérieur, Arnulf n’a pas rencontré grande difficulté pour s’imposer. En
889, l’assemblée de Forchheim (entre Bamberg et Nuremberg, à la limite entre Franconie et
Bavière) reconnaît la succession au trône pour ses deux fils illégitimes Zwentibold et Ratold
(si toutefois ne naissent pas d’ici son propre décès des enfants d’une union légitime ; Ratold

3
meurt peu après 896) ; en 891, la mort du fils de Charles III, Bernard, fait disparaître un
opposant. A. mène aussi une politique d’alliance avec les grandes familles, spécialement avec
les Conradins (< Konrad), maîtres du Rhin moyen : la femme d’A., Oda, épousée en 888, est
peut-être une « Conradine », tandis que Conrad l’Ancien reçut en 892 une responsabilité quasi
ducale en Thuringe qui assura une position de force à la famille dans la région pour
longtemps.
La Lotharingie posait cependant quelque difficulté, car son intégration territoriale
officielle depuis 880 ne doit pas masquer qu’elle garde son identité de « royaume » qui la met
à part des simples duchés, tandis que les clivages au sein de l’aristocratie régionale, qui ont
duré jusqu’au milieu du Xe siècle, la tirent tantôt vers l’est tantôt vers l’ouest. Si en octobre
891, une importante victoire remportée contre les Normands près de Louvain assure à Arnulf
un complément de légitimité locale, cela n’empêche pas l’année suivante qu’un de ses plus
importants partisans sur place, le comte Mégingaud (qui « gouvernait » les territoires du cours
moyen de la Meuse), soit assassiné. Pour mieux arrimer alors la Lotharingie à la Fr. orientale,
les biens de Mégingaud furent alors assignés en bénéfice à Zwentibold, lequel fut dans un
deuxième temps élu et sacré roi « en Lotharingie », ce qui redonnait une existence visible au
regnum Lotharii qui n’avait plus eu de titulaire depuis la mort de Lothaire II en 869
(assemblée de Worms, mai 895, couplée avec un important concile présidé par A. qui marqua
l’intégration de l’épiscopat de tout le royaume au gouvernement [de manière générale, le
règne d’A. se signale par l’importance des conciles : 6 entre 888 et 895 dont 2 « du
royaume », alors que les décennies précédentes étaient très pauvres en réunions de ce genre] ;
à la même assemblée fut reçu Eudes, dont fut confirmée la dignité royale). Cela ne ramena
pas vraiment le calme pour autant, car Zwentibold n’eut rien de plus pressé que d’intervenir
sur la scène occidentale en prenant le parti de Charles le Simple contre Eudes.
La maladie d’Arnulf fut suffisamment longue pour que, à son décès en décembre 899,
la succession se fît de manière très préparée. Le bénéficiaire en fut Louis IV l’Enfant, né en
893 du mariage avec Oda, qui fut élu et couronné en février 900. Zwentibold, lui, fut
totalement écarté, non seulement de la « Germanie » mais aussi de la Lotharingie qui lui avait
été attribuée en 895 (comme compensation pour l’éviction future) et dont les grands firent
hommage à Louis. Débute alors une régence, aux mains des principaux conseillers du
royaume : pour les ecclésiastiques l’archevêque de Mayence Atton (parrain de Louis, c’est lui
qui l’a couronné), l’évêque d’Augsbourg Adalbéron, celui de Constance Salomon ; pour les
laïcs, le comte Conrad, chef des Conradins. Mais très vite le royaume est en proie aux rivalités
des grands (spécialement entre les Conradins et les Babenberg ; cette dernière famille avait
été écartée par Arnulf au profit des Conradins). L’intégration régionale s’effrite, tandis que se
renforcent les positions locales des aristocraties, rangées autour de quelques familles-clés :
Conradins en Franconie, Liudolfingiens en Saxe, Liutpoldingiens en Bavière, Hunfridingiens
en Souabe/alémanie. À cela s’ajoutent les incursions hongroises, attestées à partir de 900 en
Bavière : on les signale en Saxe et en Thuringe en 906 et 908 ; en 907, l’armée bavaroise subit
une lourde défaite face à eux (mort du marquis Luitpold et de plusieurs comtes, de
l’archevêque de Salzbourg et archichapelain Theotmar, de l’évêque de Freising) ; autre
défaite en 910, soldée cette fois par la mort du comte du Palais Gozbert et, plus importa,te
peut-être pour ses conséquences politiques, par celle de Gebhard, chef des Conradins et dux
regni en Lotharingie. La majorité politique de Louis IV, en 908, ne change rien à cette
évolution délétère. Louis, dernier Carolingien oriental, meurt en 911 ; dès avant, ou juste
après, le parti le plus influent en Lotharingie file faire hommage auprès de Charles le Simple.
La transition : Conrad, 911-918

4
La disparition brutale de Louis l’Enfant, sans héritier, posait un problème de
succession analogue à celui de 888. À cette différence près que si, en 888, on avait pu écarter
Charles le Simple à cause de son jeune âge, cette fois il pouvait faire un candidat tout à fait
acceptable, d’autant qu’il était auréolé de son succès dans le règlement du problème normand.
Mais en novembre 911, c’est Conrad de Franconie, non carolingien, qui est élu. Le choix de
Conrad ne fait que couronner une progression personnelle et familiale. Au-delà de l’individu,
on y voit surtout une rupture dynastique sur laquelle l’historiographie insiste à loisir, mais
dont il ne faut pas surévaluer la portée. L’élection se fait d’abord dans le respect de la
tradition : à Forchheim, l’un des vieux centres du pouvoir oriental, et par une assemblée
représentant tout le royaume à l’exception de la Lotharingie : Francs, Saxons, Alamans,
Bavarois. D’autre part, imaginer qu’on ait pu faire appel à Charles le Simple n’est guère
réaliste, car celui-ci avait peu de contacts en Francie orientale… et n’était sans doute pas
candidat. Il avait en revanche beaucoup de liens en Lotharingie, et il se produit comme un
équilibrage : l’ascension des Conradins, largement possessionnés en Lotharingie, pousse les
autres familles locales à chercher un contre-pouvoir, tandis que le succès personnel de Charles
dans cette région provoque une réaction inverse plus à l’est. Il n’y a en tout cas pas de rejet
dynastique pour lui-même, mais simplement une absence depuis longtemps ancrée de
tropisme occidental (à la différence des Occidentaux pour l’est).
Le bref règne de Conrad n’est pas particulièrement brillant. Il se signale par :
- La perte de la Lotharingie et les tentatives manquées d’y reprendre pied. En 911, on l’a
vu, peut-être dès avant la mort de Louis l’Enfant, les grands de Lotharingie, encouragés par la
disparition du « duc du royaume » en Lotharingie Gebhard, font défection pour Charles le
Simple. Dans les années qui suivent se succèdent plusieurs épisodes militaires peu
concluants : on voit Charles à Metz en 912, Conrad à Strasbourg la même année ; Rodolphe
de Bourgogne en profite pour mettre la main sur Bâle. Le plus clair de l’histoire est que, un an
après son élection, Conrad a durablement perdu la région : d’où un prestige amoindri pour lui-
même comme roi, et un affaiblissement de la position des Conradins à l’ouest.
- L’impossibilité à assoir réellement son autorité face aux autres ducs, qui se révoltent
contre lui (Bavière, Souabe, Saxe tour à tour), après un an de relative tranquillité. De manière
significative, presque la moitié des diplômes conservés sont antérieurs à 913, après quoi la
production devient aléatoire, signe d’un non exercice du pouvoir (i.e. absence de requêtes
présentées à la cour en vue d’obtention de la faveur royale) ou tout au moins d’une activité
uniquement dédiée aux expéditions militaires à droite et à gauche. Même l’alliance
matrimoniale, moyen habituel de se concilier une famille adverse, ne fonctionne pas : Conrad
épouse en 913 Cunégonde, la veuve du marquis de Bavière Luitpold tué par les Hongrois en
906, pour sanctionner une paix avec la famille de celle-ci (en Souabe), mais cela n’empêche
pas ses frères, et son fils, de se rebeller contre lui (le fils est exilé, les frères pendus). Conrad
est toujours capable de mater l’un ou l’autre, mais sans jamais réussir à établir de manière
stable l’autorité royale. C’est dans ce contexte que se négocie une relation particulière avec
les Liudolfingiens en Saxe : à la mort du duc Otton l’Illustre, en 912, Conrad cherche à
pousser ses pions dans la région, pour contrebalancer la toute-puissance ducale ; d’où réaction
violente du fils d’Otton, Henri ; en 915, une bataille entre les deux, à Grone près de Kassel,
semble déboucher d’une part sur la reconnaissance du pouvoir du roi par Henri, formellement
manifestée par un rituel de soumission (deditio), tandis que Conrad maintient Henri dans
l’intégralité du pouvoir ducal tel que l’exerçait Otton. De manière générale, les difficultés
politiques de Conrad sont celles rencontrées par tous les rois non-carolingiens du moment : ils
ont en commun de devoir concilier des prétentions de souveraineté puisées au modèle

5
carolingien avec celle de grands dont le pouvoir personnel n’a cessé de croître tout au long du
IXe siècle, c’est-à-dire d’un milieu dont ils sont eux-mêmes issus.
- La permanence des incursions hongroises. Il n’y a pas une année du règne de Conrad
qui n’en subisse. Une seule défaite à signaler du côté hongrois, en 913 ; le vainqueur est le
duc de Bavière Arnulf, qui met ce succès à profit pour se révolter dans la foulée contre
Conrad.
Bilan : si en 888, la Francie orientale tenait le haut du pavé, en 918 ce n’est plus le
cas ; territorialement, elle est diminuée de la Lotharingie et la Bourgogne lui taille des
croupières ; la position du roi n’y est guère plus forte que celle que peut avoir Charles le
Simple en Francie occidentale. À l’échelle européenne, le sentiment commun est encore celui
d’une appartenance à un même regnum Francorum où s’agitent plusieurs rois, au sein d’un
processus de désintégration accéléré, avec fluidité des appartenances politiques comme en
Lotharingie.
II. Avènement et mise en place de la dynastie ottonienne
Henri Ier, 919-936 : stabilisation et consolidation de la royauté
La mort de Conrad (23 décembre 918) amène un réel changement, bien plus notable
que celui qui avait marqué son arrivée sur le trône en 911. L’élection de Conrad n’avait fait
que consacrer un pouvoir déjà existant. Cette fois arrive le « duc des Saxons » Henri (les
guillemets s’imposent, car Henri n’avait peut-être que rang comtal), d’une autre famille, alors
que Conrad avait un frère, Éberhard/Évrard, qui aurait pu prétendre à la succession. D’où
l’importance de l’événement, retenu comme fondateur pour l’histoire allemande.
Pour le comprendre, nous sommes tributaires des récits des historiens de la cour
ottonienne, à commencer par celui de Widukind de Corvey : Conrad, avant sa mort, aurait
demandé que fussent portés à Henri les insignes royaux et c’est Eberhard lui-même qui se
serait acquitté de cette mission. Récits partisans forcément, mais qui ont le mérite d’être
unanimes ; on peut en garder au minimum comme « bon » le fait que l’accession au trône de
Henri s’est faite avec le soutien actif du frère de son prédécesseur. Dans l’historiographie
contemporaine, on préfère au reste parler de peuples/ethnies, là où nous voyons des
concentrations régionales de pouvoir aux mains de quelques familles dominantes : les Saxons
remplacent les Francs comme gens dominante, mais le passage de témoin par Conrad et
Eberhard permet de présenter la nouvelle royauté comme celle « des Francs et des Saxons ».
Pourquoi Henri ? Parce que c’est l’un des rares grands du royaume avec lequel Conrad
avait pu établir des relations normales, après l’épisode de 915. Il a aussi un bon pedigree, car
même si la famille est récente puisqu’on ne remonte pas au-delà de son grand-père Liudolf
(comte mi IXe, fondateur du monastère féminin de Gandersheim), elle a des relations suivies
avec les Carolingiens orientaux : Louis le Jeune († 882), fils de Louis le Germanique, a
épousé une fille de Liudolf, Liudgard, tandis qu’à la génération suivante une sœur de Henri,
Oda, a été mariée à Zwentibold ; quant au père de Henri, le duc Otton l’Illustre, il était crédité
d’un pouvoir quasi royal en Saxe. La famille fait donc jeu égal avec les Conradins, elle a aussi
en commun avec eux d’avoir des horizons politiques plus larges que leur région de souche
(Franconie pour les uns, saxe pour les autres), là où les familles ducales de Bavière et de
Souabe ont des horizons plus limités ; son arrivée au pouvoir ne fait que consacrer l’état des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%