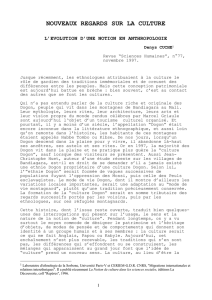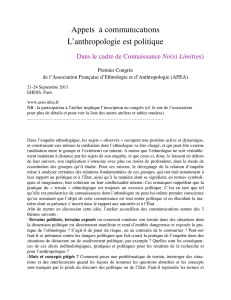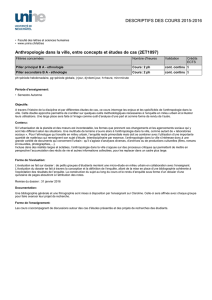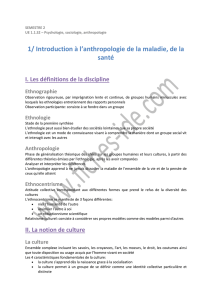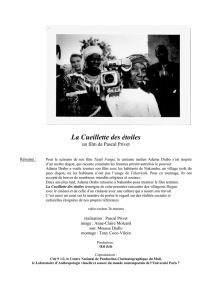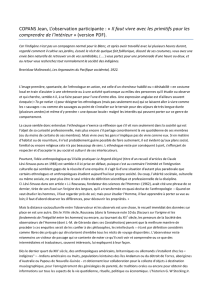nouveaux regards sur la culture

NOUVEAUX REGARDS SUR LA CULTURE
L’EVOLUTION D’UNE NOTION EN ANTHROPOLOGIE
Denys CUCHE1
Revue “Sciences Humaines”, n°77,
novembre 1997.
Jusque récemment, les ethnologues attribuaient à la culture le
rôle de gardien des traditions immémoriales et de creuset des
différences entre les peuples. Mais cette conception patrimoniale
est aujourd’hui battue en brèche : bien souvent, c’est au contact
des autres que se font les cultures.
Qui n’a pas entendu parler de la culture riche et originale des
Dogon, peuple qui vit dans les montagnes de Bandiagara au Mali.
Leur mythologie, leurs rites, leur architecture, leurs arts et
leur vision propre du monde rendus célèbres par Marcel Griaule
sont aujourd’hui l‘objet d’un tourisme culturel organisé. Et
pourtant, il y a moins d’un siècle, l’appellation “Dogon” était
encore inconnue dans la littérature ethnographique, et aussi loin
qu’on remonte dans l’histoire, les habitants de ces montagnes
étaient appelés Habbe Tombo ou Kibse. De nos jours, lorsqu’un
Dogon descend dans la plaine pour y vivre, il abandonne là-haut
ses ancêtres, ses autels et ses rites. Or en 1997, la majorité des
Dogon vit dans la plaine et ne pratique plus guère la “culture
Dogon”, sauf lorsque des visiteurs se présentent. Aussi Jean-
Christophe Huet, auteur d’une étude récente sur les villages de
Bandiagara, est-il en droit de se demander s’il a jamais existé
une ethnie Dogon propriétaire d’une culture Dogon. Selon lui,
l’”ethnie Dogon” serait formée de vagues successives de
populations fuyant l’oppression des Mossi, puis celle des Peuls
esclavagistes. Le mode de vie Dogon, dont il montre d’ailleurs les
variations locales importantes, serait une adaptation au “mode de
vie montagnard”, plutôt qu’une tradition précieusement conservée.
La formation de la “culture Dogon” serait en somme tributaire des
regards successifs portés par les voisins, puis par les
ethnologues, sur ces réfugiés montagnards.
Cette histoire, dont l’issue reste ouverte, traduit bien quelques-
unes des interrogations qui pèsent sur l’usage, le sens et la
nature de la notion de “culture”. Pendant longtemps, on y a vu
surtout le moyen commode de désigner le patrimoine et l’héritage
d’objets, de modes de pensée et de comportements qui donnent son
identité à un groupe humain et à ses membres : la culture serait
ce qui me fait Anglais, Papou ou Kabyle. Aujourd’hui, cet
enchaînement n’est plus recevable, les traditions qui n’en sont
pas, les différences qui s’effondrent ou se construisent, les
mélanges qui apparaissent au grand jour font que l’idée de
“culture” prend un nouveau sens. La culture, au lieu d’être la
1
1 Laboratoire d'ethnologie de la Sorbone, Université Paris-V et CERIEM-G.D.R. CNRS, "Migrations internationales et
relations interethniques". Il a publié récemment La Notion de culture dans les sciences sociales, éditions La
Découverte, coll "Repères", 1996.

cause de l’identité collective, devient sa conséquence et son
produit, elle n’est pas un système clos ni une tradition à
conserver, mais une construction sociale en constant
renouvellement et dont une des fonctions est de garder constamment
les frontières d’une collectivité particulière.
L’influence du culturalisme
Défini il y a à peine plus d’un siècle par Edward Tylor (1871), le
concept scientifique (c’est-à-dire descriptif et non normatif) de
culture n’a jamais cessé d’être réexaminé et repensé. Surtout
utilisé dans le champ de l’ethnologie, il a épousé les aléas de
l’histoire de cette discipline. Il a été en particulier tributaire
de la façon dont l’ethnologie envisageait les sociétés dites
“primitives”. Pendant longtemps, on a surtout pensé qu’elles ne
devaient leur survie qu’à un sens aigu de la conservation de
traditions éminemment locales.
Héritier de la philosophie romantique allemande et de sa
conception particulariste, le courant culturaliste américain a
influencé durablement l’usage du mot culture. Dans un article
publié en 1917, l’ethnologue Alfred Kroeber définit la culture
comme une sorte de “super-organisme” indépendant des personnes et
des rapports sociaux qui les unissent ou les opposent, sorte de
réalité supérieure qui détermine la conduite des individus. Cette
façon de voir, largement partagée dans les années 30, présente la
culture comme une sorte de patrimoine transmis héréditairement de
génération en génération, ne souffrant que de modifications
mineures. Parfois, cette hérédité culturelle est pensée sur le
mode de l’hérédité génétique. On parlera de la culture comme étant
une “deuxième nature”.
L’idée commune à ces conceptions est que l’individu ne peut pas
plus échapper aux déterminations de sa “nature culturelle” qu’à
celles de sa nature biologique. Dans cette acception, le mot
culture est un simple euphémisme de celui de “race”, très utile
pour camoufler la portée idéologique du discours raciste depuis
que la crise scientifique a rejeté les théories raciales du
comportement humain. Sous des apparences anodines, certaines
expressions peuvent être très ambiguës. Par exemple, dire de
quelqu’un, à propos de sa façon d‘agir, comme on l’entend souvent
: “C’est sa culture” au sens de : “Il n’y peut rien”, revient à
nier cet individu comme sujet, à le considérer comme simple
“porteur” d’une culture.
Une autre représentation héritée des ethnologues pèse sur la
manière commune dont on se figure une culture comme une entité
séparée des autres par des frontières bien nettes. Chaque culture
est réputée constituer une unité discrète, aisément identifiable
et distincte des autres. Seul le contact des cultures pourrait
venir altérer la “pureté originelle” de chaque culture
particulière. Ce schéma, largement répandu, s’accompagne
généralement d’une vue pessimiste des processus d’acculturation,
qui sont perçus comme autant d’altérations d’une culture
authentique.
Cette conception doit en fait beaucoup aux méthodes employées par
les ethnologues. L’ethnologue est un chercheur de terrain, qui
2

s’adonne à l’observation rapprochée d’une population spécifique,
généralement restreinte, considérée comme représentative d’une
culture (celle des Jivaro, des Soninké, des Hmong ou des Bretons).
Il est naturel que le chercheur soit porté à exagérer
l’originalité de la culture particulière qu’il étudie, cette
originalité affirmée garantissant du même coup celle de ses
propres recherches. Mais l’originalité, érigée en principe, peut
aboutir à ce que l’on nomme le “relativisme ontologique”’, idée
selon laquelle les cultures sont des réalités incomparables entre
elles, incommensurables les unes par rapport aux autres.
Les ethnologues qui ont soutenu ce point de vue semblent avoir été
directement influencés par leur objet d’étude : l’ethnocentrisme
étant un trait universellement partagé, tout groupe humain tend à
voir sa culture comme profondément originale. Cette originalité
revendiquée est l’expression de son identité. Tout Français, par
exemple, est plus ou moins habité par l’idée que la gastronomie
est un intérêt typiquement “de chez nous”, et que la cuisine
française est la “première du monde”. Cette réaction est un
phénomène social normal, un mécanisme de défense collectif bien
connu des psychologues sociaux. Cependant, confondre le niveau de
la réalité vécue avec celui de l’analyse peut conduire à des
positions idéologiques comme le différentialisme, éloge naïf de la
différence culturelle considérée comme un absolu dans le meilleur
des cas, reconnaissance condescendante de la différence dans
d’autres versions, comme cette forme réactionnelle qu’observait
Geza Roheim : “Vous êtes complètement différents de moi, mais je
vous pardonne “ (1); voire même, dans sa version extrémiste,
assignation à la différence : Vous êtes différents de nous,
restez-le”, autrement dit : “Restez à votre place!”. Une autre
voie dans laquelle s‘est engagée en particulier l’anthropologie
diffusionniste a été la décomposition des cultures en “traits”
techniques, symboliques et sociaux : le portage sur la tête, la
culture sur brûlis, le rite de la couvade, le monothéisme,
l’immolation de veuves ou le mariage avec la fille de l’oncle
maternel. L’accumulation, aussi exhaustive que possible des
“traits culturels” permettait, pensait-on, de définir une culture
particulière. Cette voie, toutefois a été progressivement
abandonnée, les anthropologues ont pris conscience qu’une culture
n’est pas un ensemble d’éléments juxtaposés, mais un système dont
les différents composants sont interdépendants. Ce qui compte donc
prioritairement pour le chercheur, c’est de faire apparaître la
logique du système, autrement dit ce qui lie les éléments les uns
aux autres. En d’autres termes, ceux de Ruth Benedict par exemple,
c’est cherche la configuration, le modèle (le “pattern”) qui
organise l'ensemble en un tout cohérent (2). Ainsi, selon
R.Benedict, la vie sociale des Indiens Pueblo est marquée, dans
toutes les manifestations de la vie courante, par le sens de la
mesure, et organise le comportement de chacun de ses membres.
Celui des Kwakiutl, de la côte occidentale de l’Amérique du Nord
est, en revanche, couramment caractérisé par la violence.
Là encore, une intuition pertinente a abouti, à force d’être
systématisée, à une position théorique rigide et discutable. De
l’idée d’un tout présentant une certaine cohérence, on est passé -
notamment avec Malinowski - à l’idée que toute culture serait un
système en équilibre stable (3). La critique, déjà adressée au
fonctionnalisme naïf, consiste à rappeler que cette proposition
aboutit à une tautologie : si tout élément dans une culture est
3

“fonctionnel”, répond à une nécessité, alors toute culture
fonctionne bien par définition. L’anthropologie fonctionnaliste
semble avoir été victime d’une illusion d‘optique, due, dans ce
cas aussi, aux conditions de travail de terrain. En effet, même si
l’ethnologue séjournait durablement au milieu du groupe observé,
la durée du terrain restait marginale par rapport au temps de
l’histoire vécue de ce groupe. La plupart du temps, l’ethnologue
n’avait pas la possibilité d’observer directement de changements
culturels importants comme par exemple l’émergence d'un royaume.
S’il en observait, malgré tout, il les attribuait généralement aux
contacts avec l’extérieur, chaque peuple étant supposé avoir une
tendance naturelle à conserver ses traditions. Absorbé par la
recherche d’un “modèle” sous-jacent à la culture qu’il étudiait,
l’observateur ne réalisait pas toujours que ce modèle ne devait sa
cohérence qu’à ses propres analyse, beaucoup plus qu’aux exigence
propres à la culture du groupe étudié.
Une notion abstraite
Ces conceptions de la culture ont été critiquées par
l’anthropologue britannique Radcliffe-Brown: il les qualifiait de
“réifications d'abstraction” (4). Une culture, en effet, n’est pas
une réalité concrète. Ce qui existe, expliquait Radcliffe-Brown,
ce ne sont pas des cultures, mais des êtres humains liés les uns
aux autres par une série illimitée de relations sociales. En
conséquence, la culture ne préexiste pas aux individus : ce sont
les individus qui la produisent collectivement, qui organisent
symboliquement leur existence. Une culture est une production
historique, qui connaît des évolutions, des transformations, voire
des mutations, liées à plusieurs facteurs.
L’ethnologue Margaret Mead (5) a développé l’idée que chaque
individu “interprète” le “modèle” que lui transmet le groupe
auquel il appartient en fonction de son histoire singulière et de
sa personnalité. Ces interprétations individuelles, en apparence
peu différentes les unes des autres, produisent des variations
souvent peu repérables prises une à une, mais dont la somme génère
un réajustement quasi permanent de la culture collective. Cette
proposition, qui semble évidente dans les sociétés modernes, est
tout aussi vraie pour les cultures apparemment plus conservatrices
que les ethnologues fréquentent.
Ralph Linton, autre anthropologue culturaliste, insistait sur le
fait que, dans toute société, il existe des places différenciées
liées au sexe, à l’âge, au statut social. C’est donc aussi à
travers ces déterminations que les individus interprètent la
culture qui leur est présentée (6). Chaque individu, même s’il
n’en a pas conscience, n’a qu’une vue limitée de la culture
globale de sa société; il ne peut la saisir qu’à partir de la
place à laquelle il se trouve de par son statut. Décrire une
culture implique donc d’admettre une pluralité de points de vue
sur les mêmes faits.
Comment se construit une culture?
Le courant théorique de l’interactionnisme symbolique, développé
par les sociologues de l’Université de Chicago dès la fin des
années 30, a beaucoup contribué à la critique de l’idée de la
culture comme une sorte de patrimoine qui préexisterait aux
4

pratiques des individus et leur conférerait a priori du sens. En
s‘attachant à décrire finement les représentations et les
pratiques de petites communautés marginales, sinon déviantes
(jeunes délinquants des bas quartier, immigrés, travailleurs
clandestins, musiciens de dancings), ils ont mis en valeur deux
idées : d’une part qu’une culture nouvelle peut naître d’un
certain rapport social, et d’autre part qu’elle s’élabore
quotidiennement dans les interactions collectives et
individuelles. Les individus ne peuvent donc pas être considérés
comme des marionnettes jouant une partition préétablie. Howard
Becker a décrit, en 1963, la communauté des musiciens de dancing
de Chicago. On y voit des acteurs sociaux qui créent eux-mêmes,
dans l’interaction, les règles, les conventions et les
représentations qui organisent et donnent sens à leur existence
collective. Les créant eux-mêmes, ils peuvent aussi les réviser,
les faire évoluer, les transformer, ce qui justifie en grande
partie le changement culturel.
Les interactions sont individuelles, mais elles se réalisent au
sein de rapports sociaux. L’anthropologie dynamiste, celle
d’Edmund R.Leach (7) ou encore celle de Georges Balandier (8)
s’est employée à montrer comment l’existence des cultures
dépendait d’une histoire collective liée à des enjeux de pouvoir
et à des luttes sociales. La cohérence relative dont est dotée une
culture n’est, dans cette perspective, que la “résultante” à un
moment donné, de l’ensemble des forces qui s’exercent dans la
société. Chaque système culturel peut être considéré comme un
agencement provisoire, jamais parfaitement homogène, marqué par un
certain anachronisme (les différentes pièces de l’agencement ne
datant pas de la même époque). On pensera par exemple, aux
différentes “strates” aristocratiques et libérales qui constituent
ce mixte qu’est la “culture britannique”, ou bien encore au
mélange de conformisme social et d’innovation technique qui
caractérise les Japonais, etc. C’est ce qui confère un caractère
problématique à toute culture, mais aussi une réelle plasticité.
Cette nouvelle façon de traiter les cultures a d’autres
conséquences. Pas plus qu’il n’y a de frontières “naturelles”
entre les sociétés, il n’y a de frontières clairement établies
entre les cultures. Aussi, un ethnologue spécialiste de l’Afrique,
Jean-Loup Amselle, a-t-il proposé de substituer une approche
“continuiste” à l’ancienne approche “discontinuiste (9). Toute
culture étant le produit d’une série d’interactions sociales, on
peut affirmer que les cultures sont de proche en proche
interdépendantes et en continuité les unes avec les autres.
Analyser une culture particulière implique de reconstituer et
d’évaluer l’histoire de ses relations avec les cultures
environnantes. A considérer les choses ainsi, on se rend compte
que les frontières entre les cultures sont floues et mouvantes. Où
commence et où s’arrête telle ou telle culture particulière? La
question n’appelle pas de réponse concrète. Comme le soulignait
Claude Lévi-Strauss, “une même collection d’individus, pourvu
qu’elle soit objectivement donnée dans le temps et dans l’espace,
relève simultanément de plusieurs systèmes de culture : universel,
continental, national, provincial, local, etc. et familial,
professionnel, confessionnel, politique, etc...” (10).
L’acculturation permanente
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%