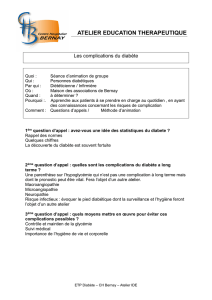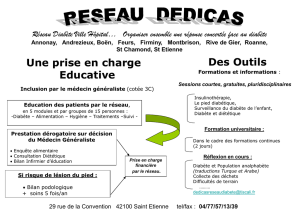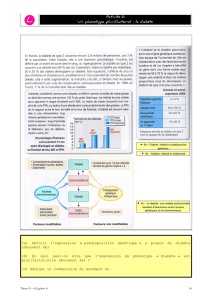Vers une étude ethnoépidémiologique du diabète de type 2 et de

Santé publique
2008,volume 20,n° 2,pp. 113-124
ÉTUDES
Correspondance:
G.Imbert
Réception :
28/03/2007 –
Acceptation :
03/01/2008
geneviev e.imbert@gmail.com
Vers une étude ethnoépidémiologique
dudiabètedetype 2
etdesescomplications
Towards the developmentof anEthno-epidemiologicalstudy
of Type-2Diabetesand its Complications
GenevièveImbert (1)
Résumé :L’évolution préoccupantedudiabètedetype 2vers saforme épidémiqueassociée
aux conséquencesdramatiquesqu’elle génère, a faitl’objetcesdernièresannéesde nom-
breusesrecherches.Cetarticle examine le diabètedetype 2et sescomplicationsàpartir
d’étudesportant sur sasituation épidémiologiqueàl’échelle internationale – incluantles
autochtones– et sur sesdéterminants socioculturels.Onrelèveainsid’importantesdispari-
tésethniquesen matièrede mortalité etde morbiditéainsi que l’origine multifactorielle de
cetrouble métabolique,s’agissantnotammentdespopulationsautochtones.Par-delàle
constatdeslimitesdesprogrammesde prévention, cetterevuede littérature ouvresur
l’importancederenforcerlaréalisation d’étudesethnoépidémiologiquesau sein despeuples
vulnérablesafin d’améliorerla compréhension de l’émergence etdudéveloppementdece
phénomène pathologique particulièrementcomplexe.
Mots-clés:
Diabètedetype 2-complications- épidémiologie - anthropologie médicale.
Summary:
The troubling evolution of Type 2Diabetesinto epidemicproportionsbearing
dramatic consequenceshasgeneratedsignificantinterest leading toastrong research focus
andthereforethe subjectof severalstudiesin recent years.Thisarticle examinesType 2
DiabetesMellitus andits complicationson the basisof aliteraturereviewaddressing their
epidemiologicalsituation on an internationalscale – including indigenous peoples–andtheir
socio-culturaldeterminants.This study revealsimportantethnic disparitiesin termsof
mortality andmorbidity, as well as the multi-factoredorigin of thismetabolic disorder,most
notablyamong indigenous populations.Aboveand beyondthe limits of prevention
programmes,thisliteraturereviewaddresses the importance of reinforcing ethno-
epidemiologicalstudiesamong vulnerable peoplesin order to improve our understanding of
the emergenceand developmentof thisparticularlycomplexpathological phenomenon
Keywords:
Type 2Diabetesmellitus -complications,epidemiology- medicalanthropology.
(1) Post-doctoralFellow, Dalhousie University, BioethicsDepartment,CRC Building,Room C315,5849 Avenue
University, Halifax, Nouvelle-Écosse, B3H4H7, Canada.

G.IMBERT
114
Santé publique
2008,volume 20,n° 2,pp. 113-124
Introduction
Lediabètereprésenteun problème majeur desanté publique en raison de
«seslourdesconséquencesmorbides, deson caractère évolutif suggérant
une prévention possible etla crainte que lasituation soitméconnue ethors
contrôle »[32].
L’objectif decetarticle est d’appréhender,selon une approche ethnoépidé-
miologique etàl’échelle internationale,lesdéterminants socioculturels
impliquésdansl’émergence etl’évolution decetrouble métaboliquevers la
gravité,en particulierau sein de minoritésethniques.Afin dedresserle por-
traitde lasituation épidémiologiquedece phénomène complexe etde porter
une attention particulièresur seshypothèsesexplicativeset sesfacteurs de
risque,en particulierauprèsd’autochtonesetde migrants,une revuede la
littératureaétéréalisée. Lecorpus des référencesbibliographiquesdites
«classiques» en santé publique eten anthropologie aétécomplété par une
recherche thématiqueapprofondie.
Par-delàleslimitesdesprogrammesde prévention faceàl’épidémie du
diabète, ces travaux conduisentàsoulignerlapertinencedesapproches
ethnoépidémiologiquesqui privilégient une analyseculturelle du risque.
Méthode
Cetextes’inscritdansla continuitédetravaux,en particulierd’une étude
exploratoire portant sur le développementetlasévéritédudiabètedetype 2
etdesescomplicationschezdesPolynésiensautochtones vivantdansla
zone urbaine deTahiti[22].Une revuede lalittératureaétéréalisée sur
Medline àpartirdesmots-clés suivants :«Diabètedetype 2, complications,
épidémiologie,ethnologie,peuplesautochtones», c’est-à-dire en utilisant
lesdescripteurs MeSH suivants :«
DiabetesMellitus, diabetescomplica-
tions,epidemiology,ethnology,indigenous population
». En outre, des
recherchesbibliographiquescomplémentairesontpermisd’accéderau
contenuplus spécifiquedetravaux centrés sur l’étudedes variablesenviron-
nementales,sociodémographiques,psychologiquesetculturellesimpliquées
dansl’émergence etle développementdudiabètedetype 2au sein de grou-
pesminoritairesautochtonesoude migrants.Le matériel exploitécomprend
lesétudesetles travaux sélectionnésen regard de leur pertinence par
rapport aux objectifspoursuivis,en particulier s’agissantdedocumenterla
situation épidémiologiquedecetrouble métabolique et son développement
au sein decommunautésoude groupesminoritairesautochtones.
Résultats
La situation épidémiologiquedudiabètedetype 2etdesescomplications
L’épidémie dediabète
quiaémergé aucours duXXesiècle etquicontinue
de progresserde manièrealarmante,s’inscritdansle contextede latransi-
tion épidémiologiquedudéveloppementdesmaladieschroniquesdansles
pays développésassocié àlamodernisation [47], etpeut ainsis’expliquer
notammentparle vieillissementde lapopulation plus exposée aux maladies

ÉTUDE ETHNOÉPIDÉMIOLOGIQUE DU DIABÈTE DE TYPE 2115
Santé publique
2008,volume 20,n° 2,pp. 113-124
chroniquesqu’aux maladiesinfectieuses,etparl’augmentation de l’inci-
dencedecesmaladiesliée à desfacteurs derisqueaggravants [35].
Ce phénomène épidémiquesesitue plus précisémentdanslatroisième
phasedumodèle detransition épidémiologique[15,21] décritparOmran[38]
qui est marquée parl’installation desmaladiesdégénératives[20], l’augmen-
tation exponentielle des taux de mortalité liésaux maladieschroniqueschez
lesadultesetlespersonnesâgées remplaçantlesdécèsetincapacitésqui
étaient, auparavant,imputablesà desmaladies transmissibles,maternelles
oupérinatales[40].
Lediabète,principalementceluidetype 2(ou
Type 2DiabetesMellitus
),
représenteun problème desanté préoccupant,en progression danspresque
toutesles régionsdumonde.
Même si lesdonnéesépidémiologiques sontincomplètesdans uncertain
nombrede pays [56], une étude prédictivede l’évolution de l’épidémie du
diabètedetype 2dansle mondeaucours dupremierquart duXXIesiècle,a
permisdedresser une courbe inflationnistedunombredediabétiquesqui
passera de 135 millionsen 1995 à300 millionsen 2025. Lespays lesplus
touchés serontl’Inde,la Chine etlesÉtats-Unis[25](2) ,75 % deces
personnes vivantdanslespays en développement[42].
Lesprojectionsde l’évolution decette épidémie conduisentà affirmer
l’urgente nécessitéde procéderàlasurveillancedudiabèteàl’échelle plané-
taire en amontdesaprévention etdeson contrôle. Àl’instardudiabètede
type 2qui est lapartie émergée de l’icebergconstitué parle syndrome méta-
bolique,l’épidémie mondiale dudiabètedetype 2 représente précisément
l’extrémitédesproblèmes sociaux considérablesquesonten train d’affronter
lespays en développement,maisaussi lesminoritésethniquesetles
communautésdéfavoriséesdanslespays développés[63].Il est ainsirecom-
mandéàl’Organisation Mondiale de la Santé etàsesdirigeants, d’adopter
une vision pragmatiqueduproblème dudiabètedetype 2en tantquesymp-
tôme d’un processus mondial,en respectant son importancesociale, cultu-
relle,économique etpolitique[63].
Taux de prévalence dudiabète etde sescomplications
Letaux d’incidencedudiabètes’avère particulièrementdifficile àobtenir
étantdonné le caractèreasymptomatiquede lamaladie [57].Enrevanche,le
taux de prévalencedudiabètedetype 2est évaluéà7%aux États-Unis[13],
à3,8 % en France[27], etaumoinsaudouble danslesdépartements et ter-
ritoiresd’outre-mer[46].AuCanada, lasituation est particulièrementinquié-
tantesurtout danslescollectivitésautochtonesoùles taux dediabètede
type 2 sont troisà cinq foisplus élevésquedanslapopulation canadienne
oùcelui-ci est estimé à4,8%[54].Danslescommunautésd’Aborigènes
d’Australie,le taux de prévalencedudiabètevarie de 10à30 % etévolue
dramatiquement vers descomplications rénalesnécessitantla dialyse provo-
quant 22 %de mortalitéchezcesdiabétiques[55].
(2)Lediabètevasurtout augmenterau sein despopulations vivantdansleszones urbaines.Sidanslespays
en développementlamajoritédesdiabétiques sontâgésde 45 à64ans, danslespays développés,ils sont
âgésde65ansouplus etce phénomène vas’accentueren 2025. Le nombrede femmesdiabétiquesest supé-
rieur aunombred’hommes,surtout danslespays développés.

G.IMBERT
116
Santé publique
2008,volume 20,n° 2,pp. 113-124
La prévalencedudiabèterelevée aux Etats-Unischezlesgroupesminori-
tairesetlescommunautésethniquesincluantlesAfricains-Américains,les
HispaniquesetlesAmérindiens– quisontaffectésde façon disproportionnée
– est généralement 2 à4 foisplus grande quedanslamajoritéde la
population [16].
LescommunautésduPacifique ne sontpasépargnées, bien aucontraire,
parle développementdesmaladiesnon transmissibles(MNT),entreautres
parceluidudiabètedetype 2dontle taux de prévalenceserait« le plus élevé
aumonde»[37].Dansleur revuede littératuresur l’obésité etle diabètede
type 2chezlesinsulairesduPacifique, Okihiro& Harrigan évoquentles
hypothèsesduchangement rapidedumodedevie associé àl’urbanisation et
àlamigration,etqualifientfinalementlescausesdece phénomène patholo-
giqued’« obscures». Une étudecomparative(3)réalisée auprèsdeMélané-
siens vivanten zone urbaine eten zone rurale apermisdesoulignerl’effet
délétèrede lavie occidentale danslapopulation mélanésienne soumiseà
une modernisation rapide[45].Onconstate que larépartition de l’épidémie
dudiabètedanscescommunautésduPacifiques’avèretrès
disparate
[12,
26].Ainsi, danscertaines zones ruralesde la Papouasie-Nouvelle-Guinée,le
taux de prévalencedudiabèteseraitpratiquementinexistant, alors quesur
l’île deNauru (4) parexemple, cetaux,le plus élevé,est estimé à40%[12,
26].
La situation de l’étatdesanté particulièrementdramatiquedesNauruans,
illustreavecune acuité extraordinaire leseffets largementdévastateurs –au
planculturel,social etécologique – dudéveloppementindustriel,sur une
population initialementconstituée dechasseurs etde pêcheurs quiasubi
depuisdesdécennieslesconséquencesd’une « mutation économico-cultu-
relle sansprécédent»[46].En effet,si l’exploitation intensivedesdépôts de
guano,suivie desextractionsetde l’exploitation desminesde phosphates
qui ont,en particulier,permisà Nauru deseclasserdanslesannées 70
« parmi lespays lesplus richesde laplanète»[7], l’appauvrissementdes
solsa conduitàune transformation radicale dumodealimentairedesNau-
ruansaffectantleur santé. Ensubstituantleur modetraditionnel alimentaire
àla consommation de produits importés(en particulierlesboîtesdeconser-
ves),laplupart sontdevenus diabétiqueset souffrentd’obésité, dans un
« paysage idylliquetransformé désastreusementen undésert lunairebordé
d’une splendeur tropicale »[59](trad. libre).
«Les résultats dévastateurs de l’intrusion occidentale dansle modedevie
traditionnel descommunautésautochtones s’observentduCercle Arctique
jusqu’aux junglesbrésiliennesetaux atollsidylliquesde l’OcéanPaci-
fique » [66](trad. libre).
EnPolynésie française, Vigneron [58] a souligné l’extrême raretédesdon-
néesdisponibles«dansle domaine desmaladiesdégénérativescardiaques
oudesurcharge (…) alors même que l’excèspondéral est unréel problème »
dansceTerritoired’Outre-mer.Letaux de prévalencede l’obésité,quiaccom-
pagne significativementceluidudiabètedetype 2etdesautresmaladiesnon
(3)Il est ainsi montré que lesMélanésiensquiviventdanslazone urbaine deNouméaont untaux de préva-
lencedediabètedetype 2plus élevé queceux quiviventdansles villages situésen zone rurale.
(4) Île deMicronésie,située dansle Pacifiqueà3 000 Kmdunord-est de l’Australie.

ÉTUDE ETHNOÉPIDÉMIOLOGIQUE DU DIABÈTE DE TYPE 2117
Santé publique
2008,volume 20,n° 2,pp. 113-124
transmissibles,étaitévalué en 1995 à37 %. Alors que30 %de lapopulation
setrouve en étatpré-diabétique (ouintoléranceauglucose),18 % est diabé-
tique. Cetaux de prévalence est largement sous-estimé en raison dunombre
dediabétiquespatents non dépistés[48]etdevraitêtreréactualisé, ainsi que
l’incidencedescomplications,laseule étuderéalisée sur laprévalencedudia-
bète etlesautresmaladiesnon transmissibles remontantà1995 [24].
Des scientifiquesontattribué les variationsdes taux de prévalencedu
diabètedetype 2à desdifférencesdesusceptibilité génétique etde facteurs
derisques sociaux,telsle changementderégime alimentaire,l’obésité,
l’inactivité physique etparfoisà desfacteurs reliésaudéveloppementintra-
utérin [64].
La pluralitédesfacteurs impliquésdansl’émergence etl’évolution dece
phénomène morbiderendparticulièrementcomplexes son étude et saprise
en charge tantpréventive quecurative,mais« lavérité est que laplus grande
partie descoûts directs dudiabète est liée àsescomplications.Et si le
nombredescomplicationsaugmentecomme prévu,les servicesdesanté en
subirontde lourdesconséquences»[41].
Lesconséquenceshumainesetéconomiquesdudiabètesonten effet
redoutables[23].L’étude menée parl’
Asia Pacific Cohort Studies
Collaboration
[5] a confirmé que la croissancerapidedudiabètedansla
population de larégion Asie Pacifiquevaprovoquer une augmentation impor-
tantede l’incidencedescausesde mortalité liée audiabètedanslesprochai-
nesdécennies,en raison notammentde l’augmentation des risquesde
maladiescardiovasculairesquisontaussi importants quedanslespopula-
tionscaucasiennesd’Australie etdeNouvelle-Zélande (Ibid).
Leshypothèsesexplicativesetlesfacteurs derisquedudiabètedetype 2etdes
complications
Les recherchesen santé publique ne manquentpaspour rappeler
l’influencedesdéterminants de lasanté etdubien-êtresur lespopulations–
plus précisémentlesfacteurs endogènesoubiologiques,leshabitudesdevie
etlescomportements,l’environnementphysique,l’environnement social:
lesmilieux devie (famille,école,travail),lesconditionsdevie (revenu,
scolarité,logement,emploi,événements stressants),etl’organisation du
système desoinsetdeservices–[18,32].
Lesauteurs consultésdansle cadrede larevuede littératuredeLeroux &
Ninacs[29]sous l’angle
desperspectivespour la contribution de lasanté
publiqueaudéveloppement social etaudéveloppementdescommunautés
,
confirmentque l’étatdesanté etdebien-êtred’une population est fortement
déterminé pardesfacteurs comportementaux,sociaux (individuels,interper-
sonnels,institutionnels, communautairesoupolitiques),maisaussicultu-
rels,environnementaux etéconomiques.Aussi est-il « impératif d’investir
dansl’amélioration de lavie d’une communauté,par une vision plus globale
dudéveloppementetpar une réduction desinégalités sociales»[29].
Livneh & Antonak[30]fontétatde l’abondante littératureclinique et
empirique portant sur les relationsentre l’adaptation de l’individuaudiabète
detype 2etles variables socio-démographiques(comme le sexe etl’âge,par
exemple),les variablesliéesàl’incapacité,les variablespsychosocialesetles
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%