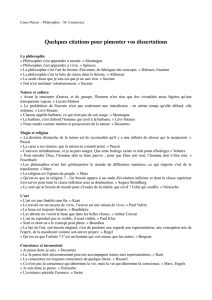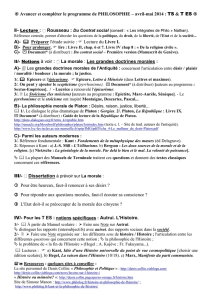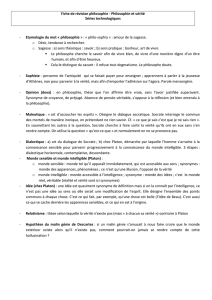TEXT URES n°2 2015

TEXTURES
n°2
2015
MAGAZINE DES ÉTUDIANTS DE PHILO
Édito (p.2)
Freud et
la religion (p.3)
Trouble
dans le genre (p.5)
Le problème du mal (p. 7)
Platon, un regard sur l’Égypte (p. 12)
Dossier Séminaire des Jeunes Chercheurs
Être Cause de Soi (p. 22)
• Au-delà des limites de la nautre humaine (p. 24)
• Nietzsche et les mirages de l’ego (p. 34)
• Être ou ne pas être cause de soi ? (p. 42)
Des affections du corps (p. 48)
Le deuxième sexe II, La femme comme
questionnement philosophique (p. 50)
La nature du Surhumain (p. 56)

2 3
«
«
ÉDITO
APPEL À
CONTRIBUTION
Textures est vôtre chose. Elle se dessèche de votre
indifférence. Il ne tient qu’à vous de l’entretenir. Si
donc, par-aphrénie ou par hasard, vous disposiez
d’un texte en stock, d’une recension d’ouvrage,
d’une synthèse de mémoire ou de quoi que ce soit
de présentable, faites-le nous parvenir à l’adresse :
fred.mathieu@live.fr.
1 Robert Rowland Smith, Petit déjeuner avec Socrate, Une philosophie
de la vie quotidienne, Paris, Seuil, 2011.
2 Dixit Deleuze des « nouveaux philosophes », virtuoses de la
pensée gazeuse (déclinaison intellectuelle de l’air-guitare).
La porcherie du monde submerge nos esprits
d’informations désordonnées ; à chaque jour sa
ration de rogatons et d’épluchures. « L’actualité »
crépite dans l’infosphère, dissolvant l’essentiel dans
l’insensé. La « prolifération » des connaissances ac-
croît le nihilisme plutôt qu’elle n’enrichit. Curieux
visage que celui d’une ère désabusée, voire dégoûtée
d’elle-même. De là, peut-être, la fonction palliative
ou régénératrice de la philosophie, propre à ferti-
liser cette bauge en friche. À l’heure où le marché
de la « pensée » tend à se répartit entre cavillations
ontiques hors-sol sur la stule ontologique de l’«
Être-en-dette » et, d’autre part, vulgate bobo-lili
nalisée au coaching personnel type Petit déjeuner
avec Socrate1, il était temps pour nous de remettre
pied à terre et le feu au landerneau. Textures n’a pas
la prétention ronante d’épater la galerie à la faveur
de « concepts vides comme des dents creuses »2,
ni la licence aqueuse du chocolat théologique ou
du café-philo. Elle se propose avant toute chose
comme une revue à l’attention de tout étudiant dé-
sireux de dévoiler un pan de sa modeste réexion ;
partant, de se soumettre à la critique (censément
bienveillante) des siens, si tant est que la guerre –
croyons-en Hippocrate – est la seule véritable école
du chirurgien. Ce deuxième numéro sera, espérons-
le, suivis de beaucoup d’autres.
Frédéric Mathieu
Président de l’association
Aujourd’hui, je vous propose de nous pencher sur ce qui
constitue l’une des questions les plus redoutables et l’un des
problèmes majeurs de la philosophie, un problème d’autant
plus central qu’il se situe à l’embranchement de la plupart
des disciplines que comprennent les sciences humaines (de
l’anthropologie à la sociologie, en passant par la psychologie),
à savoir la question de l’origine et de l’essence de la religion.
Bien entendu, une telle question ne peut être résolue ni même
résumée en l’espace de quelques minutes. Une thèse univer-
sitaire ne serait d’ailleurs elle-même pas sufsante pour tran-
cher un tel problème. C’est pourquoi je souhaiterais aborder
cette question sous un angle précis, à travers la position d’un
auteur qui, à tort ou à raison, qu’on le déplore ou qu’on s’en
félicite, a marqué en profondeur l’esprit européen et occiden-
tal, à savoir Sigmund Freud, et plus particulièrement à partir
d’un texte extrait de L’Avenir d’une illusion, ouvrage qu’il fait
paraître en 1927, et dont le titre donne, comme nous allons
le voir, une assez bonne indication sur la position freudienne
en matière de religion.
Puisque le moyen le plus sûr de saisir la pensée d’un auteur
reste encore de s’en remettre aux textes qu’il a nous a laissés,
commençons par prendre connaissance de l’extrait en ques-
tion. Je cite :
La première idée formulée dans ce texte, c’est que la
religion ne saurait en aucun cas être assimilée à une
quelconque forme de savoir, à une quelconque forme
de connaissance. En effet, on considère habituel-
lement que la connaissance humaine n’a que deux
sources, deux provenances possibles : ou bien la
connaissance est le produit de l’expérience ; ou bien
elle est le résultat de la réexion, c’est-à-dire du rai-
sonnement intellectuel, fondé sur la logique. C’est la
distinction classique, en philosophie, entre partisans
de l’empirisme, qui voient dans la connaissance l’effet de ce
que produisent les objets sur nos sens (la vue, l’ouïe, le tou-
cher, etc.), et partisans du rationalisme, qui considèrent, au
contraire, que c’est seulement par la déduction logique et le
recours à l’activité rationnelle qu’on peut accéder à un certain
nombre de vérités. Or, pour Freud, la religion n’entre dans
aucun de ces deux cas de gure : elle n’est pas « le résidu de
l’expérience », au sens où elle ne découle pas d’une rencontre
avec Dieu, pour le dire vite, elle ne procède pas d’un rapport
immédiat avec l’objet divin par l’intermédiaire de nos sens.
Elle n’est pas non plus le « résultat nal de la réexion », car
quand bien même on chercherait à asseoir la religion sur des
bases rationnelles et logiques, sur un raisonnement déductif,
il ne peut s’agir que d’un raisonnement interrompu en cours
de route, un raisonnement non nalisé, inabouti. La religion,
si on préfère, ne peut faire l’objet d’une « démonstration ». De
sorte que, pour Freud, la religion ne relève en aucun cas du
champ du savoir, elle ne relève pas de la sphère de la connais-
sance, mais de la seule sphère de la croyance. Croyance et
connaissance représentant un tandem conceptuel bien connu
en philosophie, les deux notions étant généralement consi-
dérées comme adverses et supposées s’exclure l’un au pro-
t de l’autre : on se situe soit du côté de la croyance, soit
du côté de la connaissance, soit dans le camp de la foi, soit
dans le camp du savoir. Il est
révélateur, d’ailleurs, que l’éty-
mologie du mot « savoir » soit
le mot latin « scio », qui a don-
né « science » en français. Or,
« science » et « croyance » sont
ordinairement conçus, préci-
sément, comme des notions
qui s’opposent. La science, au
sens occidental et moderne
du terme, c’est un ensemble
de connaissances fondées sur
une méthode qui exclut, par
dénition, le recours à la seule
croyance, qui bannit le carac-
tère approximatif et douteux,
sinon infondé, de la foi, au pro-
t de la seule rationalité et de
l’observation des faits (c’est, en
quelque sorte, la synthèse de la
méthode empiriste et de l’esprit
Les idées religieuses, qui professent d’être des dogmes, ne sont pas le
résidu de l’expérience ou le résultat nal de la réexion : elles sont des
illusions, la réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus
pressants de l’humanité ; le secret de leur force est la force de ces désirs.
Nous le savons déjà : l’impression terriante de la détresse infantile avait
éveillé le besoin d’être protégé - protégé en étant aimé - besoin auquel le
père a satisfait ; la reconnaissance du fait que cette détresse dure toute
la vie a fait que l’homme s’est cramponné à un père, à un père cette fois
plus puissant. L’angoisse humaine en face des dangers de la vie s’apaise à
la pensée du règne bienveillant de la Providence divine, l’institution d’un
ordre moral de l’univers assure la réalisation des exigences de la justice,
si souvent demeurées irréalisées dans les civilisations humaines, et la
prolongation de l’existence terrestre par une vie future fournit les cadres
de temps et de lieu où ces désirs se réaliseront. Des réponses aux ques-
tions que se pose la curiosité humaine touchant ces énigmes : la genèse de
l’univers, le rapport entre le corporel et le spirituel, s’élaborent suivant les
prémisses du système religieux. Et c’est un formidable allègement pour
l’âme individuelle que de voir les conits de l’enfance émanés du complexe
paternel - conits jamais entièrement résolus -, lui être pour ainsi dire
enlevés et recevoir une solution acceptée de tous.
Freud et
la religion

rationaliste que j’évoquais précédemment). Bref, quoiqu’il en
soit, c’est d’abord comme système de croyance, et non de
connaissance, que Freud dénit la religion. Ce qui se justie
d’ailleurs dans une large mesure, puisque c’est bien sur une
croyance primordiale que se construit la pratique religieuse
(puisque la religion, c’est l’association d’une croyance et d’une
pratique), à savoir... la croyance en Dieu.
Alors, la question qui se pose est la suivante : quel est le statut
de Dieu et de la religion dans le freudisme ?
Autrement dit, que représentent les idées religieuses et à quoi
renvoient-elles ? La réponse de Freud ne va pas se faire at-
tendre : Dieu est une illusion ; il est une invention de l’esprit
humain, une création imaginaire et symbolique des hommes.
Il faut bien garder à l’esprit, et, encore une fois, quelle que soit
l’opinion qu’on puisse avoir du freudisme et de la psychana-
lyse en général, que Freud se place en tant que clinicien du
psychisme humain, en tant que « médecin des âmes », comme
on disait jusqu’au XVIIIe siècle. Sa position n’est donc pas
celle d’un moraliste (il faudrait plutôt dire, d’ailleurs, d’un
« démoraliste ») ; elle n’est pas celle d’un professeur d’athéisme
(du moins pas explicitement) ; elle est celle d’un scientique
de l’esprit humain, pour lequel, par dénition, toute produc-
tion spirituelle (et a fortiori religieuse) doit d’abord s’analyser
comme symptôme clinique et comme résultat d’une activi-
té psychique, y compris inconsciente. Freud peut bien être
l’inventeur du concept d’ « inconscient » ; il n’en demeure
pas moins un théoricien matérialiste, un individu qui cherche
dans la matière (en l’occurrence : dans la matière psychique)
l’origine et la signication des production mentales. Et ranger
Freud du côté des scientiques ne revient pas à accréditer ses
théories, mais seulement à caractériser sa méthode et à dénir
son point de vue : un point de vue profane, un point de vue
athée, un point de vue matérialiste (les philosophes diraient
« immanentiste ») : tous ces mots décrivent exactement la
même chose, à savoir que la préoccupation de Freud n’est pas
ici de disqualier la pensée religieuse ou de la tourner en ridi-
cule, mais d’en découvrir les racines humaines et psychiques
(je ferme ici la parenthèse).
Alors, que faut-il entendre exactement dans ce terme d’ « illu-
sion » que Freud emploie ici pour qualier la croyance reli-
gieuse ? Est-ce que cela veut dire que le fait de croire
en Dieu serait le symptôme clinique d’une patho-
logie mentale, d’un délire, voire d’une hallu-
cination ? Cela semble difcile à croire. Et
pour la simple raison qu’on voit mal com-
ment des milliards d’individus, à la surface
de cette planète, et en y ajoutant les généra-
tions qui nous ont précédées, on voit mal,
donc, comment autant de personnes, de
communautés et de nations pourraient
toutes avoir été atteintes par cet étrange
syndrome délirant, à moins de n’être obli-
gé de redénir la frontière entre ce que
Georges Canguilhem appelait le « nor-
mal et le pathologique », puisqu’alors
c’est le pathologique, c’est-à-dire les
victimes de ce délire, de cette hallu-
cination, qui représenterait la norme
(la norme correspondant à la situa-
tion majoritaire observable). En fait, ce
n’est pas exactement ainsi qu’il faut voir
les choses. Lorsque Freud parle de Dieu
et de la religion comme d’une « illusion », il
parle d’une illusion structurante, constitu-
tive, en clair, d’une illusion propre à l’être humain, propre à
son être et à sa nature. Dieu serait l’enfant des hommes au lieu
que les hommes soient les enfants de Dieu ; il serait l’enfant de
leur esprit, au sens où c’est le psychisme humain qui enfante
l’idée de Dieu, qui la produit. Les hommes ont créé Dieu, nous
dit Freud, et non l’inverse. Ils ont créé un être suprême, un
être omnipotent (c’est-à-dire tout-puissant), un être juste et
providentiel, créateur de l’Univers, garant du salut des âmes
et réponse à l’énigme de l’origine du monde. Et si les hommes
ont crée Dieu, c’est, toujours selon Freud, en raison de leur
incapacité à assumer seuls les vicissitudes de la vie et l’angoisse
de la mort. Dieu, c’est la réponse des hommes aux vicissitudes
de la vie et à l’angoisse de la mort : c’est Dieu qui nous rassure
de sa présence dans les épreuves et les drames qui marquent et
ponctuent notre vie terrestre ; c’est Dieu qui nous console de
la mort (la nôtre et celle de nos proches) par la promesse du
salut éternel et d’une vie après la mort, d’une existence par-delà
la mort physique, d’une existence, donc, littéralement, méta-
physique ; c’est Dieu qui fournit la réponse au mystère de la
création de l’Univers et de l’apparition des hommes sur Terre,
et qui nous assure une justice céleste quand la vie terrestre n’est
rien d’autre qu’iniquité et corruption. En somme, Dieu, c’est le
Père idéal des peuples et des nations. « Idéal » au sens philoso-
phique du terme (ce qui est idéal étant ce qui relève de l’idée,
donc de l’esprit, par opposition à la matière) ; « Père », dans
la mesure où sa fonction et sa responsabilité sont analogues à
celle d’un père : l’amour et la protection, l’affection et la toute-
puissance, la présence en arrière-plan d’une justice implacable.
C’est ainsi qu’il faut comprendre l’origine et l’essence des idées
religieuses selon la théorie freudienne : « la réalisation des dé-
sirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l’huma-
nité » : désirs d’être protégés, désirs d’être rassurés, désir d’être
accompagnés dans ce tunnel noir de la terreur qui conduit à la
mort par un être qu’on n’hésite pas, précisément, à symboliser
par la lumière, une lumière englobante, embrassante (dans les
deux sens de ce mot). L’enfant avait besoin du Père (ou, du
moins, de sa gure, et il est intéressant de noter que la « face
de Dieu », autrement dit de sa gure, est justement l’un des
thèmes les plus visités dans l’art de la Renaissance) ; l’enfant,
disais-je, avait besoin du Père, puisque l’enfant est celui qui se
trouve dans l’incapacité constitutive de se maintenir dans l’exis-
tence par ses propres moyens (aussi bien sur le plan physique
et matériel que sur le plan psychologique et affectif) ; l’adulte,
c’est cet enfant ayant atteint l’âge de l’autonomie physique et
matérielle, de l’indépendance psychologique et affective, mais
toujours amputé de la main et de l’épaule métaphysiques qu’il
recherche plus que tout pour l’accompagner et le consoler dans
l’épreuve de la mort physique et pour lui faire caresser l’espoir
d’une existence post-terrestre. « L’impression terriante de la
détresse infantile, écrit Freud, avait éveillé le besoin d’être pro-
tégé - protégé en étant aimé - besoin auquel le père a satisfait
; la reconnaissance du fait que cette détresse dure toute la vie
a fait que l’homme s’est cramponné à un père, à un père cette
fois plus puissant. » Ce père, ce sera Dieu, cet être grâce auquel
l’angoisse s’apaise.
Charles Robin
Littérature Générale
Fiche de lecture
Trouble dans
le Genre
Chapitre 1 : Sujets de sexe/genre/désir
Trouble dans le Genre : Le féminisme et la subversion de
l’identité est un ouvrage philosophique de Judith Butler
publié aux Etats-Unis en 1990. C’est l’une des œuvres
majeures qui, de par son engagement certain, a fortement
inuencé les « théories queer » et le féminisme. L’auteure
nous invite ici à repenser le « genre », tout en localisant,
comme le titre l’indique, le « trouble » qui le perturbe.
Tout d’abord, la première partie « Sujets de sexe/genre/
désir » se livre à une « généalogie » au sens nietzschéen
de la notion de genre, pour en conclure que « le pouvoir
juridique «produit» incontestablement ce qu’il prétend
simplement représenter » (p. 61). Il n’y aurait donc pas
de « sujet » avant la loi en matière de genre. Par ailleurs,
nous confondons l’effet et la cause : c’est effectivement
la loi qui a inventé et encadré le genre, ce en quoi nous
pouvons parler de valeur performative du langage…
Cependant, Butler entend également briser les principes
centraux des théories féministes se chevauchant au cours
du XXe siècle, à savoir en particulier : l’hypothèse de
l’existence d’une identité ayant besoin d’être représentée
dans la sphère politique et linguistique. Elle admet que
mettre un nom sur la chose était nécessaire, car le langage
traduit le réel, à une époque où « le vécu des femmes était
mal, voire pas du tout représenté dans la culture domi-
nante » (p.60). Mais un problème de taille persiste, l’uni-
versalité de la « femme », autrement dit que le terme «
femme » est supposé dénoter une seule et même identité.
Au nal, « la tâche qui nous attend consiste à formuler
[…] une critique des catégories de l’identité que les struc-
tures juridiques contemporaines produisent, naturalisent
et stabilisent » (p.65).
De plus, Judith Butler met un point d’honneur à nous
rappeler que le genre n’est absolument pas réductible au
sexe biologique de la personne en question. Fondement
des études de genre, cette séparation entre « sexe bio-
logique » et « sexe social », aussi appelé « genre », est au
cœur de l’entreprise butlérienne de constitution de l’iden-
tité. En effet, le genre n’est ni plus ni moins que la repré-
sentation sociale du sujet, il est culturellement construit,
et admet donc que le corps « femme », biologiquement
parlant, ne se traduit pas forcement en « femme ». D’une
manière générale, nous admettons sans hésiter l’existence
de deux sexes ainsi que de deux genres : « masculin/fémi-
nin » et « mâle/femelle »… certainement le fruit d’une
tradition judéo-chrétienne qui perdure dans la société
5
4

6 7
occidentale ! Encore une fois, l’auteure nous inter-
pelle sur cette bipolarisation du sujet car « supposer
que le genre est un système binaire revient toujours
à admettre le rapport mimétique entre le genre et le
sexe où le genre est le parfait reet du sexe ». Rien
ne nous indique qu’il devrait y avoir seulement
deux genres si ce n’est les cases dans lesquelles la
société post-chrétienne dont nous avons héritée.
Mais dans ce cas, nous sommes en droit de nous
demander comment se fait cette construction et
quel en est le mécanisme. Quand Simone de Beau-
voir, dans Le Deuxième Sexe, déclare que l’ « on
ne nait pas femme : on le devient », elle pose deux
choses. Premièrement, elle admet a priori un « cogi-
to » qui prendrait ce genre là, ou pourrait endosser
un tout autre genre, donc elle admet clairement la
totale variabilité du genre. Deuxièmement, cette
afrmation existentialiste nous ramène à la grande
controverse entre déterministes et partisans du «
libre-arbitre », dans la mesure où ce sont mes choix
qui me construisent, car « le « corps » est lui-même
une construction » (p. 71) nous dit Butler. Dans
la pensée existentialiste sartrienne, « l’existence
précède l’essence » (L’existentialisme est un huma-
nisme), c’est-à-dire que je suis en constant devenir.
En outre, nous voyons bien que la contrainte d’une
bonne formulation du genre et d’une formulation
plus exacte de la « femme », sont inscrites dans le
langage, car ce dernier nous habitue à considérer
l’homme comme « la personne universelle » et la
femme comme « le seul genre à être marqué » selon
les théoriciennes féministes que sont Beauvoir et
Irigaray. Autrement dit, le monde nous projette
certaines représentations qui sont immanentes à
l’Homme, dont la plus nocive considère l’homme
comme « A » et la femme comme « non-A » au lieu
de « B » ! Butler dénonce vigoureusement cette
conception-là, réduisant les femmes à leur sexe, et
gloriant les hommes pour incarner une « pseudo
» « personne universelle »… Pour Beauvoir, les
femmes constituent un manque contre lequel les
hommes établissent leur identité. Tandis que pour
Irigaray, cette dialectique relève d’une « économie
signiante », qui exclut entièrement la représen-
tation des femmes, car elle emploie le langage «
phallogocentrique ». Le mot « phallogocentrisme »,
souvent utilisé dans le livre, « est le nom donné au
projet de faire disparaître le féminin et de prendre
sa place » (p. 78).
Toutefois, comme le note Butler, Beauvoir et
Irigaray assument l’existence d’une identité fémi-
nine en soi - « a female self-identical being » - qui
aurait besoin d’être représentée ; leurs arguments
cacheraient l’impossibilité «d’être» tout simplement
un genre. Cependant, dans son introduction à l’idée
centrale de Trouble dans le Genre, Butler soutient
que le genre est performatif : il n’y a pas d’identité
derrière les actes censés « exprimer » le genre et
ces actes constituent, plutôt qu’ils n’expriment,
l’illusion d’une identité genrée stable ! D’autre part,
nous trouvons à la page 81 un éclairant éloge de
la nécessité des divergences dans le processus de
coalition politique, pour éviter de reproduire un
processus d’appropriation du pouvoir. Mais ceci est
à considérer comme une critique du féminisme de
dénonciation : « l’ «unité» de la catégorie «femme»
n’est ni postulée ni désirée » (p. 82) pour Butler.
Pour nir, si l’« être» apparent d’un genre n’est
qu’un effet d’actes culturellement signiants, alors
le genre n’est pas une donnée universelle. Consti-
tué par la réalisation de performances, le genre «
femme », le genre « homme » aussi, reste contin-
gent et sujet à interprétation et « re-signication ».
Ainsi, Butler introduit subversivement un trouble
dans le genre, en ayant recours à des performances
susceptibles de troubler ces mêmes catégories
de genre. L’idée de subversion naît quand Butler
remarque que « le gay ou la lesbienne est donc à
l’hétérosexuel - le non pas ce que la copie est à
l’original, mais plutôt ce que la copie est à la copie
» (p. 107).
Paul-Antoine Sigelon
?
La philosophie, ce n’est pas seulement « où vais-je,
qui suis-je, que fais-je et où vais-je dîner ce soir »
(Woody Allen). Le problème du mal fait partie de la
petite liste des questions que se pose l’humanité de-
puis l’âge de cavernes. Il y a eu de très nombreuses
façons de poser ce problème moral. Certaines ma-
nières sont plutôt religieuses (« Dieu est-il bon ? Si
oui, pourquoi tolère-t-il le mal ? »). D’autres sortes
de questions ne sont pas liées à la religion : elles
sont athées, laïques – le terme correct dans le voca-
bulaire philosophique pour désigner ce qui n’est pas
religieux est « profane ». Notre réexion sur l’utili-
tarisme a donc lieu dans un cadre profane. Ce cadre
n’a pu se mettre en place à la n du XVIIIe siècle
que sur le socle d’une pensée religieuse remontant
à des millénaires, bien que l’utilitarisme et, après lui,
le pragmatisme aient apportés les éléments nou-
veaux qui nous ont précipité dans la morale indivi-
dualiste du XXe siècle et dans le post-modernisme
de ce début du XXIe siècle.
La n du monde aura-t-elle
lieu bientôt ?
C’est la croyance fondamentale ! Si vous pensez
que le soleil s’éteindra dans 4,5 milliards d’années
et que d’ici là rien ne changera sous le soleil, alors
vous opterez pour l’attitude 1. Nous appellerons
cette première attitude résignation ou agnosticisme.
Pourquoi « agnostique » ? Parce que sous l’atti-
tude 1, nous rangerons également ceux qui ne se
prononcent pas et ceux pour qui la n du monde
n’est pas une question importante. Généralement,
les personnes dans l’attitude 1, pensent que cette
question n’a pas d’implication pratique et donc ne
mérite pas qu’on s’y attache. Cette attitude est stric-
tement pragmatique. Nous dénirons l’attitude 1
comme une « croyance faible » car elle ne modie
pas la vie de tous les jours des gens et n’occupe pas
non plus leurs pensées bien souvent.
À l’inverse, l’attitude 2 implique que l’on pense
qu’avant 4,5 milliards d’années un événement
va modier le destin de l’humanité. Si cet événe-
ment est négatif, cette croyance génère la crainte.
Crainte que l’humanité ne mette elle-même un
point nal à son existence par l’empoisonnement
de la planète ou la bombe atomique, ce qui donne-
rait un nal rapide ou une longue agonie. Crainte
que quelque chose ne vienne d’ailleurs mettre n
à nos existences humaines et dans ce cas le choix
est vaste : astéroïde, résurrection des morts-vivants,
fantômes, extra-terrestres, religions millénaristes…
À la crainte répond l’espoir, autre forme de l’atti-
tude 2. Cet espoir est généralement religieux et
fait souvent part de la survenue d’un sauveur. Cet
espoir peut également être profane ; l’Homme arri-
verait à sufsamment évoluer pour atteindre une
perfection qui déclencherait sur terre l’âge d’or. La
caractéristique commune entre crainte et espoir,
c’est que nous arriverions dans un état des choses
ou il n’y aurait plus d’évolution. Une fois l’Homme
éliminé, réduit en esclavage, ou bien vivant comme
une bête en attendant son extinction à cause des
produits chimiques ou encore vivant et plongé dans
la béatitude avec tous ses semblables dans la plus
parfaite communion où chacun vit dans le bon-
heur suprême , il n’y a plus d’Histoire. L’attitude 2
entraine une croyance d’autant plus forte que ses
adeptes croient la n de l’Histoire plus proche dans
l’avenir. C’est de manière générale une croyance
forte car elle modie fréquemment les actions des
gens ou occupe souvent leur pensée.
Revenons au Mal
Selon qu’ils se placent dans le cosmos de l’attitude
1 ou 2, les hommes ont tendance à voir le problème
du mal différemment.
Dans l’attitude 1 on trouve la pensée de la Grèce
antique d’un temps cyclique et de nombreuses doc-
LE PROBLEME
DU MAL
6

9
ment prévisible, où un revers de fortune l’affectera.
Le raisonnement nous amène au bord du patholo-
gique. Il ne faut pas manger, soyons anorexiques ! Il
faut souffrir, soyons masochistes, etc.
Et tout cela pour quoi ? Pour être prêts le jour
où… mon Prince viendra, la guerre généralisée
éclatera sur Terre, la famine tombera sur nous…
alors privons-nous !
Et si le Prince ne venait jamais ? à quoi cela aurait-il
servi d’être squelettique ? Et si la guerre n’éclatait
pas ? à quoi sert-il d’avoir fait fabriquer dans le jar-
din un abri antiatomique ? Et si le paradis des tra-
vailleurs enn libres des capitalistes de la mondiali-
sation ne se réalisait pas ? à quoi cela aurait-il servi
d’avoir autant manifesté ? Cette attitude 2 faite de
crainte ou d’espoir nous incite toujours à remettre
notre bonheur ou notre plaisir à plus tard. Mais
plus tard n’est-ce pas trop tard ? Au niveau indivi-
duel, nous serons morts avant d’avoir pu proter
de tous ces investissements en bonheur qui nous
ont coûté tant de douleurs ! Au niveau de l’espèce
humaine, et surtout si la n des temps est proche,
nous risquons de faire des générations de malheu-
reux qui ne vivront jamais assez vieux pour arriver
à l’âge de la retraite, l’Homme sera peut-être éteint
avant que le Capitalisme ne disparaisse… à force de
préparer le bonheur total de l’humanité.
Après Leucippe et les épicuriens, après les hédo-
nistes arrive vers 1848 John Stuart Mill (1806-1873).
Il reprend les principes de Jeremy Bentham : le
bien, c’est le plaisir. Le mal, c’est la douleur. Notre
but dans la vie, c’est donc d’avoir un maximum de
plaisir et un minimum de douleur. Comment savoir
si les gens ressentent du plaisir ou de la douleur ?
C’est bien simple : il n’y a qu’à leur demander ! C’est
pour cela qu’on appelle souvent ces deux auteurs,
les utilitaristes de la préférence révélée. Il suft de
demander aux gens de nous révéler leurs préfé-
rences et nous saurons ce qui leur fait plaisir et ce
qui les fait souffrir.
Demander leur avis aux gens, aujourd’hui cela pa-
raît simple, avec les sondages d’opinion. En 1848,
c’était terriblement révolutionnaire. D’autant que
Jeremy Bentham était favorable à demander leur
avis aux esclaves, aux animaux qu’on maltraite ou
qu’on consomme et même…aux femmes aux-
quelles il voulait donner le droit de vote2. Imaginez
encore aujourd’hui d’aller faire un sondage d’opi-
nions en Chine ou en Corée du Nord ? Combien de
temps resteriez-vous en vie à recueillir les signatures
dans la rue ? Face aux difcultés, les utilitaristes
admettent que lorsque les gens ne peuvent eux-
mêmes exprimer leurs préférences, l’on peut recou-
rir aux avis des experts. Est-il plus agréable de boire
du Champagne ou d’assister à un strip-tease, l’on
peut demander à un pilier de bar son avis sur ce qui
apporte le plus de plaisir. Mais de même qu’au plai-
sir physique répond la souffrance morale, les utilita-
ristes se démarquent des hédonistes en notant que
de nombreux plaisirs intellectuels sont plus recher-
chés que les plaisirs physiques. Un concert de U-2
ou un joint ? Il faut demander aux spécialistes…
John Stuart Mill se défend de rechercher l’anéan-
tissement de la morale, sa conance en l’Homme
en tant qu’animal rationnel, l’incite à croire que
nous allons tous nous diriger vers des plaisirs de
plus en plus intellectuels à l’avenir. Depuis 1848,
nous dirons que cette évolution n’a rien d’évident.
Du minitel rose aux sites pornos d’internet, chaque
nouvelle invention semble dévoyée vers des appli-
cations obscènes. Notre société fait incompara-
blement plus de publicité aux nouvelles voitures
qu’aux concerts classiques. Même la télé s’y met,
les émissions qui marchent en l’instant parlent de
cuisine pas de philosophie.
L’œuvre de John Stuart Mill,
L’utilitarisme
, paru en
18633, est un classique de la réexion morale plus
qu’une œuvre politique. L’auteur meurt en 1873, dix
ans plus tard après 67 années d’une vie fort rem-
plie en publications et actions politiques au service
du Libéralisme social. Ce terme semble à présent
contradictoire. Il a pourtant inspiré aussi bien Karl
Marx qu’Henry Ford. Demander l’avis des gens sert
autant à fomenter des révolutions qu’à vendre des
voitures. En fait ce qu’a inventé Mill, c’est la notion
de « Masse ». On trouve cette notion dans les mass-
média, les masses ouvrières ou la production de
masse d’automobiles. Avec Mill, le plaisir ou la dou-
leur ont cessé d’être des affaires privées pour deve-
nir des normes de notre société. Nous avons tous
désormais droit au bonheur, droit d’être soignés.
Mill n’a jamais dit que cela ne s’accompagnait pas
des devoirs correspondants même si nous l’avons
un peu oublié. L’homo economicus d’aujourd’hui se
comporte parfois comme un cochon mais ce n’est
pas la faute de Mill : « Si le rapprochement que l’on
fait entre la vie épicurienne et celle des bêtes donne
le sentiment d’une dégradation, c’est précisément
parce que les plaisirs d’une bête ne répondent
8
trines orientales. À notre conception occidentale
moderne du progrès se substitue dans les religions
de l’Inde « la conception qui restera constante dans
toute l’histoire de la pensée indienne d’un temps
cyclique sans commencement ni n »1. C’est la pé-
riodicité normale de la vie de la nature marquée par
le retour de la saison des pluies, le retour des astres
(soleil, lune) aux mêmes positions qui lie l’invoca-
tion des dieux au calendrier pour conserver le Bon
Ordre et prévenir les perturbations (une forme du
Mal que l’on peut nommer changement, évolution,
progrès). Ces croyances ont commencé à partir de
1500 ans av. J.-C. avant de se propager à l’Iran (Ma-
zdéisme puis Manichéisme) et d’autres pays voisins.
En Chine, c’est l’harmonie qu’il faut préserver, Yin
et Yang se modient, se déplacent mais il est bien
difcile de nommer bien l’un et mal l’autre. L’im-
mobilisme relatif de l’Empire du Milieu pendant
trois millénaires explique que la n des temps n’a
jamais été la préoccupation des Chinois.
On retrouve cette imbrication du bien et du mal
chez de nombreux philosophes occidentaux. Ci-
tons Leibniz, très inuencé comme presque tous
les philosophes du XVIIIe par la Chine, considérée
à l’époque depuis l’Europe comme un paradis ter-
restre où les hommes vivaient libres sous la hou-
lette d’un empereur éclairé. L’image était idyllique
! Il n’en reste pas moins que Leibniz nous présente
le bien comme la face d’une pièce de monnaie dont
le côté pile serait le mal. Bien et mal sont indisso-
ciables puisque la pièce ne saurait avoir de revers si
elle n’a pas d’avers. Sans le mal, pas de bien ! Toute
chose à son revers, même les meilleures… Chaque
plaisir a son prix… Les dictons sont nombreux.
Dans cette première attitude, la résignation peut
nous conduire à une attitude pragmatique : s’il faut
encore passer le temps (4,5 milliards d’années) au-
tant que ce soit agréablement ! Serait-il alors pos-
sible de minimiser le mal et de maximiser le bien
? Leibniz, toujours lui, dénit le mal sous deux
formes : « Il y a le mal moral, nommé souffrance.
Et il y a le mal physique, nommé douleur⁄». À cette
dénition Jeremy Bentham ajoutera « il y a le bien,
nommé plaisir ».
Dans l’attitude 2, la n des temps est relativement
proche. Il faut donc viser un résultat rapide. Agir
en fonction d’une n se nomme une attitude téléo-
nomique. Nous pouvons viser en tant qu’espèce à
nous racheter du péché originel, nous pouvons vi-
ser à faire cesser les guerres partout dans le monde
(irénisme pacique, une des aspects de Leibniz) ou
bien à assurer à chacun un minimum vital. Nous
pouvons nous perfectionner à titre individuel : être
un Homme, un héros, un génie, un saint… Nous
adoptons un but à atteindre avant la date fatidique.
Ce but donne un sens (une signication) à notre vie
en même temps qu’il donne un sens (une direction)
à l’Histoire.
Au nom de cet objectif, le bonheur individuel n’est
plus à l’ordre du jour. Le plaisir doit s’effacer de-
vant le devoir. La perfection doit être atteinte avant
la n de l’Histoire. La vitesse devient une qualité.
La terre devient cette vallée de larmes où nous ne
sommes venus au monde que pour nous rache-
ter du péché originel. Il faut souffrir pour être un
Homme, à moins qu’il ne faille souffrir pour être
belle. Tous les sacrices sont justiés, à commen-
cer par celui du plaisir. Les stoïciens se situent dans
cette téléonomie, non pour des raisons religieuses
mais pour des raisons philosophiques. Il faut faire
un homme complet. Cet homme pour être heureux
doit s’endurcir an de ne pas souffrir le jour, forcé-
L’utilitarisme
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%