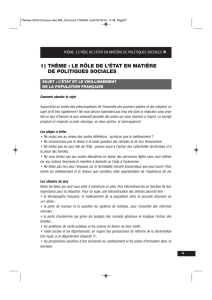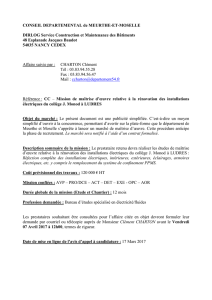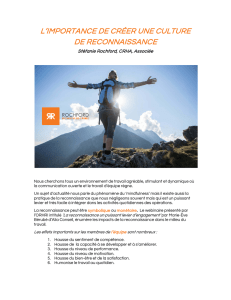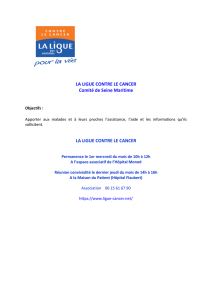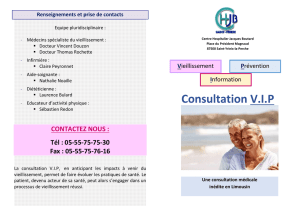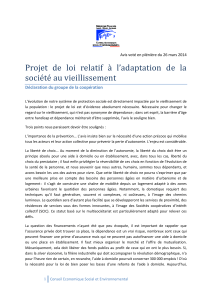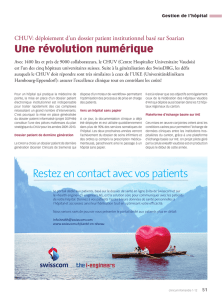Point fort 3

Point fort 3
24 heures | Lundi 20 avril 2015
Contrôle qualité
VL1
gnants. Ces plaintes épinglent un système
qui ne garantit pas la continuité des soins.
Quand une personne âgée est hospitali-
sée, on traite sa pneumonie ou on réduit
sa fracture. Mais les symptômes liés au
grand âge, comme l’état confusionnel ac-
centué par le choc de l’hospitalisation,
sont ignorés. Vite, les soignants courent
derrière une cascade d’effets négatifs non
anticipés. Le ballottage du patient dans le
système de soins et sa mauvaise informa-
tion par des acteurs ne parlant pas le
même langage occasionnent des souf-
frances inutiles et des coûts indus.
37% des plus de 90 ans vivent à
domicile sans recevoir de soins.
Peut-on faire encore mieux?
Ce résultat est déjà assez incroyable. On
peut sans doute l’améliorer si on se con-
centre sur la prévention du déclin. Les
soins à domicile permettent de pallier les
déficits fonctionnels de la personne (lui
fournir des repas, de l’aide pour sa toilette
par exemple). Le nouvel effort est de met-
tre en œuvre des prestations de préven-
tion du déclin fonctionnel (comment je
soutiens une personne pour qu’elle reste
indépendante). Cela peut se traduire par
le maintien d’une activité physique ac-
compagnée, par exemple, ou encore par
la revue d’un plan de médication.
La technologie, que le public associe
à la médecine véritablement
efficace, peut-elle apporter de
nouvelles réponses aux effets du
vieillissement sur la santé?
Allons-nous vivre des révolutions médica-
les telles qu’elles infléchiront les pronos-
tics thérapeutiques liés au grand âge?
Franchement, je suis dubitative. La géno-
mique, champ d’innovation sans doute le
plus prometteur, doit être explorée, mais
pour des résultats qui ne sont pas atten-
dus avant 50 ou 60 ans. Or la vague de
vieillissement est à notre porte. La pres-
sion sur le système de santé va brutale-
ment s’accroître. On a peu de temps pour
prendre les mesures qui éviteront l’as-
phyxie du système de soins dans 20 ans.
La médecine communautaire et la
prévention ne restent-elles pas les
parents pauvres de la médecine en
Suisse?
Le Service de la santé publique a la mis-
sion de garantir la couverture des besoins
de santé de la population. La prévention
est un élément central pour pouvoir limi-
ter autant que possible l’impact épidémio-
logique du vieillissement démographi-
que. Le service est également garant d’un
accès de la population aux soins de santé.
En ce sens, il est aussi le garant d’une
adaptation du système de santé aux be-
soins des personnes âgées les plus vulné-
rables. Cet enjeu est traité par les pouvoirs
politiques avec autant de sérieux que les
demandes du CHUV d’acquérir des équi-
pements de pointe. Ces deux exigences
sont complémentaires, j’y tiens. L’erreur
serait de jouer l’une contre l’autre.
Comment allez-vous piloter
le changement?
Nos lignes directrices, très attendues, se-
ront publiées en toute clarté. Nous tra-
vaillons aussi à un système performant de
monitoring du besoin de soins de la popu-
lation. Sur ce plan, la Suisse a du retard.
Nous manquons par exemple d’informa-
tions centralisées pertinentes sur les be-
soins réels de soins des différents groupes
de population. Il est urgent de réunir les
données qui documenteront les futurs
besoins de soins et permettront d’ajuster
l’allocation des ressources au plus près de
ces besoins.
sur le volontarisme des acteurs. Ce n’est
pas suffisant pour l’avenir. L’Etat doit être
une force de proposition afin d’aider les
partenaires à réaliser complètement cette
coordination des soins. Nous disposons
de moyens financiers adaptés, mais le
cloisonnement du système de soins ne
permet pas d’en profiter au maximum.
Les usagers ne sont-ils pas
globalement satisfaits?
Oui, le public est content d’accéder à des
soins de qualité sans liste d’attente. Sur ce
point, la Suisse est très bien notée en
comparaison internationale. Mais les do-
léances qui se multiplient traitent surtout
du ballottage des patients dans la chaîne
de soins. Elles émanent de personnes
âgées dont les témoignages sont poi-
lopper des activités de coordination des
soins en collaboration avec ses partenai-
res pour pouvoir garantir une continuité
de prise en charge ainsi qu’un flux d’in-
formation efficient. On sait qu’étendre la
responsabilité des soignants au-delà du
séjour hospitalier (un simple téléphone
au patient 24 à 48 heures après la sortie
d’un patient qui n’aurait pas besoin de
soins à domicile) permet de diminuer le
risque de réadmission. Des nouveaux mo-
des de financement devront être dévelop-
pés pour faciliter la mise en place de ces
nouvelles pratiques.
Les soins coordonnés, on en parle
depuis vingt ans, mais rien ne s’est
passé. Pourquoi cet immobilisme?
Des efforts ont été faits, mais surtout basés
François Modoux
Stéfanie Monod travaillait au
CHUV en tant que médecin
gériatre avant de devenir
cheffe du Service vaudois de
la santé publique (SSP) il y a
une année. Sa connaissance du terrain et
ses idées originales sur l’organisation des
soins ont été deux motifs de son engage-
ment. Elle entend conduire le système de
soins vers des réformes importantes pour
faire face à l’augmentation du nombre de
personnes âgées dans un proche avenir.
Car c’est un «tsunami gris» qui s’annonce.
Le SSP organise d’ailleurs ce lundi à Lau-
sanne un symposium consacré à ce
thème et à l’«enjeu crucial» de la conti-
nuité des soins. Stéfanie Monod explique
les défis des futures réformes, qui s’an-
noncent de longue haleine.
Vous avez dit: «Si le système
de santé ne se remet pas en
question, il court à la catastrophe
d’ici vingt à trente ans.» Sur quoi
est fondée cette conviction?
C’est juste les chiffres! Le vieillissement
de nos populations est un magnifique hé-
ritage de l’évolution de notre société, ré-
sultat de son progrès social et économi-
que. Les plus de 80 ans d’aujourd’hui
sont nés avant le baby-boom. Ces vingt
prochaines années, leur nombre décu-
plera pour augmenter de 120% d’ici à
2040. Or plus on est âgé, plus on est
exposé aux maladies chroniques qui en-
traînent un risque de dépendance fonc-
tionnelle. On s’attend, dans une quin-
zaine d’années, au doublement du nom-
bre de personnes ayant besoin d’autrui
pour faire face aux activités quotidiennes.
Les prestataires de soins ont-ils
conscience de cette déferlante?
Pas assez. Une grande partie de mon tra-
vail est d’informer sur cette réalité. Tou-
tes les gouvernances des institutions de
soins doivent se responsabiliser. Il y aura
prochainement des directives de l’Etat,
mais je sais que le changement de culture
ne sera pas imposé d’en haut, top-down.
Il ne sera possible qu’avec la prise de
conscience de tous les acteurs de la santé,
sur le terrain. Je souhaite un partenariat
fort avec les prestataires de soins. Chaque
institution sera responsable de trouver la
meilleure manière de faire à son échelle.
Quelle est la faiblesse de notre
système de santé?
Son cloisonnement. Et le fait que le sys-
tème de santé est organisé pour traiter
ponctuellement des épisodes de maladies
aiguës sans véritablement être capable
d’intégrer la trajectoire du patient.
Quels leviers avez-vous identifiés
pour initier le changement?
Les mécanismes de financement sont cru-
ciaux. Un projet de décret sur la coordina-
tion des soins est en gestation. Il s’agit de
créer des incitatifs favorables à la conti-
nuité des soins. Demain, chaque institu-
tion aura intérêt à s’impliquer et à déve-
Santé
«Nous avons peu de temps
pour préparer le tsunami gris»
Gériatre venant de l’hôpital, Stéfanie Monod a un parcours atypique. Elle bouscule
désormais les soignants vaudois appelés à faire face au vieillissement des patients
U Jamais Stéfanie Monod n’avait
imaginé quitter la pratique médicale.
Quand le département de Pierre-Yves
Maillard l’approche pour lui proposer
de conduire le Service de la santé
publique, elle sait à peine ce que
recouvre cette fonction. Elle
rencontrera le conseiller d’Etat, à sa
demande, à trois reprises, et chaque
fois elle lui dira qu’il se trompe de
personne. A la fin, Pierre-Yves
Maillard la provoque: «Vous pouvez
continuer à donner des conférences et
dire que le système de santé doit
changer, mais moi je vous donne les
clés, et vous faites!» Ebranlée, elle
réfléchit, et finalement accepte. La
voilà à la tête d’un lourd service de
l’Etat, avec un budget annuel de
1,4 milliard de francs.
Née à Lausanne en 1970, Stéfanie
Monod a passé sa jeunesse en Afrique.
En Algérie puis au Burundi, où son
père travaillait comme ingénieur. A
l’âge de 18 ans, elle rentre en Suisse
pour étudier la médecine à Lausanne
et à Zurich. Elle se forme en médecine
interne dans plusieurs hôpitaux
romands puis s’oriente vers la
gériatrie. Depuis 2009, elle était
médecin-cadre au CHUV.
L’Afrique, dit-elle, l’a éveillée à la
discrimination, à la vulnérabilité, à la
souffrance. Ce sera un aiguillon dans
sa décision de faire médecine, métier
où l’on se met au service d’autrui. Le
choix de la gériatrie relève de la même
logique. Une exigence morale de se
mobiliser pour les plus fragiles. Et le
signe de son intérêt pour une méde-
cine qui considère le patient dans sa
globalité. La gériatrie, c’est la disci-
pline systémique par excellence, le
contraire des spécialisations focalisées
sur un seul organe, explique cette
mère de deux jeunes enfants. L’air
de rien, dans ce parcours atypique, il
y a un fil rouge. Réorienter le système
de soins suppose précisément la vue
d’ensemble et l’attention aux plus
vulnérables.
Un médecin au service des plus vulnérables
De l’hôpital à l’administration. Stéfanie Monod pilote les réformes du système de santé vaudois. FLORIAN CELLA
L’essentiel
U Vieillissement Le nombre des
plus de 80 ans va exploser.
U Effet Le système de soins est
menacé d’asphyxie.
U Soins coordonnés La conti-
nuité des soins est le défi majeur.
37% La part des plus de
90 ans qui vivent à la
maison, autonomes, sans soins à domicile
+75% La hausse attendue,
d’ici quinze ans,
du nombre de patients de plus de 80 ans
qui seront hospitalisés
+120% L’augmentation
des plus de
80 ans d’ici à 2040.
En chiffres
1
/
1
100%