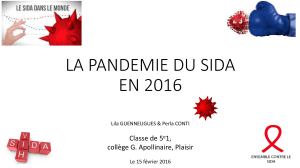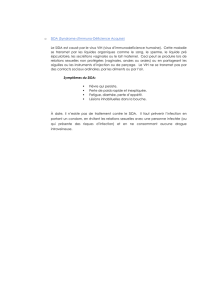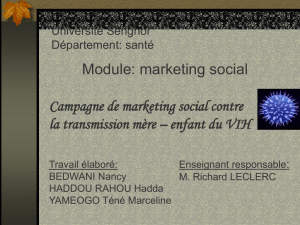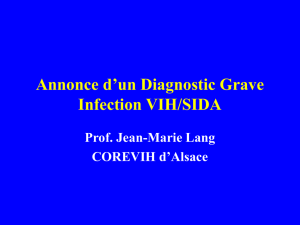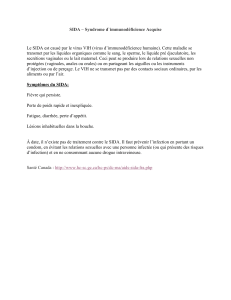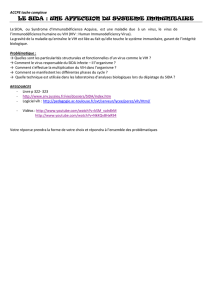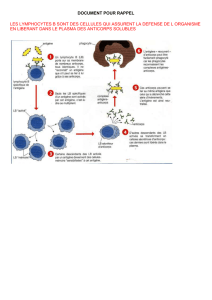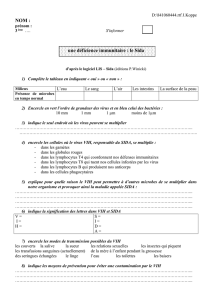La difficile observance Sida

La difficile observance
A
quelque niveau que ce soit,
les soignants ne doivent pas
trouve en dehors de l’organisme
humain. Dès lors, l’infection par
le VIH ne peut pas se produire lors
d’activités et de contacts quoti-
diens ordinaires. Le VIH se trans-
met exclusivement par les sécré-
tions sexuelles et par le sang. Il
s’agit donc d’un virus transmis-
sible, mais pas d’une maladie
contagieuse.
Toutes les relations sexuelles,
qu’elles soient vaginales, anales ou
buccales, homosexuelles ou hété-
rosexuelles, peuvent transmettre le
VIH. La transmission du VIH se
fait, dans les couples hétérosexuels,
aussi bien dans le sens homme-
femme que femme-homme. En
raison de la plus grande fragilité
des muqueuses, les relations anales
sont plus “infectantes” que les re-
lations vaginales ; les pratiques
buccales sont considérées comme
étant à risque faible mais non nul.
Les infections génitales (MST gé-
néralement) de l’un des partenaires
augmentent considérablement le
risque de transmission de la mala-
die, que ces infections soient si-
tuées sur le gland ou dans le vagin.
La prévention de la transmission
sexuelle repose sur l’utilisation du
préservatif (masculin ou féminin)
pour les rapports vaginaux ou
anaux, mais aussi pour les fella-
tions (préservatif), les cunnilin-
gus et anulingus (carré de latex
ou film plastique alimentaire).
La transmission du VIH par le
sang peut avoir lieu à différentes
occasions : lors d’une transfusion
ou de l’injection de produits san-
guins. Le risque résiduel est de-
venu très faible (mais non nul) de-
puis le dépistage systématique des
dons de sang instauré le 1er août
1985, dans les pays où ce dépis-
tage se pratique. La contamination
se fait par des seringues et des ai-
guilles souillées (cas des toxico-
manes qui utilisent du matériel
ayant déjà servi). En revanche,
dans le milieu médical, les se-
ringues, les aiguilles ou autres ins-
truments ne présentent plus au-
cun risque pour les patients, tant
sont rigoureuses les précautions
qui entourent leur usage.
Au cours de la grossesse, le VIH
peut se transmettre de la mère à
l’enfant (transmission dite “verti-
cale”) : la contamination a lieu le
plus souvent au moment du tra-
vail et de l’accouchement. La pos-
sibilité de transmission du VIH par
allaitement est maintenant bien
établie, des cas ayant été décrits
chez des mères infectées par trans-
fusion sanguine après l’accouche-
ment. Le risque pour l’enfant d’être
contaminé par le lait maternel a été
évalué à environ 14 %.
Succès et limites
des traitements
Les personnes souffrant du sida re-
connaissent que les trithérapies
ont stoppé l’hécatombe des pre-
Selon le bulletin épidémiologique publié cet été, le nombre de
nouveaux cas déclarés pour l’année 2001 est d’environ 1 600. Ce
nombre régresse seulement de 5 % par an, bien moins qu’entre
1995 et 1998. Et l’observance pose problème.
●●●
Sida
7
Professions Santé Infirmier Infirmière - No40 - octobre 2002
baisser la garde pour informer
et informer encore, et sensibiliser
les personnes séropositives à une
attitude responsable quant aux
risques de contamination.
En effet, en France, la vigilance est
en baisse, même dans les milieux
homosexuels, pourtant très impli-
qués dans la lutte contre le sida.
D’après les chiffres du ministère,
plus de la moitié des cas de sida en
2001 sont liés à une contamination
hétérosexuelle (800 cas de plus
qu’entre 1995-98) alors que la
contamination par des rapports
homosexuels représente 24 % des
cas et que celle par usage de
drogues représente 15 % des cas.
Les hétérosexuels sont les per-
sonnes les moins bien dépistées.
Une attention particulière doit
donc être portée dans les popula-
tions à risque, comme celles ori-
ginaires d’Afrique subsaharienne
ou des Caraïbes, les jeunes margi-
nalisés, les usagers de drogue, les
personnes démunies, celles prati-
quant la prostitution, les prison-
niers, les étrangers en situation ir-
régulière, etc. En effet, pour ces
populations, le dépistage se fait
trop tard, lorsqu’elles entrent dans
la maladie. Car une personne sur
deux découvre encore sa séropo-
sitivité au moment du diagnostic
du sida. Tous les résultats confir-
ment une insuffisance du dépis-
tage et de la prise en charge thé-
rapeutique. Et parmi les patients
traités, 6 % sont en échec théra-
peutique.
Rappel des modes
de transmission
Le VIH est un virus très fragile qui
survit très difficilement s’il se
L’état du sida en France
•150 000 personnes sont por-
teuses du VIH ;
•55382 ont développé un sida
depuis le début de l’épidémie ;
•40 000 personnes sont dé-
cédées depuis le début de
l’épidémie ;
•5000 à 6 000 personnes sont
infectées chaque année ;
•30 000 personnes sont por-
teuses du virus “sans le savoir” ;
•Antilles-Guyane, Île-de-France
et Provence-Alpes-Côte-d’Azur
sont les régions les plus touchées,
regroupant 60 % de cas de sida
diagnostiqués en 2001.
Informations : Ensemble contre le sida.
Site internet : www.sidaction.org.

mières années et permettent la sur-
vie de personnes qui étaient inexo-
rablement condamnées à court
terme. Mais les responsables d’as-
sociations soulignent l’effet néfaste
d’une information insuffisante sur
les médicaments auprès des jeunes
générations qui n’ont justement
pas connu les drames que les plus
anciens ont vécu. D’où un certain
relâchement dans la prévention.
Or, on ne guérit toujours pas du
sida. Et les vaccins ne sont pas
prêts d’être mis au point, ne serait-
ce qu’en raison du caractère mu-
tant du virus. Les traitements an-
tirétroviraux sont complexes et
difficiles à prendre, alors que leur
efficacité thérapeutique nécessite
une observance supérieure à 95 %.
Par comparaison, dans les mala-
dies chroniques, le taux d’obser-
vance est d’environ 50 %. Or, les
recherches montrent que l’obser-
vance dépend d’un ensemble de
cofacteurs émotionnels, sociaux,
cognitifs et comportementaux.
Il devient donc urgent d’organi-
ser des actions spécifiques de sou-
tien à l’observance des traite-
ments dans les lieux de soin.
D’autant que l’observance n’est ja-
mais acquise. Elle est fluctuante
dans le temps et dépend des évé-
nements (affectifs, professionnels
ou sociaux) qui jalonnent la vie
des personnes.
La consultation d’observance gé-
nère certes pas mal de difficultés
dans les services. Elle remet en
cause la place et le rôle de chacun.
La prise en charge est pluridisci-
plinaire. L’infirmière y joue un rôle
fondamental. Mais lorsqu’une
consultation d’observance a été
mise en place, les bénéfices ont été
immédiats pour les patients mais
aussi pour le système de soins et
les soignants. Ceux-ci ont pu
constater l’amélioration du travail
en équipe et de la communica-
tion. Pour être efficace dans cet
enjeu que représente l’observance,
l’infirmière doit se former*. Il faut
en effet se doter de connaissances
sur la complexité des comporte-
ments, des attitudes, des affects et
des croyances en jeu dans la prise
des traitements. Il est possible
d’accompagner une personne
dans la prise de son traitement à
condition d’accepter son vécu et
d’établir une relation de confiance
et de respecter ses choix. C’est une
base essentielle pour convaincre
les personnes séropositives d’ac-
cepter des traitements respon-
sables d’effets secondaires désa-
gréables, pour les soutenir dans
leurs moments de lassitude géné-
rée par des contraintes et des pers-
pectives peu optimistes. Dans les
soins prodigués aux personnes at-
teintes par le VIH, “prendre en
charge” prend tout son sens, qui
va au-delà du soin pratique, jus-
qu’au développement personnel
du patient.
Andrée-Lucie Pissondes
* Un ouvrage sur l’aide à l’observance
élaboré par des professionnels a été édité
avec le soutien de Abbott : Mettre en place
une consultation d’observance théra-
peutique aux traitements contre le
VIH/sida : de la théorie à la pratique.
Souvent
une co-infection
Une campagne de publicité invite
la population à un dépistage de
l’hépatite C. Or, les personnes in-
fectées par le VHC présentent par-
fois une co-infection avec le VIH.
L’hépatite C a été longtemps né-
gligée par les autorités sanitaires.
La conférence mondiale sur le
VIH à Barcelone en juillet dernier
soulignait les co-infections. Le
nombre de cas augmentant chez
les mono-infectés comme chez les
co-infectés, aujourd’hui, la prise
de conscience s’accélère. Le trai-
tement contre le VHC existe mais
accompagné d’effets secondaires
assez lourds. Cependant, la gué-
rison est souvent au bout. Mais
comme on peut s’en douter, la co-
infection est nettement plus grave
et compliquée. Chez certains pa-
tients, la réponse au traitement
permet seulement la régression de
la fibrose et la stabilisation de la
maladie avant, parfois, la rechute.
D’autres enfin ne répondent pas
et, pour eux, peu de solutions se
présentent. Chez les co-infectés,
la durée du traitement oscille
entre 24 et 48 semaines.
Pour les mauvais répondeurs, des
protocoles ont commencé afin
d’associer à la ribavirine et à l’in-
terféron pégylé une troisième mo-
lécule : l’amantadine. Ces patients
peuvent tout de même recevoir
de l’interféron pégylé seul en rai-
son de son action antifibrosante,
sauf en cas de cirrhose décom-
pensée. Reste la greffe, délicate,
notamment à cause de l’interac-
tion des médicaments. Rappelons
que les stratégies de traitement de
l’hépatite C chez les co-infectés
VIH sont relativement récentes.
Toxicité des antirétroviraux, effets
secondaires très lourds, obser-
vance difficile : autant d’obstacles
pour mener en parallèle les trai-
tements VIH et VHC. Un nou-
veau défi pour les patients.
A.-L.P.
8
Sida Hépatite C
●●●
Professions Santé Infirmier Infirmière - No40 - octobre 2002
Définitions
pour 20 ans d’épidémie
•L’acronyme SIDA signifie syndrome
d’immuno-déficience acquise.
•Un syndrome est une association
de plusieurs symptômes, signes ou
anomalies constituant une entité cli-
nique reconnaissable, soit par l’uni-
formité de l’association des manifes-
tations morbides, soit par le fait
qu’elle traduit l’atteinte d’un organe
ou d’un système bien défini.
•L’immuno-déficience est une in-
suffisance fonctionnelle du système
immunitaire.
•Le terme “acquise” signifie que le
sida n’est pas une maladie hérédi-
taire mais due à un agent avec lequel
le malade entre accidentellement en
contact. Cet agent est le virus de
l’immuno-déficience humaine ou
VIH (HIV en anglais).
1
/
2
100%