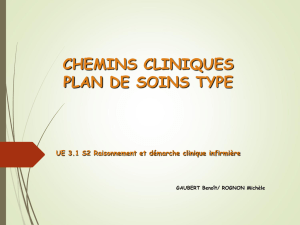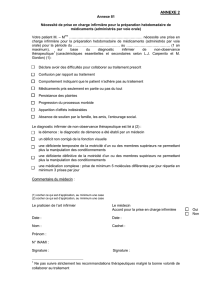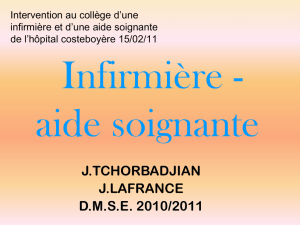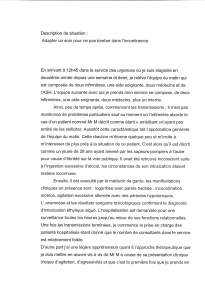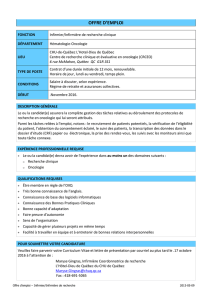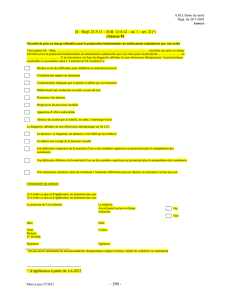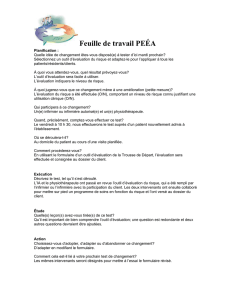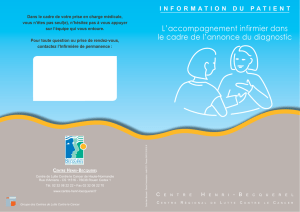De la compréhension à l’action Neurologie

Une meilleure connaissance des pathologies
et du fonctionnement du système nerveux,
des traitements adaptés, des techniques d’inves-
tigation plus pointues, etc., font de la neurologie
une discipline qui a fait des progrès spectacu-
laires mais dans laquelle il reste encore beaucoup
à découvrir. Même si le domaine est difficile pour
les soignants, quelquefois à la limite du suppor-
table physiquement et émotionnellement, les
infirmières s’y attachent beaucoup. La
relation patients/soignants est par-
ticulièrement riche et rapproche
les uns et les autres dans l’effort
qu’il y a à accomplir ensem-
ble. Les services connaissent
d’ailleurs peu de turn-over.
En effet, l’inconnu est si vaste
qu’il existe toujours un espoir
pour les soignants, parce que
des résultats que l’on n’envi-
sageait pas hier sont désormais
possibles aujourd’hui. Et, pour
les esprits curieux, il se passe tou-
jours quelque chose en neurologie.
La plupart des affections neurologiques sont
caractérisées par une dégénérescence du sys-
tème nerveux qui entraîne des troubles souvent
à la limite du champ d’application de la psy-
chiatrie. Freud et Charcot travaillaient d’ailleurs
souvent ensemble avant que le premier ne se
tourne résolument vers la psychanalyse. Cette
frontière est encore assez floue dans certains
cas, car les déficits sont certes sensoriels, mais
ils modifient parfois l’intelligence, la pensée,
la personnalité, en dehors de tout contexte
psychiatrique. En se libérant du “tout psy”,
grâce aussi aux nouvelles technologies et à
une recherche particulièrement dynamique, la
neurologie est donc devenue, ces dix dernières
années, une des premières sources d’avancées
et de progrès thérapeutiques. Ne parle-t-on
pas aux États-Unis de “decade of the brain” ?
Quelle que soit la cause du trouble : infec-
tieuse, traumatique, génétique, environnemen-
tale, inflammatoire, la conséquence est la mort
cellulaire neuronale appelée apoptose. Les pa-
thologies, si diverses dans leurs manifes-
tations, ont toutes en commun ce
phénomène de départ identique.
Prévenir, stopper ou ralentir
cette apoptose et ses consé-
quences par des actions mé-
dicamenteuses, voire chirur-
gicales, font aujourd’hui
partie des objectifs de soins.
Par exemple, les accidents
vasculaires cérébraux, mieux
connus, diminuent grâce à la
prévention cardiovasculaire. Le
traitement de la maladie de Parkin-
son progresse du fait de l’intervention
chirurgicale qui stimule le noyau subthala-
mique. La sclérose en plaques et la maladie d’Alz-
heimer se traitent tôt afin de limiter les effets de
la dégénérescence. Quant aux thérapies gé-
niques, elles permettront peut-être d’éviter cer-
taines myopathies. Les épilepsies, la migraine,
les troubles du sommeil, etc., profitent aussi des
avancées. Il faut rappeler cependant que toutes
les maladies neurologiques ne sont pas vues en
hospitalisation, sauf pour des investigations
brèves. Par exemple, la migraine, les algies fa-
ciales, les névralgies cervico-brachiales et lom-
baires appartiennent à une pathologie banale.
Neurologie
De la compréhension
àl’action
En peu de temps, la neurologie a dépassé le domaine de la psychiatrie
pour devenir une discipline à part entière. Le domaine est si vaste
qu’il se divise même, aujourd’hui, en plusieurs “sous-spécialités”.
En neurologie, un succès n’est jamais promis, il s’acquiert.
19
Professions Santé Infirmier Infirmière - No31 - novembre 2001
Sommaire
• Les accidents
vasculaires
cérébraux
• La maladie
de Parkinson
• La sclérose
en plaques (SEP)
• L’épilepsie
• Les migraines
• Autres affections
neurologiques
• Incontinence
et rétention
©Voisin/Phanie

20
Les accidents vasculaires
cérébraux
Les accidents vasculaires cérébraux
sont des troubles neurologiques
secondaires à une souffrance
du parenchyme cérébral d’origine
artérielle ischémique ou hémorragique,
plus rarement d’origine veineuse.
Première cause de handicap persistant de
l’adulte, les accidents vasculaires cérébraux
(AVC) représentent la troisième cause de mor-
talité : ils sont au nombre de 125 000 chaque
année, en France. Vingt pour cent des per-
sonnes faisant un premier AVC décèdent rapi-
dement et la moitié des survivants garde un
handicap.
Ce nombre sans cesse croissant, lié notamment
au vieillissement de la population, en fait un réel
problème de santé publique : l’AVC est en effet
plus fréquent et plus grave lorsqu’il touche une
personne d’un âge avancé. Un risque d’AVC
passe de 2 % avant 65 ans à plus de 15 % au-
delà de 75 ans.
Moyens de prévention
L’intérêt tardif porté à l’infarctus cérébral par rap-
port à celui porté à l’infarctus du myocarde fait
que les facteurs de risque de son déclenchement
en sont beaucoup moins bien connus. Pourtant,
il ne semble guère y avoir de différences.
L’hypertension artérielle (HTA), facteur de risque
d’athérosclérose, intervient aussi bien dans les
hémorragies que dans les accidents ischémiques.
D’où le risque d’atteinte des gros troncs artériels
(athérosclérose) et aussi d’artériosclérose (at-
teinte des petits vaisseaux).
La solution préventive réside dans la régularisa-
tion des chiffres tensionnels qui s’obtient d’abord
par une bonne hygiène de vie comprenant une
gestion du stress et la pratique régulière d’une ac-
tivité physique. Ce sont aussi des règles nutri-
tives faisant perdre le poids superflu grâce à une
nourriture équilibrée, sans excès de sel, de
graisses et de sucre. Si besoin, lorsque ces me-
sures sont insuffisantes, on peut s’aider de trai-
tements antihypertenseurs.
Il est nécessaire de rechercher un éventuel
diabète (glycémie à jeun supérieure à 1,28 g/l
vérifiée à deux reprises) ainsi qu’un éventuel
cholestérol.
Le diabète cause à la fois une athérosclérose et une
artériosclérose (angiopathie diabétique), une hy-
percholestérolémie essentielle ou mixte avec ana-
lyse du rapport HDL et LDL.
L’hypercholestérolémie génère essentiellement
une athérosclérose.
Ainsi, un patient diabétique a presque trois fois
plus de risque de faire un AVC qu’une personne
indemne.
Le tabac, comme pour les autres affections vas-
culaires, présente un réel danger, deux fois plus
important ici que chez les non-fumeurs.
Cependant, la génétique ne semble pas être
étrangère au déclenchement de la maladie et l’on
doit donc s’attacher à rechercher les antécédents
familiaux : si un membre de la famille a fait un
AVC, il faut surveiller activement le reste de cette
famille.
Symptomatologie
Quatre-vingts pour cent des AVC sont d’ori-
gine ischémique contre 20 % seulement liés à
des accidents hémorragiques. Le premier signe
d’AVC est parfois un accident ischémique tran-
sitoire (AIT), qui dure moins d’une heure et
dont les séquelles ne dépassent pas le seuil des
24 heures. Les causes de ces AIT sont, en pre-
mier lieu, l’athérosclérose, suivie par les embo-
lies artérielles qui proviennent de cardiopathies,
et par les malformations vasculaires. Ils peu-
vent se manifester brutalement, par une cécité
monoculaire transitoire (touchant une partie du
champ visuel), une paralysie brachio-faciale
transitoire, une aphasie. Ces signes doivent
alerter et provoquer la mise en route d’un bilan
étiologique complet. Malheureusement, leur
caractère épisodique fait qu’ils ne sont parfois
retrouvés qu’à l’interrogatoire d’un AVC consti-
tué. Le patient n’a pas consulté son médecin
pour une anomalie qui a cédé d’elle-même et ne
l’a donc pas suffisamment alerté. Lors d’un AVC
constitué, il est essentiel de déterminer rapide-
ment la nature de l’accident : ischémique ou
hémorragique. La première cause d’hémorragie
cérébrale est l’HTA, puis une malformation vas-
culaire qui relève, elle, d’un acte chirurgical, en-
fin un trouble de la coagulation comme celui
observé lors des hépatopathies.
Des signes cliniques, tels que des céphalées bru-
tales ou la survenue de l’accident au cours d’une
activité plutôt qu’au repos, peuvent guider plu-
tôt vers une hémorragie. De toute façon, un AVC
commande une hospitalisation d’urgence. Dans
ce cadre, le diagnostic étiologique sera établi
dans des conditions optimales.
Essentiel et pratiqué dès l’arrivée du malade, le
scanner affirme la nature ischémique ou hémor-
ragique de l’accident. Il engage le traitement.
Neurologie
Professions Santé Infirmier Infirmière - No31 - novembre 2001

Traitement
En cas d’AIC (accident ischémique cérébral), un
traitement médicamenteux est aussitôt mis en
œuvre. Il peut comprendre des antiplaquettaires,
parfois des anticoagulants, voire des thromboly-
tiques. Certaines pathologies nécessitent un acte
chirurgical d’emblée.
En cas d’hémorragie cérébrale, les traitements
médicamenteux sont d’une efficacité bien plus li-
mitée. Soit un acte chirurgical est possible, soit
une surveillance est établie, avec prise en charge
des facteurs de risque existants.
Le traitement le plus efficace et souhaitable
pour un AVC est encore sa prévention. La prise
d’aspirine, d’une association dipyridamole/as-
pirine, de clopidrogel ou de ticlopidine est utile
en complément des mesures préventives.
Comme, en général, l’accident coronarien pré-
cède de dix ans en moyenne les AVC, la pré-
vention des accidents coronariens est également
une bonne prévention pour les AVC. Le pro-
nostic des AVC est vital et fonctionnel. Les
traitements médicamenteux ne peuvent ac-
tuellement pas modifier la récupération neuro-
logique et seule la rééducation peut limiter le
handicap.
Rôle infirmier
La surveillance neurologique d’un patient atteint
d’un AVC en phase aiguë porte essentiellement
sur l’apparition des signes d’aggravation à véri-
fier toutes les demi-heures environ.
Il s’agit de surveiller :
–le niveau de conscience : normal, confusion,
agitation, voire coma... Le patient répond-il aux
stimuli verbaux, aux stimuli nociceptifs ? Pré-
sente-t-il ou non des troubles neurovégétatifs ?
(échelle de Glasgow) ;
–la force musculaire et la mobilité des membres :
mobiliser le visage, faire mobiliser les membres
supérieurs et inférieurs, serrer la main... ;
–la surveillance du réflexe photomoteur : re-
cherche de la contraction pupillaire à la lumière.
Ne jamais dilater la pupille pour un fond d’œil,
ce qui gênerait la surveillance ;
–les troubles de la déglutition : une fausse route
implique l’arrêt de l’alimentation orale... ;
–les signes vitaux : surveillance de la tension ar-
térielle, des pulsations et de la température...
Mettre en route le traitement et en surveiller les
effets.
Le patient doit être installé en décubitus dorsal,
tête légèrement surélevée. Le repos strict au lit est
obligatoire pendant les premiers jours. Assurer le
confort du malade est une priorité (tout à portée
de main).
L’hygiène doit être assurée par une toilette quo-
tidienne (le risque d’escarres est réel). L’alimen-
tation est préparée et surveillée avec une atten-
tion particulière pour éviter la déshydratation.
Il faut veiller à l’élimination des urines (inconti-
nence ou rétention) et à l’élimination intestinale.
L’infirmière est habilitée à administrer des laxa-
tifs doux. Si le patient est aphasique, il est in-
dispensable de lui parler, de lui expliquer ce
qu’on lui fait. Compte tenu de l’anxiété qui ré-
sulte d’un AVC, l’infirmière a un rôle essentiel
de soutien.
La maladie de Parkinson
En France, soixante mille personnes
sont atteintes de la maladie de Parkinson,
soit 1,5 % de la population.
De diagnostic difficile par rapport
aux syndromes parkinsoniens, la maladie
est encore de cause inconnue.
Le trépied symptomatique classique com-
prend un tremblement de repos, la bradyki-
nésie et la rigidité. A ces trois signes cardinaux
s’ajoutent quelques collatéraux comme l’asymé-
trie, l’absence de signes caractéristiques d’une
autre affection, la réponse positive à un traite-
ment d’épreuve à la L-dopa, qui peuvent confir-
mer le diagnostic. La maladie de Parkinson est
une maladie dégénérative. Sa physiologie est liée
à une diminution d’un neurotransmetteur, la
dopamine. Celle-ci a pour cible les structures
sous-corticales profondes ou noyaux gris cen-
traux, et en particulier le striatum. Ces struc-
tures sont impliquées dans le contrôle et l’ini-
tiation des mouvements.
Examens complémentaires
Le scanner crânien peut être normal ou montrer
des signes d’atrophie cérébrale diffuse.
A l’IRM, on peut constater des anomalies de si-
gnaux des noyaux gris centraux et, à l’EEG, un
ralentissement du rythme de base guère plus spé-
cifique que les anomalies observées lors de l’exa-
men des potentiels auditifs évoqués.
Les tests neuropsychologiques permettent, eux,
de repérer une démence.
Des examens complémentaires sont surtout
utiles pour établir un diagnostic différentiel :
–dosage de cuivre plasmatique permettant d’éli-
miner une maladie de Wilson ;
–scanner et IRM décelant des ischémies cérébrales.
21
Professions Santé Infirmier Infirmière - No31 - novembre 2001

22
Encore au stade expérimental, la spectroscopie
par résonance magnétique, en particulier la spec-
trométrie hydrogène réalisée avec un appareil
IRM, peut doser un métabolite significatif de
perte neuronal : l’acétyl aspartate.
Autre voie de recherche : la génétique, avec la dé-
couverte récente de formes autosomiques réces-
sives, les formes familiales autosomiques domi-
nantes étant extrêmement rares.
Traitement
La stratégie thérapeutique est fondée sur les
notions d’âge, de gêne fonctionnelle, de profil
psychologique du patient. Les troubles neurolo-
giques sont radicalement modifiés par le traite-
ment. Celui-ci n’est pas curatif mais substitutif et
vise à compenser le déficit en dopamine. Il ne
permet pas de limiter l’évolution de la maladie et
une perte de son efficacité est observée après
quelques années.
Avant toute thérapeutique, une certitude dia-
gnostique est nécessaire. Le déficit essentiel étant
celui de la voie dopaminergique, le traitement
principal repose sur la L-dopa. Celle-ci peut être
utilisée seule, sous sa forme à libération prolon-
gée ou sous sa forme dispersible. Elle peut être
associée à un inhibiteur de la dopadécarboxylase.
Sont utilisés aussi les agonistes dopaminer-
giques, ergotés ou non ergotés. Les anticholiner-
giques comme l’amantadine sont toujours utili-
sables. Enfin, des médications possiblement
neuroprotectrices sont apparues.
Si les signes fonctionnels sont peu importants,
n’entraînant pas de handicap, l’abstention théra-
peutique est de règle. Si les signes deviennent gê-
nants, avec un handicap modéré, on prescrit un
traitement symptomatique non dopaminergique.
L’amantadine trouve ici sa place.
Le traitement dopaminergique s’impose devant
un handicap existant chez un sujet jeune. Si ce-
lui-ci a moins de 60 ans, on utilisera les agonistes
dopaminergiques tels que la bromocriptine ou,
plus récemment, le ropinirole.
En cas d’échec thérapeutique, on peut augmen-
ter les doses de l’agoniste. On peut changer
d’agoniste ou lui ajouter de la L-dopa.
Chez le patient de plus de 70 ans, la L-dopa sera
utilisée en adoptant des paliers thérapeutiques
respectant la dose minimale efficace. En effet, à
cet âge, les complications motrices inhérentes
àce type de traitement sont moins à craindre.
Des effets secondaires sont possibles. Des nau-
sées et des vomissements, une hypotension or-
thostatique, des dyskinésies sont observés. Des
contre-indications existent : certaines patholo-
gies cardiaques, les ulcères gastroduodénaux
en évolution, des antécédents psychiatriques et
l’association aux neuroleptiques.
La neurostimulation du noyau sous-thalamique
constitue un espoir chirurgical. Efficace sur les
symptômes cardinaux et pour des profils de
malades bien particuliers, elle permet de réduire
de manière importante les doses de dopathéra-
pie. Les greffes neuronales demandent, elles,
confirmation.
Rôle infirmier
La maladie de Parkinson nécessite un traitement
à vie. Ce qui suppose, à un moment ou un autre,
des effets indésirables que l’infirmière doit
connaître. Les troubles digestifs sont souvent
transitoires et cèdent aux antiémétiques. Il est
donc recommandé de faire prendre au patient ses
traitements au milieu des repas. Une anorexie
Neurologie
Professions Santé Infirmier Infirmière - No31 - novembre 2001
Échelle d’évaluation
de la maladie de Parkinson : UPDRS
Cet examen est le plus simple et le plus efficace.
Il comprend plusieurs sections :
–évaluation des fonctions cognitives
;
–autoquestionnaire de handicap ;
–cotation clinique motrice ;
–évaluation de la présence et de l’importance des
dyskinésies ;
–fluctuations et complications des traitements.
©V.Burger/Phanie

peut être responsable de dénutrition, d’où la né-
cessité d’un contrôle régulier du poids. La ten-
sion artérielle est à surveiller en conseillant au
patient de ne pas se lever brutalement pour évi-
ter les chutes. Il est important de veiller à la
fréquence cardiaque et d’effectuer des électro-
cardiogrammes. La dépression accompagnée
d’anxiété étant fréquente, l’infirmière doit établir
une relation d’aide en fonction de l’acceptation
de la maladie ainsi qu’une information auprès
des familles. L’infirmière doit s’assurer que le pa-
tient a bien compris ses traitements. A un stade
avancé de la maladie, le contrôle de la fonction
urinaire doit être effectué, en surveillant notam-
ment les infections, fréquentes, ainsi que les po-
lyuries et pollakiuries. La constipation est prati-
quement constante chez le parkinsonien, aussi
faut-il prévoir des laxatifs, une alimentation
adaptée et la surveillance des selles. La transpi-
ration et une sialorrhée étant importantes, une
bonne hygiène s’impose.
La sclérose en plaques (SEP)
Trente-cinq à 40 000 Français
sont atteints de sclérose en plaques,
soit une prévalence de 50 à 60 cas
pour 100 000 habitants. Le diagnostic
est porté plus souvent qu’il y a quelques
années mais le nombre de cas diagnostiqués
serait encore en deçà de la réalité.
Si l’on compare ces chiffres à ceux des autres
pays européens (Grande-Bretagne 100 cas
sur 100 000 habitants), la France paraît moins
atteinte.
La prévalence est féminine, avec 60 % des cas, et
il existe une tendance à un rajeunissement des
patients : 70 % sont âgés de 20 à 40 ans et il y
en a davantage dans les régions du Nord. Il est
vrai que, comme les traitements ne peuvent stop-
per l’évolution de la maladie, un consensus est
établi en France pour ne pas révéler la maladie
lors de la première poussée. En effet, il peut se
passer une dizaine d’années avant la deuxième
poussée. Et la dépression est un risque important
quand ces sujets jeunes apprennent qu’à plus ou
moins longue échéance, leur avenir se situe dans
la dépendance.
Les symptômes de la SEP sont multiples et variés
mais une de leurs caractéristiques principales
est d’évoluer selon des poussées spontanément
régressives. Ces signes traduisent un dysfonc-
tionnement du système nerveux central : des pa-
resthésies des membres, une faiblesse, un déro-
bement d’une jambe, une perte transitoire de la
force d’un muscle ou d’un groupe musculaire.
Parfois aussi des vertiges, une instabilité à la
marche, un trouble de la régulation, des effets
émotifs apparaissent.
Un trouble oculaire peut être un révélateur, par
exemple une cécité brutale, le plus souvent par-
tielle, une douleur oculaire, tous ces signes tra-
duisant une névrite optique rétrobulbaire.
L’existence d’une diplopie, d’une baisse de l’acuité
visuelle, d’un scotome est possible.
Toutes ces manifestations sont isolées ou grou-
pées et évoluent en poussées, ce qui retarde d’au-
tant l’établissement d’un diagnostic, le tableau
clinique entre les crises étant, lui, apparemment
normal.
Le diagnostic plus suspicieux, c’est-à-dire fondé
sur des impressions davantage que sur des
certitudes, doit être étayé par des examens
complémentaires.
Examens complémentaires
La ponction lombaire montre typiquement une
réaction cellulaire modérée à prédominance
lymphocytaire, témoignant d’une synthèse lo-
cale d’anticorps. Ces anomalies, si elles sont
évocatrices d’une SEP, ne sont pas forcément
spécifiques de cette maladie. Une IRM ne doit
être demandée que devant une deuxième pous-
sée supposée de la maladie. Elle n’est pas tou-
jours explicite et peut parfois être excessive :
classiquement, le diagnostic est établi sur la
présence de plaques de leucoaraïose ou plaques
blanches, dont le nombre et l’importance de-
mandent une étude. L’examen utile au diagnos-
tic, même s’il existe une phase infraradiologique,
23
Professions Santé Infirmier Infirmière - No31 - novembre 2001
L’imagerie à venir
•L’IRM de diffusion étudie, à l’aide de l’étude
de mouvements browniens, la destruction des
tissus cérébraux.
•L’IRM de transfert d’aimantation permet de
repérer les phénomènes de démyélinisation.
•L’IRM fonctionnelle permet de mettre en rela-
tion un dysfonctionnement moteur et une
atteinte cérébrale.
•L’IRM ou spectrométrie utilise un neurotrans-
metteur (N-acétyl-aspartate) comme révélateur
du fonctionnement neuronal : une diminution
de son taux traduit une baisse de la fonction
neuronale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%