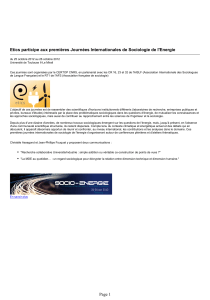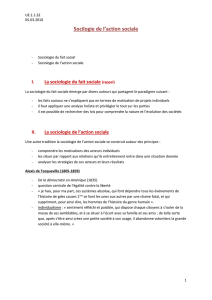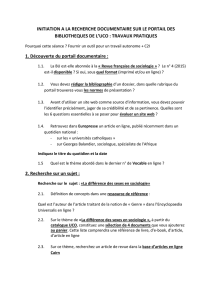Les femmes dans la sociologie Annie Cloutier L`auteure est

A
SPECTS SOCIOLOGIQUES
,
VOL
.
18
NO
1,
MARS
2011
Les femmes dans la sociologie
C
OMPTE
-
RENDU ET BRÈVE ANALYSE D
’
UN NUMÉRO DE
S
OCIOLOGIE ET SOCIÉTÉS DE
1981
PORTANT SUR LES FEMMES COMME SUJETS ET AUTEURES DE LA SOCIOLOGIE
QUÉBÉCOISE
Annie Cloutier
L’auteure est étudiante à la maîtrise en sociologie à
l’Université Laval et écrivaine. Elle tient à remercier Diane
Lamoureux et Nicole Laurin pour leur participation à cette
enquête, ainsi que Mélanie Bédard, pour ses conseils et son
soutien.
Le féminin est employé dans le but d’alléger le texte.
Depuis les années 1960, le féminisme est devenu un courant de pensée
important des sociétés occidentales. Les sciences sociales ont été
influencées par les concepts qu’il propose et par sa volonté de faire une plus
grande place aux femmes dans le monde universitaire. En 1981, quatorze
femmes sociologues discutaient, dans la revue Sociologie et sociétés, de leur
conception du féminisme et de la place faite aux femmes dans la société
québécoise en général, et dans le milieu universitaire en particulier. Leurs
constatations sont-elles encore aujourd’hui d’actualité?

A
SPECTS SOCIOLOGIQUES
,
VOL
.
18
NO
1,
MARS
2011
1. Introduction
Le féminisme ne date pas d’hier. Certaines auteures en font remonter
l’origine au XIX
e
siècle. Ce n’est toutefois que vers les années 1950 qu’un
mouvement de fond de revendications féminines et féministes se répand
dans les sociétés occidentales. Au milieu des années 1960, ce mouvement
commence à avoir des répercussions importantes sur la production de
recherches et de théories en sciences sociales. Les chercheures et les
théoriciennes féministes, convaincues de l’impossibilité d’instaurer
l’égalité dans des sociétés occidentales qu’elles jugent fondamentalement
patriarcales, commencent à questionner, dans toute leur envergure, les
systèmes qui fondent ces sociétés. Pour ce faire, elles se concentrent
d’abord sur les relations sociales au sens large et sur les situations
d’oppression spécifiques aux femmes (Nengeh Mensah,
2005 : 13). Mais
c’est surtout pendant la décennie 1970-1980 qu’elles produisent un
foisonnement d’études et qu’elles multiplient les « champs féminins ». Un
élan créatif réussit à percer à travers les méthodologies établies
jusqu’alors : les chercheures osent présenter les faits sociaux sous un
angle différent, elles osent critiquer les théories classiques. Par ailleurs
on assiste, tout au long de cette décennie, à un engouement pour les
causes féministes dans plusieurs sphères de la société. Les subventions
gouvernementales et universitaires, ainsi que l’intérêt des médias, sont
au rendez-vous et, avec eux, l’institutionnalisation du mouvement, et ce
que cette institutionnalisation suppose de récupération et de perte de
créativité
1
. Au début des années 1980, songeuses devant les effets
1
L’institutionnalisation est une préoccupation importante des féministes de 1981, et
demeure d’actualité en 2010. Faut-il adapter les luttes féministes aux discours, aux

pervers de leurs acquis et devant la difficulté de penser une société
véritablement égalitaire, et épuisées par la multiplication des luttes
qu’elles doivent mener seules, les féministes sont, de leur propre aveu, à
bout de souffle. Elles ressentent le besoin de recentrer leurs énergies et
de prendre la mesure du chemin parcouru. Doivent-elles poursuivre les
mêmes objectifs qu’à l’origine ?, se demandent-elles. Et quels étaient ces
objectifs ?
C’est dans ce contexte qu’en octobre 1981
2
, la revue Sociologie et
sociétés fait paraître un numéro intitulé Les femmes dans la sociologie.
Quatorze femmes sociologues
3
, toutes ouvertement féministes, y
présentent, dans onze textes, leur vision de la sociologie féministe au
terme de la décennie 1970-1980. La relecture de cette véritable synthèse
collective, près de 30 ans plus tard, permet de comprendre certains
éléments de la démarche et de la réflexion de ces femmes qui vivent alors
au quotidien les luttes féministes. Ces éléments de réflexion, offerts par
ces femmes aux points de vue parfois divergents, mais toujours assumés,
permettent aujourd’hui de répondre, au moins en partie, aux questions
exigences et aux critères des institutions sociales telles que l’université, les médias et
le gouvernement afin d’obtenir, de leur part, subventions, connaissance et exposure?
Ou faut-il, au contraire, laisser ces luttes se déployer « sur le terrain », dans toute leur
spontanéité et leur diversité, près des personnes qu’elles concernent, et ainsi leur
conserver leur sens de « mouvement social »? La question est débattue par les
auteures de Les femmes dans la sociologie et bien qu’il ne fasse aucun doute que le
féminisme, en 2010, est au moins partiellement institutionnalisé, elle continue de l’être
aujourd’hui. J’y reviens plus loin.
2
Ce texte est écrit au présent. Toutefois, les opinions et les faits qui y sont recensés
sont ceux de 1981.
3
Les femmes sociologues ne sont pas nécessairement féministes. J’emploie le terme
« femme sociologue » pour désigner toute femme qui fait profession dans le domaine
de la sociologie, en posant l’hypothèse, à l’instar des auteures de Les femmes dans la
sociologie, que le seul fait d’être femme apporte quelque chose de différent à la
pratique de cette profession.

A
SPECTS SOCIOLOGIQUES
,
VOL
.
18
NO
1,
MARS
2011
suivantes : quelle était la situation institutionnelle et théorique de la
sociologie féministe au début des années 1980 ? Quels étaient ses acquis
et ses projets ? Quelle était sa place dans le cadre plus général de la
sociologie et du féminisme québécois ?
Je tente ici de résumer les positions exprimées par ces femmes,
positions qui, si elles sont « partielles et partiales », pour rendre
hommage à l’expression de Danielle Juteau-Lee, n’en sont pas moins
d’une grande pertinence pour la lectrice
4
du XXI
e
siècle. Je propose
d’abord une brève mise en contexte de la publication du numéro spécial
de Sociologie et sociétés sur la sociologie des femmes, ainsi que des
résumés du contenu de chacun des onze textes qui en forment le corpus.
Dans une seconde partie, j’analyse certains thèmes abordés dans les onze
textes : la triple place et le triple rôle historique des femmes dans la
sociologie
5
, la division de la sociologie faite par et au sujet des femmes en
trois principaux types de recherches, l’importance du marxisme dans la
pensée des femmes en sociologie, l’inscription de la sociologie des
femmes dans la pensée féministe, son institutionnalisation, et son avenir.
Je propose, en conclusion, un parallèle avec la situation des femmes dans
la sociologie en 2010. Cette réflexion finale est basée sur les témoignages
de Diane Lamoureux et de Nicole Laurin, que j’ai interrogées en janvier
2010.
4
Je rappelle que mon emploi du féminin inclut le masculin.
5
Cette place et ce rôle sont triples parce qu’ils comprennent les femmes à la fois en
tant que sociologues, théoriciennes et objets des recherches. Les « femmes dans la
sociologie », comme les « femmes sociologues » (les expressions sont synonymes), sont
donc ces femmes qui occupent une ou plusieurs de ces places et qui jouent un ou
plusieurs de ces rôles.

Le but de ce texte n’est pas de donner des réponses toutes faites sur
la situation actuelle. J’espère qu’il soit lu comme un témoignage de
l’effort historique de certaines femmes et qu’il soulève de lui-même des
questions auxquelles il appartient à chacune de trouver des réponses
satisfaisantes. Le témoignage des femmes de 1981 est poignant parce
qu’il met naturellement en évidence que si certaines choses ont évolué,
d’autres ont malheureusement
6
stagné. J’espère que mon texte est
d’autant plus puissant qu’il ne fait que rapporter un état de fait qui date
de près de trente ans. Tant mieux, toutefois, s’il évoque de multiples
questions : la sociologie des femmes a-t-elle avancé ? De façon générale,
la sociologie tient-elle mieux compte, désormais, de la réalité des
femmes ? Les femmes sociologues de 2010 ont-elles les mêmes
possibilités d’avancement que les hommes dans les institutions
universitaires ? Les femmes comme objets sociologiques forment-elles
toujours une catégorie minoritaire ? Jusqu’à quel point la sociologie faite
par des femmes est-elle intégrée au corpus enseigné ? Et la sociologie des
femmes est-elle un sous-genre de la sociologie, ou une sociologie à part
entière ? Une seule chose est certaine : ces interrogations, en 2010, ont
conservé toute leur pertinence. Et le seul fait de les considérer, permet
d’avancer.
2. Sociologie et sociétés
Sociologie et sociétés est une revue savante thématique qui fait
principalement état de la réflexion et de la recherche sociologiques
6
Je suis féministe. Pourquoi m’en cacherais-je? Les femmes de 1981 reconnaissent la
nécessité, et ont le courage, d’affirmer les principes qui les guident, de reconnaître les
biais qui orientent leur réflexion, pour mieux en tenir compte. J’espère apporter à ce
texte une conviction intellectuelle nuancée qui leur fasse honneur.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
1
/
47
100%