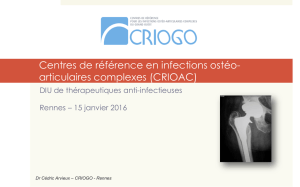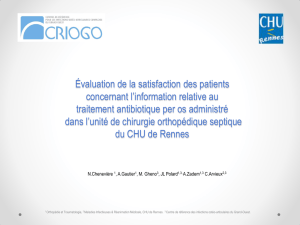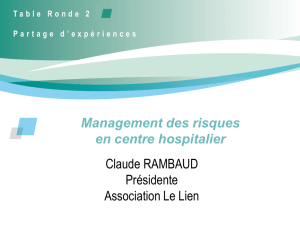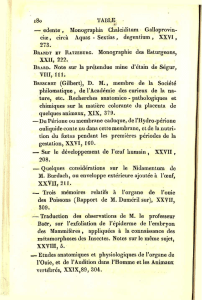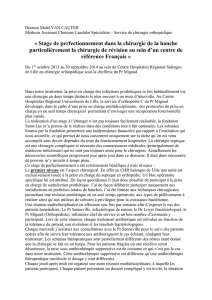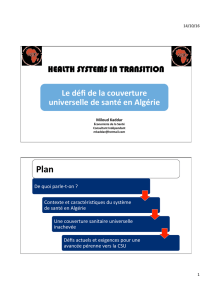“ L CRIOAC : trois ans déjà ! CRIOAC: three years already!

98 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 3 - mai-juin 2012
ÉDITORIAL
“
Éric Senneville,
Henri Migaud
Coordonnateurs du Centre de réfé-
rence des infections ostéoarticulaires
complexes de l’interrégion Nord-
Ouest (CRIOAC-G4 Lille-Tourcoing).
CRIOAC : trois ans déjà !
CRIOAC: three years already!
Les centres de référence des infections ostéoarticulaires complexes
(CRIOAC) ont été labellisés en France par le ministre Roselyne Bachelot-
Narquin à partir de septembre 2008, après des années de concertation
entre le ministère et différentes sociétés savantes, conduites, en particulier pour
la SPILF, par le très regretté Pr J.M. Besnier. Au nombre de 9, dont 2 en région
parisienne, ces centres nous sont enviés par nos collègues des différents pays
européens, impressionnés par cette tentative d’organisation de la prise en charge
des patients atteints d’une IOAC. Plus de 3 ans et demi après la labellisation
desCRIOAC, où en sommes-nous réellement ?
La réflexion sur la nécessité de créer des CRIOAC a été initiée par l’association
“LeLien” et son président J.M. Ceretti, soutenus par le Dr P. Mamoudy, après la survenue
de cas groupés d’infections postopératoires à Mycobacterium xenopi dansuneclinique
de la région parisienne dans les années 1990. L’objectif annoncé de ces centres était
defaciliter l’accessibilité des patients souffrant d’une IOAC à un centre spécialisé dans ce
domaine et disposant d’une équipe multidisciplinaire. L’une des idées phares à l’origine
de ce projet était que seul un très petit nombre de ces centres français (à peine 2 ou 3,
comme on a pu le lire dans la presse à l’époque) était apte à traiter ce type de patient.
Les difficultés ont commencé lorsqu’il s’est agi de définir les missions des centres.
Lapremière était que la notion d’IOA “complexe” n’était connue d’aucun des responsables
descentres. La seconde résidait dans le terme de “centre de référence”, élogieux et
gratifiant pour les centres labellisés mais qui, pour les autres centres ayant postulé sans
être retenus, pouvait les amener à réduire leur ardeur à s’investir dans le projet.
La perspective d’une surtarification des groupes homogènes de patients, définis par
lecaractère complexe de l’IOA – dont la prise en charge était validée par le CRIOAC –,
et la volonté affichée de certains centres de s’investir dans cette aventure, ont finalement
permis la labellisation de centres associés (CA) aux CRIOAC. La notion de CA a fait
l’objet d’un débat qui illustre bien les différentes visions de ce que peut être une organisation
territoriale de la prise en charge de ces patients. L’une prônait la vision
élitiste desCRIOAC (peu, voire pas de centres associés, car ces centres compétents…
n’existent pas) ; dans ce schéma, la mission des CRIOAC, ne prenant en charge
queles pathologies les plus lourdes, était réduite à une offre de soins spécialisés
pourunnombre probablement limité de patients (bien que difficilement évaluable
actuellement). L’autre vision allait davantage dans le sens d’un maillage du territoire,
avecdésignation d’un nombre suffisant de centres associés travaillant en coordination
avecleCRIOAC interrégional correspondant. Cette vision avait le mérite d’uneappré-
hension plus globale de la pathologie, ne se limitant pasà la pathologie “extraordinaire”,
voire sensationnelle. C’est, comme souvent en pareille situation, une solution
intermédiaire qui a été retenue, prévoyant la désignation de 2 centres associés à chaque
CRIOAC, soit 18 centres en tout en plus des 9 CRIOAC. Certains CA sont ainsi distants
de leur CRIOAC de plus de 400km, mais il est vrai que nous sommes à l’heure d’In-
ternet… Malheureusement, on n’a pas encore réussi à faire circuler les patients parle
réseau du web ! Cela entraîne une certaine sélection en fonction des capacités àsupporter
les frais engagés par ces déplacements.

La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 3 - mai-juin 2012 | 99
ÉDITORIAL
”
Les missions des CRIOAC sont très lourdes, associant la prise en charge effective
despatients les plus sévèrement atteints, l’organisation de l’offre de soins sur l’interrégion
etla validation des fiches de réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) propo-
sées par les CA et d’autres établissements de soins. Une aide financière est allouée
chaque année aux CRIOAC pour aider à l’organisation interrégionale de leurs différentes
missions. L’année 2012 devrait voir aboutir les travaux du groupe des représentants
desCRIOAC sur la création d’une fiche de recueil commune permettant la validation
de la RCP, mais également l’alimentation d’une base nationale d’évaluation des pratiques
actuelles des centres impliqués dans la prise en charge des patients avec IOAC.
Le levier médico-légal sera amené à jouer un rôle majeur dans la “promotion”
desCRIOAC. En effet, une fois les CRIOAC identifiés et la liste des catégories
depatients relevant de ces centres connue de tous, partant du constat que les bénéfices
dela surtarification ne concernent que les CA/CRIOAC et que les demandes
de réparation en cas d’infection nosocomiale et de mise en cause des praticiens
chirurgiens orthopédistes ne cessent d’augmenter, on peut imaginer que les trans-
ferts depatients vers les CA/CRIOAC augmenteront dans un avenir très proche.
Onpeut interpréter cette évolution comme un résultat positif de la mise en place
desCA/CRIOAC, à la nuance près que beaucoup de ces centres sont déjà actuellement
saturés etque cela risque de conduire à une augmentation du délai de prise en charge
despatients et, en quelque sorte, à un contre-résultat.
Le modèle d’organisation des CA/CRIOAC tel qu’il est proposé actuellement ne doit
pas faire oublier que le diagnostic d’une IOAC est aussi, la plupart du temps, le résultat
de la prise en charge d’une situation infectieuse au départ simple mais qui, en raison
du non-respect de certaines recommandations, a abouti à une IOAC. Il paraît donc
important de penser dès à présent à l’organisation d’actions de prévention des IOAC
etdeformation-information des praticiens orthopédistes dont il est utile de rappeler
qu’ils exercent, pour la grande majorité d’entre eux, dans des centres non CA/CRIOAC.
Enfin, la mise en place de cette machine complexe n’est pas incompatible
avecl’intérêt que pourrait représenter la création d’un groupe multidisciplinaire
national, qui aurait pour vocation l’organisation de la recherche clinique et fondamentale
dans le domaine des IOAC, et, même, des infections sur matériel au sens large. Il suffit
de jeter un coup d’œil à l’activité considérable de publication dans ce domaine de la part
de nos collègues espagnols ces 10 dernières années pour nous en convaincre.
Liens d’intérêts. Éric Senneville
déclare avoir des liens d’intérêts
avec Sanofi-Aventis, MSD, Pfizer
etNovartis.
Henri Migaud déclare avoir une
activité ponctuelle de consultant
pour l’éducation et la recherche
pour Zimmer et Tornier.
AVIS AUX LECTEURS
Les revues Edimark sont publiées en toute indépendance et sous l’unique et entière responsabilité du directeur de la publication et du rédacteur
en chef.
Le comité de rédaction est composé d’une dizaine de praticiens (chercheurs, hospitaliers, universitaires et libéraux), installés partout en France,
qui représentent, dans leur diversité (lieu et mode d’exercice, domaine de prédilection, âge, etc.), la pluralité de la discipline. L’équipe se réunit 2
ou 3 fois par an pour débattre des sujets et des auteurs à publier.
La qualité des textes est garantie par la sollicitation systématique d’une relecture scientifi que en double aveugle, l’implication d’un service de
rédaction/révision in situ et la validation des épreuves par les auteurs et les rédacteurs en chef.
Notre publication répond aux critères d’exigence de la presse :
· accréditation par la CPPAP (Commission paritaire des publications et agences de presse) réservée aux revues sur abonnements,
· adhésion au SPEPS (Syndicat de la presse et de l’édition des professions de santé),
· indexation dans la base de données INIST-CNRS et liens privilégiés avec la SPILF,
· déclaration publique de liens d’intérêts demandée à nos auteurs,
· identifi cation claire et transparente des espaces publicitaires et des publi-rédactionnels en marge des articles scientifi ques.
1
/
2
100%