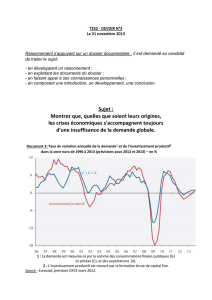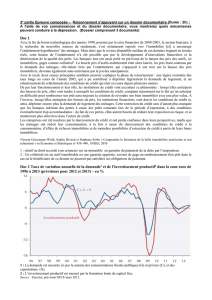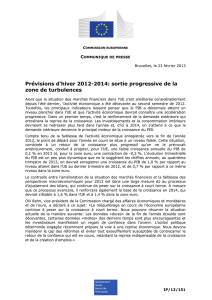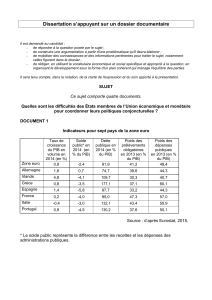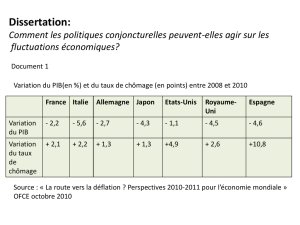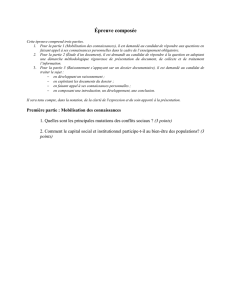N° 79 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

N° 79
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 novembre 2000
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la Délégation du Sénat pour la planification (1) sur les
perspectives macroéconomiques à moyen terme (2000-2005),
Par M. Joël BOURDIN,
Sénateur.
(1). Cette délégation est composée de : M. Joël Bourdin, président ; MM. Serge
Lepeltier, Marcel Lesbros, Georges Mouly, Jean-Pierre Plancade, vice-présidents ; M. Pierre André,
Mmes Odette Terrade, secrétaires ; Janine Bardou, MM. Alain Hethener, Patrick Lassourd, Henri Le
Breton, Daniel Percheron, Roger Rinchet, Gérard Roujas, Alain Vasselle, membres.
Prévisions et projections économiques - Chômage - Consommation - Croissance potentielle - Déficit public -
Dépenses de santé - Dette publique - Dollar - Échanges extérieurs - Économie mondiale - Emploi - États-Unis -
Finances sociales - Fonction publique - Inflation - Investissement - Modèles macroéconomiques - Nouvelles
technologies - Politique budgétaire - Population active - Productivité - Réduction de la durée du travail - Taux de
change - Taux d’intérêt.

- 2 -
SOMMAIRE
Pages
PRESENTATION................................................................................................................5
CHAPITRE I : L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL A MOYEN TERME...............7
I. L’ECONOMIE MONDIALE : DES PREVISIONS OPTIMISTES MAIS DES
INCERTITUDES NON NEGLIGEABLES.....................................................................7
A. DES PREVISIONS OPTIMISTES ....................................................................................7
B. DES INCERTITUDES NON NEGLIGEABLES .................................................................9
1. Le prix du pétrole.........................................................................................................9
2. Les marchés financiers...............................................................................................10
II. LA CROISSANCE EUROPEENNE A MOYEN TERME ...........................................12
A. LA “ NOUVELLE ECONOMIE ” : L’ETAT DU DEBAT.................................................12
1. La “ nouvelle économie ” aux Etats-Unis.....................................................................13
a) Les technologies de l’information et de la communication accélèrent-elles la
croissance ?.............................................................................................................13
b) La “ nouvelle économie ” suscite-t-elle une croissance plus stable ?..........................20
2. La “ nouvelle économie ” en France et en Europe........................................................21
a) Des retards importants dans les secteurs producteurs ................................................21
b) Quel impact sur la croissance et l’emploi en France ? ...............................................24
3. Conclusion..................................................................................................................25
B. LA DEPRECIATION DE L’EURO : CAUSES ET CONSEQUENCES ..............................26
1. Pourquoi l’euro se déprécie-t-il depuis janvier 1999 ?..................................................27
a) L’écart de taux d’intérêt entre la zone euro et les Etats-Unis : une explication
valable seulement jusqu'à la mi-1999 ?.....................................................................27
b) Le différentiel de croissance entre la zone euro et les Etats-Unis ...............................28
c) Le développement des investissements directs de la zone euro vers les Etats-Unis ......30
d) La faiblesse de l’union politique de la zone euro.......................................................30
2. Quel est le “ bon ” taux de change de l’euro ?.............................................................33
a) L'approche “ traditionnelle ”, à partir de considérations de compétitivité : 1 euro
pour 1 dollar ?.........................................................................................................33
b) L'approche par la balance des paiements courants : des résultats incertains................34
3. Quelles sont les conséquences de la dépréciation de l’euro ?........................................35
4. Quelle sera l’évolution du taux de change de l’euro ? ..................................................36
5. Conclusion..................................................................................................................37
CHAPITRE II : PERSPECTIVES MACROECONOMIQUES A MOYEN TERME
POUR L’ECONOMIE FRANÇAISE.................................................................................38
I. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS D’UNE PROJECTION DE L’ECONOMIE
FRANÇAISE A L’HORIZON 2005 ..............................................................................38
A. LA DEMANDE INTERIEURE SOUTIENT LA CROISSANCE........................................38
1. La demande intérieure à moyen terme..........................................................................38
2. La croissance à moyen terme.......................................................................................39
3. La décrue du chômage.................................................................................................40

- 3 -
B. L’IMPACT DE L’AUGMENTATION DU PRIX DU PETROLE .......................................41
1. Quel a été l’impact en l’an 2000 de l’augmentation du prix du pétrole ?.......................41
2. Quelle pourrait être l’évolution du prix du pétrole au cours des cinq prochaines
années ? .....................................................................................................................41
3. Quel serait l’impact d’un prix du pétrole plus élevé que prévu en l’an 2001 ?...............42
4. Conclusion..................................................................................................................44
II. DOIT-ON ENVISAGER UN RETOUR DE L’INFLATION ?......................................46
A. SELON LES PRINCIPAUX SCENARIOS A MOYEN TERME, L’INFLATION
ANNUELLE RALENTIRAIT EN L’AN 2001 ET ACCELERERAIT A PARTIR DE
L’AN 2003, POUR ATTEINDRE UN TAUX DE L’ORDRE DE 2%.................................46
1. L’inflation à court terme .............................................................................................47
2. L’inflation à moyen terme............................................................................................48
B. DES SCENARIOS D’INFLATION PLUS RAPIDE SONT ENVISAGEABLES..................48
1. L’inflation à court terme .............................................................................................48
2. L’inflation à moyen terme............................................................................................51
3. Conclusion..................................................................................................................52
III. SYNTHESE COMPARATIVE DES PREVISIONS A MOYEN TERME ...................53
A. LE SCENARIO A MOYEN TERME ELABORE PAR L’INSEE.......................................53
B. LA PREVISION DU BIPE ..............................................................................................55
C. LA PREVISION DE REXECODE ...................................................................................55
CHAPITRE III : LES TENDANCES DES FINANCES PUBLIQUES ...............................58
I. L’EQUILIBRE A MOYEN TERME DES FINANCES PUBLIQUES ............................58
A. L’EQUILIBRE DES FINANCES PUBLIQUES PEUT-IL ETRE ATTEINT EN L’AN
2005 ? ...........................................................................................................................58
1. Les hypothèses de l’OFCE...........................................................................................58
2. La projection de l’OFCE.............................................................................................59
B. DES SCENARIOS MOINS FAVORABLES SONT ENVISAGEABLES ............................60
1. Le déficit public pourrait s’accroître en l’an 2001 du fait d’une croissance moins
forte ...........................................................................................................................60
2. Les dépenses publiques pourraient augmenter plus rapidement que prévu .....................62
II. LE PLAN GOUVERNEMENTAL DE BAISSE DES IMPÔTS : QUELLES
CONSÉQUENCES ?.....................................................................................................63
A. LE PLAN DE BAISSE DES IMPOTS..............................................................................63
B. QUEL IMPACT ? ...........................................................................................................64

- 4 -
ANNEXE
UNE PROJECTION DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE (2000-2005)................................................... 67
Réalisée à l’aide du modèle e-mod.fr de l’OFCE (cette annexe est précédée d’un
sommaire détaillé)

- 5 -
PRÉSENTATION
LA DÉLÉGATION POUR LA PLANIFICATION
Depuis sa création par la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la
planification, la Délégation pour la Planification du Sénat présente chaque
année, au moment de la discussion budgétaire, la synthèse de travaux de
projection et de simulation, réalisés à l’aide de modèles économétriques.
Ces travaux sont commandés par le Service des Etudes du Sénat à des
instituts “ indépendants ”, tels que le Centre d’Observation Economique
(COE) de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, ou l’Observatoire
français des conjonctures économiques (OFCE).
Le choix de passer commande à des organismes extérieurs, de
préférence à l’utilisation et à l’exploitation directes d’un modèle par le Sénat,
obéit à la fois à des considérations de bonne gestion des deniers publics et au
souci de garantir l’indépendance scientifique de ces travaux.
LES PROJECTIONS MACROECONOMIQUES
Comme votre Délégation l’a souvent rappelé, une projection ne
constitue qu’une prolongation du passé et, de ce fait, qu’une extrapolation
des tendances en cours.
Ainsi, la Délégation pour la Planification ne prétend-elle pas, en
présentant ces travaux, fournir une prévision et, encore moins, une évolution
probable de l’économie française.
L’intérêt d’une projection est d’illustrer les questions et les choix
devant lesquels se trouvent aujourd’hui les responsables de la politique
économique, en décrivant un scénario dont la cohérence globale est garantie,
l’utilisation des modèles en “ variante ” permettant par ailleurs d’étudier des
scénarios alternatifs.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
1
/
106
100%