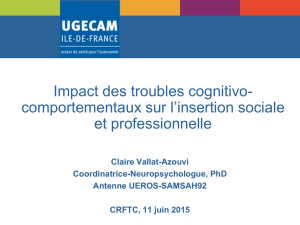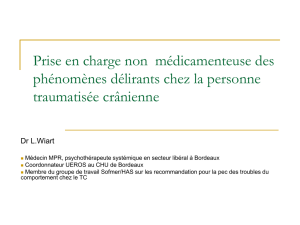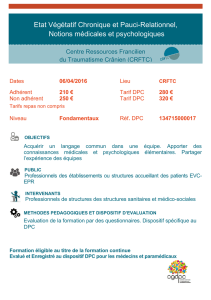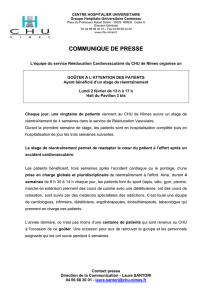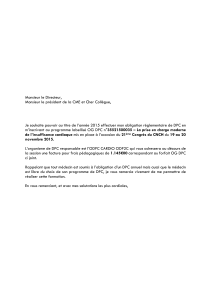Le réseau UEROS :

390 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 11 - décembre 2009
VIE PROFESSIONNELLE
Le réseau UEROS :
pour l’évaluation et l’accompagnement
à l’insertion socioprofessionnelle
des blessés traumatisés crâniens
E. Eusop-Roussel*
* Centre de Coubert, antenne UEROS,
URSP, Coubert, et antenne UEROS,
pavillon Marguerite-Bottard, service
du Pr Baulac, hôpital de la Pitié-Salpê-
trière, Paris.
P
our le patient accidenté, au-delà de l’acci-
dent lui-même et d’un parcours médicalisé
parfois très long, le retour à domicile est
une phase délicate. La personne qui a présenté un
traumatisme crânien (TC) est en effet confrontée
aux nécessités d’adaptation à son environne-
ment familial, social et professionnel, mais avec
des troubles spécifiques (troubles cognitivo-
comportementaux, perturbation de la sphère
psycho-affective), souvent mal identifiables et
compréhensibles pour elle-même et pour ses
proches (handicap nommé “invisible”) [1]. L’impact
de ces troubles favorise beaucoup la désadapta-
tion sociale (rupture familiale, perte des amis, de
l’emploi), d’où la nécessité d’un accompagnement
approprié.
Si à peine 5 % des blessés vivent en institution après
la phase de rééducation, la plupart récupèrent une
autonomie satisfaisante pour les actes élémentaires
de la vie quotidienne. En revanche, de nombreux
patients restent dépendants pour les activités plus
élaborées (faire les courses, se déplacer, gérer son
budget, anticiper ses besoins, etc.). Ils ne pourront
pas reprendre d’activité professionnelle, et se retrou-
vent déstabilisés devant la formulation d’un nouveau
projet de vie.
Lorsqu’elle est envisageable, la réinsertion au travail
est un enjeu essentiel dans la prise en charge de ces
blessés, souvent jeunes et actifs avant leur accident.
Deux types de facteurs sont assez bien prédictifs
de cette réinsertion : ceux liés à la sévérité du TC
(score de Glasgow, niveau d’autonomie acquis
après le TC) et ceux liés aux données sociodémo-
graphiques (âge, situation socioprofessionnelle et
familiale antérieure, stabilité du travail antérieur,
niveau d’études, etc. [2].
L’enquête Lebeau, publiée en 1995, souligne bien
la complexité et la spécificité des situations des
personnes à distance de leur TC, ainsi que la néces-
sité d’un accompagnement adapté. Un an après
la parution de cette enquête, les Unités d’Évalua-
tion, de Réentraînement et d’Orientation Sociale
et/ou professionnelle (UEROS) ont été créées par
une circulaire ministérielle (circulaire n° 96-428
du 4 juillet 1996, mise à jour par le décret n° 2009-
299 du 17 mars 2009). En 1997, 10 UEROS sont ainsi
ouvertes, et 29 couvrent actuellement le territoire
français, dont une pour enfants à Saint-Maurice (94).
La circulaire prévoit que l’UEROS se situe dans un
centre de réadaptation professionnelle (CRP). Il existe
très souvent une collaboration par convention avec
un CHU ou un centre de médecine physique et de
réadaptation (MPR) qui accueille une antenne UEROS.
L’Île-de-France dispose, par exemple, de 2 UEROS :
l’une à Évry (91) et la seconde à Coubert (77). Celle de
Coubert siège au pôle de réadaptation professionnelle
du centre de Coubert. Elle dispose de 2 antennes
en CHU (l’hôpital Raymond-Poincaré à Garches et
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris), d’une antenne
en établissement MPR (CMPJA de Bouffémont) et
d’une antenne sur le pôle SSR du centre de Coubert.
À quel moment et pourquoi
s’adresser à une UEROS ?
L’UEROS est un dispositif médico-social accueillant
des adultes cérébro-lésés (pathologies acquises : TC,
accident vasculaire cérébral [AVC], tumeur, etc.),
– à distance de la lésion cérébrale – en demande
d’orientation sociale et/ou professionnelle. L’ac-
compagnement UEROS se situe après la phase de
soins de rééducation, après un retour à domicile

Rééducation
Expressions de troubles
– Moteurs
– Cognitifs
– Comportementaux
– Psycho-affectifs
Retour au domicile
– Rééducation
– Réadaptation
– Réinsertion sociale ?
– Réinsertion professionnelle ?
– Ampleur des séquelles ?
Phase aiguë
– Réanimation
– Chirurgie, etc.
UEROS
MDHP
– Partenaires sociaux
– Médecins
– MPR, etc.
CAJ
FAM
MAS
SAMSAH
SAVS, etc.
Continuité de l’accompagnement
Accident
Rupture
du parcours
de vie
pour la personne
et ses proches
Figure 1. Continuité de prise en charge d’un blessé traumatisé crânien.
Figure 2. Le parcours dans un dispositif UEROS.
1 - Accueil de consultation
Analyse de la demande
Propositions d’orientation
Maintien dans l’emploi
Prises en charges médico-sociales
2 - Évaluation des lésions,
déficiences et aptitudes
2 - Réorientation
vers le réseau de partenaires
avec une démarche de solutions alternatives
3- Stage UEROS (15 à 18 semaines)
Réentraînement socio-professionnel
Émergence et élaboration d’un projet social ou professionnel
Validation du projet
Proposition d’orientation
4 - Suivi de la personnne dans sa nouvelle orientation
Décision MDPH
Soins
La Lettre du Neurologue • Vol. XIII -n° 11 - décembre 2009 | 391
VIE PROFESSIONNELLE
effectif ou au cours d’une prise en charge en foyer
d’accueil médicalisé (FAM) ou en centre d’accueil
de jour (CAJ) et doit s’inscrire dans la continuité du
parcours de réadaptation (figure 1).
Le plus souvent, l’UEROS est sollicitée pour des
questions professionnelles.
▶ Un avis concernant la reprise d’une activité profes-
sionnelle : est-elle possible ? Est-elle prématurée ?
Nécessite-t-elle des aménagements (temps partiel,
tutorat, etc.), un reclassement sur un autre poste de
l’entreprise, une réorientation sur un autre secteur
professionnel ? Est-elle possible en milieu ordinaire,
en ESAT ? etc.
▶ Un avis, des conseils et un suivi pour un maintien
dans l’emploi avec la collaboration du médecin du
travail.
▶ Aider à l’élaboration d’un nouveau projet profes-
sionnel réaliste en adéquation avec le profil cogni-
tivo-comportemental et les capacités physiques.
▶ Argumenter sur la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH), en lien avec la MDPH.
▶ Aider à renoncer à une insertion professionnelle
et formaliser l’impossibilité du retour à l’emploi.
L’UEROS est également sollicitée pour des problé-
matiques d’insertion sociale.
▶ Aider à l’élaboration d’un projet de vie (activités
occupationnelles de loisirs, vie associative, béné-
volat).
▶ Développer l’autonomie pour les actes élaborés
de la vie quotidienne par le biais de mises en situa-
tion répétée.
▶ Évaluer et reconnaître le handicap pour la
personne elle-même, vis-à-vis de ses proches et de
la société (en motivant, par exemple, des prestations
de type AAH, invalidité, etc.).
▶ Évaluer les besoins d’accompagnement et les
moyens de compensation : aides humaines et
services d’accompagnement (tierce personne, service
d’accompagnement à la vie sociale [SAVS], service
d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés [SAMSAH]), les services (services aux
transports, etc.), la protection juridique, etc.

Formation
ESAT
Occupationnel
FAM
Pôle emploi
Figure 3. Exemples d’orientation à l’issue du stage
UEROS de Coubert en 2008.
392 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 11 - décembre 2009
VIE PROFESSIONNELLE
Les missions des UEROS :
le déroulement d’un parcours
(figure 2)
Accueillir, informer, conseiller
L’UEROS est un lieu de conseils et d’informations,
pour les personnes, leurs familles mais aussi les
professionnels, concernant les dispositifs d’accompa-
gnement, les prérequis à l’insertion professionnelle,
les démarches administratives, etc.
Évaluer les capacités et les séquelles
physiques et neuropsychologiques
Les évaluations médicale, psycho-comportementale
et cognitive de la personne accueillie à l’UEROS sont
souvent réalisées en antenne UEROS, au CHU ou au
centre MPR. Elles sont proposées de manière quasi
systématique pour faire un état des lieux quant aux
séquelles cognitives, comportementales et psycho-
logiques (car les troubles peuvent évoluer durant de
longues années ; ils sont souvent méconnus et/ou mal
compris de l’entourage, mais aussi de la personne elle-
même). Il s’agit, dans la majorité, des cas d’un examen
neuropsychologique comprenant des tests psychomé-
triques et des entretiens. Cette évaluation peut être
complétée, si besoin est, et en fonction des profils
cliniques, d’une consultation médicale spécialisée
(psychiatrie), d’une évaluation psychologique. Cet état
des lieux permet de repérer les éléments qui devront
être pris en compte dans le parcours d’insertion :
psychopathologie, conduites addictives, expertise
en cours, précarité sociale, difficultés familiales, inter-
ventions chirurgicales à venir, etc. L’évaluation permet
également d’apprécier la faisabilité d’un programme
de réentraînement et d’élaboration de projet.
Élaborer un programme de réentraînement
Mettre au point un programme de réentraînement
permet de :
– consolider et accroître l’autonomie et les acquis
obtenus en rééducation fonctionnelle et au domicile ;
– construire un projet d’insertion sociale et/ou
professionnelle.
Cette phase se déroule sous la forme d’un stage de
15 à 18 semaines, en CRP, via une notification de la
MDPH. Les personnes accueillies ont un statut de
stagiaire de la formation professionnelle. Le stage se
divise en 3 phases : l’évaluation ; le réentraînement ;
l’élaboration de projet et la confirmation du projet. Les
équipes d’accompagnement sont pluri disciplinaires
(formateurs, ergothérapeutes, psychologues, assistante
sociale, médecin) et proposent des prises en charge
individuelles et collectives avec des supports variés
adaptés aux besoins de la personne : essai en apparte-
ment thérapeutique, entraînement pour l’utilisation des
transports, gestion d’un budget et des aspects admi-
nistratifs, stage en entreprise, enquête métiers, entraî-
nement sur des activités de français/mathématiques,
apprentissage de moyens de compensation des troubles
cognitifs, groupes de parole, sport, etc. Les objectifs
du stage sont définis avec la personne, en fonction de
ses besoins en réentraînement (ils peuvent porter sur
des aptitudes cognitives ou sur les aspects psycho-
comportementaux) et du projet de vie à travailler
(projet d’insertion sociale, projet professionnel).
À l’issue du stage, différentes orientations sont
envisageables : accueil en structure médico-sociale
type FAM, retour au domicile avec mise en place
d’activités occupationnelles et socialisantes asso-
ciées au non à l’intervention d’une équipe mobile
de type SAMSAH-SAVS, orientation en formation
qualifiante, maintien dans l’emploi, insertion en
ESAT, etc. (figure 3).
Transmission des éléments
L’UEROS fournit aux intéressés, aux partenaires et
aux MDPH tous les éléments pour :
– déterminer ou réévaluer le niveau des capacités et
des situations de handicap (voir la partie portant sur
l’évaluation) dans la perspective d’apprécier l’évo-
lution clinique et surtout les besoins en accompa-
gnement ;
– faciliter l’orientation sociale et professionnelle.

La Lettre du Neurologue • Vol. XIII -n° 11 - décembre 2009 | 393
VIE PROFESSIONNELLE
Assurer un suivi individualisé
Le profil cognitivo-comportemental et la chronicité
des difficultés du blessé nécessitent un étayage au
long cours. Il est donc essentiel d’aider à la mise
en place des préconisations et des orientations
issues des évaluations et/ou du stage UEROS, et
de développer un réseau de partenaires autour de
la personne. Ce suivi ne supplée pas à une prise en
charge rééducative. Il favorise le lien pour éviter
l’errance du blessé dans son parcours d’insertion et
pour prévenir les ruptures. Ce suivi permet égale-
ment d’adapter les orientations en fonction des expé-
riences et de l’évolution de la personne. Les équipes
sont toutefois souvent confrontées au manque de
• Liste des UEROS: http://www.crlc-cmudd.org
• CRFTC : centre ressources francilien du traumatisme crânien
http://www.crftc.org
• FTC: France traumatisme crânien (association de profes-
sionnels du traumatisme crânien)
http://www.francetraumatismecranien.fr
• UNAFTC: union nationale des familles de traumatisés crâniens
http://www.traumacranien.org
• EBIS :
European Brain Injury Society
, association euro-
péenne d’étude des traumatisés crâniens et de leur réin-
sertion, société à vocation scientifique et sociale
http: //www.ebissociety.org
1. Leclerc M. L’insertion, dans le traumatisme crânien, guide à
l’usage des proches. Paris : Solal, 2007;153-77.
2. Vallat-Azouvi C, Galimard N, Schnitzler A et al. Facteurs prédic-
tifs de la réinsertion socioprofessionnelle des traumatisés crâniens
sévères. In: Azouvi P, Joseph PA, Pélissier J, Pellas F. Prise en charge
des traumatisés cranio-encéphaliques, de l’éveil à la réinsertion.
Paris : Masson, 2007; 193-8.
Références bibliographiques
moyens adéquats et à la carence de partenaires
avertis et/ou de structures adaptées.
Conclusion
L’UEROS intervient donc à distance de l’accident pour
évaluer le handicap et les besoins relatifs à l’insertion
sociale et/ou professionnelle de la personne, lui en
rendre compte et identifier les moyens pour y pallier.
Ces besoins sont principalement liés à des limitations
cognitivo-comportementales, parfois subtiles, mais
réduisant l’autonomie et les capacités de travail, dont
le patient ne se plaint pas toujours. L’UEROS offre un
accompagnement spécifique et individuel, sous la forme
d’une évaluation, puis d’une phase de réentraînement
et d’élaboration de projet, et en privilégiant la création
d’un réseau de partenaires autour de la personne pour
faciliter l’insertion et éviter les ruptures. ◾
Les acronymes se suivent et ne se ressemblent pas…
Le DPC nouveau est arrivé
Isabelle de Gaudemar (service ORL, hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Paris)
Il y avait l’EPP, la FMC... Voilà le DPC ou
“développement professionnel continu”.
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
“Hôpital, patients, santé et territoires”
(HPST), dans son article 19, devrait aussi
mettre fin à la longue traversée du désert
de la FMC, obligatoire mais non reconnue
depuis 1996, pour laisser place au DPC.
Le DPC est déjà actif dans presque tous les
pays européens et en Amérique du Nord.
Le but est toujours le même : améliorer
les pratiques médicales, en montrant que
les connaissances sont à jour, par l’inter-
médiaire d’une forme d’évaluation mise au
point par des organismes agréés.
Sur le fond, le DPC, rassemblant l’EPP et la
FMC, permet de sortir du faux débat entre
l’évaluation et la formation.
Sur la forme, avant même la sortie des
décrets d’application, plusieurs dispositions
du DPC semblent déjà très lourdes et bien
compliquées, avec un Conseil national de
DPC, une commission scientifique indé-
pendante et un organisme gestionnaire.
À l’heure des hyperspécialisations, un seul
thème annuel par spécialité sera prioritaire.
Les autres principales nouveautés sont
l’implication plus importante du Conseil de
l’Ordre, et des évaluations identiques quel
que soit le statut du médecin : libéral, hospi-
talier, universitaire. Enfin, la question cruciale
du financement est aussi générale que floue.
Au final, quel est l’intérêt de monter une
telle usine à gaz ? L’objectif est toujours le
même depuis 15 ans : tenter de réduire le
déficit abyssal de la Sécurité sociale, avec
le peu de succès que l’on sait.
Et si l’on faisait confiance aux médecins ?
Et si le meilleur DPC était celui organisé par
les praticiens eux-mêmes, au contact de la
maladie et des malades plutôt que par les
bureaucrates des ministères ?
Roselyne Bachelot devrait y penser. Ce serait
une vraie rupture, celle qu’appelait de ses
vœux le président Sarkozy en 2007. ◾
© La Lettre de l’ORL - n° 319 - octobre-novembre-
décembre 2009.
1
/
4
100%