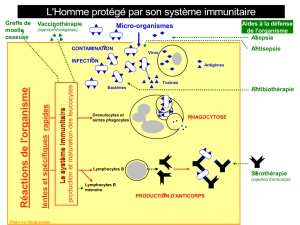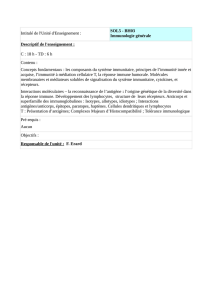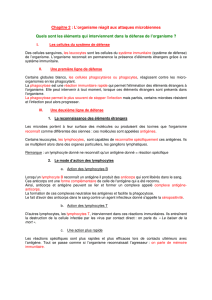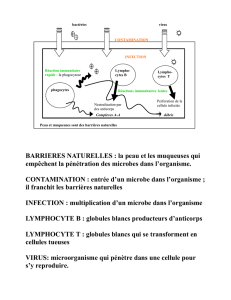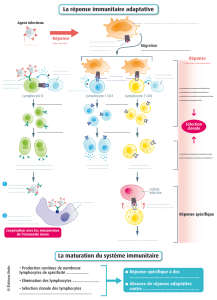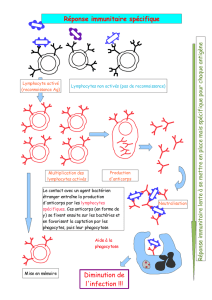RôLE dU LYMPhOcYtE b EN PathOLOgIE RéNaLE

- 105 -
RôLE dU LYMPhOcYtE b
EN PathOLOgIE RéNaLE
PhiliPPe rieu
Service de Néphrologie
Reims
Les lymphocytes B jouent un rôle essentiel dans la réponse immunitaire, en patrouillant
l’organisme à la recherche d’antigènes du « non soi », en présentant les antigènes
aux lymphocytes T et en produisant des anticorps. Les cellules B matures captent
les antigènes avec le récepteur des cellules B (BCR). L’interaction entre BCR et
l’antigène active le lymphocyte B et entraîne l’expression des molécules B7 (B7.1 et
B7.2) et l’internalisation de l’antigène, qui est dégradé pour être présenté sous forme
de peptides associés au complexe majeur d’histocompatibilité aux lymphocytes T. Le
lymphocyte B ne peut achever son programme d’excrétion d’immunoglobuline de
haute afnité qu’en collaboration avec le lymphocyte T CD4. Ce dernier, activé par le
lymphocyte B présentant l’antigène et les molécules de co-stimulations (molécules
B7), exprime CD40L et des cytokines (IL4, IL5) qui permettent la différenciation du
lymphocyte B en plasmocyte ou lymphocyte B mémoire [1].
Les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires (ganglions lymphatiques,
rate, système lymphoïde associé aux muqueuses ou MALT pour Mucosae-associated
lymphoid tissue) sont conçus pour organiser le rendez vous entre l’antigène et le
système immunitaire an d’initier la réponse immunitaire spécique. Des structures
similaires appelées organes lymphoïdes tertiaires peuvent apparaître dans les tissus
soumis à une inammation chronique. Les chémokines jouent un rôle important
dans le positionnement des lymphocytes dans les organes lymphoïdes. Les cellules
B naïves qui sortent de la moelle expriment le récepteur CXCR5 et se localisent
dans les follicules lymphoïdes des organes lymphoïdes périphériques attirées par
la chémokine CXCL13/BLC (ligand de CXCR5) produite par les cellules folliculaires
stromales. Après avoir rencontré l’antigène, les lymphocytes B expriment le récepteur
CCR7 et vont être ainsi attirée vers la zone paracorticale T dépendant.
Les lymphocytes B sont rendus tolérants aux antigènes du soi par délétion clonale,
par anergie, par révision (« receptor editing » : qui conduit à un recommencement du
réarrangement et la formation d’un nouvel anticorps de spécicité différente) ou par
régulation extrinsèque. Les antigènes sont reconnus par les lymphocytes B comme
des antigènes du soi si 1) ils sont présents durant la maturation lymphocytaire ; 2)
ils sont en concentration élevée et constante dans l’organismes ; et 3) ils n’activent
pas l’immunité innée [1].
La rupture de tolérance par les lymphocytes B peut conduire à des maladies
autoimmunes impliquant la production d’auto-anticorps. Ces maladies peuvent

- 106 -
être spéciques d’organes, secondaires à une réaction anticorps dirigée contre
des antigènes dont la distribution tissulaire est limitée (glomérulonéphrite
extramembraneuse, syndrome de goodpasture), ou être systémiques lorsque les auto-
antigènes sont ubiquitaires (lupus systémique, syndrome des antiphospholipides) ou
circulants (cryoglobulinémie). Les lymphocytes B semblent aussi impliqués dans les
maladies inammatoires chroniques indépendamment de la production d’anticorps.
Le rôle pathogène des anticorps a été clairement démontré dans plusieurs maladies
rénales. En ce qui concerne les GEM, les modèles expérimentaux ont montré
l’implication d’anticorps dirigés contre des antigènes podocytaires. La description
d’une glomérulonéphrite extra membraneuse induite par une allo-immunisation
foetomaternelle contre un antigène podocytaire a démontré l’implication des anticorps
anti-antigènes podocytaires dans la physiopathologie de cette glomérulonéphrite
chez l’homme [2]. De même, le rôle pathogène des ANCA a été démontré chez la
souris en induisant la maladie par transfert passif d’anticorps anti-MPO [3]. L’existence
de cas de vascularite chez le nouveau né induit par passage maternofoetale des
ANCA maternels plaide pour un rôle pathogène des ces anticorps chez l’homme [4].
Dans d’autres affections telles que le syndrome des antiphospholipides, les données
expérimentales et cliniques ne permettent pas de savoir si les auto-anticorps détectés
sont des marqueurs ou des acteurs de la pathologie.
A côté du rôle pathogène des auto-anticorps, le lymphocyte B pourrait être impliqué
dans les maladies dysimmunitaires en activant la réponse lymphocytaire T. Dans
le modèle de souris lupique MLR/lpr, les lymphocytes B sont indispensables à
l’apparition de la maladie [5]. Par contre la présence d’anticorps circulants n’est
pas nécessaire. En effet, une mutation des lymphocytes B de ces souris qui inhibe
la sécrétion des immunoglobulines sans en bloquer l’expression membranaire
n’empêche pas le développement de la maladie [6]. Dans ce modèle, les cellules
B autoréactives jouent un rôle important dans la progression de la maladie en
activant les cellules T.. Dans les néphropathies interstitielles primitives ou associées
à une néphropathie à IgA, l’inltration lymphocytaire B prédomine [7]. Dans un
tiers des cas, les inltrats forment des structures lymphoïdes tertiaires entourés
de néolymphatiques. Ces structures ont aussi été décrites dans la néphropathie
lupique et dans les vascularites à ANCA [8]. Ces organes lymphoides tertiaires (OLT)
sont retrouvés dans de nombreuses maladies inammatoires chroniques telles
que la polyarthrite rhumatoide, la thyroidite d’Hashimoto, le syndrome de Sjogren
et les maladies inammatoires digestives [9]. Les OLT rapprochent la réponse
immunitaire de l’antigène tissulaire. Ils sont composés de cellules B, T et de cellules
dentritiques. Les lignées B, stimulées par l’antigène, se différentient dans ces OLT
avec commutation de classe et hypermutation de la partie VDJ. Cette différentiation
lymphocytaire au sein des tissus inammatoires conduit a une maturation de l’afnité
dépendante des antigènes tissulaires et ainsi à la formation de clones B autoréactifs
avec de nouvelles spécicités antigéniques. La maturation lymphocytaire B se faisant
dans des centres germinatifs ectopiques peut conduire à la génération de clones

- 107 -
B autoréactifs qui échappent à l’induction de tolérance par régulation extrinsèque.
Au décours de ce processus, la différentiation conduit, comme dans les organes
lymphoïdes secondaire, à des plasmocytes (CD38 +, CD20-) et à des lymphocytes B
mémoires (CD38-, CD20+). Les cellules B produisent des cytokines inammatoires
qui entretiennent la réaction inammatoire et qui pourraient aussi participer à la brose
tissulaire (IL-6). Elles stimulent les cellules T et activent les clones T autoréactifs en
présentant l’autoantigène. Ces éléments peuvent expliquer que certaines maladies
dyimmunitaires T puissent être améliorées par la déplétion lymphocytaire B. C’est le
cas du diabète de type 1 (souris NOD) [10], de la polyarthrite rhumatoide [11], et du
syndrome néphrotique idiopathique [12]. Il est possible aussi que les lymphocytes
B soient impliqués dans la brose tissulaire. Dans un modèle de toxicité hépatique
induit par CCl4, il a été montré que la brose hépatique dépendait de la présence
de lymphocytes B, et était indépendante de la sécrétion d’anticorps et de l’activation
des cellules T [13]. Dans un modèle de syndrome d’Alport, le décit en lymphocyte
réduit la brose interstitielle sans modier la glomérulopathie [14]. Au cours de la
greffe rénale, les lésions de brose interstitielle chronique et d’atrophie tubulaire sont
corrélées à l’inltration lymphocytaire B [15]. Les lymphocytes B sont donc impliqués
dans ces lésions. Il est cependant difcile de savoir si la présence des cellules B est
la cause ou la conséquence de la brose interstitielle.
En résumé, les lymphocytes B sont impliqués dans de nombreuses maladies
dysimmunitaires rénales. Leur rôle pathogène est lié à la production d’anticorps.
Il peut s’agir d’autoanticorps tissulaires (MBG et Syndrome de Goodpasture),
d’autoanticorps circulants (facteur rhumatoïde et cryoglobulinémie), d’autoanticorps
systémiques (anti-nucléosome et néphropathie lupique), d’autoanticorps
leucocytaires (MPO et vascularite à ANCA), ou encore d’anticorps dirigés contre
des agents infectieux (endocardite sub-aigue). Le lymphocyte B est aussi impliqué
dans les maladies dysimmunitaires indépendamment de la sécrétion d’anticorps en
activant la réponse lymphocytaire T (SN idiopathique). Enn, il pourrait participer
à la brose interstitielle rénale au cours des néphropathies interstitielles, du rejet
chronique, ou des glomérulopathies.
•

- 108 -
Références bibliographiques :
1 Janeway C, Travers P, Walport M and Shlomchik M. ImmunoBiology: the
immune system in health and disease. 2005; 6th Edition:Garland Science:
Taylor ans Francis Group
2 Debiec H, Guigonis V, Mougenot B, Decobert F, Haymann JP, Bensman A, et al.
Antenatal membranous glomerulonephritis due to anti-neutral endopeptidase
antibodies. N Engl J Med 2002; 346:2053-60
3 Xiao H, Heeringa P, Hu P, Liu Z, Zhao M, Aratani Y, et al. Antineutrophil
cytoplasmic autoantibodies specic for myeloperoxidase cause
glomerulonephritis and vasculitis in mice. J Clin Invest 2002; 110:955-63
4 Schlieben DJ, Korbet SM, Kimura RE, Schwartz MM and Lewis EJ. Pulmonary-
renal syndrome in a newborn with placental transmission of ANCAs. Am J
Kidney Dis 2005; 45:758-61
5 Shlomchik MJ, Madaio MP, Ni D, Trounstein M and Huszar D. The role of B
cells in lpr/lpr-induced autoimmunity. J Exp Med 1994; 180:1295-306
6 Chan OT, Hannum LG, Haberman AM, Madaio MP and Shlomchik MJ. A
novel mouse with B cells but lacking serum antibody reveals an antibody-
independent role for B cells in murine lupus. J Exp Med 1999; 189:1639-48
7 Heller F, Lindenmeyer MT, Cohen CD, Brandt U, Draganovici D, Fischereder
M, et al. The contribution of B cells to renal interstitial inammation. Am J
Pathol 2007; 170:457-68
8 Steinmetz OM, Velden J, Kneissler U, Marx M, Klein A, Helmchen U, et al.
Analysis and classication of B-cell inltrates in lupus and ANCA-associated
nephritis. Kidney Int 2008; 74:448-57
9 Aloisi F and Pujol-Borrell R. Lymphoid neogenesis in chronic inammatory
diseases. Nat Rev Immunol 2006; 6:205-17
10 Serreze DV, Chapman HD, Varnum DS, Hanson MS, Reifsnyder PC, Richard
SD, et al. B lymphocytes are essential for the initiation of T cell-mediated
autoimmune diabetes: analysis of a new «speed congenic» stock of NOD.Ig
mu null mice. J Exp Med 1996; 184:2049-53

- 109 -
11 Takemura S, Klimiuk PA, Braun A, Goronzy JJ and Weyand CM. T cell activation
in rheumatoid synovium is B cell dependent. J Immunol 2001; 167:4710-8
12 Guigonis V, Dallocchio A, Baudouin V, Dehennault M, Hachon-Le Camus
C, Afanetti M, et al. Rituximab treatment for severe steroid- or cyclosporine-
dependent nephrotic syndrome: a multicentric series of 22 cases. Pediatr
Nephrol 2008; 23:1269-79
13 Novobrantseva TI, Majeau GR, Amatucci A, Kogan S, Brenner I, Casola S,
et al. Attenuated liver brosis in the absence of B cells. J Clin Invest 2005;
115:3072-82
14 Lebleu VS, Sugimoto H, Miller CA, Gattone VH, 2nd and Kalluri R. Lymphocytes
are dispensable for glomerulonephritis but required for renal interstitial brosis
in matrix defect-induced Alport renal disease. Lab Invest 2008; 88:284-92
15 Moreso F, Seron D, O’Valle F, Ibernon M, Goma M, Hueso M, et al.
Immunephenotype of glomerular and interstitial inltrating cells in protocol
renal allograft biopsies and histological diagnosis. Am J Transplant 2007;
7:2739-47
•
1
/
5
100%