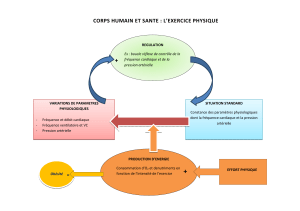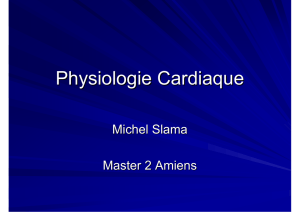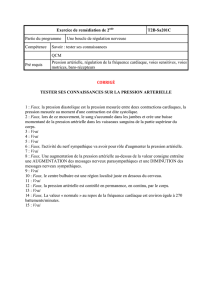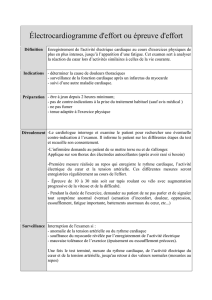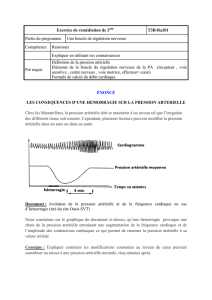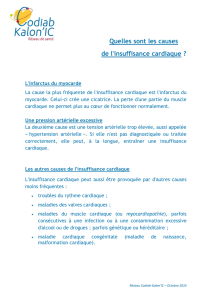Tolérance lors de l’utilisation du Viagra chez l’hypertendu traité

Act. Méd. Int. - Hypertension (10), n° 9, novembre 1998
214
Tolérance lors de l’utilisation du
Viagra®chez l’hypertendu traité
Les troubles de l’érection sont une plainte
fréquente des hypertendus traités, et la
commercialisation du Viagra®(sildefanil)
va conduire à une demande de prescrip-
tion de la “pilule bleue”. Dans le dossier
d’enregistrement du Viagra®, environ
30 % des sujets étaient des hypertendus
traités, et l’analyse de cette cohorte de
1 218 hypertendus donne des informa-
tions sur la tolérance du Viagra®par com-
paraison au placebo. Ces sujets étaient des
hypertendus traités par des antihyperten-
seurs de toutes les familles thérapeutiques,
et ces hommes d’un âge moyen de 56 ans
ont utilisé le Viagra®pendant 6 mois. Le
Viagra®permet une amélioration statisti-
quement significative de trois critères : “la
qualité de la pénétration”, “le maintien de
l’érection” et “l’amélioration de l’érec-
tion”. Ces résultats positifs sont aussi
observés chez l’hypertendu traité. Les
bénéfices sont comparables que les sujets
prennent ou non un traitement antihyper-
tenseur. Mis à part les effets secondaires
bénins connus du traitement (céphalée
14 %, flush 14 %), la tolérance cardiovas-
culaire a été comparable pour les deux
groupes, et la pression artérielle est restée
équilibrée sans que surviennent notam-
ment des épisodes d’hypotension. Il faut
rappeler que la principale contre-indica-
tion du Viagra®est sa coprescription avec
un dérivé nitré car il existe un risque d’hy-
potension ; toutefois aucune précaution
particulière n’est recommandée chez les
utilisateurs de médicaments antihyperten-
seurs. Les résultats de cette analyse, bien
que n’apportant pas les réponses à toutes
les questions que se poseront les patients
et leur médecin concernant les risques car-
diovasculaires éventuels du Viagra®, indi-
quent qu’au moins chez les hypertendus
non compliqués de la cinquantaine, cette
prescription n’expose pas à des complica-
tions cardiovasculaires. Voilà qui devrait
tout de même nous aider à conseiller nos
hypertendus se plaignant d’une dysfonc-
tion érectile.
- Feldman R. et coll. : XIIIecongrès de
l’American Society of Hypertension, New
York, 1998, Am. J. Hypertens., 1998, 11 : part
2, 10A. P.C.
Relation entre variations nycthé-
mérales tensionnelles et épisodes
ischémiques chez le coronarien
hypertendu
Chez le patient hypertendu coronarien,
l’apparition d’épisodes ischémiques
(symptomatiques ou non) peut être
secondaire soit à une augmentation de la
consommation en oxygène du myocarde
par le biais d’une poussée tensionnelle,
soit, à l’inverse, à une réduction de la
pression de perfusion coronaire du fait
d’une baisse tensionnelle. Plusieurs
études, pas toutes cependant, ont rappor-
té l’effet bénéfique de la baisse de la
pression artérielle diastolique sur le
risque d’infarctus du myocarde, jusqu’à
une valeur seuil de pression artérielle
diastolique en deçà de laquelle le risque
d’infarctus augmente (courbe en J).
Dans le même sens, des épisodes passés
inaperçus de baisse tensionnelle noctur-
ne pourraient expliquer l’absence de
bénéfice franc du traitement antihyper-
tenseur sur le risque d’événement coro-
narien. L’intérêt, entre autres, de la
mesure ambulatoire de la pression arté-
rielle est d’avoir révélé que le profil ten-
sionnel nycthéméral n’est pas uniforme
chez l’hypertendu. Certains patients,
appelés “non-dippers”, n’ont pas de
baisse tensionnelle nocturne contraire-
ment aux “dippers” et aux “over-dip-
pers”. Des épisodes d’ischémie sympto-
matique ou indolore ont été détectés
chez des coronariens stables normoten-
dus, de même que chez des hypertendus
avec ou sans coronaropathie clinique. Il
semble que ces épisodes ischémiques
objectivés par un holter ECG, par
exemple, soient de mauvais pronostic
chez le coronarien stable.
L’étude récemment publiée dans le JACC
a montré, pour la première fois, l’in-
fluence des variations nycthémérales de
la tension artérielle sur le déclenchement
d’épisodes ischémiques chez des hyper-
tendus coronariens. Vingt et un patients
“non-dippers” (pas de chute tensionnelle
nocturne), 35 “dippers” (chute tension-
nelle de 10 à 20 % de la pression artériel-
le diurne) et 14 “over-dippers” (chute ten-
sionnelle de plus de 20 %) ont simultané-
ment bénéficié d’un holter tensionnel et
ECG. Ces deux enregistrements ont été
effectués avant traitement antihyperten-
seur (nitré + aténolol ou nitré + vérapamil)
et après un mois de traitement par l’une ou
l’autre des deux associations.
Le traitement a significativement réduit la
pression artérielle dans chacun des trois
groupes. En période diurne, la fréquence
et la durée des épisodes ischémiques sont
identiques dans les trois groupes avant ou
après traitement. Avant traitement, en
période nocturne, les épisodes isché-
miques sont plus fréquents chez les “non-
dippers”. Après traitement, ils diminuent
chez les “non-dippers”, restent inchangés
chez les “dippers” et augmentent chez les
“over-dippers”. Au cours du traitement,
les épisodes ischémiques sont plus fré-
quents chez les “over-dippers”. Au cours
du traitement, les épisodes ischémiques
sont plus fréquents chez les “over-dip-
pers” que chez les autres.
Cette étude suggère donc, pour la pre-
mière fois, une relation entre les varia-
tions nycthémérales de la pression arté-
rielle et épisodes ischémiques détectés
par un enregistrement holter ECG. Elle
prouve tout l’intérêt du monitoring
ambulatoire de la pression artérielle chez
le coronarien hypertendu. Elle montre,
en effet, l’intérêt de diminuer la pression
artérielle nocturne chez les “non-dip-
Revue de presse
Patrice Colin, Xavier Girerd

215
pers” et les dangers d’une baisse trop
profonde de la pression chez les “over-
dippers”, pour lesquels la prise vespérale
d’un antihypertenseur est à déconseiller.
- Pierdomenico S.D. et coll. : Circadian blood
pressure changes and myocardial ischemia in
hypertensive patients with coronary artery disea-
se. J. Am. Coll. Cardiol., 1998, 31 : 1627-34.
P.C.
Patient “dipper” et “non-dipper” :
une caractéristique non reproductible
La pratique d’enregistrements de la
MAPA a conduit à différencier des
sujets chez lesquels une baisse de la
pression artérielle était notée au cours
de la période nocturne. Ces sujets appe-
lés “dippers” ont été opposés aux “non-
dippers” dont la pression artérielle ne
baissait pas la nuit. Le pronostic cardio-
vasculaire des patients “non-dippers”
ayant été décrit comme moins bon que
celui des patients “dippers”, porter ce
diagnostic avec certitude est potentiel-
lement important. La reproductibilité
de ce paramètre a été étudiée sur un
groupe de sujets normotendus ou
hypertendus non traités, à partir de l’en-
registrement de deux MAPA à une
semaine d’intervalle. Ces deux enregis-
trements ont été effectués dans des
conditions différentes, au cours d’une
journée d’hospitalisation et en ambula-
toire. Aucune corrélation entre les dif-
férents indices qui caractérisent les
patients “dippers” et “non-dippers”, n’a
été retrouvée. Ainsi, la baisse tension-
nelle nocturne semble dépendre de
façon prépondérante des circonstances
de l’enregistrement de la MAPA. Le
caractère “dipper” ou “non-dipper”,
n’est donc pas une caractéristique de
l’individu mais plutôt celle des circons-
tances de l’enregistrement.
- Dimsdale J.E. et coll. : How reliable is night
time blood pressure dipping ? Am. J.
Hypertens., 1998, 11 : 606-9. X.G.
Absence de relation entre la varia-
bilité tensionnelle et l’hypertrophie
cardiaque
Le “bon sens” physiopathologique vou-
drait que la variabilité de la pression
artérielle constitue le marqueur d’un
risque augmenté de maladie cardiovas-
culaire chez l’hypertendu. Mais jusqu’à
présent les preuves scientifiques en
faveur de cette hypothèse sont restées
peu nombreuses. En cherchant à mettre
en évidence une relation entre la pré-
sence d’une hypertrophie ventriculaire
gauche échographique et la variabilité
tensionnelle dans une population de
1 822 hypertendus non traités, l’équipe
de Schillaci a tenté de conforter cette
hypothèse. Pour estimer la variabilité ten-
sionnelle, l’écart type des valeurs de
pression artérielle obtenues par MAPA
sur 24 heures a été utilisé. Cet indice de
variabilité à “court terme” a été obtenu
pour la période d’activité (en moyenne
65 mesures) et pour la période nocturne
(en moyenne 27 mesures). L’hypertrophie
ventriculaire gauche a été estimée par la
mesure de la masse cardiaque indexée à
la surface corporelle. Comme une rela-
tion positive entre la variabilité et la PAS
a été classiquement retrouvée, la popula-
tion a été divisée par quartile de PAS, et
pour chaque quartile les sujets ont été
classés en “variabilité forte” ou “variabi-
lité faible” en prenant comme valeur-
seuil la médiane de l’écart type de la
variabilité en période d’activité. Les
valeurs des masses cardiaques indexées à
l’âge ont été comparées entre le groupe
des sujets à “variabilité forte” et celui des
sujets à “variabilité faible” dans chaque
quartile de PAS. Si la masse cardiaque
augmente avec le niveau de la PAS,
aucune différence n’est observée selon le
niveau de variabilité. Dans la discussion
de leurs résultats, les auteurs rappellent
qu’au cours du suivi de 1 372 hyperten-
dus sur 9 années, la variabilité à court
terme n’était pas un facteur de risque
indépendant de complications cardiovas-
culaire. Les conclusions de cette étude ne
confirment donc pas le “bon sens”, mais
indiquent avec beaucoup de clarté que
l’atteinte des organes cibles de l’hyper-
tendu dépend avant tout du niveau moyen
de la pression artérielle du sujet. Ces
nouvelles preuves devraient aider les
médecins à se persuader que le meilleur
moyen de lutter contre la variabilité ten-
sionnelle est de faire baisser le niveau
moyen de la pression artérielle.
- Schillaci G. et coll. : Lack of association
between blood pressure variability and left
ventricular mass in essential hypertension.
Am. J. Hypertens., 1998, 11 : 6515-22. X.G.
HTA limite et réserve de flux coronaire
Une diminution de la réserve de flux coro-
naire est une des anomalies les plus pré-
coces observées dans les coronaropathies.
Chez des patients hypertendus avec ou
sans hypertrophie ventriculaire gauche, de
précédentes études ont retrouvé une dimi-
nution de la réserve de flux.
Le flux coronaire a été étudié à l’état de
base et après hyperhémie induite par le
dipyridamole, grâce à la tomographie par
émission de positrons, chez 16 sujets de
37 ans de moyenne d’âge, non fumeurs,
asymptomatiques et sans hypertrophie
ventriculaire gauche, avec une hyperten-
sion artérielle limite (140 < PA systolique
< 160 mmHg, et 90 < PA diastolique < 95
mmHg), et chez 19 sujets contrôles. Les
flux à l’état de base sont identiques dans
les deux groupes ; en revanche, la réserve
de flux coronaire est significativement
plus basse dans le groupe des hypertendus
limites.
- Laine H. et coll. : Early impairment of corona-
ry flow reserve in young men borderline hyper-
tension. J. Am. Coll. Cardiol., 1998, 32 : 147-53.
P.C.

Revue de presse
Act. Méd. Int. - Hypertension (10), n° 9, novembre 1998
216
Scintigraphie à la MIBG dans l’hyper-
tension artérielle et effets comparés
de l’énalapril et de la nitrendipine
L’hyperactivité sympathique joue un
rôle physiopathologique et pronostique
majeur dans un grand nombre de patho-
logies cardiovasculaires.
Malgré leur utilisation large, peu d’infor-
mations sont disponibles sur les effets des
anticalciques à longue durée d’action sur
l’activité sympathique cardiaque. Les
effets délétères observés avec les antical-
ciques à durée d’action courte sont certai-
nement secondaires, au moins en partie, à
une activation neurohormonale. A contra-
rio, les inhibiteurs de l’enzyme de conver-
sion, de façon indirecte (effet hémodyna-
mique bénéfique) et directe (diminution de
la libération présynaptique de la norépiné-
phrine) diminuent l’activité sympathique.
La scintigraphie cardiaque à la MIBG
permet une évaluation fiable, in vivo,
de l’activité sympathique cardiaque
(cinétique de fixation et de lavage de la
MIBG). Cet examen a été réalisé avant
et 3 mois après traitement antihyperten-
seur chez 46 patients avec une hyper-
tension artérielle modérée. Vingt-deux
patients ont été traités par 5 à 10 mg
d’énalapril et 24 par 5 à 10 mg de
nitrendipine. Vingt sujets normotendus
constituaient le groupe contrôle.
La réduction de la pression artérielle a
été identique quel que soit le traitement.
Avant traitement, dans les deux groupes
hypertendus, la scintigraphie à la
MIBG a permis d’objectiver une hyper-
activité sympathique comparée au
groupe contrôle. D’autres études, utili-
sant l’analyse spectrale ou le dosage de
norépinéphrine tritiée, ont également
retrouvé une telle hyperactivité dans
l’hypertension artérielle essentielle.
Après trois mois de traitement par IEC,
cette hyperactivité est significativement
réduite. Le traitement par nitrendipine est,
lui, sans effet sur la cinétique de la MIBG.
Connaissant le rôle pronostique péjoratif
de l’hyperactivité sympathique en patho-
logie cardiaque, ces résultats ne sont pas
sans implications cliniques potentielles.
- Sakata K. et coll. : Comparison of effects of
enalapril and nitrendipine on cardiac sympa-
thic nervous system in essential hypertension.
J. Am. Coll. Cardiol., 1998, 32 : 438-43. P.C.
Helicobacter pylori
n’est plus (un
facteur de risque coronarien)
Laissons l’Helicobacter pylori aux gas-
troentérologues et à l’ulcère digestif. Il
n’y a probablement aucun lien de causa-
lité entre séropositivité et athérome coro-
narien comme le soulignent deux études
récentes publiées dans Circulation.La
séropositivité à l’Helicobacter pylori est
retrouvée plus fréquemment chez les
patients de petite taille et de niveau
socio-économique bas. L’association
avec des taux élevés de fibrinogène, de
CRP, d’homocystéine et des taux bas de
HDL n’est pas constamment retrouvée
dans les différentes études.
- Folsom A.R. et coll. : Helicobacter pylori
seropositivity and coronary heart disease
incidence. Circulation, 1998, 98 : 845-50.
- Strachan D.P. et coll. : Relation of helico-
bacter pylori infection to 13-year mortality
and incident ischemic heart disease in the
Caerphilly prospective heart disease study.
Circulation, 1998, 98 : 1286-90.
Comment prédire l’efficacité d’une
monothérapie antihypertensive
Débuter un traitement par une monothé-
rapie est une recommandation toujours
actuelle pour le traitement de l’hyperten-
sion artérielle légère. Malheureusement,
la réponse à cette monothérapie n’est
jamais certaine, car le pourcentage de
“répondeurs” n’est que de 50 %.
Différents critères ont été proposés pour
prédire la réponse hypotensive à certains
médicaments antihypertenseurs. L’âge, la
race et le niveau de rénine sont les plus
populaires. Ainsi, il est habituel de dire
que chez les hypertendus avec une rénine
basse ce sont les diurétiques qui sont les
plus efficaces et qu’en revanche chez
ceux avec rénine haute ce sont les bêta-
bloquants et les inhibiteurs de l’enzyme
de conversion. Pour l’âge et la race, l’étu-
de des vétérans a montré que les “jeunes
noirs” répondaient mieux au diltiazem et
à l’aténolol, alors que pour les “noirs
âgés” la réponse hypotensive était maxi-
male avec l’hydrochlorothiazide et le dil-
tiazem. Par ailleurs, pour les “jeunes
blancs” la réponse optimale était obser-
vée avec le captopril et l’aténolol, alors
que pour les “blancs âgés” le diltiazem et
l’aténolol étaient les plus efficaces. En
reprenant la population de l’étude des
vétérans, une analyse de la réponse à la
monothérapie a été faite selon le niveau
de la rénine, et cette réponse a été compa-
rée à celle observée selon l’âge du sujet.
La normalisation après traitement (PAD <
90 mmHg) a été obtenue avec la clonidi-
ne et le diltiazem de façon comparable
quel que soit le niveau de la rénine.
L’hydrochlorothiazide et la prazosine ont
été plus efficaces chez les hypertendus à
rénine basse ou moyenne ; le captopril a
été plus actif chez les hypertendus à réni-
ne moyenne ou haute. Enfin, la prédiction
de réponse hypotensive à une monothéra-
pie est meilleure lorsque l’on se base sur
le profil “âge-race” que lorsque l’on se
base sur le niveau de rénine.
- Preston R.A. et coll. : Age-race subgroup
compared with renin profile as predictors of
blood pressure response to antihyperensive
therapy. JAMA, 1998, 280 : 1168-1172.X.G.
Imprimé en France - Differdange S.A.
95110 Sannois -
Dépôt légal 4etrimestre 1998 -
© janvier 1989 - Médica-Press International
1
/
3
100%