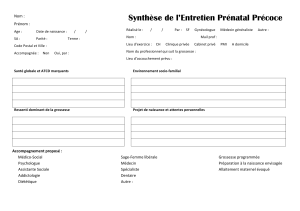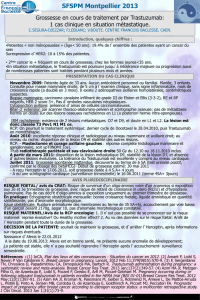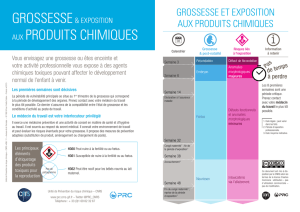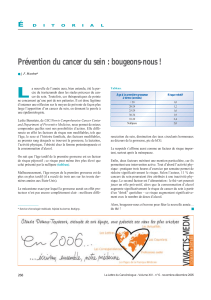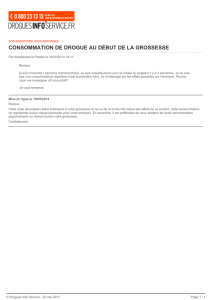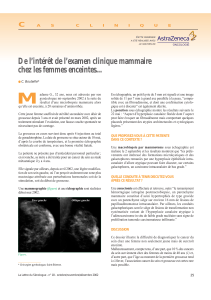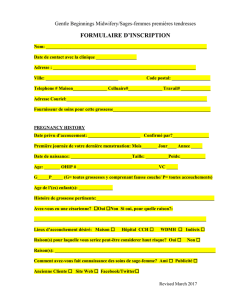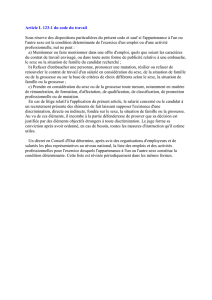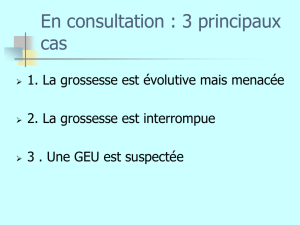L Prise en charge du cancer du sein pendant la grossesse DOSSIER THÉMATIQUE

12 | La Lettre du Sénologue ̐ n° 55 - janvier-février-mars 2012
DOSSIER THÉMATIQUE Grossesse et cancer du sein
* Centre des maladies du sein,
hôpital Saint-Louis, Paris.
Prise en charge du cancer du sein
pendant la grossesse
Breast cancer management in pregnancy
C. Cuvier*, F. Ledoux*, F. Coussy*, M. Espié*
L
es cancers diagnostiqués pendant la grossesse
ou dans l’année après l’accouchement sont
considérés comme cancers du sein associés
à la grossesse. Ces cancers poseront 2 problèmes
essentiels, l’un diagnostique et l’autre thérapeutique,
notamment en raison d’un risque de toxicité fœtale.
D’un point de vue épidémiologique, on estime qu’il y
a environ 1 cancer du sein pour 3 000 grossesses, ce
qui représenterait 200 à 300 cas par an en France.
L’âge moyen au diagnostic est entre 33 et 36 ans et
l’âge gestationnel médian au diagnostic est d’environ
23 semaines.
On estime que 7 à 14 % des cancers du sein qui
surviennent avant 45 ans coïncident avec une gros-
sesse ou avec la période d’allaitement.
Il faut noter que la fréquence de l’association cancer
du sein et grossesse simultanée est en augmen-
tation en raison d’un âge plus élevé des femmes
enceintes et d’une augmentation faible mais certaine
de l’incidence du cancer du sein, y compris avant la
ménopause.
Diagnostic du cancer du sein
Le diagnostic du cancer du sein pendant la grossesse
est souvent tardif. On estime qu’il existe un délai de
2 à 15 mois. En effet, l’examen clinique est plus diffi-
cile, la glande mammaire est richement composée
de tissu glandulaire, dense et les nodules sont plus
compliqués à individualiser.
L’examen des aires ganglionnaires est essentiel, car il
peut favoriser la mise en évidence d’une adénopathie
suspecte alors qu’il n’y a aucune anomalie clinique
décelable au niveau des seins.
Il faut noter que cet examen clinique n’est pas
toujours effectué pendant la grossesse et que
médecins, sages-femmes et patientes ont tendance
à occulter la possibilité de ce diagnostic. Les hési-
tations sont d’ailleurs fréquentes sur la conduite
à tenir.
Dans cette situation, un retard au diagnostic et au
choix thérapeutique multiplie par 2,5 le risque de
diagnostiquer le cancer du sein à un stade avancé.
Au niveau de l’imagerie, la mammographie, moins
sensible pendant la grossesse, est parallèle à
l’examen clinique, plus difficile et très lié à l’expé-
rience de l’examinateur.
La mammographie est cependant utile et possible
avec une protection abdominale en plomb. L’écho-
graphie est très utile mais également opérateur-
dépendante. La cytoponction et la microbiopsie sont
fondamentales et l’IRM est envisageable.
L’échographie va montrer des masses hypoécho-
gènes pouvant parfois faire hésiter pour des images
kystiques dont les contours sont mal limités. Il peut
y avoir également des masses hypoéchogènes avec
des contours bien limités mais lobulés pouvant faire
évoquer à tort un adénofibrome comme dans les
cancers triple négatifs ou les cancers canalaires
infiltrants de haut grade.
En 1998, la série de Dawson et al. (1), incluant
68 patientes de moins de 35 ans avec une lésion
suspecte, a montré que l’examen clinique et la
mammographie évoquaient un cancer chez 45 d’entre
elles (66 %) et un adénofibrome ou une autre lésion
bénigne chez les 23 autres (34 %). Et c’est en fait la
cytoponction qui a évoqué la malignité dans 86 %
des cas. Elle a été classée atypique dans 12 % des cas
et négative dans 1,4 % des cas. Elle a donc permis de
redresser les diagnostics pour 22 des 23 patientes dont
la lésion avait été étiquetée bénigne par l’imagerie.

La Lettre du Sénologue ̐ n° 55 - janvier-février-mars 2012 | 13
Points forts Mots-clés
Cancer du sein
Grossesse
Traitement du cancer
du sein
Pronostic
Allaitement
La cytoponction ou la microbiopsie sont donc des
gestes indispensables au moindre doute. Il existe
cependant des faux positifs plus fréquents en cyto-
logie avec une hypercellularité et des atypies plus
souvent observées pendant la grossesse. La sensi-
bilité est d’environ 90 % (2). Là encore, en cas de
doute, il faudra effectuer des microbiopsies.
Caractéristiques tumorales
La grande majorité des cancers du sein associés à la
grossesse sont des cancers classiques, de type cana-
laire infiltrant. Dans 1,5 à 5 % des cas, les cancers sont
inflammatoires. On constate souvent un envahisse-
ment ganglionnaire colligé dans certaines séries,
entre 56 et 89 % contre 38 à 54 % en dehors de la
grossesse. La taille tumorale est aussi plus impor-
tante (3,5 cm en moyenne contre 2 cm en dehors
de la grossesse). On note davantage de tumeurs de
grade 3 (69 à 85 % des cas), d’emboles vasculaires
(50 à 88 % des cas), de récepteurs hormonaux néga-
tifs (50 à 70 % contre 40 % chez les femmes jeunes
en dehors de la grossesse).
Il existe une surexpression de HER2 plus fréquente
(25 à 40 %) ainsi qu’un KI 67 élevé dans 60 % des cas.
Enfin, dans 10 % des cas, on observe des formes
métastatiques d’emblée (3-6).
Bilan du cancer du sein
On peut pratiquer un bilan biologique conven-
tionnel et le dosage des marqueurs tumoraux tout
en sachant qu’il peut y avoir une petite élévation
du CA 15-3 au cours de la grossesse.
La radiographie thoracique est possible avec une
protection plombée abdominale. Il n’y a aucun
problème pour effectuer une échographie abdo-
minale et pelvienne.
Il est envisageable d’effectuer une IRM vertébrale,
éventuellement sans injection, notamment pour les
grosses tumeurs de mauvais pronostic T3-T4 ou N1-N2.
En revanche, il est nécessaire d’effectuer un bilan
de la grossesse pour déterminer l’âge fœtal et la
croissance et pour évaluer de manière aussi précise
que possible la date du terme.
Pronostic
Pour la mère
Il y a des discordances à ce sujet. L'absence de diffé-
rence pronostique à âge égal, à taille tumorale égale
et à extension ganglionnaire égale était classiquement
admise. On a généralement le même pronostic pour
les petites tumeurs, mais il semble souvent moins
bon pour les tumeurs plus évoluées, avec un retard
au diagnostic qui est souvent de l’ordre de 6 mois.
Comme nous l’avons déjà écrit, il y a davantage de
formes métastatiques d’emblée et la survie à 5 ans
est estimée entre 40 et 70 %.
En reprenant une série de 99 patientes traitées
entre 1992 et 2007, dont 36 ont été diagnostiquées
pendant la grossesse et 63 dans l’année suivant
l’accouchement, Murphy et al. (7) confirment
que ces données sur le pronostic sont identiques.
Ces patientes ont été comparées à des témoins
(1 patiente comparée à 2 témoins). Davantage de
tumeurs RE– (59 % versus 31 % ; p < 0,0001) et RP–
(72 % versus 40 % ; p < 0,0001), de stades avancés
(p = 0,0271), de N+ (p = 0,0104), de grade élevé
(p = 0,0115) ont été observées. Avec une médiane
de suivi de 6,3 ans, il n’a cependant pas été mis
en évidence de différence de survie (p = 0,0787).
En analyse multivariée, ce n’est pas le diagnostic
pendant la grossesse, mais les tumeurs RE et N qui
sont significatives.
A contrario, Mathelin et al. (8), comparant
40 patientes (18 diagnostiquées pendant la grossesse
et 22 dans l’année qui suit) à 61 témoins a trouvé,
à caractéristiques égales, une plus mauvaise survie
des patientes diagnostiquées pendant la grossesse
(p = 0,017). Les patientes enceintes se sont vues
moins souvent proposées une hormonothérapie ou
n'ont pas souhaité la prendre (p < 0,0004) en raison
d’un diagnostic d’hormonosensibilité en immuno-
histochimie possiblement erroné.
Azim et al. (9) retrouvent également une survie sans
rechute moins bonne chez les patientes enceintes
lors du diagnostic (p = 0,01) et évoquent la possibilité
d’un rôle spécifique de la GH (Growth Hormone) et de
l’IGF1 (Insulin-like Growth Factor 1), ou d’interactions
particulières avec le stroma ou de l’utilisation d’une
chimiothérapie infra-optimale.
Highlights
It is not exceptional that breast
cancer and pregnancy should
occur at the same time. This
raises a number of therapeutic,
psychological and diagnostic
problems. The clinical and
radiological diagnosis is more
difficult, and microbiopsy is
very important. For the same
stage and age, the prognosis
does not seem to be different
from that of a non pregnant
woman. Surgery is always
possible, chemotherapy can be
considered at the end of the
first term, radiotherapy must be
postponed until after delivery,
tamoxifen is contra-indicated.
There is no reason for contra-
indicating breast-feeding.
Keywords
Breast cancer
Pregnancy
Breast cancer treatment
Prognosis
Breast feeding
»
L’association entre le cancer du sein et la grossesse n’est pas exceptionnelle. Elle pose de nombreux
problèmes diagnostiques, thérapeutiques et psychologiques. Le diagnostic clinique et radiologique est plus
difficile, la microbiopsie est très importante. À stade et à âge égal, le pronostic ne semble pas différent de
celui d’une femme non enceinte. La chirurgie est toujours possible, la chimiothérapie peut s’envisager après le
premier trimestre, la radiothérapie doit être différée après l’accouchement, le tamoxifène est contre-indiqué.
Il n’y a pas de raison de contre-indiquer l’allaitement

14 | La Lettre du Sénologue ̐ n° 55 - janvier-février-mars 2012
DOSSIER THÉMATIQUE Grossesse et cancer du sein
Lyons et al. (10) concluent que le diagnostic est plus
mauvais essentiellement pour les patientes qui déve-
loppent un cancer du sein pendant le post-partum
et non pendant la grossesse, car la période d’invo-
lution de la glande mammaire stimulerait l’action
de facteurs de croissance, l’action d’enzymes et, en
modifiant l’immunité, elle favoriserait la proliféra-
tion tumorale.
Pour le fœtus
Pour le fœtus, les risques principaux sont la malfor-
mation, la prématurité, le plus souvent iatrogène, et
l’hypotrophie expliquée par la prématurité mais aussi
par l’altération de l’état général maternel.
Traitement
Les enjeux du traitement seront de pondérer le
souhait de préserver la grossesse en informant la
patiente des risques pour elle et le fœtus. Il faudra
respecter au mieux les 2 vies et proposer un trai-
tement optimal pour la mère tout en évitant au
maximum les risques pour le fœtus, notamment les
risques de malformation. Il est nécessaire de délivrer
une information aussi exhaustive que possible à
la patiente et au couple tout en comprenant bien
le retentissement psychologique majeur de cette
situation. Au final, c’est à la patiente et au couple
de décider s’ils souhaitent ou non poursuivre la
grossesse.
Nous discuterons bien sûr en réunion de concertation
pluridisciplinaire élargie des modalités de la prise en
charge thérapeutique.
Interruption de grossesse
L’interruption de grossesse n’est pas une procédure
thérapeutique. Elle n’améliore en rien le pronostic
des patientes. Par ailleurs, on n’observe pas de
transmission du cancer du sein au fœtus. Soixante
cas de métastases placentaires ont cependant été
décrits sans conséquence fœtale, et ce en l’absence
de chimiothérapie (11). On peut cependant être
amené à proposer une interruption thérapeutique
de grossesse uniquement si la grossesse compromet
l’instauration du traitement et cette interruption
thérapeutique sera effectuée dans la plupart des
cas lorsque les diagnostics de cancer du sein et de
grossesse sont concomitants (6).
Chirurgie
La chirurgie est toujours possible mais est souvent plus
hémorragique qu’en dehors de la grossesse. On pose
généralement les mêmes indications qu’en dehors de
la grossesse sauf parfois au premier trimestre. En effet,
la radiothérapie ne peut pas être effectuée pendant
la grossesse et il faut donc pouvoir reporter la radio-
thérapie au post-partum, ce qui entraîne parfois des
délais qui peuvent être jugés trop importants. Lors
de l’anesthésie générale, une surveillance fœtale est
bien sûr nécessaire, car il a été décrit plus de fausses
couches et d’accouchements prématurés.
Il est enfin nécessaire si la patiente est opérée après
25 semaines de grossesse que l’obstétricien et le
pédiatre soient sur place en cas d’accouchement
d’un enfant prématuré viable. Cardonick et al. (12)
ont noté, en 2010, 7 % de fausses couches après une
chirurgie effectuée pendant le premier trimestre de
la grossesse. Le risque de fausse couche du fait de la
chirurgie semble plus élevé pendant les 12 premières
semaines, la chirurgie n’augmentant pas par ailleurs
le risque de malformation fœtale.
Peut-on pratiquer la technique du ganglion senti-
nelle ? On a très peu de données en cours de gros-
sesse avec essentiellement des “case report” et on
n’en connaît pas la sensibilité ni la spécificité. Les
doses d’irradiation délivrées au fœtus sont très faibles
(de l’ordre de 2 à 4 milligrays [Gy]). La technique du
bleu semble contre-indiquée en raison des réactions
anaphylactiques (15 %) et d’effets tératogènes poten-
tiels. On a une seule modalité avec la méthode isoto-
pique, ce qui entraîne une sensibilité moindre de la
méthode. La technique du ganglion sentinelle semble
donc à éviter avant 30 semaines. Il faut noter qu’il
existe un taux important d’envahissement ganglion-
naire pendant la grossesse et les recommandations
nord-américaines du NCCN (National Comprehensive
Cancer Network) conviennent qu’il n’y a finalement
pas de recommandations possibles et que la décision
est au cas par cas.
Radiothérapie
Le terme de la grossesse est fondamental dans le
déterminisme de la toxicité de la radiothérapie.
Avant la 2e semaine de la grossesse c’est la loi du
tout ou rien (fausse couche ou pas d’anomalie). Entre
la 2
e
et la 8
e
semaine, il existe un risque important de
malformation et de la 8e à la 25e semaine, il existe
des risques neurocarcinologiques.
De la 8e à la 15e semaine, la dose délivrée au fœtus
est de l’ordre de 0,1 Gy et cette dose peut entraîner

La Lettre du Sénologue ̐ n° 55 - janvier-février-mars 2012 | 15
DOSSIER THÉMATIQUE
une chute significative du quotient intellectuel. On a
observé qu’une dose fœtale de 1 Gy était à l’origine
dans 40 % des cas d’un retard mental sévère (13).
À plus long terme, la radiothérapie peut s’accompa-
gner d’un risque leucémogène et cancérogène pour
l’enfant. Ce risque, majoré de 40 % pour 0,01 Gy,
sera de 3 à 4/1 000 contre 2 à 3/1 000.
Pour une irradiation du sein ou de la paroi à 50 Gy,
le fœtus recevra une dose de 0,05 à 0,15 Gy dans les
8 premières semaines et de 2 Gy en fin de grossesse.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de différer
la radiothérapie après l’accouchement.
Dans la série de Brent, publiée en 1989 (14), 25
microcéphalies et 11 arriérations mentales ont été
mises en évidence chez 78 patientes irradiées avant
16 semaines de grossesse. Pour les 105 patientes
irradiées après 16 semaines de radiothérapie, il a été
observé 7 microcéphalies et 4 arriérations mentales.
Chimiothérapie
Il existe des problèmes pharmacologiques liés à l’admi-
nistration de la chimiothérapie et il n’est pas certain
que nous effectuions chez nos patientes des doses
optimales. En effet, le liquide amniotique constitue
un troisième secteur et il y a d’importantes modifica-
tions pharmacocinétiques pendant la grossesse avec
cependant peu de données publiées. Il est habituel de
commencer la chimiothérapie aux doses usuelles, ce qui
peut éventuellement représenter un sous-dosage (15).
L’état gravidique entraîne donc une augmentation du
volume plasmatique, une augmentation de l’espace
de dilution pour les médicaments hydrosolubles. On
observe une diminution du taux d’albumine plas-
matique et une augmentation des autres protéines
plasmatiques. Il existe fréquemment des perturba-
tions du métabolisme hépatique. On va observer une
augmentation du flux plasmatique rénal, de la filtration
glomérulaire et de la clairance de la créatinine, ce qui va
entraîner une modification de la clairance des médica-
ments. On aura donc des modifications de paramètres
pharmacologiques comme l’aire sous la courbe.
Le troisième secteur retardera l’élimination des médi-
caments et peut être responsable de l’augmentation
de la toxicité de certains d’entre eux. Cela a été décrit
pour le méthotrexate. En pratique, on peut donc
avoir une augmentation de la toxicité potentielle de
certains médicaments et peut-être une sous-efficacité
pour d’autres.
◆Problèmes pour le fœtus
La toxicité de la chimiothérapie pour le fœtus va
dépendre du terme de la grossesse, de la nature de
la molécule et de son passage transplacentaire et
bien sûr de la dose délivrée.
Le passage transplacentaire est d’autant plus impor-
tant que le poids moléculaire de la molécule est
faible, que sa liposolubilité est élevée et que sa fixa-
tion en protéines plasmatiques est faible.
La plupart des médicaments peuvent passer dans la
circulation fœtale et être éventuellement excrétés
dans le placenta et ingérés par le fœtus.
La Food and Drug Administration (FDA) a classé
les médicaments et leurs répercussions sur la gros-
sesse en 4 catégories. La chimiothérapie, dans la
catégorie D, mentionne qu’il existe des preuves de
risques pour le fœtus, mais que l’éventuel bénéfice
de l’utilisation de ces médicaments chez la femme
enceinte doit cependant être envisagé en dépit de
risques potentiels.
◆Qu’en est-il en clinique ?
Nous disposons en fait de données fragmentaires
et de petites séries et il y a peu de données sur le
passage transplacentaire des médicaments.
Toxicité fœtale immédiate
Au cours du premier trimestre
Environ 21 % des cancers du sein pendant la gros-
sesse surviennent lors du premier trimestre. En cas
de chimiothérapie, on observe des avortements, des
décès in utero, des prématurités, des hypotrophies,
des malformations et des anomalies viscérales. Le
type de toxicité lors de l’administration de chimio-
thérapie pendant le premier trimestre est lié au type
de médicament et à la date d’administration.
Là encore, lors de la première semaine, c’est la loi
du tout ou rien avec soit une fausse couche soit un
fœtus sain (16, 17).
Après la première semaine, toujours lors du premier
trimestre, on note des avortements, 2 sur 2 dans
la série de Giacalone et al. (17), 75 sur 121 dans la
série de Sutcliffe (18). On observe des malforma-
tions suivant les séries dans 7 à 17 % des cas : 7,5 %
dans celle de Nicholson et Byrne (19), 11,5 % dans
celle de Murray et Werner (20), 12,7 % dans celle
de Schapira et Chudley (21) et 17 % dans celle de
Doll et al. (16).
Les produits les plus tératogènes sont les antimé-
tabolites (méthotrexate) et les alkylants (cyclo-
phosphamide). Il a cependant été rapporté des cas
d’enfants en bonne santé après exposition au cyclo-
phosphamide pendant le premier trimestre (16, 22).
Les produits les moins tératogènes semblent être
les anthracyclines, les alcaloïdes de la pervenche.
On observe davantage de toxicité en cas d’utilisation

16 | La Lettre du Sénologue ̐ n° 55 - janvier-février-mars 2012
DOSSIER THÉMATIQUE Grossesse et cancer du sein
d’une polychimiothérapie avec 25 % de malforma-
tions contre 6 à 15 % de malformations pour les
monochimiothérapie, à l’exception de l’utilisation
du méthotrexate.
Au cours des deuxième et troisième trimestres
Après le premier
trimestre, on ne constate pas
d’augmentation du risque de malformations, qui
est estimé à 1,3 %, identique à ce que l’on note en
dehors de la grossesse (4). En revanche, on peut
observer des retards de croissance, des avortements,
des accouchements prématurés dans 13 % des cas et
des anomalies organiques fonctionnelles (anémie,
leuconeutropénie et alopécie) [16, 23].
L’hypotrophie est fréquemment observée dans 40 %
des cas, tous trimestres confondus (24). Il a été
rapporté par Zemlickis et al. (25) un poids médian de
2,227 kg contre 3,519 kg. Il faut noter cependant que,
pour Hahn et al. (26), le poids médian était de 2,980 kg
et pour Ring et al. le poids médian était de 3 kg (4).
Pour van Calsteren et al. (23), le poids était inférieur
au dixième percentile dans 7,3 % des cas.
En ce qui concerne les anomalies organiques, il faut
noter que 2 cas de toxicité cardiaque ont été décrits
après utilisation de doxorubicine, dont 1 infarctus du
myocarde, ainsi que quelques cas de myélosuppression
néonatale. Ces données ont été rapportées dans le
cas de traitements de leucémies (27-29).
Nous avons davantage de données pour les anthra-
cyclines et les alkylants avec un risque minimal aux
deuxième et troisième trimestres de la grossesse
lorsque l’organogenèse est terminée.
Il ne semble pas y avoir de contre-indication à l’uti-
lisation des sétrons ni à celle des corticoïdes et des
facteurs de croissance hématopoïétiques à partir du
deuxième trimestre de la grossesse.
Des schémas avec anthracyclines ont donc été
publiés. Dans la série de Berry et al. rapportée dans
le Journal of Clinical Oncology en 1999 (30) avec une
chimiothérapie de type FAC (fluorouracil, doxorubicin,
cyclophosphamide) [4 cures en moyenne]chez des
patientes traitées après le premier trimestre, il n’y a
pas eu de toxicité maternelle significative. La médiane
de la délivrance a été à 38 semaines. Trois accouche-
ments avant terme ont été observés. L’Apgar à 5 min
était supérieur ou égal à 9 chez tous les nouveau-
nés. Aucune malformation ou hypotrophie n’ont
été notées. Un enfant est né avec une leucopénie
transitoire, 2 autres avec une alopécie imputée à la
chimiothérapie. Avec un suivi médian de 4 à 5 ans, il
n’a pas été observé d’anomalies du développement.
Cette série a été actualisée pour 57 patientes par
Hahn et al. (26). Le poids médian était de 2,980 kg.
Soixante pour cent des accouchements était effec-
tués par voie basse. Aucun décès fœtal n’a été
observé. On a noté une leuconeutropénie associée
à une hémorragie méningée, une trisomie 21 et 2
anomalies congénitales avec un pied-bot et un reflux
urétéral bilatéral.
Giacalone et al. ont publié dans Cancer en 1999
(17) une compilation française de 20 patientes
enceintes avec un cancer du sein ayant reçu en
médiane 2 cycles de chimiothérapie 1 fois sur 2 par
FEC (fluorouracil, epirubicin, cyclophosphamide).
Deux patientes ont été traitées pendant le premier
trimestre, ce qui a entraîné 2 avortements spon-
tanés. Il a été observé 1 décès in utero au deuxième
trimestre et 4 accouchements prématurés.
On a noté 1 leuconeutropénie néonatale, 2 détresses
respiratoires, 1 hypotrophie, 1 décès à 8 jours de
cause non déterminée, mais pas d’anomalie congé-
nitale. À 3 et 4 ans de suivi, tous les enfants ont eu
un développement normal.
Dans la série de Cardonick et al. publiée en 2010
(31), 104 patientes enceintes ont été analysées
avec un âge gestationnel médian lors de la première
cure de chimiothérapie de 20,4 ± 5,4 semaines. Les
chimiothérapies utilisées ont été essentiellement de
l’adriamycine + cyclophosphamide (AC ), du FEC ou
du FAC. Quelques cas ont été traités avec un taxane.
On a noté 8 cas de retard de croissance intra-utérins,
5 complications pulmonaires néonatales, 3 ictères, 2
complications placentaires, 1 maladie auto-immune
avec 1 décès à 13 mois.
Dans la série de Ring et al. rapportée en 2005 (4), 27
nouveau-nés de mères traitées par chimiothérapie
pendant les deuxième et troisième trimestres de la
grossesse ont été décrits. Ces patientes avaient été
traitées dans 12 cas par cytométrie en flux et dans
15 cas avec des schémas comportant des anthra-
cyclines. L’âge médian de la délivrance a été de 37
semaines, le poids médian de 3 kg. Il a été noté 1
retard de croissance intra-utérin, 2 dyspnées tran-
sitoires, mais aucune malformation.
Dans la série d’Aviles et Neri, publiée en 2001 (32),
qui portait essentiellement sur des hémopathies,
84 enfants ont été exposés in utero avec un suivi
médian de 18 ans. Ce recul est important puisqu’il
n’a été observé aucune malformation, ni problème
cardiaque. Le développement intellectuel a été jugé
normal. Il n’est pas apparu de cancer ni d’hémopathie
secondaire et pas de problème pour les enfants de
la deuxième génération.
Nous avons moins de données concernant les
taxanes et la vinorelbine. Ce sont des molécules
de bas poids moléculaire, lipophiles qui traversent
 6
6
 7
7
1
/
7
100%