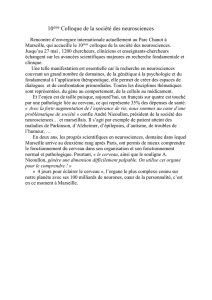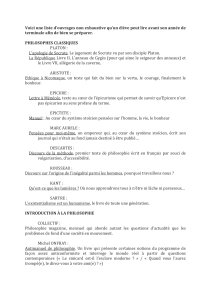Les neurosciences, champ d'investigation des philosophes

Vous êtes ici :
Accueil> Territoire> Les neurosciences, champ d'investigation des philosophes
Les neurosciences, champ d'investigation des
philosophes
INTERVIEW DE JEAN-JACQUES WUNENBURGER ET DANIEL PARROCHIA
<< Par rapport à un certain fantasme réductionniste, je ne crois pas qu’il faille voir une menace dans la prise de
conscience que le cerveau apparaît comme de plus en plus perfectionné >>.
Interview de Jean-Jacques Wunenburger, doyen de la faculté de philosophie de l'Université Jean Moulin - Lyon 3,
responsable du Réseau Interdisciplinaire Santé, Éthique, Société, et Daniel Parrochia, professeur de philosophie des
sciences à l'Université Jean Moulin - Lyon3.
Aujourd'hui, la santé, les biotechnologies et les sciences du vivant en général préoccupent aussi les sciences
humaines et sociales . Ainsi les neurosciences, discipline médicale avant tout, sont-elles devenues un champ
d'investigation de la part des philosophes. En effet, ceux-ci s'intéressent depuis longtemps aux relations entre cerveau et
conscience. Quels sont donc les sujets propres aux neurosciences que les philosophes ont investi aujourd'hui ?
Existe-t-il plusieurs écoles philosophiques décrivant les fonctions du cerveau ? Quel est l'apport de la neurophilosophie
dans les neurosciences ?
Réalisée par : Marianne CHOUTEAU
Tag(s) : Biotechnologie, SHS
Date : 01/02/2006
Philosophie et médecine sont deux disciplines qui parlent de l’homme avec des approches et des
questionnements différents. Quels sont les liens que la Faculté de philosophie a tissés avec les disciplines
médicales ?
Jean-Jacques Wunenburger : La Faculté de philosophie a depuis toujours eu des compétences et des intérêts pour
l’ensemble des sciences biologiques et médicales. François Dagognet s’y est beaucoup intéressé, Jean-Claude Beaune
a continué et, depuis quelques années, Daniel Parrochia et moi-même, avons repris ces problématiques. Nous avons
d’ailleurs créé un diplôme, bientôt un Master, « Philosophie du vivant » — aspects historiques, épistémologiques et
éthiques — et nous proposons un plan pluri-formations (PPF) intitulé Réseau Interdisciplinaire Santé, Éthique, Société
(RISES) qui sert de plate-forme de discussions aux différentes disciplines sur les questions plutôt médicales et des
biotechnologies. Ce réseau a donné naissance à un projet d’UMR INSERM — en cours d’expertise à l’INSERM —
réunissant toutes les disciplines des SHS de Lyon II et Lyon III autour d’un noyau médical de Lyon I. Cela montre la
volonté des différents partenaires lyonnais de développer une structuration des SHS autour des questions de santé, de
biotechnologie, etc., Nous avons tous entendu le message autour des biopôles et des pôles de compétitivités ; les
problèmes du vivant sont au centre des interrogations.
Daniel Parrochia : Nous avons des liens très serrés avec les enseignants des SHS de médecine qui participent à
l’actuel Diplôme inter-universitaire de « philosophie du vivant ». Dans le cadre du DIU, nous assistons aux séminaire des

uns et des autres et avons développé des projets communs comme, par exemple, le colloque « Représenter, nommer,
classer » qui rassemblait des enseignants des SHS de médecine, des enseignants de médecine et de bio-médecine et
des étudiants de philosophie.
Vu de l’extérieur, on a l’impression que ces questions sont encore peu abordées par les philosophes et que les
SHS ont un peu de mal à s’approprier le discours scientifique sur le cerveau produit par les neurosciences. Cela
tient-il à une différence de culture scientifique, de méthodologie, ou est-ce parce qu’il s’agit de contenus
difficiles à appréhender pour qui n’est pas médecin ?
Daniel Parrochia : Traditionnellement, en France, ce sont plutôt les médecins qui se sont occupés des questions
touchant le cerveau. Cela tient à l’histoire des sciences. Au 19e siècle, c’est Gall, un médecin, qui produit la théorie des
localisations cérébrales, puis il y a la théorie des neurones et le début de l’histo-anatomie. Au cours du 20e siècle, les
révolutions concernant la connaissance du cerveau sont le fait de médecins : la messagerie chimique, l’identification des
récepteurs, etc. Une neurophysiologie un peu « humide » se superpose à la neurophysiologie « sèche » du cerveau,
celle de la transmission électrique. Tout cela est longtemps resté bio-médical et c’est seulement à partir du moment où
se sont développées les sciences cognitives, via l’informatique et l’intelligence artificielle, que cette réflexion s’est
décalée de la médecine vers la psychologie de la connaissance et ce que l’on a appelé les sciences cognitives. C’est
donc dans les années 70 que ces problématiques ont été appropriées par la philosophie, d’abord par la philosophie
américaine de l’esprit puis ont nourri, petit à petit, l’ensemble des réflexions traditionnelles de la philosophie de la
connaissance, des rapports de l’âme et du corps, etc. C’est probablement cette exportation assez récente qui explique
que ces questions puissent sembler marginales dans les programmes.
Jean-Jacques Wunenburger : Je nuancerai un peu ce qu’a dit Daniel Parrochia. Non pas que l’approche historique qu’il
propose soit discutable, mais parce que les philosophes, par d’autres biais, se sont toujours intéressés aux relations
entre le corps et l’esprit. C’est vrai que progressivement, à partir du 19e siècle, la relation entre cerveau et conscience
est devenue un objet d’étude croisée entre médecine et philosophie. Mais cela ne veut pas dire qu’auparavant, ça n’était
pas une préoccupation majeure de la philosophie. Pour ce qui concerne cette double approche, elle est repérable dès les
années 1930 avec Bergson qui a, le premier, réconcilié la philosophie avec les connaissances médicales et
neuro-biologiques. Cela s’est d’abord fait à travers l’étude des fonctions supérieures ; mémoire, rêve, ainsi que leurs
pathologies. On retrouve cela dans tous les manuels de philosophie du milieu du 20e siècle. Les données sur les
localisations des fonctions cérébrales sont, par exemple, étudiées lorsqu’on aborde les études psychologiques. Si vous
prenez la philosophie médiatique des années 70-80, en France en particulier, elle est effectivement très détachée des
problèmes des sciences et en particulier des sciences du vivant. Mais c’est très français. On a pratiqué une philosophie
très littéraire et, il faut le reconnaître également, ces nouveaux savoirs médicaux sont issus d’un mouvement
d’accélération des sciences qui a un peu dépassé les philosophes. Mais aujourd’hui, et votre présence en témoigne, les
choses sont en train de changer. Ici, plusieurs enseignants-chercheurs travaillent sur ce sujet. Nous ne prétendons pas
maîtriser les savoirs des biologistes mais travailler à une rencontre fructueuse entre les milieux scientifiques et les
savoirs philosophiques.
Daniel Parrochia : Les neurosciences sont une discipline assez récente. Elle date des années 60. La philosophie des
neurosciences ne peut pas se mettre en place avant les neurosciences elles-mêmes… Ce que faisait Bergson était
relatif à l’état du développement des sciences du système nerveux des années 20-30, de la psychologie expérimentale,
etc. Toute sa philosophie est une grande protestation contre les excès de la théorie de la localisation cérébrale. Que
manque-t-il à celui à qui il ne manque que la parole ? Beaucoup plus que la parole stricto sensu.
Longtemps, on a eu besoin de faire appel à des notions comme l’ego, le moi ou le « self » pour rendre compte
de l’unité de l’expérience (les données des sens, le temps, etc.). Les explications des neurosciences qui rendent
compte de cette unité comme d’une unité « fonctionnelle » produite par des fonctions cognitives donnent le
sentiment que le cerveau suffit et qu’on n’a plus besoin de ces concepts là. Comment les philosophes
réagissent-ils à cela ?
Jean-Jacques Wunenburger : Effectivement on parvient à reconstituer la plupart des opérations de la vie mentale dont
on connaît de mieux en mieux la complexité et les performances. Mais il n’empêche que, phénoménologiquement, si
nous voulons parler de ce dont on parle, on le fait à partir d’un langage et d’une conscience qui ne sont pas réductibles à
cet appareillage, à ce soubassement matériel, même si ont sait mieux aujourd’hui toute la place qu’il occupe dans
l’accomplissement de ces fonctions. Je pense ainsi que les notions de self, d’ego, de « je », de subjectivité, etc.,
demeurent et qu’elles sont d’un autre ordre, celui de la réflexivité et non du mécanisme. Par rapport à un certain

fantasme réductionniste, je ne crois pas qu’il faille voir une menace dans la prise de conscience que le cerveau apparaît
comme de plus en plus perfectionné.
Je vais être encore plus provocant. Certains articles décrivent les sentiments religieux ou amoureux comme de
simples opérations cognitives. D’autres vont même jusqu’à faire de l’expérience mystique un dérèglement
fonctionnel. Cela ne pose-t-il pas de réelles questions sur ce qu’est l’homme ?
Jean-Jacques Wunenburger : Ce que vous décrivez, sentiment amoureux, religieux, etc., sont des expériences vécues.
Elles n’existent que rapportées à un sujet et le langage en témoigne : « je sens » ou « je ne sens pas ». Cela, une
machine ne peut pas le restituer. Il s’agit d’un irréductible dont le langage et le vécu sont témoins. On peut montrer que si
l’ensemble de l’opération est sous-tendu par des mécanismes de causes et d’effets neurochimiques, il reste que ce que
j’ai à la conscience est d’un autre ordre.
Daniel Parrochia : Il faut bien comprendre qu’il y a toujours eu sur ces questions des positions philosophiques
différentes. Les neurosciences ne changent rien au fait que des positions empiricomatérialistes s’opposent à des
positions plus spiritualistes. Ces courants philosophiques s’affrontent de tous temps. Des arguments sont apportés tantôt
du côté des empirico-matérialistes selon lesquels l’esprit serait un pur épiphénomène et d’autres sont apportés par la
psychologie de la volonté ou la psychomotricité volontaire à ceux qui soutiennent l’idée qu’il existe une instance capable
d’imposer quelque chose à la matérialité, un quelque chose qui n’est pas de cet ordre-là. Ces thèses se combattent au
cours du temps et je ne crois pas que la thèse empirico-matérialiste soit aujourd’hui bien plus forte qu’elle ne l’a été par
le passé, y compris à l’époque des théories de la localisation cérébrale. On n’a pas beaucoup avancé sur le fond. Aucun
philosophe, pas même Descartes qui, au fond, relie l’âme et le corps, n’a défendu l’idée d’un esprit totalement
indépendant d’un substrat biologique…
Jean-Jacques Wunenburger : … et inversement, aucun philosophe n’a jamais défendu l’idée d’un substrat biologique
qui à un moment donné ne produise une forme de réflexivité laquelle, en définitive, est hors du système. Cette réflexivité
est notre conscience. C’est elle qui peut dire que tout ce que vous me montrez-là fonctionne effectivement mais qu’en
plus, il y a moi qui en ai conscience. Cette conscience n’est pas totalement comprise dans ce dont on parle. C’est là la
limite de toute réduction à un monisme matérialiste.
Daniel Parrochia : oui, je ne crois pas qu’on puisse localiser la pensée ; l’associer comme une sorte d’équivalent des
substances matérielles à l’existe nce de certains sentiments. Bien sûr, certains travaux sur la biologie des passions,
comme ceux de Jean-Didier Vincent, vont dans ce sens. Mais vous sentez bien la différence entre les propositions : «
J’aime quelque un » et : « Il existe un certain taux de lulibérine dans mon hypothalamus ». Même si les deux se
produisent à l’occasion l’un de l’autre, il y a une différence d’ordre qui est totale.
Les travaux montrent que la connaissance de soi repose sur des fonctions cognitives telle que la
reconnaissance physique et l’agentivité. Ils décrivent une première « brique » de ce qui forme la conscience. On
a l’impression d’un nouveau désenchantement, mais de l’homme.
Jean-Jacques Wunenburger : Si vous voulez dire par-là qu’il y a tout un moment dans le processus de la
reconnaissance de soi qui relève de procédures mécanistes, pourquoi pas. Mais la réponse est ici encore la même. Pour
être simple, même si on transfère vers la matière un certain nombre d’opérations qu’on croyait réservées à l’esprit, la
question reste : « Est-ce que tout l’esprit peut-être transféré ? ». Non, car dans la reconnaissance, le préfixe « re- »
implique phénoménologiquement quelque chose qu’aucun mécanisme extérieur n’est capable de reproduire. Ça n’a pas
de sens d’attribuer à un pur mécanisme la capacité de réflexivité. Ou alors, vous donnez raison à ce projet de
science-fiction qui est qu’un jour une machine puisse totalement imiter la vie, dans toutes ses dimensions psychiques.
Ici ou là, il y a des descriptions des fonctions du cerveau sur des phénomènes qui relevaient du champ de la
philosophie.
Jean-Jacques Wunenburger : Qui « relevaient de la philosophie », dites-vous... Mais la philosophie n’a pas d’objet
propre, elle a des questions propres. Ce n’est pas la même chose. Les philosophes ne revendiquent pas d’objet en
propre. Si les neurologues peuvent nous dire quelque chose de la conscience, par exemple, c’est très bien. Après, il y a
des questions philosophiques qui se posent sur la conscience. Pour autant, elles ne sont pas forcément posées par un
philosophe, n’importe qui peut se les poser.

Daniel Parrochia : Les neurosciences amènent des arguments tantôt à une thèse tantôt à une autre, généralement à la
thèse matérialiste mais pas de manière aussi nette qu’on le croit. Il y a toujours un moment où celui qui tente de tirer des
enseignements scientifiques des arguments en faveur de cette thèse opère un saut. Si vous lisez L’homme neuronal de
Jean-Pierre Changeux, il tire de ses connaissances beaucoup plus qu’elles ne livrent. Parmi les scientifiques, tout le
monde n’est d’ailleurs pas d’accord, et d’autres, à partir des mêmes données objectives, livreront un autre discours.
Jean-Jacques Wunenburger : Jean-Pierre Changeux est un grand amateur d’art. L’émotion esthétique mobilise
probablement tous ces supports matériels cognitifs, mais elle n’en reste pas moins une jouissance irréductible à une
formule neurochimique.
D’un point de vue éthique, le cerveau peut-il être considéré comme un organe comme les autres ?
Daniel Parrochia : Je ne suis pas spécialiste de l’éthique, mais il ne me semble pas que les neurosciences posent des
problèmes particuliers par rapport aux autres disciplines biomédicales. Très largement, on retrouve les mêmes questions
qui sont celles ce l’embryologie, de la mort, etc.. Concernant l’expérimentation, qu’il s’agisse du cerveau ou d’un autre
organe, elle pose des problèmes identiques ; il faut que celui qui accepte les expérimentations bénéficie de l’information
nécessaire pour donner un « consentement éclairé », ce qui est un problème massif de la bio-éthique. Du côté des
substances qui agissent sur le cerveau, elles ont des effets qui peuvent être très importants comme l’addiction, la
modification des comportements, etc. Cela pose effectivement des problèmes éthiques mais ceux-ci ne sont pas
nouveaux. Il me semble qu’il n’y a pas de problèmes singuliers posés par les neurobiologies, même s’ils sont peut-être
potentialisés dès lors qu’il s’agit du cerveau, un organe lié à la personnalité, à nos comportements, etc.
La question des modifications des états de consciences…
Daniel Parrochia : C’est pareil. A-t-on le droit d’agir sur quelqu’un pour modifier ses états de conscience ? Ca n’est pas
une question spécifiquement liée aux neurosciences. Lorsque dans un supermarché les produits sont disposés de
manières à induire des actes d’achats bien déterminés, on peut se la poser. Mais encore une fois, il n’y a pas de
problème théorique nouveau. Certes, il faut mettre un certain nombre de barrières à l’utilisation de ces substances parce
qu’elles ont une action directe, mais ceci n’est qu’une partie d’un problème beaucoup plus vaste. Dès que nous entrons
en relation et en communication les uns avec les autres, nous nous modifions les uns les autres, nous interagissons.
Jusqu’à quel point tolérer cette action de modification et où mettre la limite ?
Jean-Jacques Wunenburger : Oui, je crois qu’il y a une différence de degrés entre certains organes et d’autres. La
reproduction et le cerveau sont deux fonctions vitales qui renvoient à la transmission de l’identité et à sa conservation, et
elles ont été valorisées culturellement et affectivement, ce qui est fondée philosophiquement. Il est certain qu’une greffe
de cœur n’a rien à voir avec une greffe de cerveau. Ceci dit, il y a à la fois une simple reprise des questions de fond, et
d’autre part une sorte de surdétermination de l’intervention, sous couvert de recherche biologique, mais qui ne font que
prolonger pour le cerveau des situations que nous connaissons déjà sur le plan de la vie. Il n’y a qu’un changement
d’échelle. Toutes ces questions sur les limites de la liberté, les processus d’aliénation, la perte d’identité, etc., sont des
choses qui se produisent déjà dans la vie, il n’y a rien de nouveau. D’une certaine manière, notre réaction est de dire : s’il
y a sans doute dans les neurosciences des avancées très impressionnantes, pour nous philosophes, ce n’est pas si
spectaculaire que cela car cela nous renvoie à des questionnements que l’on rencontre depuis très longtemps. Bien sûr
les objets n’ont pas la même échelle, les mêmes noms, etc., mais cela ne modifie pas complètement le questionnement.
Liberté, limite, intégrité, ce sont des questions qui traversent l’histoire des sciences et de l’anthropologie.
Un courant de la philosophie s’est intitulé la neurophilosophie. S’agit -il d’une discipline qui existe vraiment,
tirant son contenu de l’apport des neurosciences, ou s’agit -il davantage d’un effet de mode ?
Daniel Parrochia : A partir du moment où les neurosciences ont commencé à se développer, la philosophie américaine
de l’esprit s’est attachée à préciser les positions philosophiques que j’ai schématisées tout à l’heure : « empirisme », «
spiritualisme », etc. On a distingué entre les matérialistes substantialistes, d’autres plus fonctionnalistes, d’autres encore
plus physicalistes, etc. Ceci peut-être taxé de neurophilosophie — notamment quand on adopte des positions plus
matérialistes ou empiristes que spiritualistes —, il demeure qu’il ne s’agit, là encore, que d’un raffinement de positions

qui ont été traditionnellement répertoriées dans la philosophie. Je ne crois pas que cela fasse une discipline en soi, ni
que cela débouche sur une science en soi qui consisterait à rapporter des opérations philosophiques à des opérations
neuro-cérébrales… Je ne vois d’ailleurs pas bien ce que cela pourrait signifier.
Jean-Jacques Wunenburger : Il est vrai que les neurosciences ont permis un renouvellement des questionnements.
Mais on se rend compte que ces questionnements se réduisent en définitive à deux préoccupations classiques de la
philosophie. La première est épistémologique : quel modèle adopte-ton pour décrire telle réalité, comme la nature, le
cerveau, etc. La seconde est métaphysique et interroge le rapport liberté / nécessité, matière / non-matière, etc. Cela,
c’est la philosophie tout court, ça n’est pas spécifiquement la neurophilosophie. Il y a bien sûr toujours la tentation
d’identifier un domaine particulier avec des compétences particulières, mais ce sont un peu des effets de mode. Sur le
fond, je ne crois pas qu’il puisse y avoir une neurophilosophie qui ouvre à quelque chose d’inédit.
Daniel Parrochia : Il se produit aujourd’hui avec les neurosciences ce qui s’est produit dans les années 60-70 avec les
Sciences humaines. A l’époque, certains scientifiques des sciences humaines essayent de faire croire qu’ils grignotaient
le domaine de la philosophie. La psychologie reprenait les grandes questions de l’âme et de l’esprit, la sociologie
abordait le domaine de la politique et de la cité, l’ethnologie, le rapport de l’homme avec les ethnies étrangères, etc.
Selon eux, la philosophie allait être dépossédée. Or l’expérience montre que des problèmes philosophiques se posent
toujours en psychologie ou en sociologie. Ils perdurent malgré l’existence de ces disciplines. Si on comprend très bien
qu’une discipline crée un domaine d’objet, des problèmes philosophiques se posent dans la constitution même de ce
champ, dans les méthodes employées, les positions philosophiques des chercheurs, etc. Les interrogations demeurent
donc et la philosophie les prend en charge. Pour ces mêmes raisons, les neurosciences n’ont pas du tout grignoté le
domaine de la philosophie.
1
/
5
100%