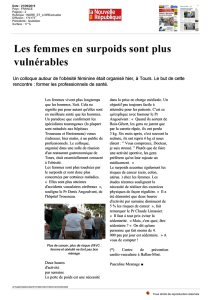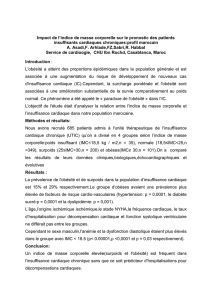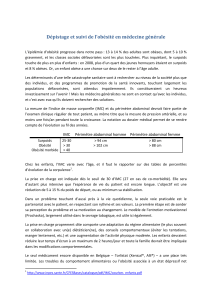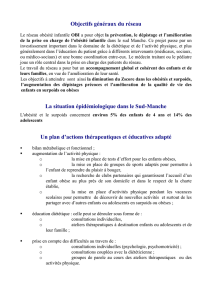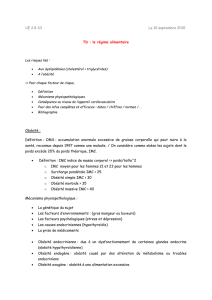Lire l'article complet

MISE AU POINT
12 | La Lettre du Rhumatologue • No 397 - décembre 2013
Regard sur le surpoids
et l’obésité
A critical look at obesity
A. Avignon*
* Département des maladies méta-
boliques, hôpital Lapeyronie, CHRU de
Montpellier ; université Montpellier-I,
EA4202 ; Inserm, ERI25, “Muscle et
pathologies”, Montpellier.
L
a prévalence du surpoids et de l’obésité ne cesse
d’augmenter à travers la planète et l’obésité
constitue à l’heure actuelle l’un des problèmes
de santé les plus importants à l’échelle mondiale.
Au même titre que la lutte contre le tabagisme et
l’alcoolisme, la lutte contre l’obésité est devenue
une priorité de santé publique. En France, le lan-
cement d’un “plan contre l’obésité” en juin 2010
par le Président de la République pour renforcer la
recherche, la prévention et la prise en charge de
l’obésité témoigne de la prise de conscience du pro-
blème par les pouvoirs publics. La gravité de l’obé-
sité tient à son retentissement sur l’ensemble des
organes, conduisant à de nombreuses complications
au premier plan desquelles se situent, au côté des
maladies cardiovasculaires, du diabète et de cer-
tains cancers, les troubles musculo-squelettiques.
Ainsi, tout médecin, quelle que soit sa spécialité, se
retrouve de façon quotidienne confronté à la prise
en charge de personnes présentant un excès de
poids qui joue un rôle causal ou aggravant dans sa
pathologie (douleurs articulaires, dyspnée, diabète,
hypertension artérielle, etc.). Perdre du poids fera
alors partie intégrante du traitement. Mais comment
guider le patient pour qu’il parvienne à cet objectif
sans se limiter à une simple injonction à la perte
de poids, dont les conséquences sont parfois plus
délétères que bénéfi ques ? Dans cet article, nous
essayerons essentiellement d’analyser la place que
doit tenir le médecin “non nutritionniste” face à un
patient présentant un excès de poids.
Défi nitions
Le surpoids et l’obésité sont défi nis par l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) [1] comme une
accumulation anormale ou excessive de graisse
corporelle qui peut nuire à la santé. L’indice de
masse corporelle (IMC) est couramment utilisé
dans les populations et chez les individus adultes
pour estimer le surpoids et l’obésité. Il correspond
au poids divisé par le carré de la taille, exprimé
en kg/ m2.
L’OMS défi nit le surpoids comme un IMC égal ou
supérieur à 25 kg/m
2
et l’obésité comme un IMC égal
ou supérieur à 30 kg/m2. On distingue l’obésité de
grade I ou modérée (30 ≤ IMC ≤ 34,9 kg/m2), l’obé-
sité de grade II ou sévère (35 ≤ IMC ≤ 39,9 kg/m
2
) et
l’obésité de grade III ou extrême (IMC ≥ 40 kg/m
2
).
Ces seuils servent de repères pour une évaluation
individuelle, mais il est en fait avéré que le risque
de maladies chroniques augmente progressivement
avec l’IMC et ce, avant même d’atteindre le seuil
de 25 kg/m2.
La répartition corporelle des graisses est un facteur
important du risque de complication cardio-
métabolique. On oppose ainsi les obésités avec
une prépondérance de la graisse sous-cutanée
et celles où la graisse s’accumule préférentiel-
lement au niveau abdominal, périviscéral. C’est
cette dernière qui conditionne le risque cardio-
métabolique. Les techniques sophistiquées et coû-
teuses – scanner, IRM, DEXA – permettent une
évaluation précise de la répartition des graisses.
En pratique clinique courante, on se limitera à
la simple évaluation du tour de taille mesuré à
l’horizontale (sans nécessairement passer par
l’ombilic), à mi-distance entre le bord inférieur
des côtes et le bord supérieur de la crête iliaque.
On peut retenir 2 niveaux de seuil pour le tour
de taille, définissant une augmentation modérée
ou importante du risque cardiométabolique. Pour
les populations européennes, ces seuils sont de
80 et 88 cm chez la femme et de 94 et 102 cm
chez l’homme (2).

Points forts
La Lettre du Rhumatologue • No 397 - décembre 2013 | 13
Le surpoids et l’obésité
en quelques chiffres
D’après les estimations mondiales de l’OMS pour
l’année 2005, environ 1,6 milliard d’adultes (âgés
de 15 ans et plus) étaient en surpoids et au moins
400 millions d’adultes étaient obèses ; les prévisions
de l’époque pour 2015 étaient de quelque 2,3 mil-
liards d’adultes en surpoids et plus de 700 millions en
situation d’obésité. Au moins 20 millions d’enfants
de moins de 5 ans avaient un surpoids en 2005.
En France, depuis 1997, l’étude ObÉpi-Roche
apprécie tous les 3 ans la prévalence du surpoids
et de l’obésité, afi n d’évaluer son évolution dans
la population âgée de 18 ans et plus. La dernière
enquête, de 2012 (3), fait état de 32,3 % de Français
adultes de 18 ans et plus en surpoids et de 15 %
en situation d’obésité. Après des années de forte
augmentation, une tendance à la stabilisation de la
prévalence de l’obésité semble apparaître au cours
de ces dernières années. En effet, par rapport à la
prévalence estimée en 2009 (14,5 %), la prévalence
en 2012 (15 %) représente une augmentation rela-
tive du nombre d’obèses dans la population limitée
à 3,4 %. Cette augmentation est signifi cativement
inférieure à celle des années précédentes, qui avait
été de 18,8 % entre 1997 et 2000, de 17,8 % entre
2000 et 2003, de 10,1 % entre 2003 et 2006 et de
10,7 % entre 2006 et 2009. Le nombre de personnes
obèses en France en 2012 est ainsi estimé à environ
6 922 000, ce qui correspond à 3 356 000 personnes
supplémentaires par rapport au chiffre de 1997. La
prévalence de l’obésité est plus élevée chez les
femmes (15,7 % versus 14,3 % chez les hommes ;
p < 0,01). L’Étude nationale Nutrition-Santé (ENNS)
de 2006 (4), menée chez des adultes âgés de 18 à
74 ans, retrouve une prévalence supérieure aussi bien
pour l’obésité (16,9 %) que pour le surpoids (32,4 %)
comparativement aux 13,1 % et 30,6 % des chiffres
d’ObÉpi 2006. La méthodologie des 2 études était
différente (poids et taille déclaratifs dans ObÉpi,
et mesurés dans l’ENNS), ce qui peut expliquer
la discordance des résultats, qui reste cependant
modérée. Dans les 2 études, la prévalence de l’obé-
sité augmentait avec l’âge pour atteindre 24,0 % des
hommes et 24,1 % des femmes entre 55 et 74 ans
dans l’ENNS. Enfi n, la prévalence et l’augmentation
de l’obésité sont plus importantes dans les catégo-
ries socio professionnelles inférieures et sont inver-
sement proportionnelles au niveau d’instruction.
La prévalence de l’obésité est ainsi de 24,5 % pour
un niveau d’instruction primaire et de 7,3 % pour
un niveau de troisième cycle universitaire dans
ObÉpi 2012. Ces chiffres témoignent de l’importance
du problème, même si nous restons pour l’instant
bien loin des valeurs retrouvées aux États-Unis, où
69 % de la population atteignaient ou dépassaient
la barre des 25 kg/m2 d’IMC, avec 35,5 % d’obèses
(IMC > 30 kg/ m2) en 2009-2010 (5).
L’obésité, une maladie
L’obésité est-elle une maladie ? La question peut
sembler triviale, mais elle reste d’actualité, comme
le montrent les récents débats qu’elle a suscités au
sein de l’Association médicale américaine (AMA) [6].
Sans entrer dans ce débat, 2 arguments peuvent
soutenir l’idée que l’obésité est bien une maladie.
Le premier est celui des complications qu’elle induit.
Celles-ci touchent absolument tous les organes
(fi gure, p. 14) et conduisent à une altération de
la qualité de vie. Il ne faut pas non plus oublier les
complications psychosociales, avec un plus grand
nombre de dépressions, des revenus inférieurs et
une discrimination à l’embauche et dans le monde
du travail. La personne obèse passe fréquemment
pour un “bon vivant” dont l’attention est tournée
vers les autres, mais vit le plus souvent un calvaire
et souffre souvent de dépression. Les conséquences
économiques sont importantes, avec des coûts de
santé multipliés par 2 à 3 par rapport aux personnes
de poids normal et jusqu’à 10 à 12 pour les obésités
extrêmes (IMC > 40 kg/m2).
La deuxième raison pour laquelle l’obésité peut
être considérée comme une maladie est celle de
son étiologie. Conformément à la première loi de la
thermodynamique, qui nous rappelle que l’énergie
ne peut être ni créée ni détruite, l’accumulation de
graisse – dont chaque gramme représente 9 kcal –
ne peut résulter que d’un déséquilibre de la balance
énergétique, avec des prises caloriques dépassant
les dépenses énergétiques. Bien sûr, à ce niveau, il
est très facile de franchir le pas et de culpabiliser nos
»
Près de 50 % de la population présente une surcharge pondérale. Tout médecin est donc confronté à
des patients en surpoids ou obèses.
»La physiopathologie de l’obésité est complexe et fait entrer en jeu de nombreux mécanismes : prendre
du poids, ce n’est pas simplement manger trop par manque de volonté !
»Tout médecin doit savoir repérer les patients dont l’état justifie une prise en charge pondérale ; il doit
également savoir les orienter vers les filières adaptées.
»
Le médecin doit accueillir avec respect la personne obèse et éviter les “injonctions à maigrir” sans
accompagnement.
Mots-clés
Obésité
Surpoids
Diagnostic
Prise en charge
Accompagnement
Highlights
»
Nearly 50% of the popula-
tion is overweight. Thus, every
physician is confronted with
patients who are overweight
or obese.
»
The pathophysiology of
obesity is complex and brings
into play many mechanisms;
gaining weight is not just over-
eating and lack of will!
»
A physician must be able to
identify patients who should be
recommanded to lose weight;
he should also be able to guide
the patients through the avail-
able ressources.
»
Physicians must accept obese
patients with respect and avoid
discriminating against obese
people.
Keywords
Obesity
Overweight
Diagnosis
Care
Support

Regard sur le surpoids etl’obésité
MISE AU POINT
Figure. Principales complications de l’obésité.
Maladies pulmonaires
• Syndrome des apnées du sommeil
• Syndrome d’hypoventilation
Maladies hépatiques
• Stéatose
• Stéatohépatite
• Cirrhose
Lithiases vésicales
Maladies gynécologiques
• Troubles des règles
• Syndrome des ovaires polykystiques
• Infertilité
Ostéoarthrite
Peau
Goutte
Hypertension
intracrânienne idiopathique
AVC
Cataracte
Maladies coronariennes
Diabète
Dyslipidémie
Pancréatites
Cancers
• Sein, utérus, col
• Côlon, œsophage, pancréas
• Rein, prostate
Phlébites
Stase veineuse
14 | La Lettre du Rhumatologue • No 397 - décembre 2013
patients en les rendant responsables de ce déséqui-
libre énergétique dû à la faiblesse et/ ou au manque
de volonté. Prendre ce raccourci, ce qui est trop fré-
quemment le cas, y compris de la part des méde-
cins, revient à négliger les mécanismes complexes
de régulation de la balance énergétique. Si le poids
corporel est bien déterminé par l’environnement
dans lequel nous vivons, et en particulier par notre
alimentation et par l’activité physique, l’inter action
avec le capital génétique est majeure. Les études de
jumeaux ont en effet permis de montrer que l’héri-
tabilité (fraction de la variance phénotypique totale
d’un caractère quantitatif attribuable aux gènes
dans un environnement particulier) des mesures
de l’adiposité est plus élevée que pour la plupart
des autres maladies complexes. Les estimations
de l’héritabilité vont ainsi de 50 à 70 % pour l’IMC
et de 71 à 86 % pour la composition corporelle
et la répartition des graisses (7). Les systèmes de
contrôle qui régulent le poids corporel sont nom-
breux et complexes. L’hypothalamus joue un rôle
important, en intégrant d’une part des signaux bio-
logiques provenant notamment du tissu adipeux, et
d’autre part des signaux cognitifs. Cette intégration
implique un ensemble complexe de neuropeptides
et neurotransmetteurs ainsi que différents circuits
qui régulent d’une part l’appétit et d’autre part
l’apport et la dépense énergétique. L’existence d’un
génotype dit “économe” est de plus en plus admise
et rend ainsi certaines personnes plus sensibles
que d’autres à notre environnement obésogène.
Nous connaissons d’ailleurs tous des personnes
qui “mangent comme quatre” et restent minces,
alors que d’autres passent leur temps à contrôler
leurs rations tout en continuant à prendre du poids.
Enfi n, dans les mécanismes physiopathologiques
de l’obésité, il convient de ne pas négliger les fac-
teurs épigénétiques, dont l’importance a été bien
démontrée au cours des dernières années. Le terme
“épigénétique” désigne les changements d’expres-
sion des gènes survenant en l’absence de mutation
de l’ADN, par un remodelage de la chromatine, de
manière durable. Elles sont potentiellement réver-
sibles mais peuvent parfois se “verrouiller” si cer-
tains états persistent dans le temps. Ainsi, on sait
actuellement que le fœtus s’adapte aux altérations

MISE AU POINT
Regard sur le surpoids etl’obésité
La Lettre du Rhumatologue • No 397 - décembre 2013 | 17
du métabolisme intra-utérin (restriction ou excès
d’apports), mais aussi à la présence de toxiques
ou polluants atmosphériques (tabac), grâce à des
réponses adaptatives qui engendrent des modifi ca-
tions défi nitives au niveau de l’expression des gènes
de certains organes, conférant une susceptibilité à
des maladies comme l’obésité et le diabète à l’âge
adulte (8). Enfi n, les travaux de la dernière décennie
ont également mis en exergue le rôle fondamental
joué par le microbiote intestinal dans la régulation
de la masse corporelle. D’après les travaux menés
sur des souris à microbiote contrôlé, il semble que la
présence d’un microbiote favorise la vascularisation
entourant l’intestin grêle (angiogenèse), permette
une meilleure digestion des résidus alimentaires et
stimule l’assimilation des lipides (9).
Le médecin face à la personne
en situation d’obésité
L’obésité commune, excluant les obésités dites “syn-
dromiques”, est donc en grande partie expliquée
par une interaction entre terrain génétique et envi-
ronnement. De même que nos gènes ne dépendent
pas de nous, nous ne sommes pas plus responsables
d’une grande partie de notre environnement (urba-
nisation, modes de transport, publicité, qualité des
aliments à disposition, etc.). Il ne saurait donc être
question de rendre les personnes obèses coupables
de leur condition. Pourtant, c’est là une attitude très
courante chez les médecins, et ce, quelle que soit
leur spécialité (10). Sur une enquête que nous avons
réalisée en 2005 auprès de plus de 700 médecins
généralistes de la région Languedoc-Roussillon (11),
73 % d’entre eux reconnaissaient qu’il existe une
attitude négative envers les personnes obèses de
la part des personnels de santé. Plus d’un tiers des
participants déclarait que les patients manquent
de motivation et sont peu compliants et un autre
tiers disait ne pas avoir de succès dans la prise en
charge des problèmes pondéraux. Enfi n, moins de
50 % des médecins reconnaissent la nécessité de
suivre les patients durant plusieurs années. Tous ces
éléments témoignent du caractère frustrant pour
les médecins de la prise en charge de la personne
obèse, conduisant souvent à une déconsidération
et à une culpabilisation des patients.
La reconnaissance de l’obésité comme maladie chro-
nique nous oblige pourtant bien à reconnaître la
nécessité d’accompagner nos patients tout au long
des années et sans relâche, comme nous le faisons
pour toutes les autres pathologies chroniques.
Qui prendre en charge
pour un problème pondéral ?
Sur le plan de la santé publique, il n’y a aucun doute :
des efforts doivent être faits pour maintenir la plus
grande proportion possible de la population en
dessous d’un IMC de 25 kg/ m
2
de façon à réduire
l’incidence des maladies chroniques. Cet objectif de
prévention dépend essentiellement de notre envi-
ronnement et relève donc avant tout des pouvoirs
publics et non du domaine du soin médical.
En tant que médecins cliniciens, c’est à l’individu
que nous nous adressons pour le soigner, dans le
respect de son autonomie et de sa volonté. Or, trop
souvent, que nous soyons omnipraticiens ou spécia-
listes, nous demandons à nos patients de maigrir,
certes dans le but de leur éviter une complication,
qu’elle soit articulaire, métabolique, respiratoire ou
autre, mais sans réellement leur proposer d’accom-
pagnement thérapeutique. Cette approche s’appa-
rente à une “injonction à maigrir” : vous avez mal au
genou, vous avez mal au dos, vous êtes essouffl é(e),
vous avez du diabète, la solution est simple : vous
n’avez qu’à maigrir ! En pratiquant ainsi, nous ren-
voyons nos patients à une responsabilité indivi-
duelle, sous-entendant qu’ils n’ont qu’à faire preuve
d’un peu de volonté et à se montrer responsables
en mangeant moins. Mais c’est là négliger la com-
plexité de la problématique obésité et, quelque part,
refuser de faire l’aveu de notre propre impuissance,
ne sachant pas nous-mêmes comment accompa-
gner le patient. En pratiquant ainsi, nous ne faisons
qu’ajouter la souffrance psychologique à la souf-
france liée au poids.
Savoir à qui conseiller de perdre du poids est une ques-
tion essentielle. Elle ne peut être envisagée indépen-
damment de son corollaire, à savoir comment aider
nos patients à perdre du poids. Le cas le plus simple
est celui de la personne présentant une obésité avérée
(IMC > 30 kg/ m
2
) compliquée (dyspnée d’effort, arth-
rose du genou) ou associée à une comorbidité. Il est
évident ici que la thérapeutique passe par une prise
en charge du poids. De fait, même en dehors d’une
complication ou d’une comorbidité, un IMC supérieur
à 30 kg/ m2 est associé à un risque plus important
qui justifi e de sensibiliser toute personne obèse sur
les relations entre poids et santé et de l’encourager
à s’engager dans une prise en charge. En dessous
de 30 kg/ m
2
, la relation entre poids et complica-
tions est beaucoup moins certaine et nous devons
dans ce cas limiter le conseil d’amaigrissement aux
patients présentant des facteurs de risque associés
ou une complication (gonalgie), à ceux qui ont une

Regard sur le surpoids etl’obésité
MISE AU POINT
18 | La Lettre du Rhumatologue • No 397 - décembre 2013
augmentation importante du périmètre abdominal,
au-delà des seuils préa lablement défi nis et dont le
poids augmente régulièrement, ou à ceux qui sont
demandeurs. Quant aux personnes qui ne sollicitent
pas de prise en charge, il est particulièrement impor-
tant de ne leur conseiller de perdre du poids que si
nous sommes certains qu’elles peuvent en tirer un
bénéfi ce pour leur santé et sans souffrir d’un reten-
tissement psychologique trop important.
Qu’en est-il des personnes présentant des douleurs
ou des pathologies articulaires ? Les personnes
obèses se plaignent plus fréquemment que la popu-
lation contrôle de douleurs à tous les niveaux, mais
plus particulièrement à la partie inférieure de l’orga-
nisme : hanches, jambes, genoux et pieds. L’arthrose
est plus fréquente, touchant essentiellement les
genoux, le risque de gonarthrose augmentant de
15 % pour chaque élévation de 1 unité d’IMC. La
fi bromyalgie est également plus fréquente. Comme
pour les complications métaboliques, le lien entre
poids et douleurs articulaires n’est clairement avéré
que pour les obésités vraies (IMC > 30 kg/ m
2
), mais
il est beaucoup moins franc pour les simples surpoids
(IMC entre 25 et 29,9 kg/ m
2
) [12]. Le médecin nutri-
tionniste se trouve ainsi souvent amené à voir des
patients consultant sur les conseils de leur rhumato-
logue ou de leur orthopédiste pour perdre du poids
en vue de soulager des douleurs articulaires ou avant
d’être opérés. Les demandes sont parfois – souvent –
irréalistes, ciblant des pertes de poids de plusieurs
dizaines de kilos dans des délais rapides, avant une
intervention chirurgicale. Dans ces circonstances,
il serait important que les objectifs soient fi xés en
commun par les spécialistes des pathologies arti-
culaires et ceux de l’obésité. Encore une fois, il est
important de garder à l’esprit que l’obésité est une
pathologie complexe et diffi cile à prendre en charge.
Ainsi, ce qui compte, c’est que le patient s’engage
dans un processus de suivi et de prise en charge. Mais
une fois celui-ci engagé, certains patients gagneront
à être opérés plus précocement de façon à pouvoir
restaurer une mobilité qui facilitera la perte de poids
ultérieure.
Dans tous les cas, quel que soit le niveau d’IMC, une
attention particulière doit être portée à la manière
dont le problème du poids sera abordé avec le
patient. Comme dans toute relation humaine, la
relation médecin-malade fait entrer en jeu des fac-
teurs de séduction. Ainsi, lorsqu’un médecin annonce
à un patient qu’il est obèse, il s’agit bien d’un
médecin qui annonce un diagnostic à un patient,
mais il peut aussi s’agir d’un homme qui déclare
à une femme (ou d’une femme qui déclare à un
homme) qu’elle (qu’il) est “grosse” (“gros”), parfois
même sans l’avoir ni pesée ni mesurée, et surtout
sans avoir pris conscience de l’impact psychologique
– du “poids” – de ses paroles. Ainsi, il est logique,
de la part d’un chirurgien orthopédique, après une
entorse du genou consécutive à une chute à ski chez
une jeune fi lle de 16 ans dont l’IMC n’atteint pas
25 kg/ m2 de déclarer : “ma petite, il faudrait peut-
être que tu perdes un peu de poids”. Y a-t-il, d’une
part, un lien réel entre son poids et sa pathologie
et, d’autre part, un bénéfi ce attendu pour la santé
supérieur au traumatisme psychologique engendré
suite à une telle déclaration ? Est-il plus concevable,
chez une dame d’une soixantaine d’années, ayant un
IMC dépassant 30 kg/m
2
et consultant un rhumato-
logue pour gonalgies, d’accompagner le “ma p’tite
dame, il faudrait penser à perdre du poids” d’une
petite tape dont les conséquences psychologiques
seront désastreuses ?
Quelle prise en charge
pour le surpoids et l’obésité ?
Les prises en charge conventionnelles
ou “régimes”
Si la prise de poids résulte d’un déséquilibre de
la balance énergétique au bénéfi ce des apports,
la perte de poids va, elle, nécessiter un déséqui-
libre dans l’autre sens, c’est-à-dire au bénéfi ce des
dépenses. Pas de mystère à ce niveau : il va falloir
diminuer les prises alimentaires et augmenter l’acti-
vité physique.
Les “approches classiques” de la prise en charge du
surpoids et de l’obésité reposent sur les “régimes”.
Ils sont nombreux, plus ou moins médiatisés, mais
tous se fondent sur le même principe, à savoir des
listes d’aliments à favoriser ou à éviter ainsi que
des quantités conseillées. Le terme “régime” com-
mençant à avoir mauvaise presse, de nombreuses
méthodes évitent de l’utiliser mais restent néan-
moins fondées sur ces principes de sélection/limi-
tation d’aliments.
Pourquoi les approches classiques
et les régimes ne fonctionnent-ils pas
sur la durée ?
Dans un régime, ce n’est pas le patient qui décide de
ce qu’il doit manger ni de quand il doit le manger.
C’est le programme ou régime qui contrôle les prises
 6
6
 7
7
1
/
7
100%