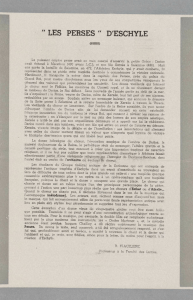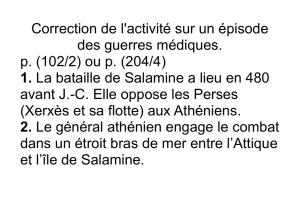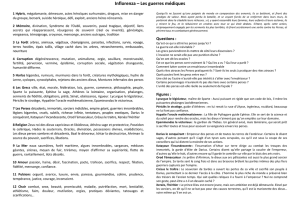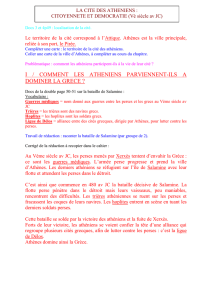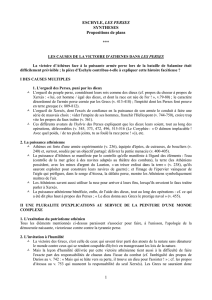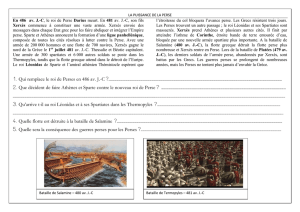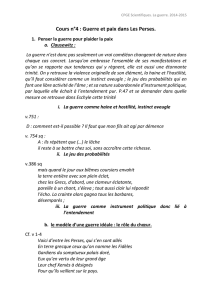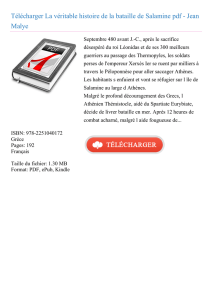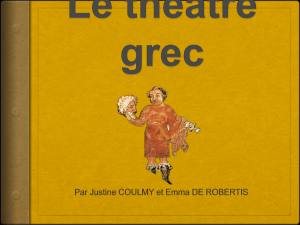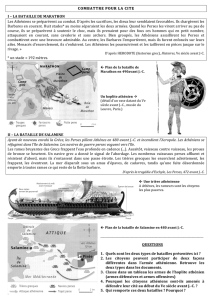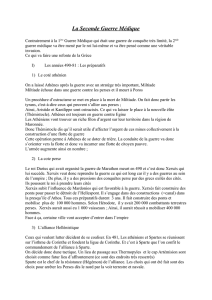Les Perses

Les Perses
ESCHYLE
Les Perses
n° 1127
ragédie toujours fort estimée, mais assez peu lue, Les
Perses d’Eschyle paraissent dans la collection GF
sous la forme d’une édition séparée. Par rapport au
volume des Tragédies complètes d’Eschyle traduites par
Émile Chambry (GF n° 8), où Les Perses figurent bien
évidemment, ce nouvel ouvrage répond à une double
ambition.
• Proposer au public une traduction nouvelle, qui soit
pleinement lisible – c’est-à-dire une traduction littéraire,
et non pas « universitaire », une traduction visant à donner
dans notre langue un reflet de l’ensemble des aspects de
l’œuvre originale. On ne s’est donc pas limité à transposer
simplement le contenu discursif de la pièce : on a voulu
restituer aussi quelque chose de sa tonalité, ou plutôt de
ses diverses tonalités – tragique, bien sûr, mais aussi
épique, et peut-être secrètement ironique ; on s’est appli-
qué à donner une idée de la puissance poétique du langage
d’Eschyle, dans sa simplicité comme dans ses audaces ; on
a tenté de serrer ce langage, autant qu’il se pouvait, dans sa
densité, son mouvement et ses rythmes. Proposer une tra-
duction lisible : mais, dès lors, une traduction jouable,
aussi bien…
• Mettre l’œuvre en perspective par un appareil critique
(notes, Présentation, Dossier) qui permette au lecteur
d’aujourd’hui d’en saisir la portée. Celle qu’elle pouvait
avoir pour Eschyle et ses contemporains, qui trouvaient
dans l’évocation du désastre des Perses devant l’armée
grecque, à Salamine, de quoi flatter leur orgueil national ;
mais également, par-delà cette antique confrontation entre
l’Occident et l’Orient, la portée intemporelle et universelle
qui est la sienne, dans la méditation qu’elle nous invite à
T
1

8
mener, comme toute grande tragédie, sur les pièges que la
fatalité ourdit pour punir la démesure des hommes.
L’appareil critique s’attache ainsi à mettre en regard les
Perses imaginaires d’Eschyle avec les Perses réels – ceux
que les historiens, en particulier Hérodote, nous laissent
connaître ; à préciser le contexte historique, pour apprécier
la latitude qu’Eschyle s’est autorisée dans le traitement de
faits réels et contemporains ; à analyser, dans la composi-
tion de l’œuvre, la marque propre du poète-dramaturge,
mais aussi ce dont il est redevable à la tradition littéraire
grecque, en particulier à Homère et à l’épopée ; à souli-
gner enfin l’originalité irréductible de ces Perses par rap-
port au genre de la tragédie, notamment tel qu’il a été
codifié ultérieurement par Aristote.
Le Parcours de Lecture qui suit reprend, développe et
prolonge certaines de ces pistes, et en explore quelques
autres.
Danielle SONNIER & Boris DONNÉ.

Les Perses
Eschyle est le mystère antique fait homme ;
quelque chose comme un prophète païen. Son
œuvre, si nous l’avions toute, serait une sorte de
bible grecque.
V. Hugo, William Shakespeare
La tragédie des Perses est vieille de deux mille cinq
cents ans. Il serait absurde de vouloir en montrer la moder-
nité, quand il y a tout à gagner à découvrir la puissante
étrangeté d’un texte « lointain et sauvage
1 ». D’emblée,
trois remarques s’imposent.
– Il s’agit sans doute (en concurrence avec les Sup-
pliantes) de la plus ancienne des trente-deux tragédies qui
nous ont été conservées du répertoire grec, et la simplicité
tout archaïque de sa structure semble mettre en pleine
lumière les ressorts fondamentaux du tragique grec.
– Négligeant les sujets tirés de la mythologie ou de
l’épopée homérique, Eschyle prend ici pour thème un événe-
ment récent, la victoire des Athéniens et de leurs alliés grecs
sur l’armée perse, commandée par le « grand roi » Xerxès à
la bataille navale de Salamine (à quelques kilomètres
d’Athènes), en 480 avant J.-C. Or si l’on sait qu’Eschyle
était présent comme soldat à cette bataille, on comprend quel
intérêt personnel il porte à cet événement. Huit ans plus tard
(en 472 avant J.-C.) au théâtre de Dionysos à Athènes, au
pied de l’Acropole, il présente cette tragédie devant des gra-
dins où sont assis bon nombre d’anciens combattants, et des
hommes et des femmes qui ont vu Athènes occupée, l’Acro-
pole et ses temples incendiés.
1. J. de Romilly, Les Perses, PUF, coll. « Érasme », 1974, p. 21.

10
– Eschyle situe la scène en Perse (s’il avait choisi
Athènes, la joie des Athéniens vainqueurs n’aurait pas
fourni une donnée tragique !). L’action se passe donc au
palais royal perse, et les événements de 480 sont vécus et
commentés, avec le retard dû à la distance, du point de
vue des vaincus. Certes, la pièce est patriotique, elle
flatte la fierté d’être grec, elle donne à voir la douleur des
Perses qu’un tyran mégalomane a conduits au désastre.
Mais la peinture de la souffrance de l’adversaire vaincu
ne saurait se réduire à un exercice de ricanement
sadique : la tragédie ne se moque pas de la douleur, elle
la fait partager (terreur et pitié…) 1. Et par là, elle vise à
l’universel : elle demande aux vainqueurs de se mettre en
sympathie avec les vaincus. Surtout elle pose les grandes
questions « bibliques » : à quelles lois obéit l’histoire ?
Pourquoi la douleur ? Que veulent les dieux ? Que peu-
vent les hommes ? Pourquoi le malheur sur un homme,
sur une famille ou tout un peuple ? Autant de questions
qui fondent toute tragédie eschylienne.
I. LE TRAGIQUE : ANGOISSE
ET ATTENTE, DÉSESPOIR
L’
ANGOISSE
Les deux cent cinquante premiers vers en orchestrent la
montée progressive, en trois paliers successifs : le cory-
phée, le chœur, la reine mère viennent installer ce climat.
La pièce s’ouvre par un prologue, prononcé ici par le cory-
phée, chef et porte-parole du chœur. Le chœur entre avec
lui solennellement et se met en place lentement pendant
que leur chef s’exprime. Ce sont des vieillards (quinze
sans doute), notables du palais, préoccupés par le sort de
l’armée dont on est sans nouvelles. Le coryphée cherche à
se rassurer : la Perse est puissante, riche. Que peut-on
craindre au milieu de l’or qui resplendit partout ? Dans les
cinquante-six premiers vers, il utilise quatre fois le mot
1. Nous reviendrons plus loin sur l’aspect caricatural que prend parfois
la douleur perse.

11
Les Perses
poluchrusos (tout en or). Pourtant, « le tourment / point le
cœur de mon cœur » (• v. 10-11) ; son cœur est un
« prophète de malheur » (kakomantis thumos) qui lui ins-
pire de noires inquiétudes et qui assombrit l’éclat de l’or.
Il a beau énumérer ensuite la formidable puissance de
l’armée « dorée » partie avec Xerxès, il trouve le temps
long et les messagers lents.
Le chœur, une fois en place (• v. 65), entonne son
Ier chant : on l’appelle la parodos, le chant d’entrée du
chœur, qui suppose danse et psalmodie. Pour autant, le
chœur n’est pas un élément décoratif ; il participe à
l’action, il est intéressé à l’avenir obscur. Ces vieillards
ont peur, pour eux-mêmes, pour leurs enfants absents ;
mais ils expriment aussi l’angoisse de tout un peuple, des
« femmes perses, de douleurs / prostrées » dont « les lits
sont tout pleins de larmes » (• v. 133-135). Ils élargissent
ainsi les propos alarmistes du coryphée. Toutefois, eux
aussi essaient de se rassurer : l’armée a déjà franchi l’Hel-
lespont (le Bosphore) qui sépare les deux continents… Le
« troupeau merveilleux » conduit par Xerxès est comme
« la mer / qui déferle, irrésistible » (• v. 74 et 90). Mais le
cœur n’y est pas, les vieillards sont, plus que d’autres,
sujets à l’angoisse 1. Ces vieillards paralysés par l’âge et
l’anxiété sont donc la voix même du tragique, offerts aux
coups du destin sans moyen de défense. D’où l’impor-
tance du chœur dans les tout débuts du genre tragique, au
point qu’on a pu dire que « la tragédie est née du chœur
tragique, à l’origine elle fut le chœur et rien que le
chœur 2 ». Les Perses gardent bien des traits de ces ori-
gines, dans la mesure où le texte ressemble encore à un
« poème tragique », sans beaucoup d’action, tout en
« plaintes dolentes » (• v. 1077).
Après la parodos viennent les épisodes, les parties com-
prises entre deux chants du chœur, et tandis que les épi-
1. Cf. J. de Romilly : « Le chœur doit être à la fois plus intéressé que qui-
conque à l’issue des événements, et partout incapable d’y jouer lui-
même aucun rôle. Il est par définition impuissant. Aussi est-il le plus
souvent formé de femmes ou de vieillards, trop vieux pour aller se
battre. » La Tragédie grecque, PUF, 1970, p. 28.
2. Nietzsche, Naissance de la tragédie (1871), Gonthier, p. 47.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%