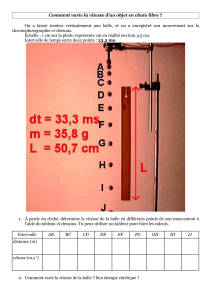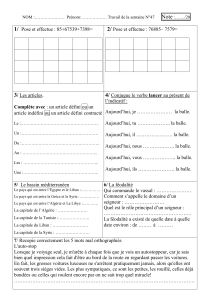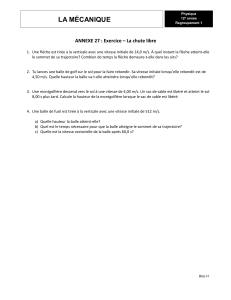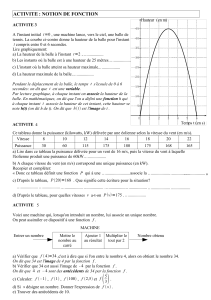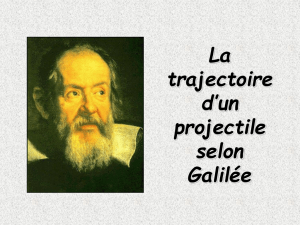La relocalisation de l’économie comme levier essentiel de la prospérité économique

Vous êtes ici :
Accueil> Société> Développer l'économie de proximité
> La relocalisation de l’économie comme levier essentiel de la prospérité
économique
La relocalisation de l’économie comme levier essentiel
de la prospérité économique
INTERVIEW DE RAPHAËL SOUCHIER
Vous venez de publier « Made in local », ouvrage dans lequel vous explorez un ensemble d’initiatives
développées aux Etats-Unis et au Canada en faveur de la relocalisation de l’économie, et en particulier le
mouvement d’entrepreneurs Business Alliance for Local Living Economies (BALLE). Pouvez-vous nous
présenter en quelques mots l’origine du mouvement ?
consultant européen économies locales
soutenables
<< Promouvoir la relocalisation de l'économie n'est pas
remettre en cause le principe d'ouverture économique.
Il s'agit plutôt de repenser, en la rééquilibrant, notre
conception de la mondialisation >>.
Auteur et conférencier, Raphaël Souchier est aussi
consultant européen en économies locales soutenables,
facilitation de processus et coopération trans-culturelle. Au
cours des 20 dernières années, il a animé pour l’Union
Européenne onze réseaux de coopération et projets
d'échange d'expériences entre collectivités, universités et
entreprises à travers le continent. Son dernier ouvrage «
Made in local » a été publié en 2013 aux éditions Eyrolles.
1
Dans cette interview, Raphaël Souchier nous fait découvrir
le mouvement d’entrepreneurs nord-américain Business
Alliance for Local Living Economies (BALLE). Faisant de la
localisation de l’économie un levier essentiel de la
prospérité économique, sociale et environnementale des
territoires, ce mouvement repose sur une dynamique
entrepreneuriale éthique, pragmatique et résolument
collective.
Interview réalisée dans le cadre de la démarche « Grand
Lyon Vision Solidaire » qui vise à réinterroger l’enjeu du
développement solidaire dans l’agglomération.
Réalisée par : Boris CHABANEL
Tag(s) : Mondialisation, Proximité, Labs/Laboratoire
Date : 24/04/2014

Pour comprendre l’émergence du mouvement BALLE, dont la particularité est d’être impulsée non pas par des
collectivités mais plutôt par des entrepreneurs, revenons sur le contexte américain. L’impact de la mondialisation sur les
économies locales y est, depuis plusieurs décennies, beaucoup plus violent qu’en France, car il n’est pas modéré par la
puissance publique. Aux Etats-Unis, il n’y a pas, comme ici, des amortisseurs sociaux qui absorbent un peu les chocs et
permettent de conserver un certain équilibre socio-économique entre les territoires du pays. Au cours des dernières
décennies, certaines régions américaines autrefois prospères ont vu leur économie imploser. Le déplacement des
industries manufacturières vers les Etats du Sud pour trouver de moindres contraintes sociales et salariales, puis la
vague de délocalisation de la production vers le Mexique, l‘Europe de l’Est et l’Asie ont entraîné la paupérisation d’une
large partie de la population américaine, sur le plan économique, social, sanitaire ou encore éducatif et culturel.
C’est dans ce contexte qu’ont commencé à se fédérer, un peu partout aux Etats-Unis puis au Canada, des entrepreneurs
conscients et préoccupés de l’impact de leur activité sur le territoire où ils vivent et travaillent. Ils se demandent d’abord
non pas « Comment puis-je gagner plus ? », mais « Que pouvons-nous faire pour l’avenir de notre communauté en
matière d’emploi, de pauvreté, d’environnement, etc. ? » Ce point est essentiel car le ciment et le moteur du mouvement
BALLE sont d’abord une certaine éthique du business, du rôle de l’entreprise dans la société. Aux yeux de ces
entrepreneurs, leur activité est le prolongement de leurs valeurs personnelles, dans une recherche de cohérence. Ainsi,
BALLE est née au début des années 2000 de la volonté visionnaire de Judy Wicks et Laury Hammel. Judy était riche de
l’expérience du « Sustainable Business Network » qu’elle avait fait émerger à Philadelphie. Entrepreneur social de
Boston, Laury avait quant à lui co-fondé en 1991 le réseau national « Business Social Responsability ». C’est au cours
d’une rencontre organisée par un mouvement d’investisseurs et d’entrepreneurs sociaux – le Social Venture Network
(SVN) – que ces deux pionniers eurent l’idée de forger un mouvement en faveur de la création de réseaux locaux
d’entrepreneurs engagés dans la construction d’économies locales soutenables sur un plan économique, social et
environnemental. Cette proposition fut présentée lors de la conférence annuelle de SVN en 2011. Judy et Laury
convièrent à cette conférence les deux économistes Michael Shuman et David Korten à partager leur vision d’une
alternative à la mondialisation économique, fondée sur le renforcement de la démocratie, des économies et des
entreprises locales. Le mouvement BALLE fut officiellement lancé en octobre 2001 avec les membres de SVN qui
souhaitaient s’impliquer. Aujourd’hui, l’association BALLE réunit plus de 80 réseaux locaux d’entreprises en Amérique du
Nord, soit plus de 35 000 entreprises et un demi-million d’emplois.
Au moment où les Etats-Unis et la Commission Européenne négocient un traité transatlantique de libre-échange,
le mouvement BALLE défend, quant à lui, l’idée que la prospérité économique passe d’abord par la localisation
de l’économie
Effectivement, BALLE est à la fois un mouvement très pragmatique, avec une volonté d’avancer collectivement sur des
projets concrets ; mais c’est aussi devenu le creuset d’une réflexion de fond sur les ressorts de la vitalité économique
des territoires, assise sur des données statistiques solides. Ce mouvement défend l’idée que les communautés locales
doivent reconquérir leur autonomie, reprendre le contrôle de leur destinée, en recréant des économies vivantes. Cette
conviction fait écho au constat de l’échec et des dérives du système économique globalisé, dérégulé et financiarisé,
érigé en modèle universel depuis le tournant ultra-libéral des années 1980. C’est en premier lieu une question
démocratique. Comme le dit David Korten, « dans les années 1980 le capitalisme a triomphé du communisme, dans les
années 1990 il a triomphé de la démocratie ». Force est, en effet, de constater que celle-ci se trouve très affaiblie par la
libéralisation des échanges à l’échelle mondiale et l’émergence des firmes multinationales. Lesquelles se jouent des
régulations politiques, notamment fiscales et règlementaires, leur puissance de lobbying leur permettant de tenir la plume
du législateur. Ce phénomène atteint des proportions particulièrement inquiétantes aux Etats-Unis, où les firmes sont les
principaux financeurs des campagnes électorales. Une récente étude portant sur plusieurs décennies de décisions
politiques montre comment « les élites économiques et les groupes organisés qui représentent des intérêts commerciaux
ont un impact important sur la politique du gouvernement des États-Unis, tandis que les groupes d’intérêt qui
représentent la masse et les citoyens ordinaires ont peu ou pas d’influence. » Le premier enjeu est donc un enjeu de2
réappropriation de la démocratie par son ré-enracinement au sein des communautés locales.
C’est aussi une question sociale, puisque la compétition à tout crin organisée à l’échelle planétaire se traduit par le
ralentissement de l’emploi et des salaires, et par des logiques de dumping fiscal dont profite à plein l’oligarchie
économique et financière. Comme le décrit dans son dernier livre l’économiste Thomas Piketty, les inégalités n’ont3
cessé de se creuser ces dernières décennies pour atteindre aujourd’hui des sommets outre-Atlantique.
Le troisième enjeu est économique. Michael Shuman explique comment les grandes firmes de l’industrie et de la
distribution se sont emparé d’une part croissante de l’activité et des revenus de l’économie locale et à quel point cela a
contribué à l’appauvrir. Il nous invite à sortir de la croyance selon laquelle il suffirait que des grandes firmes soient
présentes sur un territoire pour que ce dernier devienne prospère. La rhétorique de la diffusion de la richesse par
ruissèlement ne tient pas, car ces firmes poursuivent des stratégies de compression de l’emploi, leurs profits ne restent
pas sur place, leurs investissements et leurs approvisionnements dépendent de décisions sur lesquelles le territoire n’a
pas de prise. Bref, ces entreprises ont un enracinement territorial de plus en plus faible, voire nul, qui fait que la majeure

partie de la richesse créée quitte le territoire. En rupture avec cette vision, les réflexions développées par le mouvement
BALLE, et d’autres comme American Independent Business Alliance (AMIBA) ou l’Institute for Local Self-Reliance (ILSR)
montrent que la prospérité économique, sociale et écologique des territoires est, en réalité, liée à l’ancrage local du
capital des entreprises et au couple production-consommation.
Qu’entend-on ici par « entreprise locale » et pourquoi jouent-elles un rôle important dans le développement
économique du territoire ?
Pour BALLE, une entreprise n’est « locale » que si son capital est majoritairement détenu par des personnes ou
organisations résidant dans la région où opère principalement l’entreprise, mais aussi si ses dirigeants y vivent et
travaillent. Pour la pensée économique dominante, savoir qui détient la propriété des entreprises n’a aucune importance
: toutes contribuent à la création de richesses et d’emplois, paient des impôts, etc. Or, rien n’est moins vrai ! Les études
conduites par Shuman, BALLE, l’Institute for Local Self-Reliance et plusieurs universités ont montré que les entreprises
locales contribuent beaucoup plus au développement économique du territoire que ne le font les firmes non locales. La
part du chiffre d’affaires d’une entreprise locale qui est réinjectée dans l’économie du territoire est, en moyenne, trois fois
supérieure à celle des grandes chaînes nationales et internationales. En effet, par unité de chiffre d’affaires ou d’actifs,
les entreprises locales créent davantage d’emplois, offrent de meilleurs salaires, s’approvisionnent davantage
localement, génèrent plus de retombées pour le monde associatif et de rentrées fiscales pour les collectivités. On peut
ajouter que le dynamisme des entreprises locales ne contribue pas seulement à la prospérité économique des territoires,
il favorise aussi leur cohésion et leur résilience. En effet, quand les entrepreneurs vivent dans la communauté où se
déploie leur activité, ils sont plus sensibles aux impacts - positifs ou négatifs - que peuvent avoir leurs décisions sur la
communauté. De même, lorsque les chaînes d’approvisionnement privilégient les ressources et les savoir-faire de
proximité, la communauté est davantage encline à préserver ces derniers et se trouve du même coup moins affectée par
les chocs extérieurs.
Ainsi, selon Michael Shuman, les communautés locales les plus prospères sont celles qui maximisent leur autonomie
dans la satisfaction de leurs besoins. Il constate que les communautés locales disposent d’un réel pouvoir d’agir, à
travers l’entrepreneuriat et la consommation. D’un côté, l’entrepreneuriat local permet de diversifier l’offre de biens et de
services. De l’autre, chacun peut faire le choix d’acheter et d’investir en priorité dans les entreprises du territoire.
Face à la mondialisation, l’autarcie ?
Non, ce n’est clairement pas l’état d’esprit des membres de BALLE ! Promouvoir la relocalisation de l’économie n’est pas
remettre en cause le principe d’ouverture économique et les échanges qu’il permet. Il s’agit plutôt de repenser, en la
rééquilibrant, notre conception de la mondialisation. Aujourd’hui, l’une des erreurs des politiques conventionnelles de
développement économique est de se focaliser trop exclusivement sur les marchés mondiaux, sous-estimant ou ignorant
les opportunités et enjeux locaux. Leur hypothèse est que si vous êtes compétitifs sur les marchés mondiaux, la
prospérité locale suivra mécaniquement. D’autre part, certains pourraient penser qu’aller vers davantage d’autonomie
des communautés locales se traduirait par un recul des échanges et donc de la richesse. Selon Michael Shuman, ce
raisonnement est erroné. En effet, même si cela peut paraitre contre-intuitif, la relocalisation de l’économie pourrait au
contraire stimuler le commerce. D’une part, si l’on peut amener les territoires à un niveau d’autonomie optimale – et non
totale, comme dans le cas de l’autarcie– ils libèreront plus de moyens pour acquérir sur le marché mondial les produits et
services qui ne peuvent être produits de façon performante à proximité. D’autre part, stimuler l’offre locale par la
demande locale permettra d’atteindre un seuil de maturité du tissu économique local grâce auquel certaines entreprises
du cru émergeront pour se tourner vers les marchés nationaux et mondiaux. Au final, on peut même penser que, parce
qu’elles seront d’abord et avant tout ancrées sur leur marché régional, donc moins dépendantes du marché mondialisé
pour leur survie, les entreprises accepteront davantage de partager leurs techniques et savoir-faire avec les acteurs
d’autres économies locales.
Du reste, le mouvement de relocalisation de l’économie paraît aujourd’hui amorcé. La montée du prix du pétrole, la
fiscalisation croissante des externalités négatives, la demande des consommateurs pour des produits du cru, de
multiples facteurs poussent les acteurs économiques à réorganiser les chaînes de valeur. Contrairement aux échanges
d’informations et de connaissances, qui devraient aller en se globalisant, les transports de matière et d’énergie sont
appelés à se développer sur des échelles progressivement plus réduites.
Cependant, les entreprises locales sont généralement de plus petite taille. N’est-ce pas un handicap pour
proposer des biens et services de qualité et au meilleur coût ?
Pour Shuman, il s’agit là aussi d’une erreur de raisonnement. Tout d’abord, lorsque l’on parle d’économie d’échelle, on
utilise souvent une extrapolation faussée de la théorie. Car cette dernière nous dit qu’il existe, quelque part, un seuil
optimal sur l’échelle de la performance, et que si la taille de l’entreprise s’éloigne de ce seuil -en diminuant ou en
augmentant-, son efficacité se réduit. Le niveau optimal, le plus performant, n’est donc pas le « toujours plus grand »!
D’ailleurs, on ne compte plus les études américaines montrant que les entreprises les plus dynamiques en termes
d’innovation ne sont pas les plus grosses. Les grands groupes ne se développent-ils pas, pour une bonne part, par
croissance externe, c’est-à-dire par agrégation d’entreprises plus petites et plus performantes ? Ils rachètent la meilleure
capacité d’innovation des start-up. Et puis, comme le soutient Michael Shuman, les économies d’échelle liées à la taille

ne sont pas l’apanage des grandes firmes. Il n'y a pas d'économie d'échelle que les entreprises locales ne puissent
réaliser par le moyen de la collaboration : par la mise en commun de leurs forces, les petites entreprises peuvent, elles
aussi, atteindre une masse critique et être en capacité de produire et vendre en quantité. Un exemple de cela nous est
donné par Organic Valley aux Etats-Unis. En 20 ans, Organic Valley est devenue la première coopérative de
commercialisation indépendante d’agriculteurs familiaux bio d’Amérique du Nord, et le principal producteur et distributeur
de produits biologiques de saison. Elle est passée de 7 cofondateurs à près de 1 800 coopérateurs aujourd’hui. Enfin, en
réduisant les coûts logistiques (conditionnement, transport, etc.) et les coûts cachés liées à l’éclatement des chaînes de
valeur à l’échelle mondiale (délais, défauts de qualité, complexité organisationnelle, risques climatiques et
technologiques, etc.), la relocalisation peut permettre aux entreprises locales de proposer à l’avenir des produits plus
compétitifs, au delà des seules hautes gammes.
Vous dites que l’avantage de la relocalisation de l’économie peut être démontré sur le plan statistique.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
C’est en effet un autre point intéressant, car pour mobiliser, il faut pouvoir prouver ce que l’on avance. Afin
d’accompagner la mutation engagée par les entreprises et communautés locales, Michael Shuman et l’équipe de BALLE
ont conçu une série d’outils statistiques. En premier lieu, comme je l’évoquais tout à l’heure, ils sont capables d’analyser
les retombées locales de l’activité d’une entreprise : l’activité induite par l’approvisionnement local, les emplois directs et
indirects, les rentrées fiscales, etc. Un second calculateur a été développé pour révéler les « emplois cachés ». Il permet
de mesurer le niveau d’autonomie locale dans chacune des catégories de la nomenclature nationale des activités
(l’équivalent de notre NAF). Concrètement, pour chaque catégorie d’activité, on met en regard ce qui est produit sur
place et ce qui est importé. Ce qui permet d’en déduire les emplois et revenus supplémentaires qui pourraient être
générés si l’autonomie était optimisée. Sur cette base, il est alors possible de hiérarchiser les secteurs d’activité les plus
porteurs en termes d’emplois et de revenus, et de suivre les progrès réalisés vers une autonomie accrue; même si,
encore une fois, il ne s’agit de vouloir arriver à tout localiser à 100%. Cet outil permet aussi à un entrepreneur souhaitant
faire une étude de marché de se faire une idée du niveau de saturation de la demande locale par d’autres producteurs. Il
est intéressant de noter que ce type d’approche est depuis peu également possible en France, en particulier grâce aux
outils « Local footprint » et « Réflexe Local » développés par le cabinet Utopies. Ce qui va nous permettre, d’une part, de
nous appuyer sur des chiffres « français » et, d’autre part, d’aider les entreprises à mesurer et optimiser leurs impacts
économiques, sociaux et environnementaux ; et les collectivités territoriales à visualiser et valoriser les opportunités de
création d’emplois et de réduction des « fuites économiques » de leur territoire …
Je peux également évoquer un troisième calculateur développé par BALLE qui permet, quant à lui, d’estimer le potentiel
d’épargne locale susceptible d’être investi dans les entreprises du territoire. Par ailleurs, depuis cinq ans, l’Institute for
Local Self-Reliance réalise une enquête nationale auprès des entreprises indépendantes américaines ; celle-ci montre
que, dans les villes et territoires où des campagnes de sensibilisation sur la consommation locale sont menées, les
entreprises locales connaissent une progression sensiblement supérieure de leur chiffre d’affaires. Créer des alliances
entre entrepreneurs et consommateurs sur le long terme constitue donc une vraie opportunité.
La constitution de « Business Alliances » à l’échelle locale apparaît comme un levier essentiel du processus de
relocalisation de l’économie. En quoi consistent-t-elles ?
Pour comprendre l’esprit de ces Alliances d’entreprises locales, prenons l’exemple de la fondatrice du mouvement
BALLE, Judy Wicks. En 1983, Judy ouvre au rez-de-chaussée de sa maison à Philadelphie le White Dog Café, qui
deviendra en quelques années un restaurant de deux-cents couverts. En 1998, elle découvre le traitement cruel que
subissent les porcs en élevage industriel. Elle décide alors de trouver un éleveur plus respectueux des conditions de vie
naturelles des animaux. Mais Judy ne s’arrête pas là. Elle part à la découverte des fermes de la région, en quête de
producteurs qui puissent lui fournir du bœuf, des œufs, des fruits et légumes, des produits laitiers issus d’élevages bio.
Bientôt, son restaurant devient une référence pour son menu local et éthique, dont les produits frais proviennent de
fermes situées dans un rayon de 80 km. Encore une fois, elle décide de prolonger sa démarche en mobilisant ses
collègues restaurateurs de Philadelphie. Elle crée « White Dog Community Entreprises », une fondation à laquelle elle
versera désormais 20% des bénéfices de son restaurant pour l’aider à accomplir sa mission : mettre en relation les
restaurateurs, les commerçants et les fermiers locaux, et construire un réseau régional de fermes, de restaurants et de
magasins. Judy élargit alors le questionnement : qu’est-ce qui pourrait faire l’objet d’un approvisionnement à la fois plus
local et plus soutenable ? Les vêtements ? Les matériaux de construction ? L’énergie ? Elle commence à se réunir avec
d’autres entrepreneurs de même sensibilité et à partager avec eux sa vision d’une économie locale soutenable. C’est
ainsi que naît, en 2001, le « Sustainable Business Network » de Philadelphie. Aujourd’hui ce réseau compte plus de 400
membres de tous les secteurs de l’économie locale.
Autrement dit, les alliances naissent non d’une décision technocratique mais d’individus porteurs de valeurs,
d’entrepreneurs engagés qui, ensemble, commencent à travailler à l’amélioration de leur business selon une logique de «

triple résultat » : devenir performant à la fois dans la production de biens ou services, dans le développement des
capacités et opportunités des membres de la communauté, dans la protection de la nature. Pour chacun des principaux
secteurs d’activité de l’économie du territoire, chaque réseau identifie et teste les modèles d’affaires et les modalités de
coopération les plus performantes au regard de ces trois objectifs. Ce qui implique, par exemple, de savoir mobiliser et
réunir l’ensemble des acteurs concernés – privés et publics – autour d’une filière de valorisation agricole, textile, etc.
Comment se positionne l’équipe de BALLE par rapport à ces alliances locales ?
Elle joue un rôle d’inspiration, d’accompagnement et de capitalisation. En fonction des besoins spécifiques de chaque
alliance, elle apporte des outils de diagnostic, des manuels pour concevoir un projet de développement local ou des
campagnes de sensibilisation « Local first », une bibliothèque d'exemples et de modèles pouvant inspirer les
entrepreneurs. Autrement dit, elle fait bénéficier chaque alliance locale de l’effet réseau national. D’autre part, BALLE
capitalise les données chiffrées et qualitatives sur les modèles d’entreprise innovants qui rencontrent le succès, pour en
faciliter l’analyse et la réplication sur d’autres territoires.
Le mouvement BALLE a-t-il des attentes à l’égard des pouvoirs publics ?
Comme je le disais tout à l’heure, tout est fait aujourd’hui pour adapter le cadre réglementaire et fiscal aux intérêts des
grandes firmes. Ce qui a amené les membres de BALLE et nombre d’autres acteurs à comprendre que si « voter avec
son porte-monnaie » reste essentiel, cela ne suffira pas. Il va aussi falloir se donner les moyens de peser sur le politique,
afin que les régulations publiques deviennent plus favorables aux entreprises et économies locales comme aux citoyens.
On voit ainsi, depuis deux ans, le mouvement localiste converger dans cette direction. Des représentants de BALLE et
de mouvements proches ont été reçus à la Maison Blanche et interviennent auprès du Congrès. Certains leaders locaux
ou régionaux posent leur candidature aux élections afin de se faire les porte-parole d’une offre politique alternative. Peu
à peu, les idées localistes font leur chemin dans les médias et se voient adoptées par un nombre croissant de citoyens.
Ce mouvement, qui n’a pas fini de faire parler de lui, commence aussi à faire des émules dans d’autres pays.
1- Raphaël Souchier, Made in local. Emploi, croissance, durabilité : et si la solution était locale?, Eyrolles, 2013. www.madeinlocal.info
2- M. Gilens, Princeton University, B. I. Page, Northwestern University. Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and
Average Citizens, 9 avril 2014
3- T. Piketty, Le Capital au XXIe siècle, les livres du nouveau monde, Seuil, 2013
1
/
5
100%