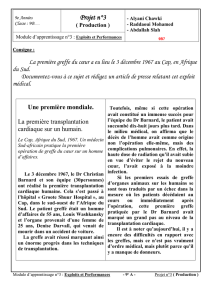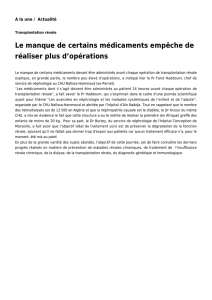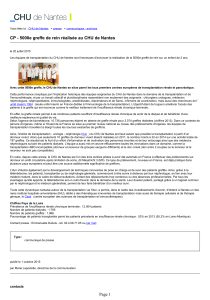Lire l'article complet

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XIII - n° 3 - juillet-août-septembre 2013
96
Dossier thématique
Le receveur vieillissant
Résumé
Summary
»
La prévalence de l’insuffisance rénale chronique du sujet âgé est
en augmentation régulière. Les seniors ont donc bénéficié d’un
accès facilité à la greffe ces dernières années. Cette population
est préférentiellement greffée avec des reins à critères élargis et
au travers de programme d’attribution de type old-for-old. De
plus, les patients âgés présentent des risques de morbidité et
de mortalité accrus après transplantation. Néanmoins, avec une
sélection rigoureuse des donneurs et des receveurs et l’utilisation
de protocoles immunosuppresseurs adaptés, la transplantation
rénale permet une meilleure survie des patients et une meilleure
qualité de vie que la dialyse et doit être recommandée.
Mots-clés : Transplantation rénale – Sujet âgé – Donneurs à critères
élargis.
The older end-stage renal disease population prevalence is
growing over time. The elderly have consequently benefited
from increased access to renal transplantation in recent years.
This population is more likely to receive a graft from expanded
criteria donors and through old for old allocation system.
Furthermore, elderly people are at greater risk of morbidity and
mortality after transplantation. However, with careful donor
and recipient selection, with adapted immunosuppressive
strategies, kidney transplantation improves patient survival
and quality of life compared with dialysis and should be
recommended.
Highlights: Kidney graft – Elderly patients – Expanded
criteria donors.
Résultats de la transplantation rénale
chez le sujet âgé
Outcomes of renal transplantation in elderly patients
Yannick Le Meur*
L
a définition du sujet âgé n’est pas universelle. Dans
la littérature concernant la greffe, on parle, dans
bon nombre d’articles, de “sujet âgé” dès 60 ans.
Une enquête réalisée en France en 2010 auprès des
médecins transplanteurs a montré qu'ils privilégiaient
plutôt l’âge de 65 ans. Les classifications de l’Agence de
la biomédecine (ABM) se réfèrent également au seuil de
65 ans. L’accès à la liste d’attente de greffe des patients
âgés s’est considérablement modifié au cours de ces
20 dernières années. La meilleure prise en charge des
facteurs de risque cardiovasculaire ainsi que les progrès
réalisés dans le domaine de la transplantation rénale
(chirurgie, immunosuppression, prophylaxie anti-infec-
tieuse, etc.) font que de plus en plus de sujets hémodia-
lysés âgés sont maintenant inscrits sur liste d’attente de
transplantation rénale.
Données démographiques
Vieillissement de la population générale
Au cours du siècle dernier, l’espérance de vie dans les pays
industrialisés a augmenté de 25 ans. En France, l’espérance
de vie est actuellement de 78,4 ans pour les hommes et de
84,8 ans pour les femmes (figure 1). Pour la première fois
en 2012, l’espérance de vie semble stagner, alors qu’elle
progressait régulièrement de 4 mois par an depuis 10 ans.
Cette augmentation de l’espérance de vie est essentielle-
ment due à l’accroissement de la durée de vie aux âges
élevés (alors que, auparavant, la diminution de la mortalité
infantile en était la principale cause). L’allongement de
l’espérance de vie associé à un indice de fécondité faible
est responsable d’un profond remaniement démogra-
phique, qui a pour conséquence le vieillissement de la
population. Actuellement, près de 18 % de la population
a plus de 65 ans, et le nombre de patients âgés de plus
de 75 ans est en augmentation constante.
Vieillissement de la population dialysée
En France, l’incidence de l’insuffisance rénale terminale
était en 2011 selon le registre du réseau épidémiologie
et information en néphrologie (Rein) de 149 par million
d’habitants (figure 2). Il semble que l’on assiste actuel-
lement à une stabilisation de cette incidence, qui aug-
mentait auparavant de 5 % par an. La prévalence est de
l’ordre de 1 091 par million d’habitants. L’insuffisance
rénale terminale (IRCT) est une pathologie du sujet âgé.
L’âge médian des patients en France à l’instauration du
traitement est de 70,4 ans. L’incidence est 30 fois plus
élevée chez les sujets de plus de 75 ans que chez ceux
de moins de 20 ans.
* Service de néphro-
logie, CHRU de la Cavale
Blanche, Brest.

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XIII - n° 3 - juillet-août-septembre 2013 97
Augmentation du nombre de sujets âgés
sur les listes d’attente
En 2012, en France, les patients de plus de 65 ans repré-
sentaient 12 % de l’ensemble des inscrits et plus de
15 % des greffes réalisées. Ces chiffres passent à près
de 30 % si l’on considère les plus de 60 ans et ils sont en
augmentation régulière. Sur les 10 dernières années,
nous avons multiplié par 3 le nombre de patients ins-
crits âgés de 60 à 69 ans et par plus de 10 celui des
plus de 70 ans. Dans le programme Eurotransplant,
on constate une augmentation identique sur la même
période : de 3,6 à plus de 20 % des patients sur liste de
plus de 65 ans (1).
Justification des programmes “old-to-old”
Le type de donneur influence considérablement les
résultats des greffes, et ce d’autant plus chez le receveur
âgé. La plupart des systèmes d’allocation à travers le
monde se fondent aujourd’hui sur l’adéquation entre
l’âge du donneur et celui du receveur. C’est en parti-
culier le cas dans le score français de l’ABM, renforcé
parfois régionalement dans les scores locaux. Ainsi, sur
une enquête menée en 2011, on estime que les rece-
veurs de plus de 60 ans ont reçu le rein d’un donneur
de plus de 60 ans dans 78 % des cas, et ceux de plus
de 70 ans, celui d’un donneur de plus de 70 ans dans
74 % des cas (figure 3, p. 98).
Plusieurs arguments plaident en faveur de l’attribution
aux receveurs âgés de greffons provenant également
de donneurs âgés.
Des raisons éthiques
À ce jour, en France, compte tenu de la modification de
la démographie des donneurs (diminution drastique des
accidents de la voie publique et diminution des AVC),
la catégorie la plus difficile à greffer est celle des sujets
jeunes. En cette période de pénurie d’organes, il n’est
pas acceptable d’attribuer des greffons de donneurs
jeunes à des receveurs âgés.
Des raisons d’efficience
Une étude portant sur 1 269 transplantés, s’intéressant à
la survie des greffons en fonction de l’âge des donneurs
et des receveurs, a montré que, à long terme, la survie
du greffon est nettement plus faible chez les receveurs
jeunes (< 55 ans) ayant reçu un rein de donneur âgé
(> 55 ans) que dans les autres cas de combinaisons
donneur-receveur (2). En revanche, les résultats pour
les receveurs âgés sont identiques quel que soit l’âge
du donneur. Ces résultats ont été confirmés dans le pro-
gramme Eurotransplant senior avec des donneurs et des
receveurs de plus de 65 ans (3). Des résultats identiques
Figure 1. Augmentation de l’espérance de vie en France
(INSEE, données de 2012).
1994 1998 2002 2006 2010
Années
72
74
76
78
84
82
80
86
Âge
Femmes
Hommes
Figure 2. Incidence et prévalence de l’insuffisance rénale terminale traitée par dialyse en 2011
par million d’habitants en France (données du Rapport Rein de 2011).
0-19 ans 20-44 ans 45-64 ans 65-74 ans 75-84 ans > 85 ans
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Prévalence standardisée (pmh)
Hommes
Femmes
4 307
4 235
2 122
832
212
11
1 436
1 996
1 218
510
140
5
0-19 ans 20-44 ans 45-64 ans 65-74 ans 75-84 ans > 85 ans
1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Incidence standardisée (pmh)
Hommes
Femmes
339
444
282
115
31
1 107
1 077
561
210
55
9
Résultats de la transplantation rénale chez le sujet âgé

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XIII - n° 3 - juillet-août-septembre 2013
98
Dossier thématique
Le receveur vieillissant
ont été retrouvés dans le cas de greffes concernant des
donneurs de plus de 70 ans et des receveurs de moins
de 60 ans, où le risque de décès et de perte de greffon
était nettement supérieur (4).
Des raisons d’économie
La cause la plus fréquente de perte de greffon chez
le sujet âgé est le décès du patient avec un greffon
fonctionnel (80 %), décès le plus souvent d’origine
cardiovasculaire (5). Le but, chez le sujet âgé, compte
tenu de l’espérance de vie plus courte, n’est donc pas
d’avoir des greffons ayant une survie de 20 ans mais
d’assurer le maintien d’une qualité de vie satisfaisante
pendant un temps limité.
Des raisons métaboliques
Les besoins métaboliques diminuant avec l’âge, la greffe
d’un rein âgé ayant une capacité fonctionnelle moindre
peut correspondre à un appariement physiologique
suffisant.
Des raisons d’urgence
Les sujets âgés sont plus sensibles au développement
des lésions dégénératives vasculaires qui s’accélèrent
après la mise en hémodialyse. La progression de ces
pathologies vasculaires aboutit en quelques mois à
contre-indiquer la greffe du fait d’une augmentation
considérable des risques anesthésiques et chirurgi-
caux. Ainsi, la transplantation chez le sujet âgé ne peut
se concevoir que dans un intervalle de temps limité
qui ne permet pas d’attendre un éventuel donneur
optimal.
Accès à la liste d’attente et à la transplantation
De façon générale, l’accès à la greffe des patients en
liste d’attente semble peu influencé par l’âge du rece-
veur. Ainsi, aux États-Unis, en 2011, le pourcentage
de patients transplantés était identique quelle que
soit la tranche d’âge du receveur : 18-34 ans, 35-49 ans,
50-64 ans ou plus de 65 ans (données SRTR [scientific
registry of transplant recipients] 2011). En France, en
2011, les chiffres sont similaires, avec un taux de 30 à
35 % à 1 an et de 65 à 75 % à 3 ans, quelles que soient
les catégories d’âge chez l’adulte [Rapport Rein 2011]. À
noter que la durée d’attente est également identique.
Par contre, l’accès à la liste d’attente est plus probléma-
tique : seulement 3,4 % des plus de 60 ans sont inscrits
pour une greffe préemptive, contre 11,2 % des moins de
60 ans ; 1 an après le début de la dialyse, 18 % des plus
de 60 ans sont inscrits, contre 43 % des moins de 60 ans.
Cela est dû à de plus nombreuses contre-indications
médicales, mais pas seulement, comme l’attestent les
importantes variations régionales de l’accès à la liste
d’attente pour les patients âgés (Rapport Rein 2011). Au
total, seuls 16,4 % des patients de plus de 60 ans com-
mençant l’hémodialyse seront greffés dans les 3 ans,
contre 42 % des moins de 60 ans (Rapport Rein 2011).
Résultats de la transplantation
chezlesujet âgé
L’analyse des résultats de la greffe chez les sujets âgés est
compliquée : par essence, cette catégorie de receveurs a
un plus grand risque de décès, plus de facteurs de risque
cardiovasculaire, un plus grand risque infectieux. De plus,
les receveurs âgés reçoivent des reins à critères élargis (en
particulier les plus âgés), des reins souvent moins bien
appariés et, paradoxalement, les reins dont l’ischémie
froide est la plus longue (4). Le groupe contrôle le plus per-
tinent est donc une population hémodialysée cumulant
les mêmes facteurs de risque et inscrite sur liste d’attente.
Survie des patients et des greffons
Les résultats publiés dans la littérature sont assez
concordants et montrent que la survie est moins
bonne dans les tranches d'âges supérieures, ce qui
est logique, mais que la survie du greffon censurée
pour le décès est identique. Mis en évidence dans les
données du registre américain (6), ce phénomène a
été parfaitement confirmé dans des cohortes euro-
péennes assez récentes : écossaise (7), norvégienne (8)
et autrichienne (9). Dans le rapport de 2012 de l’ABM,
l’étude des courbes de survie retrouve une différence
de 7,4 % à 5 ans et de 9,1 % à 10 ans entre sujets jeunes
et sujets de plus de 60 ans. Cette différence disparaît
Figure 3. Adéquation à l’âge : données de l’ABM de 2010, résultats toutes transplantations
confondues incluant les priorités nationales.
00 10 20 30 40 50 60 8070 90
Âge donneur
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Âge receveur
2003
2006
2009
+
×
o

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XIII - n° 3 - juillet-août-septembre 2013 99
après censure des décès avec un greffon fonctionnel.
En définitive, les insuffisants rénaux chroniques âgés
cumulent des facteurs de risque et des antécédents,
en particulier cardiovasculaires, ce qui explique que,
après 60 ans, le décès du patient (qui est majoritai-
rement de cause cardiovasculaire) soit la première
cause de perte du greffon. Il a été bien montré que
les comorbidités mises en évidence au moment du
bilan prégreffe (diabète, maladies coronaires, artérite,
AVC, bronchopathies chroniques, cancers) augmen-
taient la mortalité précoce (moins de 90 jours) et plus
tardive (12 mois), quel que soit l’âge du patient, mais
que l’âge était un facteur supplémentaire multipliant
encore par 2 le risque de mortalité à 1 an chez les
patients de plus de 60 ans (10). Ainsi, toute la difficulté
consiste à apprécier, chez un patient âgé en insuffi-
sance rénale terminale, les risques de mortalité lors de
la première année après la greffe. Ces décès sont liés
à 3 causes principales : les maladies cardiovasculaires,
les infections et les cancers. La connaissance de ces
causes a permis d’identifier plusieurs facteurs de risque
spécifiques de décès précoce (6) et donc d’améliorer
la sélection des receveurs. On estime que le risque de
décès précoce après transplantation chez le receveur de
plus de 60 ans est multiplié par 5 en cas d’antécédent
de cancer solide, par 2,9 en cas d’atteinte vasculaire
périphérique et par 7,9 chez le fumeur (6). Une étude
canadienne retrouvait, en 2005, l’obésité (RR = 1,34), le
temps passé en dialyse (RR = 1,1) et, surtout, le tabac
(RR = 2,09) comme facteurs de risque indépendants
de mortalité chez le receveur de plus de 60 ans (11).
Transplantation versus hémodialyse
Plusieurs études ont comparé la survie des patients de
plus de 60 ans en hémodialyse et après transplanta-
tion rénale. La plus importante est celle de R.A. Wolfe
et al. (12), qui portait sur une population de plus de
79 000 patients inscrits sur liste d’attente de transplan-
tation et dont 1/3 avaient été transplantés et 2/3 étaient
encore en hémodialyse. Cette étude a montré que,
quelle que soit la catégorie d’âge étudiée, la trans-
plantation rénale améliore de manière significative
la survie des patients. Dans la sous-population des
patients ayant entre 60 et 74 ans, le gain de vie estimé
après une transplantation rénale était de 4 ans, avec
une espérance de vie qui passait de 6 ans en hémo-
dialyse à 10 ans après la transplantation. Les résultats
de cette étude peuvent être critiqués en raison de la
mortalité importante des patients hémodialysés aux
États-Unis par rapport à celle constatée en Europe.
Cependant, une étude écossaise réalisée sur le même
mode retrouve des résultats similaires, avec une espé-
rance de vie doublée chez les receveurs de plus de
65 ans (7). En France, une étude menée en Lorraine
confirme également l’avantage de la transplantation
chez les patients de plus de 60 ans, et cela après ajuste-
ment pour les comorbidités, l’IMC et le taux d’albumine
sérique (13). Dans une analyse plus récente du SRTR
portant sur des patients âgés de plus de 70 ans, on
constate un net avantage de la transplantation sur la
dialyse : moins de 41 % de risque de décès par rapport à
une population en liste d’attente non transplantée (14).
Il faut noter que les patients transplantés sont exposés
à un surrisque de mortalité initial, et ce n’est que plus
de 1 an après une greffe fonctionnelle que le bénéfice
en termes de survie apparaît. La même amélioration de
survie de 40 % était également notée dans l’expérience
norvégienne (8).
Résultats en fonction du type de donneur
Les résultats globaux de la transplantation rénale du
sujet âgé doivent être interprétés en fonction du type
de donneur. Si la majorité des greffes se font avec des
greffons issus de donneurs âgés répondant pour la
plupart aux critères élargis, certains receveurs bénéfi-
cient de greffons issus de donneurs standard et, parfois,
de donneurs vivants.
Type des donneurs
(standard, critères élargis, vivants)
Les données de l’ABM ont été publiées en 2007 (15).
Dans cette étude comprenant 2 498 patients de plus
de 60 ans inscrits en liste d’attente entre 1996 et 2004,
65 % ont été greffés. Quatre facteurs liés au donneur
et influençant négativement le devenir de la greffe
ont été mis en évidence (permettant de définir un
donneur à critères élargis quand l’un des 4 facteurs
était présent) : âge du donneur supérieur à 60 ans,
antécédent d’hypertension, diabète et décès de cause
cardiovasculaire. L’information principale est que la
survie des patients était moins bonne avec les gref-
fons à critères élargis qu’avec les greffons de donneurs
standard mais restait supérieure à celle des patients
inscrits sur liste mais non greffés. Dans les données du
SRTR de 2005, les patients âgés de plus de 60 ans ayant
reçu un greffon à critères élargis ont une surmortalité
de 28 % par rapport à ceux ayant reçu un greffon de
donneur standard (16). Le recours au donneur vivant
et, en particulier, aux donneurs vivants âgés est une
solution intéressante. Les données du registre amé-
ricain montrent que la survie du greffon est similaire
en cas de donneur décédé de moins de 55 ans et en
cas de donneur vivant de moins de 65 ans (17), et ce
quel que soit l’âge du receveur.
Résultats de la transplantation rénale chez le sujet âgé

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XIII - n° 3 - juillet-août-septembre 2013
100
Dossier thématique
Le receveur vieillissant
Dans un article plus récent reprenant les données de
l’USRDS (United States Renal Data System) sur plus de
25 000 patients, les auteurs confirment que, quel que soit
le type de donneur, la survie des patients à moyen terme
est meilleure en transplantation que chez ceux restés
en liste d’attente. Par contre, à risque cardiovasculaire
identique, lorsque le donneur est décédé (donneurs
standard et à critères élargis), le risque de mortalité
péri-opératoire et lors de la première année suivant la
greffe est plus élevé que lorsque le donneur est vivant et
que pour les patients restés en liste d’attente (18). Plus le
receveur cumule des facteurs de risque cardiovasculaire,
plus le délai après la greffe pour obtenir un bénéfice
en termes de suivie est long. Pour les patients les plus
à risque sur le plan cardiovasculaire, la survie devient
supérieure dans le groupe transplanté après 4 mois
pour un donneur vivant, 1 an pour un donneur à critères
standard et 18 mois pour un donneur à critères élargis.
Il est en revanche bien établi que plus le greffon est
âgé, plus les risques de décès, de perte de greffon ou
de mauvaise fonction rénale sont importants. C’est ce
qu’ont montré les études américaines comparant les
donneurs à critères élargis de plus de 70 ans à ceux âgés
de 50 à 69 ans (4). Un effort particulier doit être fait dans
ces combinaisons “old-to-old” pour réduire autant que
possible le temps d’ischémie froide, comme l’a montré
avec succès l’expérience d’Eurotransplant (3). Il faut noter
que, avec l’avènement et la généralisation de l’utilisation
des machines à perfusion pour ces greffons de qualité
limite, les résultats vont immanquablement s’améliorer.
Bigreffe
Une autre possibilité est représentée par la bigreffe.
La masse néphronique des reins âgés est réduite, à
cause du vieillissement physiologique (diminution de
50 % de la filtration glomérulaire à la fin de la sixième
décade) [19] et des différents antécédents des patients.
Afin d’assurer la greffe d’une masse néphronique suf-
fisante et d’utiliser des reins qui n’auraient pas été
sélectionnés par ailleurs, certaines équipes réalisent
la transplantation chez le même receveur des 2 reins
d’un même donneur. Les greffons sont implantés
soit au niveau de 2 sites opératoires distincts (fosses
iliaques droite et gauche), soit sur des axes vasculaires
homolatéraux, en bloc. Les résultats de ce type de trans-
plantation sont encourageants. Ainsi, A. Andres et al.
rapportent une survie actuarielle des greffons à 1 an
de 95 % (20), et K.H. Dietl et al. rapportent une survie
actuarielle des greffons de 92 % à 2 ans avec une créa-
tinine moyenne de 1,9 ± 0,6 mg/dl (21). À plus long
terme, ces bons résultats se confirment avec une survie
des greffons à 5 ans de 69 % dans le groupe bigreffe
avec donneur de plus de 50 ans contre 61 % dans un
groupe témoin ayant reçu un greffon de donneur âgé
de 35 à 49 ans (22). Un programme bigreffe a débuté
en France sous le nom de BIGRE en 2002. La sélection
des greffons repose sur un âge du donneur supérieur à
65 ans, l’existence de facteurs de risque cardiovasculaire
(hypertension artérielle, diabète ou décès par AVC),
une clairance de la créatinine du donneur comprise
entre 30 et 60 ml/ mn et, dans tous les cas, une ischémie
froide inférieure à 24 heures. Ce protocole est réservé
aux receveurs de plus de 65 ans. Les résultats de l’ex-
périence de l’équipe de Necker montrent une survie
des patients de 88 % à 3 ans et une survie du greffon
de 88 %, résultats comparables à ceux de patients de
même âge (> de 65 ans) et ayant reçu un seul greffon
à critères étendus (23).
Sélection des donneurs
Afin de sélectionner au mieux les greffons considérés
comme “marginaux” et d’éliminer certains greffons à
risque d’échec trop élevé, 2 approches, qui peuvent
être complémentaires, ont été proposées. La pre-
mière repose sur l’analyse de facteurs cliniques par
l'établissement d’un score chez le donneur. Ce score
prend en compte : l’âge du donneur (0-25 points) et
les antécédents d’HTA (0-4 points), la clairance de la
créatinine (0-4 points), la cause de la mort (0-3 points)
et les incompatibilités HLA (0-3 points). Un score supé-
rieur à 20 indique un greffon à risque de mauvais résul-
tats (24). La fonction rénale du donneur au moment
du prélèvement semble être l’élément prépondérant.
Une clairance calculée de la créatinine supérieure à
60 ml/mn est le seuil généralement fixé (25), c’est
celui qui sert de référence à l’ABM en France. D’autres
équipes ont réalisé des biopsies avant la transplanta-
tion afin d’avoir une évaluation histologique des gref-
fons potentiels. Les résultats de ces études sont assez
discordants. Pour certaines, le degré de fibrose inters-
titielle est l’élément le plus important pour accepter
ou rejeter un greffon (26), tandis que, pour d’autres, un
pourcentage de glomérulosclérose supérieur à 20 %
est le facteur limitant (27, 28). L’équipe de G. Remuzzi a
utilisé avec succès un score histologique associant glo-
mérulosclérose, fibrose interstitielle, atrophie tubulaire
et lésion vasculaire (29). Enfin, d’autres équipes n’ont
pas retrouvé de corrélation entre les données de la
biopsie de déclampage et l’évolution clinique (30, 31).
L’avantage principal de ce type de biopsies est d’avoir
une référence histologique utile pour juger de l’évo-
lution ultérieure de la transplantation.
La sélection des greffons dans les programmes de
bigreffe est un enjeu majeur : faut il greffer 1 ou 2 reins,
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%