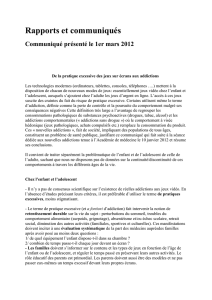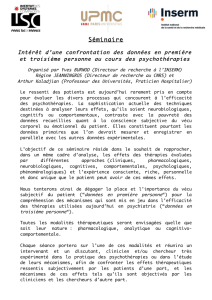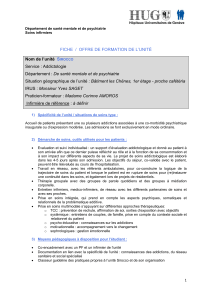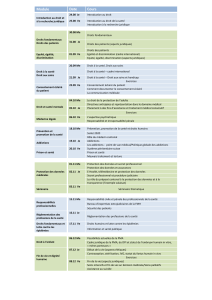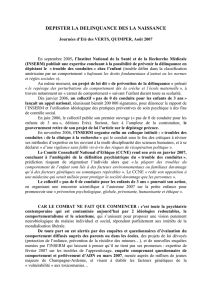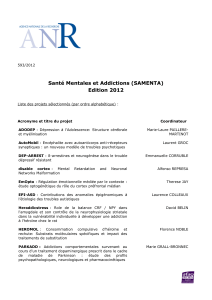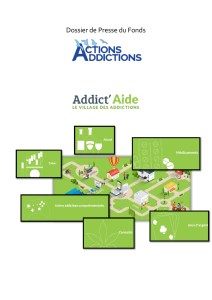FOUSFUJFO Pour une approche scientifique du subjectif Au premier étage de

Le Courrier des addictions (9) – n° 4 – octobre-novembre-décembre 2007 112
F
O
U
S
F
U
J
F
O
Pour une approche scientifique
du subjectif
Un entretien avec Bruno Falissard*
Propos recueillis par Didier Touzeau et Patricia de Postis
Cafet’ de Rob-Deb, avec gobelet de carton et part de piz-
za improbable : Bruno Falissard, un interne de chez... ?
Pas du tout ! Il est le patron d’une grosse unité Inserm, la
U-669 “Santé mentale de l’adolescent”, qui compte 84
personnes travaillant en dix équipes. Il est aussi praticien
hospitalier, professeur de biostatistique, ancien chef de
clinique en pédopsychiatrie… Il a, dans son CV, 41 ans
(qui en font dix de moins), une femme, Magali, trois en-
fants de 9 à 15 ans, et quelques hobbies sympathiques :
le piano, l’escrime, le marathon, les jeux de rôle et… le
vin (il est bordelais de naissance !). Il arbore sans ostenta-
tion une allure de moine-soldat de la recherche (en biosta-
tistique), un sourire modeste d’ascète des mathématiques
qui collectionne les parchemins de haute volée (polytech-
nique, DES de psychiatrie, docteur en statistiques et santé
de l’université Paris-XI…) ! Il mène de front plusieurs acti-
vités. Hospitalières, d’abord. En bref : une consultation
à Robert-Debré dans le service du Pr Mouren-Siméoni,
dont il a été le chef de clinique assistant, la création et
responsabilité du département de santé publique de l’hô-
pital Paul-Brousse. Les activités d’enseignement, ensuite
: il est PU-PH en biostatistique à la faculté de médecine
de Paris-Sud, hôpital Paul-Brousse et assure plus de 250
heures d’enseignement par an. Les activités d’expertise
et de coordination, évidemment : au sein de l’Inserm, la
Haute Autorité de Santé, l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, l’Association française
des myopathes… Celles de recherche, bien sûr : Il a mis
au point un logiciel (le package “psy” du logiciel R, mais
ne me demandez pas de quoi il retourne !), a commis 90
publications au bas mot, beaucoup d’articles de statisti-
ques et une quantité d’articles référencés dans Medline,
deux ouvrages chez Masson (Comprendre et utiliser les
statistiques dans les sciences de la vie (2005) et Mesurer
la subjectivité en santé : perspective méthodologique et
statistique (2001). Le cœur de sa préoccupation.
Au premier étage de
la Maison de Solenn
Le Courrier des addictions :
Quand, comment et sur quels
objectifs s’est constituée l’Uni-
té Inserm que vous dirigez ?
Bruno Falissard : Comme
vous le savez, en 1989 Madame
Bernadette Chirac a créé une
Fondation assistance publique-
hôpitaux de Paris avec pour
mission l’amélioration de la
qualité de vie des enfants, des
adolescents et des personnes
âgées hospitalisés. Depuis, cha-
que année, la Fondation organi-
se deux campagnes nationales
de collecte de fonds : l’une en
faveur des enfants hospitalisés
(les fameuses “Pièces jaunes”)
et l’autre au profit des person-
nes âgées hospitalisées.
La Fondation AP-HP a souhaité
mettre en chantier, avec l’ar-
gent des Pièces jaunes et de ses
partenaires (*), une structure
de prise en charge spécifique
des adolescents, qui ne sont
plus tout à fait des enfants mais
pas encore des adultes. Or, en
France, et a fortiori en région
parisienne, il n’existe que très
peu de services et de compé-
tences en matière de “santé de
l’adolescent”, que ce soit sur
le plan de la recherche ou sur
celui des soins. Ce fut le projet,
puis l’ouverture le 6 décembre
2004, dans le cadre de l’hôpital
Cochin, de la Maison des ado-
lescents ou Maison de Solenn.
L’originalité de cette structure
pluridisciplinaire est de re-
grouper, sur 8 000 m2, un lieu
d’accueil, d’information et de
prévention, de prise en charge
médicale et de suivi, d’ensei-
gnement et de recherche sur
les pathologies rencontrées à
l’adolescence, de 12 à 19 ans.
Le tout dans un cadre soigné,
accueillant (le 3e étage est celui
des différents “soins culturels”
et du restaurant et le dernier,
aménagé en terrasse, est occu-
pé par un jardin…). Ils trouvent
donc, dans un même lieu, une
aide médicale, psychologique,
juridique, et aussi des salles de
classe et des activités culturel-
les. Dix “studios médicalisés”
sont consacrés aux maladies
chroniques ou aux accidents
à répétition. Dix autres seront
tournés vers les problèmes psy-
chologiques, de la dépression
aux phobies. D’autres lieux se-
ront communs : médiathèque,
cuisines, ateliers artistiques
thérapeutiques...
En ce qui concerne plus parti-
culièrement mon domaine, ce-
lui de la recherche, c’est avec le
Pr Claude Griscelli, l’ancien
directeur de l’Inserm, que la
Fondation AP-HP a décidé de
créer une unité de recherche dé-
diée à la santé mentale des en-
fants et des adolescents, l’unité
669. Elle est la seule en France
qui traite tous les problèmes de
psychiatrie de cette population
(voir encadré). Notre unité
de recherche, qui compte dix
équipes, est située au 1er étage
qu’elle partage avec les bureaux
des médecins (*).
La subjectivité,
comme objet
Le Courrier des addictions :
Pourquoi le recours aux me-
sures de qualité de vie des
patients a-t-il été aussi tardif
en France ?
B. F. : La préoccupation de la
qualité de vie des patients et de
son évaluation n’a guère plus
tardé à apparaître en France
que dans les autres pays déve-
loppés. Avant Guerre, c’était
la communauté, (la famille, le
médecin…) qui gérait le ma-
lade, ses symptômes, sa conva-
lescence, sa “guérison”, pour
le rendre “opérationnel” et
conforme à ce qu’elle attend de
tous les individus (ne pas être
dangereux pour autrui, ne pas
transmettre une maladie conta-
gieuse, se comporter “norma-
lement”, etc.). Il était “agi” et
non “acteur”. Puis, progressi-
vement, vers la deuxième moitié
* Pédopsychiatre, professeur de santé publique, directeur de l’unité de recherche
Inserm U669, PSIGIAM, “Troubles du comportement alimentaire de l’adolescent”,
Maison de Solenn, hôpital Cochin, 97, bd de Port-Royal, 75679 Paris Cedex 14.

Le Courrier des addictions (9) – n° 4 – octobre-novembre-décembre 2007
113
F
O
U
S
F
U
J
F
O
du XXe siècle, et, en particulier
après les années 1968-1970, le
sujet, donc le patient, s’est en
quelque sorte émancipé. Il s’est
mis à exprimer ses désirs, ses at-
tentes, son ressenti… et les mé-
decins ont mesuré à quel point
sa participation était essentielle
pour une meilleure efficacité des
traitements. D’“observant”, il
est devenu plus ou moins “com-
pliant”, une “vertu” d’autant
plus cardinale que les patho-
logies chroniques ont pris de
plus en plus de place dans le
champ de la clinique. Or, pour
tenir “sur la longueur”, un
traitement, du diabète, de l’hy-
pertension, d’une addiction, re-
quiert la mise en commun des
efforts de l’entourage familial
et social, des professionnels de
santé, et au premier rang, bien
sûr, du patient lui-même. Aussi,
pour évaluer l’efficacité les trai-
tements, même s’il est toujours
aussi pertinent de mesurer gly-
cémie, tension artérielle, cho-
lestérolémie et autres constantes
physiologiques et biologiques,
et si le souci de rendre confor-
mes les individus plus ou moins
“hors normes”, est loin de ne
plus avoir cours, on sait qu’il
faut aussi évaluer ce qui comp-
te pour le patient lui-même. Et
quel est le bénéfice qu’escomp-
te de ces traitements de sevrage
ou de substitution, ce patient al-
coolodépendant, tabagique ou
héroïnomane… Plus de liber-
té ? La guérison de ses symptô-
mes digestifs, respiratoires, de
son mal-être psychique ? Une
meilleure insertion sociale, le
règlement de ses problèmes
judiciaires, la possibilité de sui-
vre une formation, d’avoir une
vie de couple, des enfants… ?
Si les traitements sont au sens
propre “insupportables” pour
les patients, comme on a pu le
voir au décours de chimiothéra-
pies diverses, anticancéreuses,
anti-VIH ou contre l’hépatite
C par exemple, il ne faut pas
en attendre des résultats opti-
maux.
Ainsi, les mesures de qualité
de vie ont envahi progressive-
ment le monde de la recherche
clinique et en particulier celui
des essais thérapeutiques. Pas
seulement pour mesurer l’ef-
ficience des médicaments ou
modalités de prise en charge
mis à disposition d’une patho-
logie donnée, mais aussi pour
établir des profils de patients,
avec leurs besoins, leurs diffi-
cultés… Désormais, la méde-
cine s’adresse tant au sujet vi-
vant, dont le corps est malade,
qu’au sujet pensant, souffrant,
douloureux, anxieux, triste…
Et pour répondre à cette dua-
lité, il a fallu mettre au point
de nouveaux types de mesure :
par exemple, auto-évaluation
du niveau de douleurs ressen-
tie, évaluation de la qualité de
vie, échelles de dépression,
d’anxiété… Le critère de la
sexualité (atteinte de la libido,
impuissance, frigidité...) est
désormais plus souvent pris en
compte dans l’évaluation des
traitements de nombreuses pa-
thologies, dont ceux des addic-
tions naturellement.
Innover pour donner
vraiment la parole
aux patients
Le Courrier des addictions :
Que signifie l’auto-évaluation
de la qualité de vie en psy-
chiatrie ?
B. F. : Le concept très améri-
cain de Patients Reported Out-
comes (PRO), qui s’appuie sur
l’autoquestionnaire (c’est le
patient qui dit comment il va,
comment il se sent), ne peut pas
s’appliquer tel en psychiatrie. Il
est évident qu’un mélancolique
et délirant, par exemple, aura
bien du mal à se représenter et
à rapporter, “avec justesse”, la
qualité de ses émotions. Cer-
tains patients schizophrènes, en
particulier ceux qui souffrent
des symptômes les plus péjora-
tifs, vont précisément être ceux
qui ne seront pas à même de
capter l’attention du médecin
sur des problèmes essentiels
qui les concernent. Ce “biais”
est constitutif de leur patholo-
gie. Il faut donc utiliser une autre
façon d’approcher ces patients.
On peut la construire à partir de
l’observation faite par un tiers
(hétéro-évaluation), médecin
ou psychologue, dans un cadre
calme, sécurisant, de confiance
réciproque, en un mot empa-
thique. Exemple : avec Na-
dine Bazin et Marie-Christine
Hardy-Bayle, du centre hospi-
talier de Versailles, nous avons
construit une sorte d’échelle de
qualité de vie pour des patients
schizophrènes, établie selon une
méthode, éminemment subjec-
tive, mais originale, et qui nous
a donné des résultats… surpre-
nants : “Outcome revealed by
preference in schizophrenia”
(OPS) (**). Dans un premier
temps, Marie-Christine a rédigé
une quinzaine de fiches, com-
portant environ 200 mots cha-
cune, sur la vie au jour le jour
de quinze patients (12 hommes
et 3 femmes, de 22 à 53 ans).
Puis, on a fait classer ces sor-
tes de “tranches de vie”, ou
“vignettes”, par ordre de préfé-
rence, d’une part par dix autres
patients schizophrènes, d’autre
part par un groupe de douze
personnes proches d’eux. On
L’unité-669 : les conduites de destruction
et l’évaluation des traitements en psychiatrie
www.idf.inserm.fr/site/u669/
Dirigée par Bruno Falissard, l’unité Inserm U-669 comprend 84
membres répartis en dix équipes qui s’intéressent aux problè-
mes de santé mentale dans une perspective de santé publique.
Elle aborde deux grandes thématiques :
Les conduites de destruction de l’adolescent et du jeune
adulte. Destruction de soi (tentatives de suicide, toxicomanie,
troubles des conduites alimentaires) ou d’autrui (troubles des
conduites, personnalité antisociale, troubles limites de la per-
sonnalité)
L’évaluation des thérapeutiques en psychiatrie (traitements
psychotropes, psychothérapies, prises en charge globales, ré-
seaux de soins dans le domaine de la santé mentale).
Elles sont “travaillées” selon dix axes de recherche :
A Épidémiologie générale de la santé mentale et de l’adolescent
(Marie Choquet).
A Évaluation pharmacologique et épidémiologique du médica-
ment (Emmanuelle Corruble).
A Épidémiologique psychiatrique de l’adulte (Isabelle Gasquet).
A Neuro-développement et troubles des apprentissages (Lau-
rence Vaivre-Douret).
A Méthodologie de recherche en psychiatrie (Bruno Falissard).
A Méthodes qualitatives (Catherine Jousselme, Anne Révah-
Lévy).
A Recherche clinique et épidémiologique des troubles des com-
portements alimentaires (Nathalie Godart)
A Études longitudinales et interventionnelles, troubles des
conduites et des comportements alimentaires en relation avec
l’attachement (Sylvana Côté).
A Trouble de la personnalité borderline (Maurice Corcos).
A Recherches cliniques et épidémiologiques dans les troubles
addictifs (Michel Reynaud).
L’unité est officiellement associée au Groupe de recherche sur
l’inadaptation psychosociale chez l’enfant (GRIP) de Montréal,
dirigé par le Pr Richard Tremblay.

Le Courrier des addictions (9) – n° 4 – octobre-novembre-décembre 2007 114
F
O
U
S
F
U
J
F
O
en a tiré six “situations de vie”
types qu’on a présentées alors à
229 patients schizophrènes, en
leur demandant celle qui avait
leur préférence, qu’ils jugeaient
meilleures que la leur. Deux de
ces vignettes décrivaient des
situations radicalement oppo-
sées : l’une correspondait à une
vie chaotique d’artiste de rue,
en rupture de ban et de traite-
ment, l’autre à l’enfermement
et isolement dans une commu-
nauté religieuse. Nous nous
attendions à ce que les patients
préfèrent la forme de liberté dé-
crite par la première vignette. Il
n’en n’a rien été : ils préféraient
la seconde ! Cela nous interroge
beaucoup sur l’état de nos pa-
tients. Ce type d’étalonnage de
la qualité de vie, très innovant,
a certainement ses limites. En
donnant vraiment les moyens
aux patients de s’exprimer se-
lon leurs possibilités, il a le mé-
rite de servir de poil à gratter,
de secouer le cocotier des certi-
tudes des psychiatres.
Le Courrier des addictions :
Quelle est la valeur scientifi-
que de ces mesures de qualité
de vie ?
B. F. : Nombreux sont, en effet,
ceux qui s’interrogent sur la
légitimité de ce type d’évalua-
tion : il s’agit, en effet, de me-
sures exclusivement subjectives
et non objectives comme on en
a l’habitude. Dès lors se pose
bien la question d’envisager de
réaliser un travail scientifique
portant sur l’évaluation de tel-
les caractéristiques. Par exem-
ple, le sous-score de dépression
(PRO) qui est, semble-t-il, une
constante de toutes les échelles
de qualité de vie, de l’évalua-
tion de la souffrance psychique.
Certaines personnes, atteintes
de maladies très sévères, vont
“en rabattre” d’elles-mêmes
sur leurs revendications “de
bien-être”, et, s’ajustant à leur
état, répondront à des questions
concernant un état de dépression
possible : “ça va !”. Et ils ob-
tiendront un score de qualité de
vie “meilleur”, alors qu’en fait,
selon des critères plus généraux
pour ne pas dire objectifs, “ça
ne va pas !”. D’où l’intérêt de
recouper “les ressentis” décla-
ratifs, pour approcher de façon
plus précise la qualité de vie
réelle des patients, comme nous
l’avons fait avec l’OPS pour
les patients schizophrènes. Le
PRO, souvent, ne suffit pas !
La recherche en psychiatrie
a été trop longtemps victime
d’une OPA de la neurobiolo-
gie qui fait du neurone et des
neuromédiateurs son paradig-
me. Au point, qu’aujourd’hui,
le champ épistémologique de
la santé mentale est la biologie,
avec l’obligation, pour le cher-
cheur qui s’y intéresse, de prou-
ver en permanence son objecti-
vité : tout ce qui est objectivable
par imagerie médicale, dans un
tube à essai est scientifique. Tout
ce qui est proche de la vie du pa-
tient, appartient à la trivialité que
l’on écarte de la main. Au nom de
quoi ? Au nom de qui ? Les gens
ne sont pas que des neurones !
Personnellement, je milite pour
que l’on fasse “de la science”
aussi avec le subjectif. Si nous ne
le faisons pas, ce sont des “gou-
rous” qui le feront !
La vie ne se résume pas
au cortex préfrontal !
Le Courrier des addictions :
Comment intégrer la notion
de qualité de vie en ce qui
concerne le problème plus
spécifique des addictions?
B. F. : Justement, pour des pa-
tients “addicts”, la vraie ques-
tion de la privation de liberté
n’est pas un problème de neuros-
ciences mais une question philo-
sophique. Le cortex préfrontal ne
résume pas toute leur vie ! Il faut
éminemment en tenir compte.
Pour ces patients, précisément,
nos traitements ne constituent
pas a priori une amélioration
de leur qualité de vie mais, sou-
vent, une forme de dégradation,
alors que c’est l’inverse pour
leur entourage, leur famille.
Ils ont tendance à choisir la sé-
dation de leur mal-être, ou de
maximaliser leur bien-être, dans
l’instant, avec le ou les produits
dont ils sont dépendants, al-
cool ou drogues, et dont on les
prive. Ils ont beaucoup de mal
à se projeter dans l’avenir. Il
nous faudra tenir compte éga-
lement de la modification de
conscience induite par les pro-
duits eux-mêmes. Les mesures
de qualité de vie ne mesure-
ront pas tout à fait les mêmes
choses chez eux que chez les
patients “classiques” de psy-
chiatrie. Mais, comme dans le
cas des patients psychiatriques,
schizophrènes, en particulier,
il n’est pas sûr que l’approche
empirique déclarative classique
soit “valide” pour faire ce genre
de mesure. Pour finir, il est très
difficile d’envisager des études
de suivi à long terme avec des
toxicomanes (un certain nombre
sont SDF, ont des personnalités
borderline, disparaissent dans
la nature…). On les limite donc
dans le temps, à six mois-un an,
ce qui en restreint sérieusement
l’intérêt! On ne mesure pas, en
effet, les mêmes choses à 5 mois
qu’à 5 ans ! Ou alors, on “se ra-
bat” sur des études de cohortes,
par définition plus faciles à me-
ner que des essais randomisés,
surtout lorsque les populations
étudiées sont coincées en insti-
tution.
Le Courrier des addictions :
Comme celles que vous avez
étudiées en 2003 et 2004
dans 23 établissements péni-
tentiaires français ? (***)
B. F. : Oui, pour la première
fois, en France, nous avons
mené une étude épidémiologi-
que transversale de grande am-
pleur auprès de 800 hommes
incarcérés, tirés au sort dans
23 établissements pénitentiai-
res français (maisons centrales,
maisons d’arrêt, centres de dé-
tention), 100 hommes dans un
établissement de Martinique
et 100 femmes dans deux éta-
blissements. La technique de
repérage diagnostique, très ori-
ginale, a combiné les avantages
d’une évaluation standardisée
et celle d’une évaluation cli-
nique. En effet, chaque détenu
était interrogé en même temps,
pendant au moins deux heures,
par un binôme de deux clini-
ciens (un psychiatre, le plus
souvent “senior”, et un psy-
chologue clinicien). Dans un
premier temps, le psychologue
conduisait un entretien structu-
ré conformément aux directives
du MINI (Mini International
Neuropsychiatric Interview).
Le psychiatre poursuivait par un
entretien libre avec la personne
de 20 minutes environ. Résul-
tats : selon le consensus des bi-
nômes d’enquêteurs, 36 % des
détenus présentaient au moins
un trouble psychiatrique, et la
grande majorité en cumulait
plusieurs (troubles anxieux ou
thymiques associés à la dépen-
dance aux substances illicites
ou à l’alcool, notamment). Et,
à chaque fois, la discussion des
deux praticiens confortait, voi-
re majorait notablement le dia-
gnostic : 6,2 % ont diagnosti-
qué, de façon consensuelle, une
schizophrénie, 24 % un trouble
dépressif majeur, 17,7 %, une
anxiété généralisée et 14,6 %
une toxicomanie.
Parmi le sous-groupe des 300
détenus incarcérés, pour la
première fois, depuis moins de
6 mois, 18 % présentaient une
dépendance aux substances illi-
cites et 16 % à l’alcool.
Les enquêteurs ont considéré
que 35 % des détenus qu’ils
avaient interrogés étaient “ma-
nifestement”, “gravement” ou
“parmi les patients les plus”
malades. D’où, au final, un pa-
tient sur cinq (soit 22 %) ont été
signalés à l’équipe soignante de
l’établissement pénitentiaire,
avec son accord (sauf cas consi-
déré comme d’urgence).
Ces prévalences sont globale-
ment plus élevées que celles
des données internationales.

Le Courrier des addictions (9) – n° 4 – octobre-novembre-décembre 2007
115
F
O
U
S
F
U
J
F
O
Pourquoi ? Peut-être est-ce du
à la spécificité des prisons fran-
çaises, sûrement aussi à la mé-
thode d’évaluation utilisée. Or,
nous savons bien à quel point le
stress lié à la privation de liberté
et le caractère déréalisant de la
vie en milieu carcéral (privation
de liberté, de sexualité, d’envi-
ronnement familial…), élément
central de tout trouble psycho-
tique, oblige à “éclater” le
cadre nosographique habituel.
Ainsi, les “types de psychose
non précisée” font référence,
le plus souvent, à des modali-
tés de fonctionnement mental
“d’allure” psychotique, mais
pas nécessairement à un trouble
mental cliniquement avéré.
En résumé, il n’est donc pas ques-
tion de plaider pour une approche
scientifique du subjectif, en dévi-
talisant celui-ci de sa substance…
Celle d’être précisément relative
aux sujets, aux conditions de vie,
aux pathologies spécifiques. Et
aussi aux enquêteurs et à leurs
méthodes !
n
Patricia de Postis
Sélection de publications
1. Revah-Levy A, Birmaher B, Gas-
quet I, Falissard B. The Adolescent
Depression Rating Scale (ADRS):
a validation study. BMC Psychiatry
2007;7.2.
2. Falissard B et al. Prevalence of
mental disorders in French prison for
men. BMC Psychiatry 2006;6,33.
3. Falissard, B. Psy, various procedu-
res used in psychometry. R. Software
ed, CRAN 2006;7.2.
4. Falissard B. Comprendre et utiliser
les statistiques dans les sciences de la
vie. Paris : Masson 2005;380.
5. Falissard B, Lukasiewicz M, Cor-
ruble E. The MDP75: a new approach
in the determination of the minimal
clinically meaningful difference in a
scale or a questionnaire. J Clin Epi-
demiol 2003;56:618-21.
6. Falissard B. Mesurer la subjecti-
vité en santé : perspective méthodo-
logique et statistique, 2003. Paris :
Masson 2001.
7. Falissard B. Focused principal
components analysis: looking at a
correlation matrix with a particular
interest in a given variable. Journal
of Computational and Graphical Sta-
tistics 1999;8:906-12.
8. Falissard B. A spherical represen-
tation of a correlation matrix. J Clas-
sification 1996;13:276-80.
9. Falissard B, Lellouch, J. The suc-
cession procedure for interim analy-
sis: extensions for early acceptance
of ho and for flexible times of analy-
sis. Stat Med 1993;12:51-67.
10. Falissard B, Lellouch J. A new
procedure for group sequential ana-
lysis in clinical trials. Biometrics
1992;48:373-88.
* Partenaires de la Fondation hôpitaux
de Paris-hôpitaux de France : Banque de
France, Bayard jeunesse, Bouygues Tele-
com, Carrefour, les Artisans Boulangers,
La Poste, Les Produits laitiers, le ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, RTL, la
SNCF et TF1. Soutiens de : l’Association
internationale des consultants en image-
France (AICI-France), l’association “Les
toiles enchantées”, la Caisse primaire
d’assurance maladie de Paris, Cosmetic
Executive Women (CEW), GIE Handiser-
vice, la Fédération française du prêt-à-por-
ter féminin, la Fondation EDF, la Fondation
Jean-Luc Lagardère, la Fondation Wyeth,
le groupe Dassault, l’Institut Mode Médi-
terranée, L’Oréal, RTL/Fun Radio, et du
soutien de l’association Les Amis de la
Maison de Solenn-Maison des adolescents.
** Falissard B, Bazin N, Hardy-Bayle
MC. Outcome revealed by preference in
schizophrenia (OPS): development of a
new class of outcome measurements. Int J
Methods Psychiat Res 2006;15(3):139-45.
*** Rouillon F, Duburcq A, Fagnani F, Falis-
sard B. Étude épidémiologique sur la santé
mentale des personnes détenues en prison.
Étude coordonnée par un groupe d’ex-
perts, sous l’égide d’un comité scientifique
présidé par les représentants des ministères
de la Santé et de la Justice et associant des
représentants des professionnels de santé
intervenant en milieu pénitentiaire. Réalisée
par le groupe d’étude en épidémiologie et
en santé publique Cemka-Eval avec un co-
financement du ministère de la Justice et
de la Santé. Voir, Falissard B et al. BMC
Psychiatry 2006;6:33.
Forum “Dans ma famille, l’alcool est un problème”
Premier bilan du forum www.forum-alcool-famille.fr, lancé le 13
mars dernier par Drogues alcool tabac info service (Datis) et l’Associa-
tion nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) :
en 6 mois, près de 150 contributions d’internautes et 1 759 visites des
pages de l’espace forum site ont été relevées. Cet espace d’échanges
et de témoignages a été créé pour soutenir les jeunes, nombreux, qui
souffrent d’une consommation excessive d’alcool au sein de leur fa-
mille. Elles sont, en effet, plus de 10 % le nombre des familles où
au moins l’un des parents a une consommation excessive d’alcool. Le
climat familial peut devenir tendu et pour les enfants de parent alcoo-
lique, la peur, la honte, la culpabilité, l’insécurité rendent difficile, voire
impossible de demander de l’aide. À la maison, le sujet est tabou. Sou-
vent, ils “n’en parlent pas”… Sur le forum, ils peuvent “se lâcher” mais
surtout tisser sur la toile un vrai réseau de solidarité. Ils disent, par
exemple : “Prononcer le mot alcool m’arrache la bouche. M’arrache comme
ça a arraché une partie de moi, de ma vie, de mon enfance, de mon adoles-
cence, de ma famille. Aujourd’hui encore j’ai du mal à dire mon papa est al-
coolique, les gens n’imagine pas ce que ça représente que de vivre avec une
personne atteint de cette maladie, voir l’une des personnes que l’on aime
le plus s’autodétruire c’est entraîné sa propre autodestruction avec elle.”
Certains enfants restent marqués de la violence des propos de leurs
parents, de leurs comportements durant des années. Un des témoi-
gnages rappelle “aux alcoolodépendants que leurs paroles et leurs gestes
envers leurs enfants, eux ne s’en souvienne peut-être plus le lendemain, mais
les enfants s’en rappelleront toute leur vie.” Les différents internautes ont
conscience qu’il faut poser ouvertement le problème aux parents ou
bien à l’entourage ou encore “en parler à ses amis de son âge”, cela pour
ne pas affronter seul les difficultés et être soutenu. “Je pense qu’il faut
parler ce cette maladie, briser le silence, casser les préjugés et s’exprimer au
lieu de rester étouffé par la bouteille”, dit l’un d’eux.
Étienne Apaire, le nouveau président de la Mission inter-
ministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
À la tête de la MILDT, l’alternance magistrat-médecin-magistrat se
poursuit avec la nomination, en conseil des ministres du 29 août
2007, d’Étienne Apaire, 48 ans.
Bref CV : auditeur de justice à l’École nationale de la magistrature, en
1986, il devient, deux ans plus tard, substitut du procureur de la Répu-
blique près le tribunal de grande instance d’Évreux où il est chargé des
infractions à la législation sur les stupéfiants. Il est aussi avocat général
près la cour d’assises de l’Eure. En 1990, substitut du procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris, il est chargé
de la lutte contre le trafic national et international de stupéfiants et
le proxénétisme. Pendant deux ans, il est aussi responsable du service
des injonctions thérapeutiques. L’année suivante, le voilà chargé de la
mission “justice” à la Délégation générale à la lutte contre la drogue
et la toxicomanie. En 1995, il prend le poste de juge d’instruction au
tribunal de grande instance de Paris (criminalité organisée ; criminalité
informatique...) et en 2001, occupe la fonction de premier substitut au
tribunal de grande instance de Nanterre. En mai 2002, il est aux côtés
de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieu-
re et des Libertés locales, comme conseiller judiciaire. Deux ans plus
tard, c’est de Dominique de Villepin, qui remplace Nicolas Sarkozy à la
tête de ce ministère, qu’il est le conseiller judiciaire. En décembre 2004,
il devient vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande
instance de Paris et, en mars 2005, chef de la mission de préfiguration
de la délégation aux interceptions judiciaires au ministère de la Justice.
En mai 2005, il est conseiller pour les affaires pénales et les victimes
de Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Enfin, en
avril 2007, il est chef de service, adjoint au directeur, à la Direction des
affaires criminelles et des grâces.
Brèves
1
/
4
100%