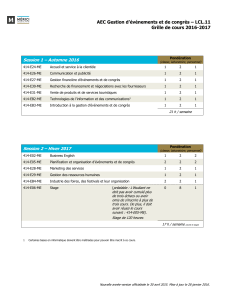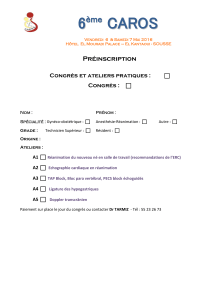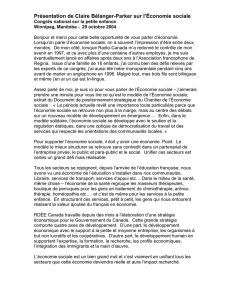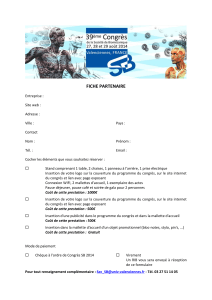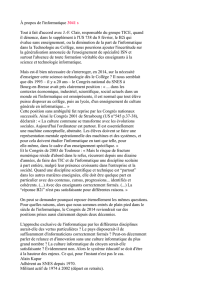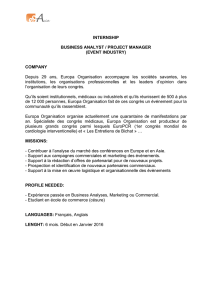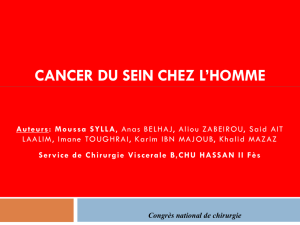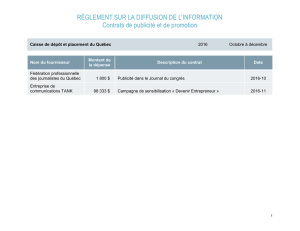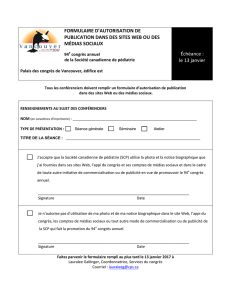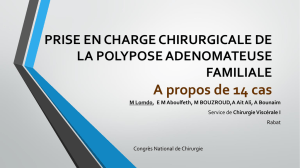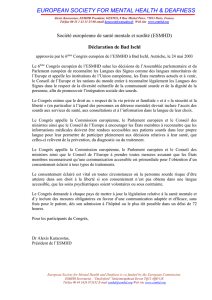r è s

Le Courrier des addictions (11) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2009 20
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
Flash-back : ce congrès a vu le jour, voilà
seize ans, à Saint-Tropez pour faire pièce
aux carences des systèmes de santé qui,
dans plusieurs pays, en France en particulier,
ne mesuraient pas la nécessité et l’urgence de
mettre en place une politique de réduction des
risques liés à l’usage de drogues afin de limiter
les dommages causés par l’épidémie du sida,
mais aussi celle des hépatites moins visibles à
l’époque. Il s’est construit également autour de
la nécessité de développer certains outils thé-
rapeutiques tels que la méthadone, qui faisait
l’objet de vives controverses sinon d’amères
polémiques.
Depuis, ce colloque international s’est tenu
tous les deux ans dans le sud-est de la France,
région d’origine de l’organisateur fondateur, le
Dr Jean-Marie Guffens, décédé en 2006.
En 2007, Bizia, avec son directeur le Dr Jean-
Pierre Daulouède, a pris le relais afin de pé-
renniser cette rencontre sur la Côte basque.
"Au fil des années, notre champ s’est élargi
Biarritz a accueilli la 9e édition du colloque européen et international "Toxicomanies
Hépatites Sida" (THS), du 13 au 16 octobre 2009. Il a été, comme le précédent en 2007,
organisé par Bizia, association qui a pour mission le soin, la prévention, la réduction des
risques et des dommages liés à l’usage des drogues, en partenariat avec la SETHS (So-
ciété européenne toxicomanies hépatites sida) et Munduko Medikuak.
Il a une nouvelle fois réuni les meilleurs spécialistes européens et américains de l’addic-
tologie qui ont présenté l’état de la recherche concernant l’actualité des soins dans le
"champ" et les problèmes infectieux associés.
Plus d'une centaine d'intervenants ont présenté leurs travaux en séances plénières, ate-
liers, rencontres et débats de société pour un public de près de 800 participants. Mené
tambour battant, le programme était copieux, les thèmes pluriels, chers à ce colloque
conçu, dès la première édition par Jean-Marie Guffens en 1993, comme interdiscipli-
naire, convivial et international. "Un colloque apparu au fil du temps comme un lieu
phare de rencontres et d’échanges entre les sciences humaines et médicales, les experts
européens et nord- et sud-américains, mais aussi, bien sûr, avec la communauté des pa-
tients et, plus largement, les usagers". C'est ainsi que cette année son président, le Pr
Christian Trepo de Lyon, le présentait en ajoutant : "Il a contribué avec succès à abolir les
traditionnelles barrières corporatistes entre la psychiatrie, la pharmacologie, la méde-
cine interne, l’infectiologe, l’hépatologie et la santé publique".
des drogues illicites vers les autres substances
psychoactives (médicaments détournés…),
vers l’alcool et le tabac aussi, enfin reconnus
comme homologues des drogues, vers d’autres
conduites addictives comme le jeu patholo-
gique et son avatar électro-Internet chez tous
les jeunes", devait expliquer Jean-Pierre Dau-
louède en introduction. Avec de nouvelles
difficultés pour appréhender les spécificités
cliniques et thérapeutiques de celles-ci. "Les
outils pour ratisser ce nouveau champ semblent
se faire plus complexes et plus ardus, disait-il. Là
où la substitution opiacée soigne l’héroïnomanie
jusqu’à la faire pratiquement disparaître, la co-
caïne, le cannabis et l’alcool, les conduites ad-
dictives, entre autres, nécessitent des approches
variées, plus complexes et plus longues, que la
combinaison de plusieurs addictions ne simpli-
fie pas".
Pour cette neuvième édition, trois thèmes
majeurs ont été présentés :
les addictions, avec la présentation des
progrès réalisés ces dernières années et l’état
des recherches, effectués notamment par le
National Institute on Drug Abuse (NIDA) et
avec la présence, entre autres personnalités,
des Prs Charles O’Brien* de Pennsylvanie,
Mary-Jeanne Kreek**, de la Rockefeller uni-
versity de New York, Bernard Roques***,
membre des académies française et euro-
péenne des sciences et pharmacologue;
l’infectiologie-virologie, avec la présenta-
tion par le Pr Julio Montaner****, président
de l’International AIDS Society, de ses travaux
sur l’intérêt des trithérapies pour limiter le
pouvoir contaminant des personnes porteuses
du VIH ; le rappel de l’importance du fléau de
l’hépatite C en Europe, et particulièrement en
France (900 décès par an), et des mises au point
sur les outils de dépistage et les stratégies de
mise en traitement de cette pathologie virale
qui est désormais potentiellement curable (Prs
Christian Trépo, Igor Grant de San Diego,
Victor De Ledinghen de Bordeaux) ;
la réduction des risques liés à l’usage de
drogues, avec la présentation d’expériences
innovantes telles que l’utilisation médicale de
l’héroïne, sous l’égide des Prs Miguel Casas de
Barcelone, Ambros Uchtenhagen de Zurich,
et Gerrit van Santen d’Amsterdam.
À cette occasion, les congressistes ont pris
connaissance de plus près avec les expé-
riences de salles de consommation à moindre
risque de Bilbao, Barcelone ou Vancouver (en
présence de Michael John Milloy)et l’éva-
luation de leur impact en termes de santé
publique. Et, pendant THS 9, une "salle de
consommation à moindre risque" a été re-
constituée pour l’occasion avec la présence de
l’association ASUD (association d’auto-sup-
port des usagers de drogues) et de Jean-Louis
Bara de First et Safe.
* Membre de l’académie des Sciences des États-Unis,
fondateur et directeur de l’Institut de recherche en ad-
dictologie, pionnier et de renommée internationale.
**Membre de l’équipe pionnière à l’origine de la
découverte de l’utilisation à usage thérapeutique de
la méthadone chez les consommateurs d’héroïne.
*** Auteur du "Rapport sur la dangerosité des drogues"
remis à Bernard Kouchner, ministre de la Santé en 1998.
****Pionnier des trithérapies du sida qui ont révolutionné
le pronostic de la maladie.
Biarritz, 13-16 octobre 2009
9e Colloque international
toxicomanies-hépatites-sida
(THS) : zoom sur de vraies
rencontres tout terrain
Patricia de Postis

Le Courrier des addictions (11) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2009
21
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
Zoom sur THS 9 :
Les addictions
La génétique
Il est loin le temps où l’on se permettait de dire,
même au sein de colloques professionnels et
scientifiques, que "les addictions sont un effet
du défaut de la volonté et que seule celle-ci peut
les défaire", comme le rappelait Jean-Pierre
Daulouède. "La saga de la découverte (en avril
2008) du premier gène de vulnérabilité pour les
addictions", contée par Philippe Gorwood à
Biarritz, est là pour en témoigner : de nom-
breux gènes candidats sont déjà connus pour
avoir un rôle potentiellement important dans
les variations interindividuelles de vulnérabili-
té de différents troubles addictifs (gène codant
pour le récepteur dopaminergique D2 dans le
syndrome du déficit de récompense, du neu-
ropeptide Y [NPY], du transporteur de la do-
pamine pour les syndromes de sevrage sévères,
du GABA-6 dans la dépendance à l’alcool, etc.).
Ils sont responsables d’effets très partiels, voire
mineurs, qui ne jouent un rôle que pour un pe-
tit nombre de patients et sont loin de rendre
compte de la complexité de tout ce qui peut
entrer en jeu dans l’émergence d’une addic-
tion. "La complexité du phénotype, l’héritabi-
lité modeste, la difficulté à reposer ces analyses
sur des approches plus biologiques, expliquent,
en bonne partie cet aspect minimaliste des ré-
sultats… La question se posait donc de savoir si
la génétique devait se contenter d’aspects aussi
discrets pour les années à venir", racontait Phi-
lippe Gorwood. Il répond : "Et bien non ! Car,
en avril 2008, a été découvert le premier gène
de vulnérabilité aux comportements addictifs.
La qualité des résultats initiaux, le nombre des
réplications et la cohérence des résultats, nous
permet d’affirmer, de manière assez exception-
nelle en psychiatrie génétique, que le cluster de
gènes en question constitue un facteur de risque
pour la dépendance au tabac" (à partir de la
réplication du rôle significatif de ce gène sur
une population de 3 000 adolescents français).
Or ce gène a déjà "des frontières phénotypiques
débordantes, puisque le risque d’alcoolodépen-
dance pourrait aussi être concerné… Une fois
que le fil d’Ariane est attrapé, le but du laby-
rinthe n’est plus très loin", concluait-il.
Les traitements
Depuis longtemps, les experts en neurobiolo-
gie, les psychiatres et les cliniciens ont prouvé,
par ailleurs, l’influence prépondérante des
facteurs de vulnérabilité aux addictions dans
la réussite ou l’échec des traitements, la plus
ou moins grande propension à "s’accrocher" et
à rechuter : "Ce sont les unlucky", comme les
appelait Charles O’Brien. Et, comme dans
nombre d’autres domaines de la médecine
(notamment en cancérologie), ce sont aussi les
facteurs de chance ou malchance de répondre
plus ou moins bien aux traitements. Mais
quels traitements ? Il semble que la polémique
de années 1980-1990, devenue nettement plus
tiède, ait cédé beaucoup de terrain à l’obser-
vation, l’expérimentation, l’évaluation. Et c’est
heureux !
Bien des intervenants et auteurs de posters ont
eu l’opportunité à Biarritz de conforter l’option
thérapeutique agoniste dans le traitement des
addictions aux opiacés, en particulier Miguel
Casas de Barcelone et, bien sûr, Marie-Jeanne
Kreek qui a rappelé qu’un million de patients
de par le monde étaient désormais sous traite-
ment de substitution par la méthadone (dont
250 000 aux États-Unis, 500 000 en Europe).
Mais, comme le Pr Charles O’Brien, elle a
pu développer également l’intérêt de "l’option"
antagoniste, avec la naltrexone, qui bloque
l’euphorie en inhibant la production de do-
pamine par les récepteurs opioïdes. "Dans les
études menées chez les alcooliques, on a donné
soit un placebo, soit de la naltrexone. Chez les
patients qui ont reçu le traitement, le craving
a notablement diminué et seulement 25 % des
patients en traitement rechutent contre 50 %
de ceux qui ont reçu le placebo", rappelait le Pr
O’Brien qui a été l’initiateur de ces travaux, qui
comptent désormais une trentaine d’études in-
ternationales.
Pascal Courty et Simon Duchâteau.
La douleur
Encore un domaine où il a fallu batailler pen-
dant des années pour faire reconnaître l’ina-
nité d’idées reçues sur la quasi-absence de
douleur aiguë, pourtant très déstabilisatrice,
du patient sous opiacés, héroïne ou traite-
ments de substitution. À Biarritz, l’équipe de
Clermont-Ferrand, Pascal Courty et Nicolas
Autier ont présenté des travaux portant sur la
comparaison des seuils de douleur de patients
substitués par méthadone ou buprénorphine
et de sujets sains contrôles. Les deux groupes
traités, de 30 patients chacun, ne diffèrent que
par la durée du traitement et les antécédents
d’injection (plus élevés dans le groupe métha-
done). En accord avec les critères d’exclusion,
les patients ne présentaient aucun toxique dans
les urines, à l’exception de cannabis, avec une
prévalence de 75 %. Les deux groupes étaient
comparables en termes d’humeur, de scores de
sévérité de l’addiction et de qualité de vie, ex-
pliquait Nicolas Authier. Résultats: "Respecti-
vement 68 % à 75 % et 28 % à 78 % des patients
méthadone et bupénorphine ont présenté une
hyperalgie mécanique et électrique statistique-
ment significative. Et cette hyperalgie semble
d’intensité et de prévalence supérieure dans
le groupe méthadone." Conclusion de Pascal
Courty: "En réalité les patients sous traitement
de substitution aux opiacés (TSO) font l’expé-
rience de la douleur. Ils connaissent à la fois la
tolérance aux opiacés et l’hyperalgésie comme
le prouvent des scores plus élevés concernant la
douleur. Néanmoins, leur douleur répond aux
opiacés et comme ils en ont besoin en première
ligne, il leur en faut en traitement de la douleur
de plus fortes doses ainsi qu’une fréquence et
une durée d’administration plus élevées."
Jean-Pierre Daulouède et Jean-Luc Venisse.
Jeu pathologique
Autre actualité de THS 9, poussée sur les de-
vants "de la scène" par la nécessité faite désor-
mais aux centres de soins d’accompagnement
et de prévention en addictologie, les CSAPA,
d’intégrer dans leurs activités les addictions
sans drogue : le jeu pathologique. Encore bien
peu exploré en France, il a donné lieu à un ate-
lier spécifique, présidé par le Pr Jean-Luc Ve-
nisse de Nantes, où se sont exprimés des spé-
cialistes canadiens et français. Ainsi Isabelle
Giroux, psychologue au centre d’excellence
québécois pour la prévention et le traitement
du jeu, a présenté deux études concernant les
Mary-Jeanne Kreek et Andrew Rosenblum.

Le Courrier des addictions (11) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2009 22
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
loteries vidéo. La première concerne la forma-
tion au hasard du jeu qui a permis de toucher
12 000 détaillants de loterie vidéo du Québec
et leurs employés. Le but en était de réviser
certains concepts relatifs au jeu (la notion de
hasard…) et, surtout, de mieux connaître les
caractéristiques d’un joueur excessif afin de
pouvoir intervenir "en prévention" auprès de
lui. En préalable, on s’est aperçu à cette oc-
casion que la plupart ne connaissait même
pas le fonctionnement des machines à sous.
Ensuite, à l’issue de cette formation, 70 % des
membres du personnel avaient bien donné un
dépliant d’information portant les adresses de
services ressources à l’assistant de recherche
jouant le client "mystère" en difficulté avec
le jeu (contre 50 % de ceux qui n’avaient pas
bénéficié de cette formation). Malheureuse-
ment, 8 mois plus tard, ce bon score ne s’était
pas maintenu.
La deuxième étude portait sur l’évaluation
d’un projet d’exclusion volontaire, lancé en
2006 par la Régie des alcools, des courses et
des jeux du Québec, en collaboration avec
de nombreux partenaires (ministre des Fi-
nances, services sociaux, services de santé,
propriétaires de brasseries, de bars, Police…).
L’université de Laval a formé pour cela des
conseillers, édité un dépliant à la disposition
des joueurs. 93 % (soit 400) des détaillants et
employés des deux régions concernées par ce
programme (Mauricie et centre Québec) ont
accepté de participer à l’étude, de répondre à
un questionnaire d’évaluation, en post-test,
puis à 6 mois. Résultats : 67 % se sont déclarés
satisfaits de la formation qu’ils avaient reçue,
et, au bout de six mois, ils avaient eu souvent
le réflexe de parler de "ressources d’aide" aux
joueurs qui les sollicitaient. Lesquels, joueurs
depuis 8 ans en moyenne et dépensant 354 $
par semaine, préféraient une exclusion de
12 mois, renouvelée pour trois mois, plutôt
qu’une exclusion moins "sévère". Décep-
tion relative : 71 % de ces clients, souffrant
d’ailleurs de problèmes concomitants d’alcool
et de drogues, avaient déjà reçu une aide. "Le
programme a donc recruté très peu de nou-
veaux clients et, de plus, ils ont été bien peu
nombreux à retourner le questionnaire", disait
Isabelle Giroux.
Marie Grall-Bronnec, du service nantais
du Pr J.L. Venisse, a, pour sa part, relativisé
l’addiction aux jeux à l’adolescence, comme
Élisabeth Rosse, de Marmottan, deux
lieux pionniers d’accueil et de soins pour
les joueurs pathologiques et forts consom-
mateurs de jeux en ligne sur Internet. Sans
pour autant en nier l’impact. Ainsi le Centre
de recherche et d’information des organisa-
tions de consommateurs belge, cité par Marie
Grall-Bronnec, a indiqué qu’en 2006, parmi
un échantillon de 2 300 sujets âgés de 10 à 17
ans, 40 % avaient déjà joué au moins une fois
à un jeu de hasard et d’argent, 2 à 9 % d’entre
eux pouvaient présenter déjà des indices
d’une pratique pathologique. "Une étude ca-
nadienne récente, portant sur un large échan-
tillon de sujets âgés en moyenne de 18,6 ans,
indiquait qu’entre 3,5 % et 5,8 % avaient un
problème probable de jeu, même si seuls 1,1 %
d’entre eux en avaient la perception", expli-
quait-elle. Et, bien sûr, comme pour bien
d’autres addictions, on retrouve parmi eux
les mêmes facteurs de vulnérabilité, avec des
problématiques très proches : personnalité
en recherche de sensations, antécédents fa-
miliaux de troubles de la personnalité, d’abus
sexuels, de maltraitance, de jeu excessif, pré-
cocité de l’initiation…
Pour Élisabeth Rosse, de Marmottan (Dr
Marc Valleur), centre qui reçoit actuellement
aux alentours de 200 hard core gamers, il est
évident que les Massively Multiplayer on Line
(les "MMO-RPG") sont souvent des jeunes
adultes qui souffrent de troubles psychia-
triques "sérieux" considérant leurs pratiques
comme un étayage "auto-médiquant". En tous
cas, qui sont à la recherche de plaisir et de
sensations excitantes et valorisantes à travers
les jeux. À ne pas confondre avec ces bouli-
miques d’images et écrans en tous genres et
tous formats, en quête d’anesthésie, d’oubli de
leur réalité et difficultés. Et sûrement pas avec
ces cohortes d’ados qui cherchent à fuir une
réalité inquiétante, les problèmes scolaires du
collège et du lycée, les angoisses de l’entrée
"dans une peau sexuée"… Bref, qui se ser-
vent des écrans comme d’un "hygiaphone
sentimental", pour communiquer soft avec
leurs pairs. Dans ce contexte, "la guilde" du
jeu en ligne et l’avatar choisi permettent
de vivre, dans l’infinitude d’un jeu qui se
greffe de perpétuelles extensions, des aven-
tures sans fin dans le virtuel. "On a plus de
prise sur son avatar que l’on peut facile-
ment moduler, changer que sur son propre
corps", disait-elle. "On voit plus parmi eux
des troubles qui sont du registre de la pho-
bie sociale que de la psychose (schizophré-
nie). Il faut remettre ces jeunes à leur place
qui est celle de sujets timides qui veulent
reprendre confiance en eux et que l’on doit
aider à prendre conscience que ce qu’ils sont
capables de faire dans le jeu, ils peuvent
l’utiliser par ailleurs", concluait-elle.
v
Centre des congrès de Biarritz.
Tabagisme,
encore plus de cancers
vLe Centre international de recherche
sur le cancer (le CIRC, Lyon) vient
d’ajouter à la liste déjà bien longue des
cancers induits par le tabagisme (cavité buc-
cale, oro-pharynx, œsophage, cavité nasale,
larynx, poumon, col de l’utérus, vessie, rein,
moelle osseuse, uretère), ceux de l’ovaire, du
côlon et du rectum…

Le Courrier des addictions (11) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2009
23
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
Biarritz, 13-16 octobre 2009
Pour les médecins de l’Association nationale
pour la recherche et l’étude sur les hépato-
pathies chroniques (ANGREHC*), ces graves
loupés dans le dépistage du VHC sont peut-
être explicables, mais en aucun cas accep-
tables. À quoi faut-il les attribuer? Au silence
de cette maladie pendant parfois longtemps,
qui la rend peu détectable en pratique, aux
réticences qu’ont certains médecins à prendre
en charge une maladie fréquente et compli-
quée dans une population de patients qu’ils
jugent "difficiles", à l’absence de soutien du
système de santé? Pourtant sa prise en charge
peut être organisée par des réseaux de soins en
toxicomanie et/ou hépatites C, la formation
des médecins généralistes n’est pas insurmon-
table puisqu’elle est déjà organisée dans bien
des réseaux. Il existe des modalités de dépis-
tage efficaces et disponibles, bien codifiées
(test ELISA, puis détection et quantification
de l’ARN du VHC par PCR, enfin dosage du
taux ALAT/ASAT permettant de savoir si la
maladie est évolutive ou pas). On a déjà beau-
coup travaillé sur la façon de faire l’annonce
du diagnostic, à qui et comment la gérer (sans
précipitation, souvent en plusieurs étapes
selon la réceptivité du patient, et toujours
dans le cadre d’un suivi du patient, de l’aidant
principal et des proches…). Enfin, comme
l’ont répété bien des intervenants dont le Dr
Xavier Aknine, responsable de l’ANGREHC,
ou encore le Dr Michel Bonjour, on connaît
mieux maintenant les modalités d’une bonne
prise en charge : "Elle doit débuter avec un ac-
compagnement psychiatrique. Il faut évaluer
l’état psychique du patient avant l'instauration
du traitement médicamenteux. Elle doit être
transdisciplinaire (généraliste, hépatologue,
travailleur social, infirmière, psychologue,
psychiatre, etc.) pour optimiser les chances de
guérison", insistait M. Bonjour. Ce concept de
travail en équipe transdisciplinaire a d’ailleurs
bien montré ses preuves dans une étude me-
née, pendant 2 ans, par le Réseau des micros-
tructures d’Alsace en 2008, présentée à THS
9. "Le travail en équipe à proximité du patient,
dans une relation de confiance, améliore la
prise en charge de l’hépatite C chez les UD",
concluait le Dr George-Henri Melenotte,
président de la CNRM**.
Et pourtant, les loupés sont toujours là, pré-
occupants, en amont comme en aval. C’est
la raison pour laquelle l’ANGREHC a alerté
les pouvoirs publics sur les graves problèmes
d’accès aux soins d’une partie de ces patients.
À THS 9, les médecins qui militent en son sein
ont donc proposé que certains généralistes
expérimentés dans la prise en charge de pa-
tients toxicomanes, porteurs de l’hépatite C,
puissent établir eux-mêmes et sous certaines
conditions, la primo-prescription nécessaire
pour débuter le traitement interféron-riba-
virine. Une mesure qui figure dans le Plan
hépatites national 2009-2012 et qui prévoit
l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques
à l'intention des médecins généralistes primo-
prescripteurs. Mais, bien sûr, il ne faudrait pas
tarder à la mettre en œuvre… "Chaque UD at-
teint d’hépatite C qui continue à s’injecter ou
sniffer est le maillon d’une chaîne de contami-
nation, il faut le dépister. Les UD ont les mêmes
chances de guérison que les non-usagers. La
clef de la guérison est la combinaison transdis-
ciplinarité et expérience. Aucun professionnel
ne peut prendre en charge un usager seul. 2010
devrait être l’année de la transdisciplinarité…",
résumait et concluait Pascal Melin, cofonda-
teur de SOS hépatites (Saint-Dizier).
v
* ANGREHC : Association
nationale pour la recherche
et l'étude sur les hépato-
pathies chroniques (www.
angrehc.com).
* CNRM : Coordination
nationale des réseaux de
microstructures (coordina-
tion-nationale@reseau-rms.
org).
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
La Bulgarie, aussi !
vL’Assemblée nationale bulgare, qui a voté au printemps der-
nier l’interdiction de fumer dans tous les lieux publics, va
mettre en pratique cette mesure à compter de juin 2010. Ce
pays, particulièrement tabagique (il se classe au deuxième rang des
pays européens pour le nombre de fumeurs réguliers, derrière la
Grèce), avait déjà interdit la cigarette dans les hôpitaux et les taxis
et imposé aux restaurateurs et cafetiers d’aménager des zones non-
fumeurs. Comme ces mesures n’étaient pas appliquées, comme on
l’a constaté en France depuis des années, le gouvernement bulgare
a décidé de passer, comme nous, à la vitesse supérieure.
Essai clinique pour le vaccin anti-cocaïne
vDes scientifiques américains ont mené un essai clinique
positif pour un vaccin anti-cocaïne qui réduirait la prise
de cette drogue en augmentant dans le sang le niveau des
anticorps contre elle, ce qui la rendrait inactive. L’essai a porté
sur 115 personnes dépendantes à la cocaïne dont 58 ont reçu le
vaccin (5 injections) et 57 un placebo. Des tests urinaires ont été
faits trois fois par semaine pour mesurer le taux des métabolites de
la cocaïne, donc l’usage de drogue. Résultat : 38 % des personnes
vaccinées ont produit assez d’anticorps pour ne plus ressentir les
effets de la drogue. Affaire à suivre…
Martell BA et al. Arch Gen Psychiatry 2009;66(10):1116-23.
L’INFECTIOLOGIE
THS 9 a consacré plu-
sieurs ateliers à l’hé-
patite C pour bien
marquer, une nou-
velle fois, l’urgence
d'une plus grande
mobilisation du corps
médical dans la lutte
contre l’infection par
le VHC. Plus de 250 000 personnes vivent en
France avec une bombe à retardement au niveau
du foie. Sans le savoir! Et pourtant, après un dé-
pistage à temps, "les traitements contre l’hépatite
C, désormais adaptés à chaque patient, permet-
tent la guérison (suppression virale) dans 63 % des
cas aujourd'hui", affirmait Victor de Ledinghen
(Bordeaux).
En résumé, d’après le Bulletin Épidémiolo-
gique Hebdomadaire du 19 mai 2009 (Institut
de veille sanitaire) plus de 500 000 personnes
sont porteuses d’une hépatite virale chronique
(232 000 de l'hépatite C, 281 000 de l'hépatite
B), près de 50 % l’ignorent et ne sont pas en-
core dépistés. Les hépatites virales sont res-
ponsables de 10fois plus de décès que le VIH.
Rappelons que chez les usagers de drogues (UD)
[par injections et sniff], la prévalence du VHC at-
teint 60 %, ce qui fait d’eux la cible privilégiée et
prioritaire du dépistage systématique (séropréva-
lence de 28 % chez les moins de 30 ans, 71 % chez
les 40 ans et plus, de 24,5 % chez ceux qui sont
atteints du sida...). Non soignées et non prises
en charge alors que des traitements efficaces
existent, les hépatites virales chroniques sont
la cause de plus de 5 000 décès chaque année
en France dont 3 500 décès dus au virus de
l’hépatite C (VHC).
On compte toujours actuellement 5 000 nou-
velles contaminations par an pour l’hépatite C
et 2 500 pour l’hépatite B.
1
/
4
100%