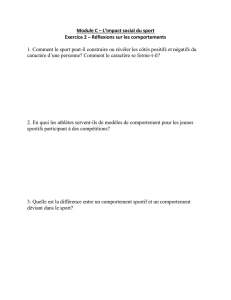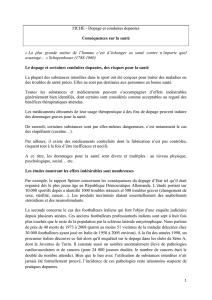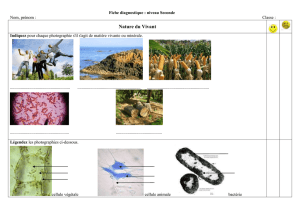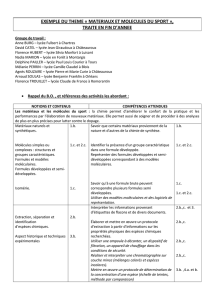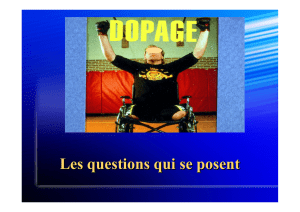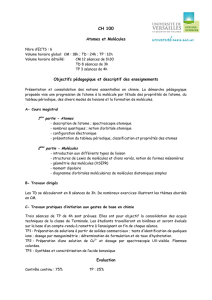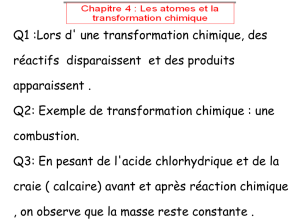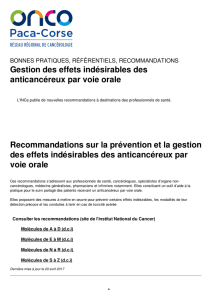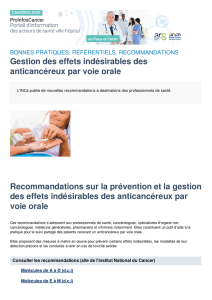Mise au point

188
Mise au point
Mise au point
◗Soit il est souhaitable de privilégier
un modèle de société qui ne bascule
pas complètement dans une logique de
profit total et qui va ainsi s’attacher à
préserver des notions de solidarité et
d’idéal. Dans ce modèle, la dimension
humaniste et éthique du sport se doit
de rejeter absolument les compromis-
sions qui aboutiraient à dénaturer
fondamentalement la notion même de
sport. Cela, bien évidemment,
implique que le mouvement sportif et
tous ses acteurs, quels qu’ils soient,
choisissent d’assumer totalement leurs
responsabilités. Toutefois, il faut
admettre que le sport peut et doit
évoluer pour rester en adéquation avec
l’évolution de la société, sans pour
autant qu’il vende son âme. Le dopage
en est ainsi logiquement banni.
◗ Soit on admet que la société libérale,
qui tend à s’imposer dans la plupart
des pays du monde dits industrialisés,
peut aller rapidement vers une dyna-
mique tout entière fondée sur le profit
et la réussite, qu’elle soit individuelle
ou de groupe. Dans cette logique, on
admettra que le sport lui-même
s’oriente de plus en plus vers le profit,
aux dépens de ses valeurs éducatives
et ludiques ; et que le mouvement
sportif institutionnel classique peut
être amené à céder une part impor-
tante de ses prérogatives aux struc-
tures privées qui disposent du pouvoir
de l’argent. Le dopage deviendrait dès
lors admissible, voire recommandé, ce
qui signifie la mise en place d’un
système organisé et structuré.
◗ Soit on se situe dans une situation
intermédiaire où les incohérences et
les ambiguïtés sont multiples. C’est-à-
dire que, sur le plan sportif, on a la
volonté plus ou moins avérée de
refuser le dopage et de lutter contre
cette pratique de façon claire et déter-
minée, mais que dans d’autres
milieux, notamment professionnels,
les même pratiques peuvent exister,
mais pas la référence, dans ce cas, au
dopage et donc ne pas être considérées
comme répréhensibles dans cet autre
contexte.
Quelle définition peut-on donner du
dopage sportif ? et du dopage tout
court ?
Il n’est pas simple de définir précisé-
ment et correctement ce que l’on
entend par “dopage”. De plus, la ou
les définitions proposées renvoient de
manière quasi exclusive au milieu
sportif. Le Comité international olym-
pique (CIO) ne propose pas de défini-
tion de référence. Il renvoie à une liste
régulièrement mise à jour. Souvent, la
définition proposée est modifiée en
fonction du pays et de son contexte
juridique. En France, la loi n° 89-432
du 29 juin 1989 indique dans son
article 1er : “Il est interdit à toute
personne d’utiliser, au cours des
compétitions et manifestations spor-
tives (...) ou en vue d’y participer, les
substances et les procédés qui, de
nature à modifier artificiellement les
capacités ou à masquer l’emploi de
substances ou de procédés ayant cette
propriété, sont déterminés par arrêté
conjoint des ministres chargés des
sports et de la santé”.
Une définition proposée dans les
années 60 reste, à l’heure actuelle, en
vigueur : “Est considéré comme
dopage l'utilisation de substances et
de tous moyens destinés à augmenter
artificiellement le rendement en vue
ou à l'occasion de la compétition, ce
qui peut porter préjudice à l'éthique
sportive et à l'intégrité physique et
psychique de l'athlète”.
Toutes les définitions dites scienti-
fiques du dopage ont toujours été
contestées par les juristes qui en
dénoncent le caractère incertain. Le
CIO a en fait construit son système sur
trois principes fondamentaux : la
protection de la santé de l’athlète, la
défense de l’éthique médicale et de
l’éthique sportive, le maintien des
chances égales dans la compétition.
Est-ce de nos jours encore adapté ?
Qu’en est-il d’une définition dépas-
sant le cadre du sport ?
La pharmacologie du dopage :
entre sport et pratique
quotidienne
P. Martin*
e dopage, quelle que soit la
personne considérée, ne doit
pas être appréhendé seule-
ment en référence à la santé. Il ne
faut pas non plus se limiter à une
approche qui ne concernerait que le
sportif et, tout particulièrement, celui
qui est appelé de “haut niveau”. Il
est vrai qu’au travers du problème du
dopage sportif et de la lutte anti-
dopage se pose en réalité la question
de la conception même du sport.
Mais, en fait, cette problématique,
surtout à l’heure actuelle, renvoie
directement à un débat beaucoup
plus large et beaucoup plus impor-
tant : celui, non seulement d’un
choix de société, mais de la société
elle-même.
L
* Département de psychiatrie et de
psychologie médicale, unité de
recherche, hôpital Saint-Antoine et
AMC, Paris.

189
Mise au point
Mise au point
Les molécules et pratiques
considérées comme
“dopantes”
Le CIO a défini comme action de
dopage tout usage volontaire ou invo-
lontaire de substances appartenant aux
classes interdites ainsi que tout
recours aux méthodes défendues
énumérées sur la liste en vigueur.
Par ailleurs, aucune des substances
appartenant aux classes interdites ne
peut être utilisée, même si elle n’est
pas citée en exemple. C’est la raison
pour laquelle l’expression “et
substances apparentées” a été intro-
duite. Cette expression fait référence
aux substances qui sont apparentées à
la classe en question par leurs effets
pharmacologiques et/ou leur structure
chimique. Mais quelle est la réalité
physiologique de l’effet réellement
dopant de ces structures apparentées ?
Quelles preuves cliniques avons-nous
à ce sujet ?
Substances interdites
Les molécules dites “stimulantes”
Quelle définition ? Elles sont
susceptibles d’appartenir soit à la
classe des psychoanaleptiques, c’est-
à-dire des molécules qui augmentent
l’activité mentale, soit à la classe des
psychodysleptiques, c’est-à-dire des
molécules qui modifient l’activité
mentale.
Ce sont essentiellement toutes les
molécules, psychotropes ou non, ayant
soit une action nooanaleptique, c’est-
à-dire stimulant la vigilance, soit une
action psychostimulante, soit une
action favorisant des fonctions suscep-
tibles d’améliorer les performances,
comme les fonctions cardiaque ou
pulmonaire, par exemple.
Quelles molécules ? Il est donc prin-
cipalement retrouvé sous cette appel-
lation de “stimulants”, les dérivés de
la phényl-éthyl-amine, dont le chef de
file est l’amphétamine, des composés
de structures chimiques proches et
possédant les mêmes propriétés quelle
qu’en soit l’indication thérapeutique
(dexamphétamine, amfépramone, etc.)
ainsi que des molécules considérées
comme apparentées (l’amineptine, la
fenfluramine, le méthylphénidate,
etc.). Par ailleurs, il est intéressant de
préciser que, dans la classe des molé-
cules psychoanaleptiques, les antidé-
presseurs ne figurent pas sur la liste
des produits dopants, à l’exception de
quelques inhibiteurs de la mono-
amine-oxydase (sélégiline). Or, ces
molécules sont, peut-être pour
d’autres propriétés pharmacologiques,
de plus en plus employées et donc
peut-être déviées de leur(s) indica-
tion(s) d’origine. De plus, certaines
molécules, comme la fluoxétine, ont
une conformation de structure
chimique proche de celle de l’amphé-
tamine et ne sont pas sur les listes.
Toutefois, l’état psychologique lié à la
pratique de la compétition pourrait,
dans certains cas, justifier une indica-
tion “d’action antidépressive” concer-
nant ces molécules.
Les principaux psychostimulants sont
les bases xanthiques comme la caféine
et ses dérivés. D’autres molécules sont
répertoriées comme psychostimu-
lantes, tels les sympathomimétiques
comme les agonistes bêta–adréner-
giques (clenbutérol, salbutamol, etc.) ;
l’éphédrine et ses dérivés, de même
que la strychnine. Des molécules toni-
cardiaques (heptaminol) et des dérivés
de la phénylpropanolamine.
Il est à noter que, pour certaines molé-
cules, l’on tolère une certaine concen-
tration plasmatique ou urinaire. C’est
le cas de la caféine – le test est consi-
déré comme positif lorsque la concen-
tration dans l’urine dépasse 12 mg/ml –
ou de l’éphédrine (concentration
urinaire supérieure à 5 mg/ml). Par
ailleurs, les vasoconstricteurs, en
particulier les dérivés de l’imidazoline
(naphazoline, etc.) et la phénylé-
phrine, sont admis pour un usage local
(gouttes ophtalmologiques ou
nasales). Il en va de même pour l’adré-
naline et ses dérivés lorsqu’ils sont
ajoutés à un anesthésique local.
Quels effets recherchés ? Le but de
ces produits est de permettre de fixer
et d'améliorer la vigilance dans le
domaine précis de l'action en cours,
tout en abaissant le niveau général de
perception de l'environnement. D'une
façon générale, l'administration de ces
produits entraîne un état d'euphorie et
réduit la sensation de fatigue
physique ; elle permet au sujet de se
dépasser lors d'un effort intense qui
l'amène le plus souvent à un seuil
proche de l'épuisement.
Quels effets délétères ? L’amphétamine
et ses dérivés induisent principalement
une symptomatologie anxieuse, de
l’agitation et un trouble du jugement.
Une utilisation massive provoque chez
certains sujets des états paranoïaques,
induit des effets délétères sur la fonc-
tion cardiaque, sur la pression arté-
rielle et peut provoquer des
convulsions.
Les stupéfiants
Quelle définition ? Ces molécules
appartiennent à la classe des psycho-
dysleptiques, c’est-à-dire des molé-
cules qui modifient l’activité mentale.
Ce sont toutes les molécules ayant une
action onirogène, c’est-à-dire capables
d’induire un bouleversement des
intensités et qualités perceptives et
possédant des propriétés toxicomano-
gènes.
Quelles molécules ? L’ensemble des
molécules appartenant à cette classe
est impliqué. Les principales sont
l’héroïne, la morphine, la cocaïne,
etc. ; la méthadone, les dérivés opiacés
dont l’usage thérapeutique principal
est d’être antalgique (buprénorphine,
pentazocine, etc.).
Il est à noter que la cocaïne est le plus
souvent répertoriée dans la classe des
stimulants, et les molécules cannabi-
noïdes, dans celle des substances
soumises à certaines restrictions.
Certaines substances de cette caté-
gorie sont autorisées lorsqu’elles sont
administrées pour traiter certains
symptômes, en particulier la toux et la
douleur, (le dextrométhorphane, le
dextropropoxyphène, la codéine et ses
Act. Méd. Int. - Psychiatrie (19) n° 7, septembre 2002

190
Mise au point
Mise au point
dérivés, la pholcodine, etc.), voire
également comme antidiarrhéique
(diphénoxylate).
Quels effets recherchés ? Ces produits
génèrent une distorsion dans l’appré-
ciation des valeurs de réalité, ils entraî-
nent une dynamique de sensation de
puissance et vont vers l’acquisition de
comportements similaires à un repli sur
soi-même. Ils repoussent également les
seuils de douleur physique ou
psychique.
Quels effets délétères ? Ce sont princi-
palement ceux propres à la classe des
stupéfiants, qu’ils soient physiques,
psychiques ou sociaux. Le dopage aux
stupéfiants pourrait être considéré
comme une sorte de toxicomanie spéci-
fique des sportifs ou des individus en
recherche de performances constituant,
à terme, pour certains individus
fragiles, une porte d’entrée à la toxico-
manie tout court.
Les molécules anabolisantes
Quelle définition ? Ce sont des
produits issus des hormones stéroïdes
androgènes en particulier, qui ont pour
effet d’accélérer le métabolisme des
synthèses protéiques dans l’organisme.
Quelles molécules ? Cette catégorie
concerne plusieurs familles de molé-
cules, dérivées et apparentées.
◗Les stéroïdes anabolisants androgènes
(androstènediol, danazol, stanozolol,
nandrolone, testostérone, etc.) ; les
molécules qui paraissent ou parais-
saient comme étant les plus fréquem-
ment utilisées sont la testostérone et la
nandrolone. La nandrolone ou 19-
nortestostérone (19-NT) est un stéroïde
anabolisant androgène de synthèse,
dont la structure chimique correspond à
celle d’une testostérone ayant perdu un
radical méthyl (-CH3) sur le carbone 19.
Elle possède des métabolites (19 NA et
19 NE) qui peuvent également résulter
de la transformation de divers types
d’hormones stéroïdes. Le 19-noran-
drostènedione, par exemple, peut-être
métabolisé en 19-NA.
Pour la testostérone, la présence d'un
rapport de testostérone (T)/épitestosté-
rone (E) supérieur à 6 dans l'urine d'un
concurrent constitue une infraction, à
moins qu’il ne soit établi que ce rapport
est dû à une condition physiologique ou
pathologique.
Il faut également considérer d’autres
dérivés comme la déhydroépiandrosté-
rone (DHEA) ou l’androstènedione, qui
peuvent être des produits de dégrada-
tion intermédiaire.
◗Les agonistes bêta-adrénergiques,
précisément de type 2, ont montré chez
l’animal des propriétés anabolisantes
(clenbutérol, salbutamol, orciprénaline,
etc.) et sont classés comme substances
dopantes.
Il est à noter que certains, comme le
salbutamol, le salmétérol et la terbuta-
line sont autorisés sous forme d'inhala-
tions dans l’asthme, causé ou non par
l’effort. D’autres bêta-2-agonistes
peuvent avoir des effets stimulants et
sont également classés comme tels par
le CIO.
Quels effets recherchés ? Il s’agit
d’augmenter la croissance musculaire,
d'améliorer la capacité d'entraînement,
de renforcer la résistance à la fatigue et
à la douleur, en vue, par exemple, de
mieux supporter des périodes très char-
gées en compétitions, de compenser des
affaiblissements physiques, de rattraper
plus rapidement des retards ou des
interruptions du programme de prépa-
ration physique, à la suite d’une bles-
sure notamment.
Leur administration, couplée à une
préparation physique spécifique et à
une alimentation adéquate, permet
essentiellement d'obtenir une augmen-
tation globale de la masse, de la force et
de la puissance musculaire. Ces
produits renforcent aussi l'agressivité et
la résistance à la fatigue et à la douleur.
Quels effets délétères ? Un individu
exposé à des doses plus ou moins
élevées d’un stéroïde anabolisant risque
principalement de développer diverses
affections de type cancer, hépatite,
diabète, hypercholestérolémie, hyper-
tension, troubles cardiovasculaires,
accidents tendineux et musculaires,
déséquilibres de la physiologie
sexuelle, éventuellement stérilité,
perturbations de la croissance chez les
jeunes et même troubles psycholo-
giques profonds du type d’une démence
stéroïdienne. À long terme, de
nombreux utilisateurs présentent des
signes d’agressivité, d’instabilité
émotionnelle et d’irritabilité.
Les molécules diurétiques
Quelle définition ? Ce sont des médi-
caments agissant sur le système rénal
en augmentant la vitesse de formation
de l’urine et l'élimination de l’eau et du
sodium.
Quelles molécules ? Ce sont tous les
diurétiques avérés : les molécules thia-
zidiques et apparentés (chlorothiazide,
hydrochlorothiazide, etc.), les diuré-
tiques comme le furosémide, l’acide
éthacrynique, etc. ; les antialdostérones
et diurétiques dits “d’épargne potas-
sique” (spironolactone, etc.) ainsi que
les diurétiques osmotiques comme le
mannitol injecté par voie veineuse.
Quels effets recherchés ? Les molé-
cules diurétiques sont considérées
comme substances dopantes dans le
sens où elles permettent l’élimination
plus rapide des produits. Elles sont
aussi utilisées par les sportifs soit pour
perdre rapidement du poids, soit pour
gêner la détection de substances illi-
cites dans l'urine en augmentant la
quantité de celle-ci.
Quels effets délétères ? Ceux liés aux
diurétiques, qui dans ce cadre peuvent
être considérés comme relativement
modestes.
Les hormones peptidiques, glycopro-
téiniques, les substances mimétiques
et analogues
Depuis deux décennies, l’utilisation des
hormones peptidiques a engendré une
course au dopage effrénée ; elle est
maintenant relayée par l’utilisation des
thérapies cellulaires et des approches
géniques. La présence, dans l’urine
d’un sportif, d’une concentration anor-
male d'une hormone endogène ou de
son (ses) marqueur(s) diagnostique(s)
constitue une infraction, à moins qu’il
ne soit établi de façon concluante
qu’elle n’est due qu’à une condition
physiologique ou pathologique.

191
Mise au point
Mise au point
Gonadotrophine chorionique humaine
(hCG), corticotrophine (ACTH),
insuline et hormone de croissance
(hGH)
Parmi les hormones peptidiques les
premières utilisées, avec plus ou moins
de succès, figurait l’hCG, qui stimule la
production de testostérone par les testi-
cules. Son action est, ainsi, indirecte-
ment anabolisante. Des effets toxiques
sur la fonction hépatique et le système
reproducteur ont été signalés à la suite
de l’usage de ces substances. L’ACTH,
l’insuline qui est autorisée uniquement
pour traiter les diabètes insulino-dépen-
dants et l’hGH ou somatotrophine
étaient aussi employées.
Cette dernière est une hormone poly-
peptidique se composant de 191 acides
aminés. Chez l'homme, elle est synthé-
tisée par l’hypophyse sous le contrôle
de plusieurs autres facteurs (GH-RH,
somatostatine), elle peut être également
libérée dans certaines conditions de
stimulation, comme par exemple l’en-
traînement, le sommeil, le stress, l’hy-
poglycémie. Il est important de noter
que l’hGH ainsi libérée n’a pas d’action
propre. Cette hormone, qui intervient
dans la régulation des métabolismes du
glucose, des acides aminés et des acides
gras, stimule la différenciation des
cellules cartilagineuses (chondrocytes)
et adipeuses (adipocytes). En associa-
tion avec d’autres facteurs (IGF-1 ou
Insulin like growth factor), l’hGH
contrôle la croissance osseuse.
Quels effets recherchés ? L’hGH est
utilisée en vue d’augmenter notable-
ment, sinon le volume, du moins la
puissance musculaire, en compensant
des troubles du métabolisme du glucose
liés à l’effort et en facilitant l’incorpo-
ration et l’utilisation cellulaire des
acides aminés (action anabolisante).
L’injection d’hormones de croissance
est également associée à la prise de
stéroïdes anabolisants. Cette synergie
permet de réduire les doses de hGH,
rendant la détection plus difficile tout
en augmentant les effets.
Quels effets délétères ? L’usage abusif
de cette hormone entraîne principale-
ment des dysharmonies dans le
processus de remodelage du tissu
osseux, au niveau du squelette de la
face en particulier, impliquant la
destruction et la reconstruction
continue de la matrice intra-osseuse.
Par ailleurs, elle induit acromégalie,
diabète, hypertrophie du muscle
cardiaque, hypertension, hypo-activité
de la glande thyroïde, croissance du
foie ou des reins, hypoglycémie, voire
mort prématurée.
Enfin, tous les facteurs de libération
respectifs des hormones peptidiques et
leurs analogues sont également interdits.
Les transporteurs d’oxygène
Quelle définition ? Substances ayant
pour effet d'accroître le volume d'oxy-
gène dans l'organisme principalement
aux niveaux musculaire, cardiaque et
pulmonaire.
Quelles molécules ?
◗ L’érythropoiétine (EPO) naturelle et
synthétique.
L’EPO physiologique appartient à la
famille des cytokines, c’est une
hormone peptidique de glycoprotéine,
longue de 166 acides aminés, où sont
enchaînés acides aminés et sucres ;
enchaînements que l’on appelle
“chaînes glycosylées”. Elle est produite
au niveau des cellules de l’endothélium
péritubulaire du cortex rénal et véhi-
culée par voie sanguine vers les cellules
cibles de la lignée érythrocytaire. Elle
accélère et augmente la production de
globules rouges via les cellules souches
totipotentes de la moelle osseuse. La
production rénale d’EPO est régulée
par la concentration tissulaire en
oxygène (PO2). Elle existe à l’état
circulant sous plusieurs isoformes, une
vingtaine environ, qui diffèrent par
leurs pourcentages de glycosylation. La
demi-vie de la molécule endogène est
de l’ordre de 5 à 6 heures. Le taux
sérique moyen d’EPO endogène chez
un sujet adulte sain est voisin de 10 à
20 mUI/ml.
Il existe une EPO humaine de synthèse
(EPO humaine recombinante), fabri-
quée par les méthodes du génie géné-
tique. L’EPO recombinante est très
difficile à caractériser par rapport à
l’EPO endogène, les différences éven-
tuelles ne portant que sur la partie
variable, les oligosaccharides de cette
dernière. La durée de vie de l’EPO
recombinante est trois fois supérieure à
celle de l’EPO naturelle.
Quels effets recherchés ? L’EPO de
synthèse est apparue au début des
années 80 et fut utilisée, à l’origine,
pour traiter les cas d’insuffisance rénale
chronique des dialysés, les nouveau-nés
prématurés, les divers types d’anémie,
chez des malades cancéreux et/ou
atteints du sida, ou en préalable à
certaines interventions chirurgicales
lourdes ; elle est administrée aux
patients en injections intraveineuses ou
sous-cutanées.
Elle est détournée de son objectif théra-
peutique et utilisée comme produit
dopant essentiellement dans le but
d’améliorer l’aptitude maximale de
l’organisme à consommer de l’oxygène
(VO2max) dans le cadre, en particulier,
de la pratique des disciplines d’endu-
rance (cyclisme, athlétisme de fond,
natation, ski de fond, etc.) et dans
d’autres disciplines, comme l’haltéro-
philie.
L’effet recherché est donc la possibilité
d’augmenter la durée des entraînements
et de supporter la multiplication des
compétitions en repoussant dans le
temps la sensation de fatigue tout en
diminuant les temps de récupération.
l’EPO est censée se substituer ainsi à
des méthodes particulières de prépara-
tion, comme l’entraînement en altitude
et les séjours dans des caissons hyper-
bares.
Quels effets délétères ? Du fait qu’elle
épaissit le sang, l’EPO peut provoquer
la formation de caillots et créer ainsi
des accidents vasculaires cérébraux,
des infarctus ou des embolies pulmo-
naires, déclenchant à long terme des
maladies auto-immunes, de l’hyperten-
sion artérielle et un cancer de la moelle
osseuse. La transpiration excessive
augmente encore le danger de forma-
tion de caillots sanguins.
◗ Les facteurs de croissance hémato-
poïétiques (FCH).
Quelle définition ? Les FCH sont un
ensemble de polypeptides de petite
Act. Méd. Int. - Psychiatrie (19) n° 7, septembre 2002

192
Mise au point
Mise au point
taille moléculaire dont les fonctions
consistent, dans le cas présent, à
pouvoir transformer la réaction héma-
poïétique.
Quelles molécules ? Il existe deux
types de FCH : les cytokines qui agis-
sent sur toutes les lignées de cellules
sanguines fabriquées à partir de la
cellule souche et dont font partie l’in-
terkeuline-3 (IL-3) et le stem cell factor
(SCF), ainsi que des facteurs plus
spécifiques, dont l’action ne concerne
qu’une seule ou plusieurs lignées,
comme l’EPO pour celle des hématies
ou le GM-CSF pour celles des
plaquettes, des macrophages, des poly-
nucléaires neutrophiles et également
des hématies.
On peut qualifier les cytokines d’héma-
topoïétiques. La plus connue est l’IL-3,
qui est une glycoprotéïne longue de
133 acides aminés, plus courte donc
que l’EPO (166) ou l’hormone de crois-
sance (191) et dont le gène est localisé
sur le chromosome 5.
Quels effets recherchés ? L’IL-3 agit
par l’intermédiaire de récepteurs spéci-
fiques à différents endroits des chaînes
de fabrication de cellules sanguines et
souvent en liaison avec d’autres molé-
cules. Pour les globules rouges, elle
remplit un rôle similaire à celui de
l’EPO, qui stimule les transformations
des cellules souches totipotentes en
hématies.
Les premiers résultats obtenus avec
l’IL-3 ont paru peu prometteurs à côté
de ceux obtenus avec l’EPO.
Rapidement, l’expérience a montré que
l’efficacité de cette molécule dépendait
de l’administration conjointe d’autres
substances, comme par exemple le GM-
CSF ou l’EPO elle-même. Des molé-
cules hybrides telle l’IL-3/EPO, furent
mises au point dans le but d’accroître le
transport d’oxygène et donc d’amé-
liorer l’endurance.
Quels effets délétères ? Toutefois, de
graves problèmes de tolérance ont été
identifiés. L’IL-3 provoque principale-
ment des effets indésirables sous la
forme de syndrome grippal qui se
manifeste assez rapidement après l’in-
jection, avec fièvre, frissons, maux de
tête et douleurs généralisées au niveau
des articulations et des muscles. Une
diminution rapide du nombre de
plaquettes, susceptible d’entraîner des
hémorragies sévères, a également été
observée, ainsi qu’une augmentation
parfois brutale de la viscosité sanguine,
responsable de thromboses veineuses.
Tous ces effets secondaires immédiats
sont, semble-t-il, dose-dépendants. En
revanche, on ne dispose pas, ou peu, à
l’heure actuelle, de données à long
terme.
◗ Le NESP (Novel Erythropoiesis
Stimulating System).
Le NESP est constitué de darbepoetin
alpha, une hormone peptidique.
Complexe proche de l’EPO, la darbe-
poetin alpha comprend deux chaînes
d’hydrate de carbone supplémentaires.
Le NESP génère les mêmes effets que
l’EPO, la production de globules
rouges se trouve stimulée, l’élimination
de l’acide lactique est améliorée et il
semble qu’il y ait peu d’effets indési-
rables en l’état actuel des connaissances
scientifiques. Sa durée d’action est
beaucoup plus longue que celle de
l’EPO. Après une injection sous-
cutanée, les effets peuvent être présents
pendant environ 40 à 60 heures.
◗Substituts sanguins ou “sang artificiel”.
Les effets attendus de ces produits
seraient comparables à ceux de l’EPO.
Ils sont, pour certains, encore en cours
d’essais cliniques et pour d’autres, ils
sont déjà détournés à des fins de
dopage ; c’est le cas de l’hémoglobine
réticulée et des perfluorocarbones
(PFC) ou perflubro, du DIACL-HB, etc.
L’hémoglobine réticulée est constituée
par un support macromoléculaire associé
à la partie active des molécules d’hé-
moglobine naturelle qui lui permet
d’assurer des transports d’oxygène.
Les PFC sont des molécules de
synthèse complexes et capables de fixer
l’oxygène au niveau de leurs longues
chaînes carbonées. Elles ont la
propriété de dissoudre des quantités
importantes de gaz – jusqu'aux deux
tiers de leur volume – comme l’oxy-
gène, le gaz carbonique, l’azote, etc.
Ces molécules, qui sont utilisées sous
forme d’émulsions, transportent direc-
tement l’oxygène, sans passer par la
voie des globules rouges. Elles agissent
différemment des globules rouges, dans
la mesure où l’hémoglobine forme une
liaison spécifique avec les gaz, alors
que les PFC agissent par un phénomène
physique passif de simple diffusion.
Ces produits sont destinés à un usage
hospitalier, pour les grands brûlés, par
exemple.
Quels effets délétères ? Les essais
cliniques effectués indiquent qu’on doit
redouter des problèmes cardiaques, des
nécroses rénales et hépatiques, ou
encore des pancréatites. Enfin, compte
tenu de la façon particulière dont ils
assurent les échanges gazeux et de leur
instabilité, la réalité de leur efficacité
comme produit dopant est loin d’être
avérée. Il ne faut pas non plus oublier
que les méthodes correspondant à un
“dopage sanguin”, même si on manque
de preuves scientifiques, risquent de
perturber gravement, et peut-être dura-
blement, les mécanismes naturels de
compensation.
Substances soumises à certaines
restrictions
L’alcool
Certaines fédérations sportives interdi-
sent la consommation d'alcool et procè-
dent à des contrôles pour l’éthanol.
Les cannabinoïdes
Certaines fédérations procèdent égale-
ment à des dépistages des cannabinoïdes
(carboxy-THC : tétrahydro-cannabinol et
ses dérivés) et molécules apparentées.
Aux Jeux olympiques, des tests sont
maintenant effectués pour les cannabi-
noïdes. Une concentration dans l’urine
de carboxy-THC supérieure à 15 ng/ml
est interdite.
L’injection d’anesthésiques locaux
Seule l’injection locale et intra-articu-
laire d’anesthésiques locaux courants
(la bupivacaïne, la lidocaïne, la mépiva-
caïne, la procaïne, etc.), à l’exception
de la cocaïne, est autorisée lorsqu’elle
est médicalement justifiée. Lors des
compétitions, avant ou immédiatement
 6
6
1
/
6
100%