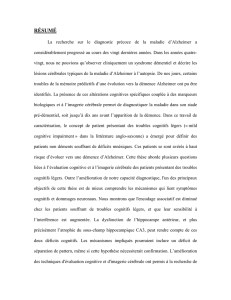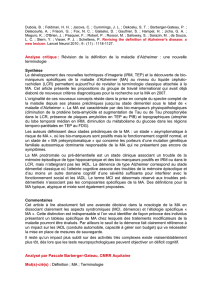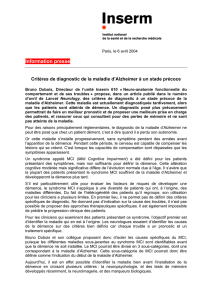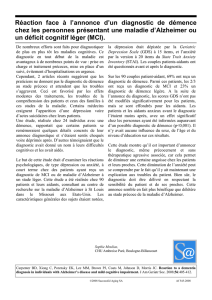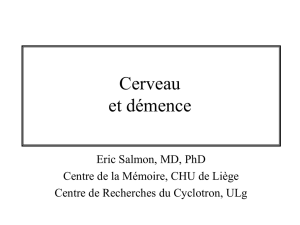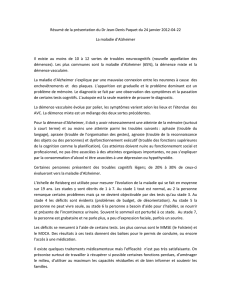L Mild ou trouble cognitif léger ? Cognitive Impairment

274 | La Lettre du Neurologue • Vol. XV - n° 8 - octobre 2011
MISE AU POINT
Que reste-t-il du Mild
Cognitive Impairment
ou trouble cognitif léger ?
The Mild Cognitive Impairment: what else?
P. Krolak-Salmon*
* Centre de mémoire, de ressource et
de recherche de Lyon.
L
e concept de trouble cognitif léger (TCL), ou Mild
Cognitive Impairment (MCI), s’est développé à la
n des années 1990 grâce à R. Petersen, qui l’a
déni comme l’association d’une plainte mnésique
corroborée par l’entourage et d’une altération
objective de la mémoire, sans retentissement sur
l’autonomie et les activités de la vie quotidienne (1).
Ce concept, qui dénit davantage un stade évolutif
qu’une pathologie à part entière, s’est ensuite étendu
à d’autres secteurs cognitifs, pour même intégrer
la possibilité d’une perte minime d’autonomie (2).
Un concept pour un stade
évolutif de multiples maladies
Ce trouble cognitif léger pouvait être attribué à
différentes pathologies : la maladie d’Alzheimer,
principalement, et d’autres affections neuro-
dégénératives, neurovasculaires ou psychia-
triques. Le développement du concept de MCI a
permis de mettre l’accent sur les stades les plus
légers de la maladie d’Alzheimer et même des
maladies apparentées. Selon une étude récente,
près de 26 % des patients souffrant d’une maladie
de Parkinson présenteraient les critères diagnos-
tiques de MCI, avec décit mnésique, altération
des performances visuo-spatiales, des fonctions
exécutives et des capacités attentionnelles (3). Le
concept de Vascular Cognitive Impairment (VCI)
se dénit par une altération cognitive en lien avec
des lésions vasculaires très hétérogènes comme des
lacunes, une leucoaraïose et même des accidents
vasculaires de localisation stratégique, n’altérant pas
les activités de la vie quotidienne (4). Ce concept
présente un intérêt particulier pour établir les
difcultés cognitives des patients avec encéphalo-
pathie vasculaire sans démence mais présentant un
trouble cognitif léger, communiquer sur l’impor-
tance de la prévention secondaire des facteurs de
risque cardiovasculaire, et favorise certainement
la prévention de la démence vasculaire et même
de l’expression clinique de la maladie d’Alzheimer
à composante cérébrovasculaire. Il a récemment
été montré que 40 % des sujets à risque génétique
de maladie de Huntington réunissaient les critères
diagnostiques de MCI, plutôt de type non amnésique,
marqués par un ralentissement de la vitesse de
traitement de l’information et une dégradation
des fonctions exécutives (5). Cet exemple illustre
l’intérêt de décliner le concept de MCI à l’ensemble
des pathologies induisant une altération cognitive
progressive, an de mieux comprendre les stades
précoces et les facteurs prédictifs de conversion
vers le handicap cognitif plus sévère, et d’enrichir
la prise en charge dès les premiers signes annonçant
cette conversion, avant d’envisager des traitements
étiopatho géniques, qui ne pourront être réellement
efcaces qu’à ces stades précoces.
Mettre l’accent sur les stades
précoces de la maladie
d’Alzheimer
Mais c’est dans le cadre des consultations pour décit
mnésique et de la suspicion de maladie d’Alzheimer
que la popularité du concept de MCI s’est considéra-
blement développée depuis les années 2000, 90 %
LN8-2011.indd 274 19/10/11 12:36

La Lettre du Neurologue • Vol. XV - n° 8 - octobre 2011 | 275
Points forts
»Le syndrome MCI reflète un stade évolutif d’une dégradation cognitive progressive.
»Ce syndrome peut être dû à plusieurs processus lésionnels neurodégénératifs ou neurovasculaires.
»La maladie d’Alzheimer peut être diagnostiquée au stade MCI.
Mots-clés
Trouble cognitif léger
MCI
Maladie d’Alzheimer
Biomarqueurs
Critères diagnostiques
Highlights
»
The MCI syndrome depicts a
course stage of a progressive
cognitive impairment.
»
This syndrome can be related
to different neurodegenerative
or neurovascular disorders.
»
Alzheimer’s disease can be
diagnosed at the MCI stage.
Keywords
Mild cognitive impairment
MCI
Alzheimer’s disease
Biomarkers
Diagnosis criteria
des neurologues américains l’utilisant pour coter
leurs consultations (6). Ce concept a indéniablement
renforcé la prise en considération des patients avant
le stade de la démence, la possibilité de mettre en
place des mesures non médicamenteuses comme
des aides à domicile, un suivi clinique, une démarche
de prévention secondaire concernant notamment
les facteurs de risque cardiovasculaire chez ces
patients qui entrent dans la lière des soins. Les
médecins américains signalent que, lorsqu’ils posent
le diagnostic de MCI, ils conseillent des mesures
hygiénodiététiques, l’exercice physique (78 % des
médecins) et les stimulations cognitives (75 %), et
ils informent le patient sur le risque de démence
(63 %) [6]. Pour ces spécialistes, ce concept est
important pour organiser l’avenir du patient (87 %)
et les aides nancières (72 %), mais ils regrettent un
diagnostic difcile selon les critères actuels (23 %)
en soulignant le fait qu’il serait plus utile parfois
d’évoquer une maladie d’Alzheimer précoce (21 %).
Le concept de MCI est assez ou : le retour à un
statut cognitif normal est fréquent (7). Mais cette
dénition du MCI permet également de conrmer
un trouble au patient sans annoncer trop tôt le
diagnostic d’une pathologie incurable. Les actions
médicosociales menées à ce stade du MCI sont
déterminantes, car, si l’on pouvait retarder de
5 ans le stade démentiel de la maladie d’Alzheimer,
l’impact médico-économique de la maladie serait
réduit de moitié (Cummings, 2007).
Les limites du concept de MCI
Les limites du concept de MCI sont apparues secon-
dairement lorsque l’évolution des patients affectés
fut précisée par le suivi de cohortes. En effet, si
10 à 15 % des patients évoluaient annuellement
vers le stade démentiel de la maladie d’Alzheimer,
le concept tel qu’il était déni par R. Petersen ne
permettait pas d’anticiper plus précisément ce risque
de conversion, même si la maladie d’Alzheimer était
particulièrement liée au MCI de type amnésique,
mais compatible avec le MCI autre domaine et
même le MCI multidomaine, ces 2 derniers sous-
types pouvant notamment donner lieu à une
démence frontotemporale, une démence à corps
de Lewy ou une démence vasculaire. Le concept de
MCI n’intègre pas la qualité du trouble mnésique
(encodage, stockage et consolidation, récupération),
les données d’imagerie encéphalique ni la biologie.
Ainsi, son utilisation dans des essais thérapeutiques
au stade précoce de la maladie d’Alzheimer a conduit
à un échec, vraisemblablement du fait de l’hétéro-
généité des pathologies sous-jacentes (8, 9). Si les
inhibiteurs de l’acétylcholinestérase n’ont pas pu
montrer leur efcacité dans un groupe de patients
recrutés selon les critères diagnostiques du MCI, on
ne peut envisager de tester sur ce groupe hétérogène
les molécules visant les mécanismes intimes de
la maladie d’Alzheimer, en particulier la protéine
amyloïde et la protéine tau. Pour ces molécules de
type disease-modifyer, il est indispensable de poser
le diagnostic de maladie d’Alzheimer. Il apparaît
donc nécessaire de distinguer la question des stades
évolutifs (MCI et démence) de celle des pathologies
sous-jacentes.
Maladie d’Alzheimer :
un continuum de lésions
et de stades cliniques
De longs suivis de cohortes ont permis de mettre
en évidence un déclin cognitif précédant de plus
de 10 ans la maladie d’Alzheimer clinique, en parti-
culier les tests explorant la mémoire sémantique,
plusieurs années avant un affaiblissement cognitif
global (Amieva, 2008), la plainte mnésique et les
symptômes dépressifs (7 ans avant le diagnostic),
puis une dégradation fonctionnelle survenant 5 ans
avant le diagnostic.
Ce type d’approche met l’accent sur la durée de la
phase préclinique de la maladie d’Alzheimer, phase
pendant laquelle les traitements étiopathogéniques
devraient être les plus efcaces. La littérature de
ces dernières années a ouvert le débat autour du
diagnostic prédémentiel. Le concept de maladie
d’Alzheimer “prodromale” a permis de réunir des
critères diagnostiques pour la recherche. Ces critères
sont principalement fondés sur le développement
d’un syndrome amnésique progressif de type hippo-
campique associé à l’un des biomarqueurs suggérant
LN8-2011.indd 275 19/10/11 12:36

Figure 1. TEP avec traceur amyloïde (PIB) chez un sujet témoin (A) et un sujet présentant un
MCI de type maladie d’Alzheimer prédémentielle (B) [D’après M. Formaglio, Cermep, Lyon].
A B
276 | La Lettre du Neurologue • Vol. XV - n° 8 - octobre 2011
Que reste-t-il du
Mild Cognitive Impairment
ou trouble cognitif léger ?
MISE AU POINT
un processus dégénératif de type Alzheimer, en parti-
culier l’atrophie hippocampique évaluée par l’IRM,
la diminution de la protéine Aβ et l’augmentation
de tau dans le liquide céphalorachidien (LCR), l’ima-
gerie métabolique (tomographie par émission de
positons [TEP] avec traceur amyloïde ou traceur
glucosé, tomographie par émission monophoto-
nique évaluant les débits sanguins cérébraux) [10].
Ces critères initialement dédiés à la sélection de
patients pour la recherche ont été récemment
adaptés à la clinique avec le développement des
concepts de maladie d’Alzheimer présymptoma-
tique (à considérer chez les patients à risque de
mutation génétique), de maladie d’Alzheimer prédé-
mentielle et démentielle (tableau I) [11]. Certains
tests neuropsychologiques permettent de dénir
un prol amnésique hippocampique et de prédire
avec une probabilité importante la conversion du
stade MCI vers le stade démentiel de la maladie
d’Alzheimer (12). Cependant, ce type de marqueur
neuropsychologique ne peut être pris en compte que
lorsque le patient ou son entourage signalent une
difculté de mémoire, puisque sa valeur diagnos-
tique prédictive semblerait bien moindre dans la
population générale (13). Par ailleurs, l’apport des
biomarqueurs explorant les processus lésionnels
précocement associés à la maladie d’Alzheimer
conrme que cette maladie peut débuter par un
MCI autre domaine ou multidomaine, et pas exclu-
sivement par un “MCI amnésique” (14).
La maladie commence
longtemps avant la démence
Les biomarqueurs relevant de l’imagerie ou de la
biologie présentent des chiffres de sensibilité et de
spécicité dépassant 85 à 90 % s’ils sont évalués
au regard de la neuropathologie (15). Ils ont permis
d’étayer la réflexion diagnostique étiologique
précoce. La conjonction d’une augmentation de la
protéine tau/phospho-tau et de la diminution de
la protéine Aβ signe, in vivo, une accumulation de
lésions caractéristiques de la maladie d’Alzheimer,
le risque de conversion du stade MCI vers le stade
démentiel à 5 ans pouvant être multiplié par 18 (16).
Les variations du taux de protéine Aβ dans le LCR
interviendraient très tôt dans le cours évolutif de la
maladie, alors que la cascade amyloïde commence
bien avant les signes cliniques (17). Les variations du
taux de protéine tau interviendraient ensuite, alors
que les dégénérescences neurobrillaires s’accu-
mulent en masse.
L’imagerie métabolique, en particulier la TEP utilisant
des traceurs amyloïdes (qui sont carbonés dans
un premier temps, ce qui nécessite un cyclotron
à proximité, mais qui seront certainement uorés
dans un avenir proche et donc accessibles dans tous
les centres de médecine nucléaire), a montré une
très grande sensibilité dès le stade MCI de la maladie
d’Alzheimer (figure 1) [18]. Ce type d’approche a
permis de constater l’ampleur des dépôts amyloïdes,
alors que la dégradation cognitive est encore extrê-
mement modeste. Même les sujets témoins consi-
dérés comme sains mais montrant un résultat positif
en TEP avec traceur amyloïde présentent un surrisque
de souffrir d'une maladie d’Alzheimer clinique dans
les quelques années suivant l’examen (19).
Alors que les marqueurs explorant l’accumulation
de protéine Aβ dans le LCR ou en imagerie sont
sensibles extrêmement tôt – certainement des
années avant les symptômes –, les mesures de
Tableau I. Le MCI au regard des nouveaux critères diagnostiques proposés pour la maladie
d’Alzheimer.
Le diagnostic de maladie d’Alzheimer prodromale ne peut être posé que si les symptômes cliniques
sont évocateurs et que les biomarqueurs sont concordants. Si les biomarqueurs sont positifs mais
la clinique non évocatrice, il n’est pas sûr que les symptômes soient en lien avec des lésions de
type Alzheimer : ils pourraient être révélateurs de lésions qui s’accumulent mais qui ne donnent
pas encore lieu à des symptômes. Si la clinique est évocatrice, mais les biomarqueurs négatifs,
il n’est pas raisonnable de porter le diagnostic de maladie d’Alzheimer.
Symptômes spécifiques
de MA
Symptômes non spécifiques
de MA
Biomarqueurspositifs MA prodromale MCI
Biomarqueurs négatifs
ou non réalisés
MCI MCI
LN8-2011.indd 276 19/10/11 12:36

Figure 2. Variations des biomarqueurs et signes cliniques au cours de la maladie d’Alzheimer
depuis les stades précliniques au stade de la démence.
Normal Pas d’altération cognitive MCI Démence
Anormal
Aβ
Dysfonctions et lésions neuronales
liées à la pathologie “Tau”
Anatomie cérébrale
structurale
Mémoire
Signes cliniques
fonctionnels
Variations des marqueurs cliniques
et paracliniques
Stade clinique
La Lettre du Neurologue • Vol. XV - n° 8 - octobre 2011 | 277
MISE AU POINT
l’atrophie cérébrale, en particulier hippocampique,
pourraient être sensibles et spéciques, mais en aval,
illustrant les conséquences neuronales de la cascade
amyloïde et de l’accumulation de dégénérescences
neurobrillaires. Il en va de même pour les variations
métaboliques de la consommation de glucose en TEP
(figure 2). Ces variations métaboliques, illustrant
les conséquences cérébrales fonctionnelles, inter-
viendraient juste avant les dégradations cognitivo-
comportementales et fonctionnelles signant le stade
de démence.
Diagnostiquer le plus tôt
possible ou diagnostiquer
la conversion imminente
vers la démence ?
Application aux essais
thérapeutiques
La combinaison de marqueurs cliniques, biologiques
et radiologiques est intéressante pour prédire la
conversion du stade MCI vers le stade démentiel (20).
Des marqueurs plus précoces des lésions, comme
la protéine Aβ dans le LCR, seraient moins utiles
pour prédire la conversion à court et moyen terme
mais permettrait plutôt de prédire la sévérité
du déclin cognitif à plus long terme. D’autres
marqueurs seraient plus sensibles pour évaluer le
risque de conversion imminente du stade MCI vers
le stade démentiel. Ainsi, les fonctions exécutives
déclineraient rapidement juste avant la conversion
clinique du stade MCI vers le stade démentiel (20).
La combinaison d’une altération du rappel verbal
libre et de la TEP au FDG serait très intéressante pour
prédire la conversion du MCI vers la démence de type
Alzheimer dans les 2 ans (21). D’autres paramètres
neuroradiologiques, en particulier issus de l’IRM,
seraient importants à prendre en considération pour
évaluer le risque à moyen terme de conversion du
stade cognitif léger vers la démence, et plus particu-
lièrement les hypersignaux de la substance blanche
dans les régions frontopariétales et sous-corticales
d’origine vasculaire associés à un déclin des fonctions
exécutives (22).
Conclusion
Ainsi, il convient de poursuivre l’étude de la place
des biomarqueurs dans l’évolution de la maladie
d’Alzheimer, depuis les stades présymptomatiques
du MCI, et surtout d’évaluer leur valeur prédictive
de conversion à court ou moyen terme. Une
recherche multimodale, clinique, neuropsycholo-
gique, biologique et neuroradiologique doit être
menée dans le cadre de cette réexion importante
pour la construction des essais thérapeutiques. En
effet, l’utilisation de biomarqueurs qui ne seraient
pertinents que lorsque l’évolution vers un stade
démentiel est encore lointaine, pourrait poser des
problèmes éthiques au regard de l’espérance de vie
des personnes âgées. La positivité des biomarqueurs
ciblant la protéine Aβ ne permettrait pas de prédire,
dans cette population, la conversion clinique vers
le handicap cognitif et comportemental dans un
délai raisonnable.
Il convient donc d’apprécier qualitativement les
marqueurs signant une conversion rapide, comme,
par exemple, la neuropsychologie, les variations du
taux de protéine tau, la consommation de glucose
en imagerie.
Cette évolution récente des concepts a permis
d’aboutir à des critères diagnostiques internationaux
pour le MCI dû à une maladie d’Alzheimer (23), en
parallèle des nouveaux critères diagnostiques de
la maladie d’Alzheimer (24). Ces critères sont de
2 types.
Les critères cliniques sont les suivants :
➤
changement récent du statut cognitif du patient ;
➤
altération significative d’un ou de plusieurs
domaines cognitifs ;
➤
absence de retentissement signicatif sur la vie
professionnelle ou domestique ;
➤absence de démence.
LN8-2011.indd 277 19/10/11 12:36

278 | La Lettre du Neurologue • Vol. XV - n° 8 - octobre 2011
Que reste-t-il du
Mild Cognitive Impairment
ou trouble cognitif léger ?
MISE AU POINT
1. Petersen RC, Smith GE, Waring SC et al. Mild cognitive
impairment: clinical characterization and outcome. Arch
Neurol 1999;56(3):303-8.
2. Portet F, Ousset PJ, Visser PJ et al. Mild cognitive impair-
ment (MCI) in medical practice: a critical review of the
concept and new diagnostic procedure. Report of the MCI
Working Group of the European Consortium on Alzheimer's
Disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006;77(6):714-8.
3. Aarsland D, Bronnick K, Williams-Gray C et al. Mild cogni-
tive impairment in Parkinson disease: a multicenter pooled
analysis. Neurology 2010;75(12):1062-9.
4. Román GC, Sachdev P, Royall DR et al. Vascular cogni-
tive disorder: a new diagnostic category updating vascular
cognitive impairment and vascular dementia. J Neurol Sci
2004;226(1-2):81-7.
5. Duff K, Paulsen J, Mills J et al. Mild cognitive impair-
ment in prediagnosed Huntington disease. Neurology
2010;75(6):500-7.
6. Roberts JS, Karlawish JH, Uhlmann WR et al. Mild cognitive
impairment in clinical care: a survey of American Academy
of Neurology members. Neurology 2010;75(5):425-31.
7. Ritchie K, Artero S, Touchon J. Classification criteria for
mild cognitive impairment: a population-based validation
study. Neurology 2001;56(1):37-42.
8. Grundman M, Petersen RC, Ferris SH et al. Mild cogni-
tive impairment can be distinguished from Alzheimer
disease and normal aging for clinical trials. Arch Neurol
2004;61(1):59-66.
9. Petersen RC, Thomas RG, Grundman M et al. Vitamin E and
donepezil for the treatment of mild cognitive impairment.
N Engl J Med 2005;352(23):2379-88.
10. Dubois B, Feldman HH, Jacova C et al. Research
criteria for the diagnosis of Alzheimer's disease: revising
the NINCDS-ADRDA criteria. Lancet Neurol 2007;6(8):
734-46.
11. Dubois B, Feldman HH, Jacova C et al. Revising the defi-
nition of Alzheimer's disease: a new lexicon. Lancet Neurol
2010;9(11):1118-27.
12. Sarazin M, Berr C, De Rotrou J et al. Amnestic syndrome
of the medial temporal type identifies prodromal AD: a longi-
tudinal study. Neurology 2007;69(19):1859-67.
13. Auriacombe S, Helmer C, Amieva H et al. Validity
of the free and cued selective reminding test in predic-
ting dementia: the 3C study. Neurology 2010;74(22):
1760-7.
14. Visser PJ, Verhey F, Knol DL et al. Prevalence and
prognostic value of CSF markers of Alzheimer's disease
pathology in patients with subjective cognitive impair-
ment or mild cognitive impairment in the DESCRIPA study:
a prospective cohort study. Lancet Neurol 2009;8(7):
619-27.
15. Tapiola T, Alafuzoff I, Herukka SK et al. Cerebro-
spinal fluid β-amyloid 42 and tau proteins as biomarkers
of Alzheimer-type pathologic changes in the brain. Arch
Neurol 2009;66(3):382-9.
16. Hansson O, Zetterberg H, Buchhave P et al. Association
between CSF biomarkers and incipient Alzheimer's disease
in patients with mild cognitive impairment: a follow-up
study. Lancet Neurol 2006;5(3):228-34.
17. Jack CR, Knopman DS, Jagust WJ et al. Hypothetical
model of dynamic biomarkers of the Alzheimer's patholo-
gical cascade. Lancet Neurol 2010;9(1):119-28.
18. Jack CR, Lowe VJ, Senjem ML et al. 11C PiB and struc-
tural MRI provide complementary information in imaging of
Alzheimer's disease and amnestic mild cognitive impairment.
Brain 2008;131(Pt 3):665-80.
19. Morris JC, Roe CM, Grant EA et al. Pittsburgh compound
B imaging and prediction of progression from cognitive
normality to symptomatic Alzheimer disease. Arch Neurol
2009;66(12):1469-75.
20. Ewers M, Walsh C, Trojanowski JQ et al. Prediction of
conversion from mild cognitive impairment to Alzheimer's
disease dementia based upon biomarkers and neuropsycho-
logical test performance. Neurobiol Aging. (À paraître.)
21. Landau SM, Harvey D, Madison CM et al. Comparing
predictors of conversion and decline in mild cognitive
impairment. Neurology 2010;75(3):230-8.
22. Jacobs HI, Visser PJ, Van Boxtel MP et al. The associa-
tion between white matter hyperintensities and executive
decline in mild cognitive impairment is network dependent.
Neurobiol Aging. (À paraître.)
23. Albert MS, DeKosky ST, Dickson D et al. The diagnosis
of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease:
recommendations from the National Institute on Aging-
Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guide-
lines for Alzheimer's disease. Alzheimers Dement 2011;7(3):
270-9.
24. McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H et al. The
diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recom-
mendations from the National Institute on Aging-Alzhei-
mer's Association workgroups on diagnostic guidelines
for Alzheimer's disease. Alzheimers Dement 2011;7(3):
263-9.
Références bibliographiques
Même si l’amnésie épisodique est le symptôme le
plus évocateur de maladie d’Alzheimer à ce stade,
il est reconnu que des symptômes atypiques tels
des troubles visuels, des troubles de la communi-
cation verbale et même des troubles comporte-
mentaux peuvent être les premiers symptômes de
la maladie. Pour évoquer une maladie d’Alzheimer
au stade du MCI, il est nécessaire d’écarter autant
que possible une encéphalopathie vasculaire, une
maladie à corps de Lewy et une dégénérescence
lobaire fronto temporale. La coexistence de plusieurs
pathologies doit être envisagée, en particulier chez
la personne âgée.
Les critères pour la recherche, y compris les essais
thérapeutiques, intègrent les biomarqueurs illus-
trant les dépôts d’Aβ (Aβ
1-42
dans le LCR et TEP
avec traceurs amyloïdes) ainsi que les marqueurs
de dysfonctionnement ou de lyse neuronale (tau et
phospho-tau dans le LCR, atrophie médiotemporale
dans le LCR, TEP au FDG, SPECT). Différents degrés
de probabilité diagnostique d’un MCI lié à la maladie
d’Alzheimer sont proposés selon la cohérence des
données cliniques et des biomarqueurs (tableau II).
Le concept de MCI pourrait gurer prochainement
dans le DSM-V. S'il apparaît très utile pour intégrer le
patient dans le système de soins le plus tôt possible,
il semble essentiel de mettre en œuvre une démarche
diagnostique optimale pour poser un diagnostic
étiologique précis. Mais il faudra certainement
manipuler avec précaution les informations multiples
issues de la clinique et des biomarqueurs avant de
préciser l’annonce diagnostique et d’indiquer des
traitements peut-être lourds, en précisant au mieux
le risque de conversion vers le stade démentiel à
court, moyen et long terme. ■
Tableau II. Critères de MCI incluant la clinique et les biomarqueurs (2).
Probabilité diagnostique -
MCI par MA
Dépôts d’Aβ
(LCR ou TEP)
Lésions neuronales
(atrophie IRM, FDG TEP, tau LCR)
Haute probabilité positif positif
Probabilité intermédiaire positif
non testé
non testé
positif
Probabilité faible négatif négatif
L’interféron bêta 1-b de Novartis
Garder le rythme de sa vie
Médicament d’exception. Prescription en conformité
avec la fi che d’information thérapeutique
Extavia 250μg/ml poudre et solvant pour solution injectable (interféron bêta-1b recombinant) Poudre (interféron bêta-1b recombinant 250μg par ml de solution reconstituée) et solvant pour solution injectable: boîte de 15fl acons
de poudre et 15seringues préremplies de solvant. Indications thérapeutiques: Extavia est indiqué dans le traitement - Des patients ayant présenté un seul événement démyélinisant, accompagné d’un processus infl ammatoire actif,
s’il est suffi samment sévère pour nécessiter un traitement par corticostéroïdes par voie intraveineuse, si les diagnostics différentiels possibles ont été exclus et si ces patients sont considérés à haut risque de développer une sclérose
en plaques cliniquement défi nie (cf. Propriétés pharmacodynamiques). - Des patients atteints de la forme rémittente-récurrente de sclérose en plaques avec au moins deux poussées au cours des deux dernières années. - Des patients
atteints de la forme secondairement progressive de sclérose en plaques, évoluant par poussées. Posologie et mode d’administration: Instauré sous contrôle de médecins spécialisés en neurologie. Adultes: Dose recommandée:
250μg contenus dans 1ml de la solution reconstituée, en SC tous les 2jours. Coût de traitement journalier: 27,58 €. Chez l’adolescent âgé de 12 à 16ans traité par 250μg/ml, en SC 1 jour sur 2, le profi l de sécurité est comparable
à celui observé chez l’adulte. Ne pas utiliser Extavia chez l’enfant de moins de 12ans. Pratiquer une augmentation progressive de dose au début du traitement. La dose initiale est de 62,5μg en SC tous les 2 jours; et pourra être
augmentée progressivement jusqu’à 250μg administrés tous les 2 jours. Si événement indésirable signifi catif, ajuster la période d’augmentation progressive de dose. Pour obtenir une effi cacité satisfaisante la dose de 250μg tous les
2 jours devra être atteinte. Contre-indications: - Initiation du traitement au cours de la grossesse. - Patient ayant des antécédents d’hypersensibilité à l’interféronß naturel ou recombinant, à l’albumine humaine, ou à l’un des excipients.
- Patient présentant une dépression sévère et/ou des idées suicidaires. -Décompensation d’une insuffi sance hépatique. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi: Syndrome de fuite capillaire avec symptomatologie de
type choc et issue fatale chez des patients porteurs d’une gammapathie monoclonale préexistante. Risque de pancréatite s’accompagnant souvent d’hypertriglycéridémie. Précaution chez les patients présentant ou ayant présenté des
troubles dépressifs, notamment si antécédents d’idées suicidaires. Les patients présentant une dépression doivent recevoir un traitement approprié et une surveillance attentive durant le traitement par Extavia. Arrêt d’Extavia si nécessaire.
Prudence en cas d’antécédents de troubles épileptiques, ou traitement anti-épileptiques, en particulier en cas d’épilepsie non contrôlée. Contient de l’albumine humaine et par conséquent risque potentiel de transmission de maladies
virales (MCJ). Bilan thyroïdien à réaliser, si antécédents ou signes cliniques de dysfonctionnement thyroïdien. Faire avant et après l’instauration du traitement puis périodiquement en l’absence de symptômes cliniques: numération
formule sanguine complète, formule leucocytaire et numération plaquettaire et des analyses de biochimie sanguine, notamment de la fonction hépatique. Suivi étroit si anémie, thrombocytopénie ou leucopénie (isolées ou associées
entre elles). Surveillance étroite en cas de neutropénie, rechercher fi èvre ou infection. Cas d’atteintes hépatiques graves, y compris des cas d’insuffi sance hépatique surtout si exposition à d’autres produits hépatotoxiques ou en cas
de co-morbidités. Surveillance étroite, si élévation des transaminases sériques. Interruption d’Extavia si les taux augmentent de façon signifi cative ou si symptômes tels jaunisse. Surveillance étroite et précaution en cas d’insuffi sance
rénale sévère. Prudence si troubles cardiaques pré-existants. Surveillance si insuffi sance cardiaque congestive, maladie coronarienne ou arythmie, pour éviter des aggravations en particulier lors de l’instauration du traitement. Les
symptômes du syndrome pseudo-grippal associé aux interférons bêta peuvent s’avérer éprouvants pour les patients atteints d’une pathologie cardiaque. Rares cas de cardiomyopathie. Si une relation avec l’utilisation d’Extavia est
suspectée, interrompre le traitement. Risque d’hypersensibilité. Si réactions sévères, interrompre le traitement. Risque de nécrose au point d’injection. Pour réduire les risques utiliser une technique d’injection aseptique, changer de
site d’injection et utiliser un autoinjecteur. Risque d’immunogénicité avec apparition d’anticorps neutralisants associée à une moindre effi cacité clinique. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions:
Aucune étude d’interaction n’a été réalisée. Lors des poussées, association à des corticoïdes ou à l’ACTH bien tolérée jusqu’à 28jours. Utilisation concomitante d’Extavia et d’immunomodulateurs autres que les corticostéroïdes
ou l’ACTH non recommandée. Prudence si administration simultanée à des médicaments ayant une marge thérapeutique étroite et dont la clairance dépend largement du système du cytochrome P450 (anti-épileptiques).
Prudence si association avec un médicament ayant une action sur le système hématopoïétique. Pas d’étude d’interactions avec les anti-convulsivants. Grossesse et allaitement: Grossesse: Extavia est contre-indiqué pendant la
grossesse. Utiliser des mesures de contraception appropriées. Allaitement: Choisir entre l’arrêt de l’allaitement et l’interruption du traitement. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Effets
indésirables: Fréquents au début du traitement, mais disparaissent généralement ensuite. Syndrome pseudo-grippal (fi èvre, frissons, arthralgie, malaise, sueurs, céphalées ou myalgie), réactions au site d’injection constituent
les réactions indésirables les plus fréquemment observées. Rougeur, gonfl ement, décoloration, infl ammation, douleur, hypersensibilité, nécrose et réactions non spécifi ques associées à un traitement par 250μg. Augmentation
progressive de la posologie afi n d’augmenter la tolérance. Les symptômes pseudo-grippaux peuvent également être réduits par les AINS. Diminution des réactions au point d’injection avec un autoinjecteur. L’ensemble des effets
indésirables rapportés à partir des rapports des études cliniques et des rapports de pharmacovigilance sont disponibles dans le résumé des caractéristiques complètes Extavia. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES: Propriétés
pharmacodynamiques : Classe pharmacothérapeutique: Interférons, code ATC: L03AB08 Liste I Médicament soumis à surveillance particulière pendant le traitement. Médicament soumis à prescription initiale et renouvellement
réservés aux spécialistes en neurologie. Extavia 250 μg/ml: EU/1/08/454/002 (2008, révisée le 25.03.2009); CIP 34009 386 554 5 2: boîte de 15 fl acons + 15 seringues préremplies Prix: 827,31 € Remboursement Séc. soc.
65 % selon la procédure des médicaments d’exception (prescription en conformité avec la Fiche d’Information Thérapeutique). Agréé collect. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: Novartis Europharm
Limited Horsham Royaume-Uni. Représentant local: Novartis Pharma S.A.S 2 et 4, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison Tél : 01.55.47.60.00 Information médicale : Tél : 01.55.47.66.00. idm.fr@novartis.com-
FMI088v5 - «Pour une information complète, consulter le texte intégral du résumé des caractéristiques du produit, soit sur le site internet de l’Afssaps si disponible, soit sur demande auprès du laboratoire.»
V7104 – Février 2011
• Patients ayant présenté un seul événement démyélinisant, accompa-
gné d’un processus infl ammatoire actif, s’il est suffi samment sévère
pour nécessiter un traitement par corticostéroïdes par voie IV, si les
diagnostics différentiels possibles ont été exclus et si ces patients sont
considérés à haut risque de développer une SEP cliniquement défi nie
• Patients atteints de la forme rémittente-récurrente de SEP avec au
moins 2poussées au cours des 2dernières années
• Patients atteints de la forme secondairement progressive de SEP,
évoluant par poussées
V7104 LettreNeuro 210x297.indd 1 17/02/11 14:56
LN8-2011.indd 278 19/10/11 12:36
1
/
5
100%