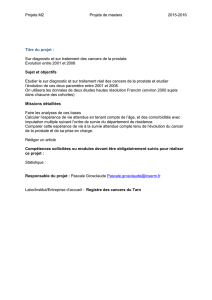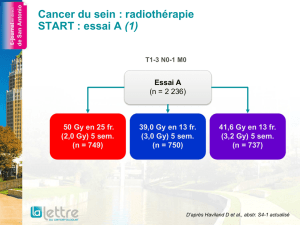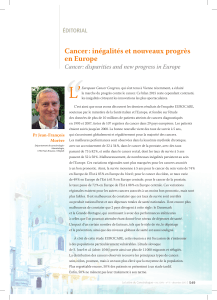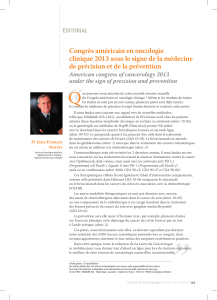Cancers de la prostate, du testicule et de la vessie DOSSIER THÉMATIQUE

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1975 19951991
1986 PSA
(pronostic)
1994 PSA
(screening)
Après 65 ans
198719831979 1999 2003 2007
Blancs Noirs
Cancers de la prostate
(nb de cas pour 1 000 hommes)
Cancers de la prostate
(nb de cas pour 1 000 hommes)
140
120
100
80
60
40
20
0
1975 19951991
1986 PSA
(pronostic)
1994 PSA
(screening)
Avant 65 ans
198719831979 1999 2003 2007
Figure 1. Incidence des cancers de la prostate aux États-Unis dans la population noire
et la population blanche (d’après Cooney KA et al., abstr. 4502 actualisé).
La Lettre du Cancérologue • Suppl. 4 au vol. XIX - n° 6 - juillet 2010 | 25
DOSSIER THÉMATIQUE
46e congrès américain
en oncologie clinique
Cancers de la prostate,
du testicule et de la vessie
Prostate, testicular and bladder cancers
P. Beuzeboc*
* Département d’oncologie médicale,
Institut Curie, Paris.
Cancer de la prostate
Épidémiologie des cancers du sujet
jeune, susceptibilité génétique
Les cancers survenant avant 56 ans représentent
10 % des cancers prostatiques. Leur incidence
augmente. Quand elle est diagnostiquée avant
50 ans, la maladie est plus agressive et le pronostic
est plus mauvais que lorsqu’elle touche les hommes
âgés de 50 à 74 ans. La survenue précoce est la
marque d’une susceptibilité génétique (Cooney KA
et al., abstr. 4502 ; Gallagher DJ et al., abstr. 4503).
E.A. Ostrander et al. (Cancer Genetics Branch,
National Human Genome Research Institute) ont
rappelé qu’environ 10 % des cancers de la prostate
avaient une origine héréditaire et insisté sur 3 points :
➤le rôle de BRCA2 ;
➤les données des GWAS (Genome-Wide Associa-
tion Studies) ;
➤les modifications de l’épidémiologie.
Les mutations de BRCA2 sont associées à un risque
plus élevé de cancer de la prostate (risque cumulé
de 20 à 34 % jusqu’à 80 ans). Les cancers chez les
patients à BRCA2 mutés sont de mauvais pronostic
et présentent des tumeurs plus indifférenciées (score
de Gleason ≥ 7). Ils ont également un risque plus
élevé de récidive (HR : 2,41 ; IC
95
: 1,23-4,75) et de
mortalité spécifique (HR : 5,48 ; IC95 : 2,03-14,79).
Les porteurs de mutations de BRCA2 ont également
un risque relatif 23 fois plus élevé de développer un
cancer de la prostate avant l’âge de 56 ans (2). Cette
mutation concerne 2 % des cancers de la prostate
au Royaume-Uni. En Islande, où 2 % des patients
présentent la mutation Icelandic BRCA2 999del5
founder, une étude comparant 30 cas mutés à des
patients non mutés a montré un stade plus avancé
au diagnostic, un grade plus élevé et une médiane de
survie bien inférieure (2,1 ans versus 12,4 ans). Dans
la population juive ashkénase, une étude israélienne
a rapporté un doublement de la fréquence en cas de
mutation 6174delT (3).
Dans une étude de la région de Washington,
concernant des sujets jeunes développant un
cancer de la prostate, aucune implication parti-
culière de BRCA2 n’a été retrouvée : seulement
0,78 % des patients sont porteurs d’une mutation
de ce gène.
Les GWAS ont pour but d’étudier des variants
associés au risque de cancer de la prostate et au
pronostic après le diagnostic. Plus de 20 SNP (Single
Nucleotide Polymorphism) associés à des cancers de
la prostate (la plupart non codants) ont été identifiés
par des GWAS.
Les données des GWAS ont montré l’implication de
plusieurs SNP dans les cancers du sujet jeune (13 des
14 SNP testés étaient significativement associés).
Le nombre des cancers du sujet jeune augmente de
façon importante aux États-Unis◆(figure◆1).

26 | La Lettre du Cancérologue • Suppl. 4 au vol. XIX - n° 6 - juillet 2010
Résumé
L’ASCO 2010 a été un grand cru pour les cancers de la prostate. L’intérêt d’associer une radiothérapie à
une hormonothérapie est maintenant confirmé sans conteste dans les formes localement avancées.
Dans les cancers résistants à la castration, les résultats positifs des études de phase III évaluant le déno-
sumab dans les métastases osseuses et le cabazitaxel après docétaxel devraient rapidement modifier les
pratiques. Dans les tumeurs germinales, les arguments se précisent en faveur de chimiothérapies à fortes
doses par rapport aux chimiothérapies conventionnelles dans les formes de mauvais pronostic et en cas
de rechute.
Dans les cancers de la vessie envahissant le muscle, le SOGUG (Spanish Oncology Genitourinary Group) a
été, comme les autres groupes, incapable de compléter le recrutement de son essai adjuvant de phase III.
Mots-clés
Cancer de la prostate
Hormonothérapie
adjuvante
Dénosumab
Cabazitaxel
Cancer du testicule
Cancer de la vessie
Highlights
The ASCO 2010 meeting has
been a great year for prostate
cancer. Radiotherapy combined
with hormonotherapy is now
indisputably confirmed as the
standard treatment of locally
advanced disease. The manage-
ment of castrate-resistant
metastatic prostate cancers
should change quickly with
the positive results of phase III
trials evaluating denosumab
versus zoledronic acid in bone
metastases and cabazitaxel
versus mitoxantrone after
docetaxel. New data suggest
that high-dose chemotherapy
may be superior to standard-
dose chemotherapy in poor
prognosis and in relapsed
germ-cell cancers.
In muscle-invading bladder
cancers, the Spanish Oncology
Genitourinary Group (SOGUG),
like the other groups, has been
unable to complete the recruit-
ment of a randomized phase III
adjuvant trial.
Keywords
Prostate cancer
Adjuvant hormonotherapy
Denosumab
Cabazitaxel
Testicular cancer
Bladder cancer
Biologie : BRAF et cancer de la prostate
Des gènes de fusion impliquant BRAF viennent d’être
décrits dans les cancers de la prostate ainsi que dans
d’autres cancers (estomac, mélanomes) [4]. Cela
pourrait peut-être ouvrir des perspectives dans ces
rares cas pour des traitements avec des inhibiteurs
de RAF et MEK.
Une expression aberrante d’ERG pourrait coopérer
avec des pertes de PTEN (Phosphatase and Tensin
Homolog deleted on chromosome TEN) [5] pour
promouvoir la progression tumorale ou coopérer avec
la voie PI3-kinase dans l’oncogenèse de la prostate (6).
Parmi les “gènes associés” d’intérêt, citons :
➤le KLK2 (human kallikrein-related protein 2) ;
➤le KLK3 (human kallikrein-related protein 3) ;
➤
le JAZF1, un répresseur transcriptionnel de NR2C2
(Nuclear Receptor subfamily 2, group C, member 2)
fortement exprimé dans le tissu prostatique, pourrait
interagir avec le récepteur aux androgènes (RA).
A. Vickers et al. ont rapporté que l’étude sanguine
d’un panel de 4 formes de kallicréines pourrait éviter
des biopsies inutiles (7).
Association
radiothérapie-hormonothérapie
Une étude intergroupe de phase III a comparé
blocage androgénique avec ou sans irradiation
dans les cancers localement avancés de la prostate
(NCIC/CTG, SWOG, MRC-UK, INT: T94-0110;
NCT00002633) [Warde PR et al., abstr. 4504].
L’incidence des tumeurs localisées à haut risque (≥ cT2
ou PSA ≥ 20 ng/ml ou score de Gleason ≥ 8) a diminué
ces dernières années (44 % entre 1990 et 1994, 29 %
entre 2001 et 2004, 24 % entre 2004 et 2007 dans
la base de données CaPSURE).
L’utilité d’associer une radiothérapie (RT) à une
hormonothérapie (HT) pour traiter les tumeurs
avancées n’était pas établie. Le but de cette étude
était donc d’évaluer l’impact de l’addition d’une RT
externe à une HT avec, comme critère de jugement
principal, la survie globale (SG) ; les objectifs secon-
daires étaient la survie spécifique, le temps jusqu’à
progression, le contrôle local symptomatique et la
qualité de vie. Au total, 1 205 patients présentant
une tumeur à haut risque ont été randomisés entre
un blocage androgénique continu par un agoniste
de la LHRH seul (n = 602) et une association de la
même HT avec une RT (n = 603) de 45 Gy au niveau
du pelvis plus un complément de 20-25 Gy au niveau
de la prostate (le radiothérapeute pouvant décider
néanmoins du caractère inapproprié d’une irradiation
pelvienne au cas par cas).
À 7 ans, un bénéfice en SG (74 % versus 66 % ;
HR : 0,77 ; IC
95
: 0,61-0,98 ; p = 0,0331) mais aussi
en survie spécifique (HR : 0,57 ; IC
95
: 0,37-0,78 ;
p = 0,001) ont été retrouvés en faveur du bras RT,
confirmant l’intérêt de la combinaison des deux
traitements (figure◆2).
Une étude randomisée française rapportée par
N. Mottet et al. (abstr. 4505) a également montré
l’impact d’une RT associée à un blocage hormonal
par un agoniste de la LHRH (ADT) pendant 3 ans
comparativement à la même HT dans les tumeurs
localement avancées (T3/T4 N0M0). Elle fait pendant
à l’étude canadienne précédente, avec la particu-
larité d’utiliser une durée de castration de 3 ans et
de compléter les données de l’essai de M. Bolla en
fournissant le bras traité par HT qui manquait. L’HT
faisait appel à la leuproréline à forme trimestrielle
pendant 3 ans associée au flutamide le premier mois.
La dose de RT conformationnelle délivrée était de
70 Gy ± 4 Gy (48 ± 2 Gy sur le pelvis).
Les critères de jugement principaux étaient les
survies sans progression (SSP) biologique et clinique
avec un bénéfice attendu de 15 % à 5 ans. Au total,
273 patients ont été randomisés (92 % de T3). Le PSA
moyen était de 51,7 ng/ ml dans le bras ADT seul versus
41,5 ng/ml dans le bras combiné. Avec un suivi médian
de 67 mois, une différence très significative de la
survie sans rechute biologique a été retrouvée, qu’elle
soit définie par les critères de l’ASTRO (médiane :
7,7 ans versus 1,7 an ; p < 0,0001) ou par les critères
plus récents de Phoenix (médiane : 6,96 ans versus
3,46 ans ; p = 0,0005). La SSP clinique était également
très significativement améliorée (88,7 % versus
62,3 % ; p < 0,001) ainsi que les survies sans rechute
loco-régionale (90,3 % versus 70,77 % ; p < 0,0002)
ou métastatique (97 % versus 89,23 % ; p = 0,018).
En revanche, la SG n’est pas modifiée (71,5 % versus
71,4 % ; p = 0,78), tout comme la survie spécifique
à 5 ans (93,2 % versus 86,1 % ; p = 0,11) [figure◆3].

Survie globale (%)
Années
100
80
60
40
20
0
0
HR : 0,77 (IC95 : 0,61-0,98)
p = 0,0331
320 décès, ADT seul : 175, ADT + RT : 145
74 %
66 %
Patients à risque (n)
ADT
ADT + RT
963
602
603 51
60
213
232
509
512
Survie spécifique (%)
Années
100
80
60
40
20
0
0
HR : 0,57 (IC95 : 0,37-0,78)
p = 0,001
140 décès par cancer de la prostate
ADT seul : 89, ADT + RT : 51
90 %
79 %
963
602
603 51
60
213
232
509
512
Figure 2. Étude de phase III intergroupe NCIC CTG PR.3/MRC PRO7/SWOG JPR3 (2)
(d’après Warde PR et al., abstract 4504 actualisé).
Survie sans progression biologique
à 5 ans (définition ASTRO) [%]
Années
100
80
60
40
20
0
0
Médiane : 7,7 ans versus 1,7 an
p < 0,0001
ADT
ADT + RT
321
130
133 24
90
60
113
90
124
654
2
36
8
61
87
0
8
1
17
13
81
ADT
ADT + RT
ADT
ADT + RT
ADT
ADT + RT
ADT
ADT + RT
ADT
ADT + RT
Survie sans progression locorégionale
(ITT population) [%]
Années
100
80
60
40
20
0
0
Médiane : 90,3 % versus 70,77 %
p < 0,0002
321
130
133 100
106
112
117
123
126
654
35
46
65
75
87
5
10
18
24
84
98
Survie sans progression clinique
(ITT population) [%]
Années
100
80
60
40
20
0
0
Médiane : 88,7 % versus 62,3 %
p < 0,0001
321
130
133 97
105
111
115
122
126
654
31
56
62
75
87
4
10
16
24
78
98
Survie sans progression à 5 ans
(critères de Phoenix) [%]
Années
100
80
60
40
20
0
0
Médiane : 6,96 ans versus 3,46 ans
p = 0,0005
321
130
133 75
102
91
115
116
124
654
7
39
19
67
87
0
9
3
18
31
92
Survie sans progression métastatique
(ITT population) [%]
Années
100
80
60
40
20
0
0
Médiane : 97 % versus 89,23 % ;
p = 0,0183
321
130
133 100
106
119
116
122
126
654
42
50
87
81
87
6
11
24
26
103
101
Survie globale (ITT population) [%]
Années
100
80
60
40
20
0
0
Médiane à 5 ans : 71,5 % versus 71,4 %
p = 0,7882
321
130
133 113
107
121
119
123
127
654
47
50
90
81
87
7
11
26
26
109
101
Figure 3. Étude randomisée française comparant une hormonothérapie + une radiothérapie (ADT + RT) à hormonothérapie seule (ADT) [d’après Mottet N
et al., abstr. 4505 actualisé].
La Lettre du Cancérologue • Suppl. 4 au vol. XIX - n° 6 - juillet 2010 | 27
DOSSIER THÉMATIQUE
46e congrès américain
en oncologie clinique
Tumeurs hormono-sensibles
Les données préliminaires des 2 essais français de
phase III évaluant le docétaxel en phase hormono-
dépendante non métastatique de Rising PSA
(254 patients) ou en phase métastatique GETUG/
AFU 15 (385 patients) ont montré une tolérance
acceptable en dehors des toxicités hématologiques.
Les taux de neutropénies fébriles ont été respec-
tivement de 7,3 % (Oudard S et al., abstr. 4685) et
7 % (Latorzeff I et al., abstr. 4685). Du fait de 3 décès
toxiques, dont 2 liés à une aplasie fébrile, après les
215 premiers patients du GETUG/AFU 15, il a été
recommandé pour la suite du protocole d’utiliser
systématiquement du G-CSF. Il faut encore attendre
pour disposer de résultats en termes d’efficacité.

Sujets sans SRE (%)
Mois
100
80
60
40
0
0
HR : 0,82 (IC95 : 0,71-0,95)
p = 0,0002 (non-infériorité)
p = 0,008 (supériorité)
Acide zolédronique
Dénosumab
Médiane : 20,7 mois versus 17,1 mois
Réduction du risque 18 %
963 181512 272421
951
950 407
472
544
582
733
758 140
168
207
259
299
361 47
39
64
70
93
115
Figure 4. Cancer de la prostate avec métastases osseuses résistant à la castration : temps
jusqu’au premier événement osseux (SRE) [d’après Fizazi K et al., abstr. 4507 actualisé].
28 | La Lettre du Cancérologue • Suppl. 4 au vol. XIX - n° 6 - juillet 2010
Cancers de la prostate, du testicule et de la vessie
DOSSIER THÉMATIQUE
46e congrès américain
en oncologie clinique
Tumeurs métastatiques hormono-
résistantes
Les résultats de l’étude internationale randomisée
de phase III comparant le dénosumab à l’acide
zolédronique dans les cancers de la prostate résis-
tants à la castration avec métastases osseuses ont
été présentés par K. Fizazi et al. (abstr. 4507).
L’activation des ostéoclastes médiée par RANKL
(Receptor Activator for Nuclear factor κB Ligand) est
responsable de résorption osseuse et de complica-
tions squelettiques. Le dénosumab est un anticorps
monoclonal complètement humanisé bloquant
RANKL. Cette étude de phase III, en double aveugle
a comparé l’efficacité et la tolérance du dénosumab
à celles du zolédronate.
Ainsi, 1 901 patients non antérieurement traités par
bisphosphonate ont reçu soit du dénosumab s.c.
à la dose mensuelle de 120 mg (n = 950), soit du
zolédronate i.v. à une dose adaptée à la fonction
rénale (n = 951). Tous les patients avaient des
suppléments en calcium et vitamine D. Le critère de
jugement principal était le temps jusqu’au premier
événement osseux, défini par une fracture patholo-
gique, une irradiation, une chirurgie osseuse ou une
compression médullaire.
Le dénosumab permet de retarder de façon statis-
tiquement significative le premier événement osseux
(HR : 0,82 ; IC
95
: 0,71-0,95 ; p = 0,008). Le temps
médian jusqu’au premier événement osseux est
de 20,7 mois versus 17,1 mois avec le zolédronate.
Il réduit aussi les autres événements osseux
(HR : 0,82 ; IC
95
: 0,71-0,94 ; p = 0,004) ainsi que les
marqueurs de turn-over osseux comme le uNTx. Les
effets indésirables sont identiques dans les 2 groupes,
notamment en ce qui concerne les hypocalcémies
(13 % avec le dénosumab versus 6 % avec le
zolédronate) ou les ostéonécroses de la mâchoire
(respectivement 2,3 % versus 1,3 % ; p = 0,09).
Le dénosumab vient donc de montrer sa supériorité
dans la prévention et le retardement de l’apparition
des événements osseux en présence de métas-
tases osseuses. En revanche, il ne modifie pas la
SG (figure◆4).
Un essai de phase II randomisé (2:1) multicentrique
international a évalué le tasquinimod (TASQ) chez
les patients chimio-naïfs avec un cancer de la
prostate métastatique asymptomatique résistant
à la castration (Pili R et al. abstr. 4510).
Le TASQ est une quinoline-3-carboxamide qui inhibe
la prolifération tumorale dans plusieurs modèles
de cancer de la prostate. Il présente des effets
antiangiogéniques in vitro et in vivo, entraînant une
régulation positive de TSP-1 (ThromboSPondin 1) et
une régulation négative d’HIF-1α (Hypoxia Induced
Factor 1α) et de VEGF (Vascular Endothelial Growth
Factor). Les données de phase I (8) avaient montré
des effets indésirables limités et transitoires – essen-
tiellement des douleurs musculaires et articulaires,
de la fatigue ainsi que des augmentations de l’amy-
lasémie.
Dans cette étude randomisée (2:1) versus placebo,
chez 206 patients asymptomatiques (136 sous
TASQ, 70 sous placebo), le traitement hormonal
était poursuivi (agoniste de la LHRH mais aussi
anti androgènes) : 201 patients ont été analysés en
intention de traiter (ITT). Le critère de jugement
principal était la proportion de patients en progression
à 6 mois : 69 % (93 sur 134) des patients du bras
TASQ, versus 34 % (23 sur 67) dans le bras placebo,
n’avaient pas progressé (p < 0,0001), pour un risque
relatif de progression de 0,47. La médiane de SSP était
de 7,6 mois versus 3,2 mois (HR : 0,52 ; p = 0,0009).
Elle était de 6 mois versus 3 mois dans le sous-groupe
métastases viscérales et de 12,2 mois versus 5,4 mois
dans le sous-groupe métastases osseuses isolées.
Le TASQ a un effet mineur, pour ne pas dire nul, sur
le PSA. La tolérance était correcte. Une étude de
phase III avant docétaxel est programmée.
L’étude CALGB 90401, randomisée, en double
aveugle, a comparé docétaxel + prednisone +
placebo versus docétaxel + prednisone + bévaci-
zumab chez des patients présentant un cancer
de la prostate métastatique en échappement
hormonal (Kelly WK et al., abstr. 4511).

Survie globale en intention de traiter (%)
Mois
100
80
60
40
20
0
0
Patients à risque (n)
MP
CBZP
6 1812 3024
377
378 188
231
300
321 67
90 1
4
11
28
Figure 6. Étude TROPIC : survie globale (d’après De Bono JS et al., abstr. 4508 actualisé).
Figure 5. Étude TROPIC (d’après De Bono JS et al., abstr. 4508 actualisé).
Patients avec CPRCm ayant progressé
sous ou après docétaxel
146 sites, 26 pays (n = 755)
Cabazitaxel 25 mg/m2/3 sem.
+ prednisone 10 mg/j pour 10 cycles
(n = 378)
Facteurs de stratification
ECOG PS (0-1 versus 2) maladie mesurable
versus non mesurable
CPRCm : cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.
Mitoxantrone 12 mg/m2/3 sem.
+ prednisone 10 mg/j pour 10 cycles
(n = 377)
MP CBZP
Médiane (SG) [mois] 12,7 15,1
HR 0,7
IC95 0,59-0,83
p < 0,0001
CBZP : cabazitaxel + prednisone ; MP : mitoxantrone.
30 | La Lettre du Cancérologue • Suppl. 4 au vol. XIX - n° 6 - juillet 2010
Cancers de la prostate, du testicule et de la vessie
DOSSIER THÉMATIQUE
46e congrès américain
en oncologie clinique
Cette étude de phase III a évalué l’apport potentiel
du bévacizumab (15 mg/kg) à la chimiothérapie
(CT) standard docétaxel + prednisone en première
ligne, administrée toutes les 3 semaines (75 mg/ m2)
chez 1 050 patients chimio-naïfs en échappement
hormonal, après vérification de l’absence de
syndrome de retrait. Le critère de jugement principal
était la SG, le protocole fixé pour détecter 21 % d’HR,
soit une augmentation de 5 mois de l’espérance de
vie (de 19 à 24 mois).
Il a été conclu que, en dépit d’une amélioration de
la SSP ainsi que des taux de réponses biologique et
clinique, l’addition du bévacizumab n’entraînait pas
l’amélioration de la SG escomptée (22,6 mois versus
21,5 mois ; HR : 0,91 ; IC95 : 0,78-1,05).
L’étude de phase III TROPIC a comparé cabazitaxel +
prednisone versus mitoxantrone + prednisone
(De Bono JS et al., abstr. 4508).
Le cabazitaxel est un taxane semi-synthétique, agent
stabilisant des microtubules, actif sur des lignées
cellulaires résistantes et sensibles aux taxanes, in
vitro et sur des modèles animaux. Cette molécule a
été principalement sélectionnée pour sa faible affinité
aux protéines MDR (MultiDrug Resistance, pgp 1),
principal élément de résistance aux taxanes. La dose
limitante toxique (DLT) est de 25 mg/m² toutes les
3 semaines, liée au risque de neutropénie fébrile (9).
L’étude a inclus 755 patients ayant progressé
pendant ou après un traitement par docétaxel.
Le bras de référence associait mitoxantrone
12 mg/ m2/3 semaines et prednisone 10 mg/j pour
10 cycles au maximum. Le bras expérimental associait
cabazitaxel 25 mg/m
2
/3 semaines et prednisone
10 mg/j pour 10 cycles au maximum (figure◆5).
L’étude était stratifiée en fonction du performance
status ([PS] ECOG 0-1 versus 2) et selon la présence
d’une maladie mesurable ou non. L’objectif principal
était la SG, les objectifs secondaires, la SSP, le taux
de réponse et la toxicité. Les caractéristiques des
patients étaient bien équilibrées entre les deux bras :
91 % avaient un PS 0-1, plus de la moitié des patients
présentaient une maladie mesurable, près de 25 %
des métastases viscérales. Plus de 70 % des patients
avaient progressé moins de 3 mois après la dernière
perfusion de docétaxel quel que soit le bras. La SG
s’est avérée significativement supérieure dans le
bras cabazitaxel + prednisone : 15,1 mois et 12,7 mois
(HR : 0,7 ; p < 0,0001) [figure◆6].
La SSP était également significativement augmentée
(2,8 mois versus 1,4 mois ; HR : 0,74 ; p < 0,0001). Les
taux de réponse objective sont faibles dans les deux
bras, tout en restant significativement supérieurs
dans le bras expérimental (14,4 % versus 4,4 % ;
p < 0,0001). Les taux de réponse du PSA sont de
39,2 % pour le bras cabazitaxel versus 17,8 % pour
le bras mitoxantrone (p = 0,0002), avec un temps
médian jusqu’à progression de 6,4 mois versus
3,1 mois (HR : 0,75 ; p = 0,001). Le nombre de cycles
médian a été de 6 pour le cabazitaxel versus 4 pour
la mitoxantrone.
En ce qui concerne la tolérance, 57,4 % des patients
du bras cabazitaxel ont présenté une toxicité
clinique de grade ≥ 3, contre 39,4 % dans le bras
mitoxantrone. Cet excès d’événements a été princi-
palement constitué par des neutropénies fébriles
(7,5 % versus 1,3 %) et des diarrhées (6,2 % versus
0,3 %). De plus, il y a eu 4,9 % (n = 18) de décès
toxiques dans le bras cabazitaxel, le plus souvent
liés aux complications de la neutropénie.
Le cabazitaxel s’inscrit comme un futur standard
de CT de deuxième ligne après échec du docétaxel.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%