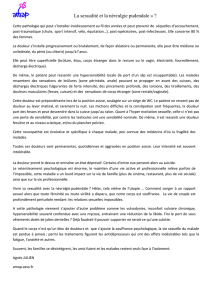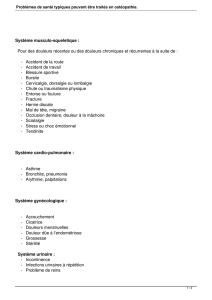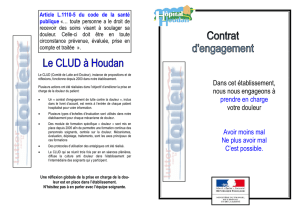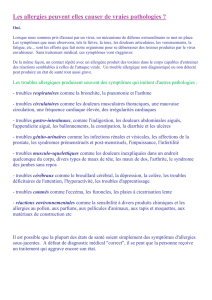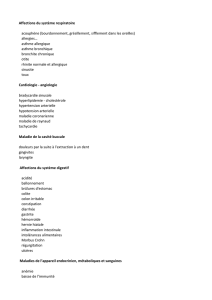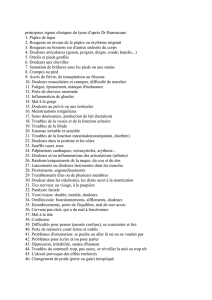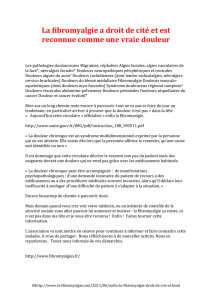Lire l'article complet

a littérature est particulièrement riche
pour désigner les différentes douleurs
pelvi-périnéales sans support lésionnel (1). Le
suffixe “dynie” (2) est souvent associé à la
topographie de la douleur pour la caractériser :
prostatodynie, vulvodynie, coccygodynie…
Mais cela définit-il un contexte pathologique
spécifique ? D’une spécialité à l’autre, les
patients seront étiquetés différemment, au
risque de laisser entendre qu’il s’agit d’er-
rances diagnostiques. Il est parfois difficile de
se retrouver dans cette jungle de mots ; l’objec-
tif de cette présentation est de vous y aider.
D
U SENS DES MOTS
:
LES SYMPTÔMES
L’ICS (International Continence Society) (3) a
récemment publié un rapport sur la terminolo-
gie des anomalies fonctionnelles du bas appa-
reil urinaire, englobant notamment les dou-
leurs. Un certain nombre de termes ont donc
été précisés dans un objectif d’uniformité et de
facilitation de la communication.
Douleurs génitales et du bas appareil urinaire
Elles peuvent être définies comme une gêne
extrême et caractérisées par leurs types, leurs
fréquences, leurs durées, leurs facteurs déclen-
chants, leurs localisations et leurs irradiations.
Les patients peuvent rattacher leur douleur au
remplissage vésical, à la miction, aux suites de
la miction ou rapporter des douleurs continues.
La douleur peut être référée, par exemple une
douleur vésicale ressentie au niveau de l’urètre
et de la verge.
Douleur vésicale
Douleur ressentie dans la région suspubienne
et habituellement augmentée par le remplis-
sage vésical, elle peut persister après la mic-
tion.
Douleur urétrale
Douleur ressentie au niveau de l’urètre.
Douleur vulvaire
Douleur ressentie au niveau de la région géni-
tale externe, entre le méat urétral et l’anus.
Douleur vaginale
Douleur ressentie comme interne, au-dessus de
la vulve.
Douleur scrotale
Douleur pouvant être localisée par le patient à
la région testiculaire ou scrotale, par exemple
au niveau de la tête de l’un ou l’autre épidi-
dyme.
Douleur périnéale, périnéalgie
Douleur ressentie entre l’urètre et l’anus et
localisée par le patient au niveau du périnée. La
douleur périnéale est ressentie par l’homme en
arrière du scrotum et en avant de l’anus ; la
douleur scrotale est différente. Chez la femme,
peut-on distinguer les douleurs vulvaires des
douleurs périnéales ?
Douleur pelvienne
La douleur pelvienne est moins bien définie que
la douleur périnéale, vésicale ou urétrale et
apparaît moins clairement rattachée au cycle
remplissage-miction ou à la fonction intestinale.
Ténesme vésical (strangury)
C’est le terme utilisé pour décrire une sensation
intense et désagréable, douloureuse, ressentie
au niveau de la vessie à la fin de la miction. Le
patient ressent la nécessité de continuer à uriner,
mais peut n’émettre que quelques gouttes. Un
calcul vésical peut donner de telles sensations.
Spasmes vésicaux
Spasme vésical est le terme utilisé pour décrire
une urgence mictionnelle extrême pouvant
entraîner ou non une fuite. Les spasmes vési-
caux peuvent être ressentis par un patient en
sonde à demeure et sont présumés pouvoir être
rattachés à des contractions involontaires du
détrusor.
8
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 1, vol. I - mars 2001
dossier
Douleurs pelvi-périnéales :
la jungle des mots
■
■
J.J. Labat*
* Centre médical Mauvoisins,
25, rue Mauvoisins, 44200 Nantes.
e-mail : [email protected]
L

9
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 1, vol. I - mars 2001
Les douleurs pelvi-périnéales
D
ES MOTS POUR LE DIRE
:
LES SYNDROMES
Certains termes ont également été définis par
consensus pour décrire les syndromes péri-
néaux douloureux.
ICS
(International continence society)
Syndrome de vessie douloureuse (painful blad-
der syndrome)
Il s’agit d’une douleur suspubienne en rela-
tion avec le remplissage vésical, habituelle-
ment accompagnée d’une pollakiurie diurne
et nocturne, en l’absence de toute patholo-
gie locale. Le terme de cystite interstitielle
ne devrait pas être utilisé tant que ce dia-
gnostic n’a pas été confirmé par la cystosco-
pie et la biopsie.
Syndrome urétral (urethral pain syndrome)
Il s’agit d’une douleur urétrale épisodique et
récurrente survenant lors de la miction, habi-
tuellement associée à une pollakiurie diurne et
nocturne, et survenant généralement en l’ab-
sence de toute pathologie et notamment de
toute infection.
Syndrome de douleur périnéale (perineal pain
syndrome)
Il s’agit d’une douleur périnéale persistante ou
épisodique et récurrente, éventuellement en
rapport avec le cycle mictionnel d’autres
troubles du bas appareil urinaire comme une
pollakiurie diurne. Les troubles surviennent en
l’absence de toute pathologie et notamment de
toute infection.
Syndrome de douleur pelvienne (pelvic pain
syndrome)
Il s’agit d’une douleur pelvienne présentant les
mêmes caractéristiques que le syndrome de
douleur périnéale.
AGA (American Gastroenterological
Association)
(4)
Syndrome du releveur
Défini, par consensus selon les critères de
Rome (1990), comme une douleur ano-rectale
chronique ou récurrente, survenant depuis plus
de trois mois, évoluant par épisodes durant
plus de 20 minutes et en dehors de toute cause
organique de douleur rectale.
Le syndrome du releveur est en fait caractérisé
par une douleur, chronique ou intermittente ; la
gêne peut être sourde, douloureuse, ou légère,
intrarectale, aggravée en position assise et sou-
lagée en position debout. Il peut exister une
sensation de remplissage rectal et de faux
besoins d’exonérer. Il peut s’y associer une ten-
sion et une dyssynergie des muscles du plan-
cher pelvien.
Proctalgie fugace
Défini, par consensus selon les critères de
Rome (1990), comme des épisodes récurrents
de douleurs de l’anus ou du bas rectum depuis
au moins trois mois, les épisodes paroxystiques
durent de quelques secondes à quelques
minutes. Il n’y a pas de douleur entre ces épi-
sodes douloureux et on ne met pas en évidence
de maladie ano-rectale.
Ces crises douloureuses sont espacées et sur-
viennent moins de 6 fois par an chez la moitié
des patients.
NIH (National Institutes of Health :
International Prostatitis Collaborative
Network)
(5)
Cette classification des prostatites a essayé de
séparer le contexte des prostatites bacté-
riennes et celui des prostatites abactériennes
et prostatodynies. Le terme de syndrome de
douleur pelvienne chronique est introduit
comme synonyme pour bien montrer que l’on
admet que ces douleurs peuvent être générées
par d’autres organes que la prostate. Ces dou-
leurs sont de très loin les plus fréquentes.
Prostatite aiguë bactérienne
Infection aiguë de la glande prostatique.
Prostatite chronique bactérienne
Infections urinaires récidivantes avec infection
chronique de la prostate.
Prostatite inflammatoire ou syndrome de dou-
leur pelvienne chronique inflammatoire
Gêne ou douleur dans la région pelvienne asso-
ciée à l’absence d’infection démontrée par les
techniques cytobactériologiques habituelles
mais comportant un nombre significatif de glo-
bules blancs dans les échantillons spécifiques
d’origine prostatique (c’est-à-dire : sperme,
sécrétions prostatiques ou urines recueillies
après massage prostatique).

Prostatite non inflammatoire ou syndrome de
douleur pelvienne chronique non inflamma-
toire
Gêne ou douleur dans la région pelvienne asso-
ciée à l’absence d’infection démontrée par les
techniques cytobactériologiques habituelles et
comportant un nombre non significatif de glo-
bules blancs dans les échantillons spécifiques
d’origine prostatique (c’est-à-dire : sperme,
sécrétions prostatiques ou urines recueillies
après massage prostatique).
Prostatite inflammatoire asymptomatique
Le patient n’a pas de douleur (à l’occasion d’un
bilan d’infertilité ou de celui d’un taux de PSA
élevé) mais il a été mis en évidence une infec-
tion ou une inflammation d’origine prostatique.
Autres terminologies
Prostatodynies et prostatite chronique abacté-
rienne
Officiellement, ces termes sont abandonnés
depuis la classification des prostatites présen-
tée ci-dessus.
Névralgie pudendale (6)
Décrite initialement en 1915 et longtemps
oubliée, la névralgie pudendale est une douleur
à type de brûlure, siégeant dans tout ou partie
du territoire du nerf pudendal (de la région cli-
toridienne ou de la verge jusqu’à l’anus),
médiane ou latéralisée. Elle est aggravée en
station assise, soulagée en position debout et
tend à disparaître en position couchée. Elle ne
s’accompagne pas d’anomalie neurologique
objective.
Syndrome du canal d’Alcock (7)
Ce terme, utilisé initialement par Gérard
Amarenco pour désigner les névralgies puden-
dales observées chez les cyclistes, sous-entend
que l’origine de la névralgie est en relation avec
un syndrome canalaire situé dans le canal
pudendal d’Alcock. En fait, l’étude opératoire
des conflits ligamentaires montre que si les
conflits sont fréquents à ce niveau, ceux situés
au niveau de la pince ligamentaire (ligament
sacro-épineux/ligament sacro-tubéral au
niveau de l’épine sciatique) le sont encore
davantage.
Vulvodynie ou syndrome de brûlure vulvaire
La vulvodynie désigne un inconfort vulvaire
chronique, une sensibilité vulvaire excessive,
une hyperesthésie vulvaire. On peut globale-
ment individualiser deux types de vulvo-
dynies : les vulvodynies symptomatiques
d’une pathologie locale spécifique et celles qui
ne le sont pas, c’est-à-dire les vulvodynies
essentielles. Celles-ci peuvent correspondre à
des vestibulites vulvaires ou à des névralgies
pudendales.
Vestibulite vulvaire (8)
Cette brûlure vulvaire a pour caractéristique
d’être tout à fait localisée au niveau du vesti-
bule, sans côté préférentiel. Celui-ci est particu-
lièrement sensible, avec une intolérance locale
au moindre contact (Coton-Tige humide),
entraînant souvent une dyspareunie sévère et
l’impossibilité d’appliquer un tampon hygié-
nique ; l’introduction du spéculum est alors
impossible. La douleur n’est pas spontanée
mais provoquée par le frottement lors de la
marche ou au contact du slip ou des pantalons
serrés. Localement, on peut retrouver un éry-
thème localisé visible macroscopiquement ou
une simple hyperémie visible en vulvoscopie.
Vulvodynies “dysesthésiques”
Il s’agit d’un terme utilisé pour désigner les vul-
vodynies en rapport avec une névralgie puden-
dale (par analogie aux “méralgies paresthé-
siques”).
Syndrome du piriforme
Il s’agit d’une douleur fréquente, située au
niveau de la fesse dans sa portion médiane, en
général aggravée en station assise, parfois par
les efforts. Cliniquement, elle s’accompagne
d’une douleur sur l’insertion trochantérienne
du muscle pyramidal du bassin (ou muscle piri-
forme), d’une douleur à la pression médiane du
muscle au passage du tronc du nerf sciatique.
Cette douleur peut s’accompagner d’irradiation
dans un territoire sciatique plus ou moins tron-
qué faisant évoquer une compression du tronc
sciatique, ou plutôt du nerf cutané postérieur
de la cuisse (nerf petit sciatique) sous le bord
inférieur du muscle dans le canal sous-piri-
forme. Cette douleur est cependant relative-
ment peu spécifique et souvent retrouvée chez
les patients présentant une douleur pelvi-péri-
néale, quelle qu’en soit l’origine.
Syndrome myofascial pelvi-périnéal (9)
Forme localisée de fibro-myalgie, les douleurs
10
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 1, vol. I - mars 2001
dossier

11
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 1, vol. I - mars 2001
Les douleurs pelvi-périnéales
myofasciales sont localisées au niveau des
muscles de la région périnéale et fessière. Elles
se caractérisent par des points gâchettes, un
contexte douloureux chronique.
Névralgie ano-rectale
Il s’agit d’un terme souvent utilisé en coloproc-
tologie pour désigner les douleurs ano-rectales
sans explication locale. On peut l’intégrer dans
le cadre des atteintes de la branche anale (ou
hémorroïdale) du nerf pudendal.
Douleur rectale chronique idiopathique
Les patients se plaignent d’une vague sensa-
tion de tension intrarectale, constante ou inter-
mittente, avec ou sans irradiation, et qui peut
être soulagée après l’émission de gaz ou de
selles, le changement de position, les bains de
siège ou les massages locaux.
Coccygodynie
La coccygodynie est une douleur aggravée par
la station assise et parfois au moment du rele-
ver, elle est reproduite par la pression ou
l’ébranlement du coccyx par voie externe ou
lors du toucher rectal. Cette douleur doit être
strictement localisée au niveau du coccyx et ne
pas avoir d’irradiation fessière ou périnéale.
Elle peut parfois être le témoin d’une instabilité
du coccyx démasquée par les clichés dyna-
miques du coccyx comparant les clichés en sta-
tion debout et assise. Une instabilité du coccyx
supérieure à 25° peut être considérée comme
pathologique. Elle peut également être en rap-
port avec une épine osseuse coccygienne.
Souvent cependant les radiographie restent
normales.
Syndrome de Maigne
Il s’agit de douleurs référées, pseudo-viscérales,
s’exprimant au niveau inguinal, testiculaire ou
labial, urétral et en rapport avec un conflit de la
charnière thoraco-lombaire. Ce syndrome est en
général d’origine articulaire postérieure ; l’exa-
men clinique retrouve des points douloureux
articulaires postérieurs, une zone de cellulalgie
en regard et une certaine sensibilité à la pression
du flanc et de la région inguinale.
C
OMMENTAIRES
Le syndrome du releveur, les douleurs rectales
chroniques idiopathiques, les névralgies ano-
rectales, les névralgies pudendales par atteinte
de la branche hémorroïdale sont probablement
le témoin d’un même contexte pathologique.
Le syndrome du piriforme semble souvent s’inté-
grer dans un contexte de syndrome myofascial.
Le terme de syndrome douloureux pelvien chro-
nique utilisé pour désigner les anciennes pros-
tatodynies est assez mal adapté et mériterait
plutôt celui de syndrome douloureux périnéal
chronique proposé par l’ICS.
Il faut constater que les gastro-entérologues ne
retiennent que deux cadres de douleurs : le
syndrome du releveur et les proctalgies
fugaces.
Si la névralgie pudendale peut être une étiolo-
gie de ces prostatites non inflammatoires, mais
également de certaines vulvodynies, de syn-
dromes du releveur, de douleurs rectales chro-
niques idiopathiques, elle ne peut l’être des
vestibulites vulvaires, des coccygodynies ou
des proctalgies fugaces, qui sont cliniquement
très différentes. ■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Wesselmann U, Burnett AL, Heinberg LJ. The
urogenital and rectal pain syndromes. Pain 1997 ;
73 : 269-94.
2. Wesselmann U, Reich SG. The dynias. Semin
Neurol 1996 ; 16 : 63-74.
3. ICS. Standardisation reports. Draft 3 termino-
logy 16.10.00. http://www.continet.org
4.Drossman DA, Funch-Jensen P, Janssens J, Talley
NJ, Thompson WG, Whitehead WE. Identification of
sub-groups of functional gastrointestinal disorders.
Gastroenterol Int 1990 ; 3 : 159-72.
5. Nickel JC, Nyberg LM, Research guidelines for
chronic prostatitis : consensus report from the First
National Institutes of Health International
Prostatitis Collaborative Network. Urology 1999 ;
54 : 2 : 229-33.
6. Labat JJ, Robert R, Bensignor M, Buzelin JM.
Les névralgies du nerf pudendal (honteux interne).
Considérations anatomo-cliniques et perspectives
thérapeutiques. J Urol (Paris) 1990 ; 96 : 239-44.
7. Amarenco G, Savatosky I, Budet C, Perrigot M.
Névralgies périnéales et syndrome du canal
d’Alcock. Ann Urol 1989 ; 6 : 488-92.
8.Friedrich Jr EG. Vulvar vestibulitis syndrome. J
Reprod Med 1987 ; 32 : 110-4.
9. Costello K. Myofascial syndromes. In : Chronic
pelvic pain. An integrated approach. Steege JF,
Metzger DA, Levy BS (eds). Saunders Company,
1998 ; 26 : 251-66.
1
/
4
100%