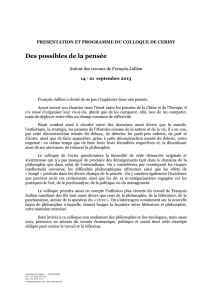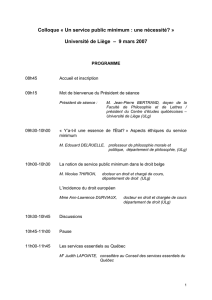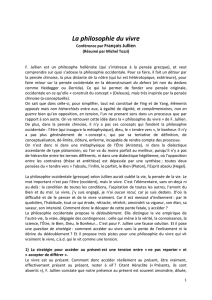Efficacité : normes et savoirs N°4 – Avril 2011

N°4 – Avril 2011
ISSN : 2031-4973 - eISSN : 2031-
4981 - Publication en ligne sur
http://popups.ulg.ac.be/dissensus/
http://www.philopol.ulg.ac.be
Efficacité : normes et savoirs (Coordination : T . Berns et D. Pieret)
Introduction p. 2
Gaëlle Jeanmart : « L’efficacité de l’exemple » p. 4
Thibault Le Texier : « D’un principe de justice à un standard d’efficacité : la rationalité régalienne à
l’épreuve de la logique gestionnaire » p. 49
Denis Pieret : « Efficacité et efficience selon François Jullien » p. 70
Géraldine Brausch : « Un détour par les stratèges de Jullien pour relire les analyses stratégiques de
Foucault » p. 80
Laurence Bouquiaux : « De la déraisonnable efficacité des modèles » p. 109
Antoinette Rouvroy : « Pour une défense de l’éprouvante inopérationnalité du droit face à
l’opérationnalité sans épreuve du comportementalisme numérique » p. 127
Thomas Berns : « L’efficacité comme norme » p. 150
Manuel Cervera-Marzal : « Vers une théorie de la révolution non-violente » p. 164
Antoine Janvier : « Pour une analyse matérialiste, généalogique et métapsychologique de la religion.
Présentation de André Tosel,
Du retour du religieux : scénarios de la mondialisation culturelle I,
Paris, Kimé,
2011 » p. 185
Vincent Bonnet : « Act Up : “Mon identité n’est pas nationale”... ni homosexuelle » p. 198

– Revue de philosophie politique de l’ULg – N°4 – Avril 2011 – p. 2
Droit et philosophie du langage ordinaire
(Coordination : T. Berns et D. Pieret)
Introduction
Le présent dossier rassemble une partie des travaux réalisé dans le cadre d’un
séminaire de recherches mené durant à l’automne 2009 à l’université de Liège.
L’argument s’appuie sur le constat que l’efficacité semble être devenue une donnée
centrale du monde contemporain dans la mesure où elle occupe véritablement l’espace
de la norme. En témoignent de nombreux phénomènes propres au monde
contemporain, dans lesquels la production de savoirs et de normes est pensée
entièrement à partir de son efficacité : le gouvernement du monde universitaire par
l’évaluation, le développement des environnements intelligents et des activités de
profilages, la transformation de l’entreprise en acteur politique responsable, vecteur de
diffusion des droits de l’homme et des idées démocratiques.
Quels changements dans la nature de la norme et dans la nature de la
connaissance découlent de ce nouveau type de gouvernement entièrement concentré
sur son efficacité ? Une norme tendancielle, exprimée en quota, momentanée, sans
cesse réformée, prétendant épouser la singularité des acteurs sur lesquels elle porte,
etc. est-elle encore une norme ? Un savoir constitué d’une suite de corrélations et
produit de manière automatisée, dont la première vertu est la masse de données qui
lui permet d’émerger, est-il encore une connaissance, aussi objectif et efficace que soit
ce savoir ? L’efficacité, souvent constatée, d’une norme ou d’un savoir ne se limite-t-
elle pas à la réussite auto-référée du processus engagé ?
Les textes qui suivent s’attachent à élucider cette notion peut thématisée en
philosophie. Gaëlle Jeanmart fournit une perspective historique et critique sur l’usage
de l’exemple et son efficacité dans l’édification morale et dans l’histoire. Thibault Le
Texier étudie l’emprise d’une « rationalité managériale » sur les institutions des

– Introduction – p. 3
sociétés industrielles qui s’accompagne d’un glissement du principe de justice vers un
impératif d’efficacité. Denis Pieret propose une synthèse des travaux de François
Jullien, l’un des seuls philosophes à avoir affronté directement le thème de l’efficacité,
de manière à opérer un déplacement par rapport au « pli » européen de la
modélisation, ce cadre impensé dans lequel nous pensons l’efficacité comme
adéquation entre la fin et les moyens. Géraldine Brausch revient vers Michel Foucault,
à partir de Jullien, pour relire ses analyses du pouvoir et donner corps à la notion
récurrente chez Foucault, mais mal définie, de stratégie. Laurence Bouquiaux repense
la « déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles » en
prenant François Jullien à contrepied : ce qui réussirait dans les sciences, ce ne serait
pas l’application d’un modèle idéal à la réalité, mais une lente transformation du
potentiel de situation. Antoinette Rouvroy s’intéresse à la « création numérique de la
réalité » pour dessiner, face à la normativité juridique, une « normativité
algorithmique » ; à partir de la concurrence entre ces deux normativités, elle invite à
reconceptualiser le « sujet de droit ». Thomas Berns, après avoir pris, à la suite
d’Agamben, le langage comme idéal d’efficacité, étudie les nouvelles formes de
normativités, inscrites dans une rationalité actuarielle et pensées comme immanentes
au réel. Dans cette perspective, la norme efficace est une norme qui n’apparaît pas.
« Telles des forces invisibles, les normes veillent au bon ordre des choses », dit la
Commission européenne.

– Revue de philosophie politique de l’ULg – N°4 – Avril 2011 – p. 4
Gaëlle Jeanmart : « L’efficacité de l’exemple »
Introduction
Le point de départ de cette réflexion vient d’un constat que nous avons fait
dans notre réflexion sur l’histoire philosophique du courage1 : au seuil des Temps
modernes, on assiste à la disparition du discours sur le courage et à la remise en
question des présupposés à la base de la morale antique et de son analyse du
courage. Le pari des Modernes semble être celui d’une moralisation immanente des
individus guidés par leurs intérêts et sous la contrainte d’une vie collective. Ce
processus de moralisation repose sur les dispositifs socio-économiques qui rendent
possible la vie commune bien davantage que sur un rapport que le sujet moral
responsable entretiendrait à lui-même et par lequel il s’obligerait à agir selon un idéal.
Or, dans la production quasi mécanique du courage par les récits héroïques, la mort du
héros prend précisément sens comme sacrifice et don gratuit pour une collectivité et la
commémoration de cette mort ou de cet exploit a pour fonction de susciter la cohésion
du groupe et un esprit d’émulation autour du héros présenté en modèle. On trouve une
présentation parlante de ce processus de moralisation et de civilisation par
l’exemplarité dans le dialogue que Platon consacre à l’oraison funèbre :
« Ils (les orateurs) célèbrent la cité de toutes les manières et font de ceux qui
sont morts à la guerre et de toute la lignée des ancêtres qui nous ont précédés
et de nous-mêmes, qui sommes encore vivants, un tel éloge que moi qui te
parle, Ménexène, je me sens tout à fait grandi par leurs louanges et que
chaque fois je reste là, plus généreux, plus beau. (…) cette haute idée que j’ai
de ma personne dure au moins trois jours ! » (
Ménexène,
235a-b).
Le récit des actes héroïques semble pouvoir susciter un enthousiasme qui
donne une force, un élan irrépressible pour passer à l’acte et imiter le héros loué pour
la survie de la patrie. Si le courage est resté une vertu moderne, serait-ce alors
seulement en tant que pris dans une telle « mécanique » de civilisation et,
particulièrement, sous la forme de récits incitateurs de vies exemplaires ? Ou bien la
moralisation par les récits légendaires et héroïques a-t-elle subit elle aussi une crise à
1T. Berns, L. Blésin, G. Jeanmart,
Du courage. Une histoire philosophique,
Paris, Les Belles Lettres,
« Encre marine », 2010.

– Gaëlle Jeanmart : « L’efficacité de l’exemple » – p. 5
l’époque Moderne ?
L’objectif de cette réflexion est de comprendre, d’une part, les différents
ressorts de cette mécanique du courage des récits de vie exemplaires, d’autre part, la
pédagogie sur laquelle ils s’appuient pour rendre « plus généreux, plus beau », et,
aurait-on pu ajouter, « plus courageux », et enfin les différentes manières de penser
l’efficacité ou la performativité de l’exemple.
Le thème de l’efficacité de l’exemple renvoie à une évidence : un acte héroïque
ou vertueux aurait de soi, ou plutôt grâce au récit qui en est fait, des potentialités
incitatives incontestables, qu’il faudrait mettre en avant et tenter d’utiliser pour lutter
contre l’impuissance d’un raisonnement, et plus largement de toute théorie, en matière
d’incitation à la pratique vertueuse. On serait tenté ainsi de mettre dos à dos
l’impuissance morale du discours intellectuel, philosophique, du discours de vérité en
somme, et l’efficacité éthique du récit d’aventures, sa puissance de transformation de
l’
éthos
des auditeurs.
La réflexion menée ici a pour but de recadrer cette évidence, c’est-à-dire de la
situer à l’intérieur d’une pensée déterminée de l’exemplarité, qu’on cherchera à
caractériser dans le contraste avec d’autres pensées de l’exemplarité. Cette manière
de recadrer une évidence a pour objectif d’inviter à la prise en considération des
présupposés sur lesquels l’évidence repose et qu’il faudrait assumer dès lors qu’on
veut continuer à y souscrire. Il s’agirait donc ici de développer une pensée critique de
la morale de l’exemple. Non au sens où il faudrait nécessairement renoncer à une telle
morale, mais simplement au sens où il faudrait à tout le moins en assumer
l’épistémologie et l’anthropologie : quelle vision de l’homme, des moteurs de son
action, de sa liberté assume une morale de l’exemple ?
Nous commencerons par répertorier quelques grands modèles
épistémologiques qui ont pris en charge la pensée de l’exemplaire sous des
déclinaisons diverses. Nous tenterons ensuite de proposer pour chaque modèle une
définition qui lui est propre de l’efficacité, de sorte qu’aux différentes conceptions ou
usages de l’exemplarité correspondent également différentes conceptions ou divers
usages de l’efficacité. Cette tentative s’autorise de la manière même dont se sont
formulées les théories de l’exemplarité dans une référence constante malgré leur
diversité à l’efficacité. Il nous faudra donc interroger : l’efficacité a-t-elle un contenu, un
objet : à quoi vise donc l’efficacité dans ces théories et sur quels mécanismes repose
cette efficacité supposée de l’exemple ?
On pense souvent l’exemplarité en termes d’efficacité, mais inversement,
l’exemple est-il un bon terrain pour penser l’efficacité ? Deux éléments permettent de
voir en lui une bonne clé de lecture pour décrire les modèles de l’efficacité : d’une part,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
1
/
210
100%