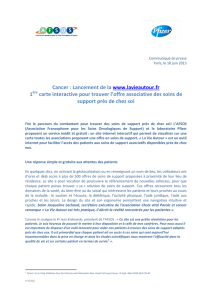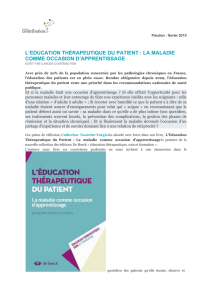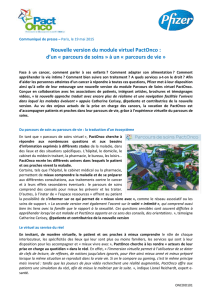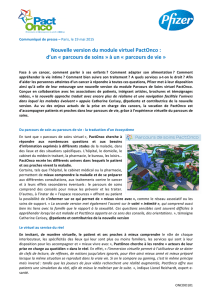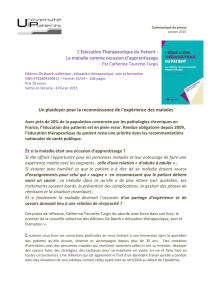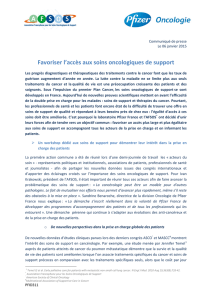l’essentiel 6 Forum Patients Pfizer edito

l’essentiel
6ème Forum Patients Pfizer
Moments forts et synthèse des débats • 21 novembre 2013 • Paris
edito
Ce Forum, chaque année très
attendu, confirme la volonté de Pfizer
de prendre en compte le besoin des
patients et de leurs attentes. De fait,
il nous est indispensable de
comprendre la maladie et son vécu
pour apporter des réponses
adaptées aux patients.
Pfizer s’engage à favoriser le bon
usage mais aussi à soutenir
l’information pouvant aider les
professionnels de santé et les
patients. Aujourd’hui, les patients
affirment de plus en plus leur besoin
d’autonomie, de connaissance et de
logique de parcours et d’accompa-
gnement ; ils deviennent acteurs de
leur prise en charge et équilibrent
leur relation avec les professionnels
de santé qui les entourent.
Tout au long de l’après-midi, interve-
nants et personnes présentes dans
le public ont donc échangé sur les
questions liées au concept du
patient acteur : comment le
devient-on ? Est-ce synonyme
d’autonomie ? L’autonomisation
est-elle un objectif de soins ou un
objectif social ?
Avec ce forum, nous espérons avoir
contribué à la réflexion et à la sensi-
bilisation à cet enjeu.
Myriam Jabri
Responsable Relations Patients Pfizer
Le patient acteur :
accompagnement et autonomie
Définir pour comprendre…
En ouverture du Forum, Madame Catherine Tourette-Turgis, maître de
conférences à l’Université Pierre et Marie Curie, a identié trois degrés
d’accompagnement selon l’état d’autonomie de l’accompagné. Tout
d’abord celui de type counseling, qui suppose une autonomie suf-
sante pour que la personne exprime clairement une demande ; ensuite
l’accompagnement de guidance, pour une personne momentanément
fragilisée ; enn l’accompagnement de portage, impliquant la prise en
charge provisoire d’une personne en situation difcile, irréversible.
Pour Mme Tourette-Turgis, l’accompagnement est à différencier du coa-
ching, qui implique un objectif de performance, et à différencier de la
médiation, qui peut être sociale, thérapeutique. “L’accompagnement
englobe trois concepts clés : la socialisation, qui touche à la fragilité, l’ex-
clusion… ; l’autonomisation, avec le débat actuel de redéfinition de l’ob-
jectif du développement des êtres humains, et la prise de conscience que
nous sommes tous aujourd’hui interdépendants les uns des autres et vul-
nérables ; et enfin, l’individualisation. Ces trois concepts cristallisent les
enjeux sociaux, produisent des tensions, et influencent les postures pro-
fessionnelles, dans la mesure où accompagner l’autre revient à prendre
position dans l’espace social, à adopter une posture où l’accompagna-
teur renonce provisoirement à sa position d’expert, en privilégiant une re-
lation centrée sur l’écoute, au détriment d’une verticalité hiérarchique”.
Le patient-acteur est-il compatible avec la notion d’accompagnement
dans le parcours de soins ? Pour Mme Catherine Tourette-Turgis, la
réponse est évidente : “Il faut savoir qu’on accompagne toujours
des sujets acteurs, au sens où tout sujet, quelle que soit sa situa-
tion, est un être qui agit, réagit, sou-
haite, expérimente. J’affirme que les
malades conduisent chaque jour des
activité invisibilisées, dépourvues de
reconnaissance et de valorisation so-
ciale, au service du maintien de leur
santé, et que les aidants et proches
agissent également pour aider les per-
sonnes dépendantes à se maintenir en
vie, dans le cadre d’une délégation du
souci de soi à autrui”.

6ème Forum Patients Pfizer• 2 •
“Patient acteur” & accompagnement
Focus
L’accompagnement est non seulement multi-
fatoriel mais il est également multi-acteurs. De
l’entourage familial aux médecins spécialistes,
en passant par l’inrmier, le médecin trai-
tant ou encore le pharmacien, chaque acteur
de santé tient un rôle spécique et la notion
même d’accompagnement peut varier selon
celui-ci.
Ainsi pour Monsieur Martial Fraysse,
Président du Conseil Régional de l’Ordre des
pharmaciens d’Ile-de-France : “Les pharma-
ciens sont répartis de façon optimale sur le
territoire, et présentent un accès facile et des
horaires larges. Ce qui diffère, d’une pharmacie
à une autre, c’est le service d’écoute. Parmi les
sujets jugés majeurs par l’Ordre dans le cadre
du développement personnel continu (DPC), il
y a l’accompagnement. En effet, le pharmacien
n’est plus un simple dispensateur de médica-
ments, et le législateur et les patients attendent
de lui une valeur ajoutée en matière d’accom-
pagnement et d’éducation thérapeutique”.
M. Fraysse a ensuite insisté sur la position
centrale et irremplaçable qu’occupe le
patient, l’usager, dans cette nouvelle dyna-
mique : “Dans le cadre du dossier pharmaceu-
tique mis en place par l’Ordre, le patient est le
moteur et le fournisseur de toutes les données
de santé qui peuvent être exploitées pour amé-
liorer ensuite les pratiques et la prise en charge.
En effet, l’Ordre a pris la décision de mettre le
patient au centre du parcours entre les diffé-
rents professionnels de santé. Parallèlement, le
pharmacien ne peut pas demeurer seul et une
coordination est nécessaire pour améliorer les
choses”. Ainsi, l’entretien pharmaceutique tel
qu’il se dénit aujourd’hui consiste à vérier
les pratiques et l’observance des traitements
des patients. Le médecin traitant est ensuite
contacté, sur l’autorisation du patient, pour
faire un retour d’information sur les problèmes
rencontrés.
“Grâce à l’écoute, on obtient des informations
que l’on peut partager pour améliorer la prise
en charge. Les entretiens pharmaceutiques
peuvent prendre du temps mais j’estime que
cela fait partie de notre action” a ajouté M.
Fraysse.
Rebondissant sur ces propos, Monsieur Alain
Donnart, Président de Alliance Maladies Rares,
a précisé que les pharmaciens sont des acteurs
privilégiés sur ce terrain : en effet, ils sont les
premiers à être contactés et beaucoup de ma-
lades leur posent des questions sur leur patho-
logie. Néanmoins, ils ont encore du mal à orien-
ter les patients vers d’autres professionnels, car
ils ignorent encore, pour beaucoup, l’existence
de centres de référence et de compétences
d’accueil des patients.
“Pour nous, le malade est expert de
sa maladie. Qui peut, mieux que lui,
connaître sa maladie, ses symptô-
mes, ses envies et ses besoins en
termes d’accompagnement, de médi-
caments ?” a poursuivi M. Donnart.
L’Alliance a fait plusieurs constats : à commen-
cer par celui d’une errance de diagnostic, qui
implique que les malades se sentent abandon-
nés. Ils ont beaucoup d’angoisses face aux mé-
decins de ville qui n’arrivent pas à les orienter
vers des spécialistes ; le deuxième constat est
l’insuffisance de coordination entre les profes-
sionnels, le troisième est un manque d’accom-
pagnement, qui implique que près de la moitié

21 novembre 2013 • 3 •
des malades ont besoin d’un soutien psycho-
logique. Enn, le dernier constat est l’absence
de coordination avec le médico-social : cela
se traduit par un manque d’aides, d’informa-
tions, de connaissances sur les maladies rares.
C’est pourquoi l’Alliance défend une proposi-
tion : celle de favoriser la création de réseaux
de prise en charge sanitaires, médico-sociaux
et sociaux.
Mme Tourette-Turgis a ajouté que, pour
certaines pathologies, il y a un vrai retard social
et psycho-social dû à un manque d’implication
et de prise en compte des problèmes rencon-
trés. Selon elle, les associations de malades
doivent assumer un rôle actif auprès des ac-
teurs sociaux.
L’accompagnement est donc du ressort de
l’entourage et des professionnels de santé mais
pas uniquement. Les autres acteurs de santé,
à l’image des laboratoires pharmaceutiques
et des organismes d’assurance, souhaitent
prendre une part plus active dans celui-ci.
Pour Madame Catherine Raynaud, Direc-
teur des Affaires institutionnelles chez Pzer :
“Concernant l’accompagnement, il n’y a pas
encore de cadre vraiment défini, ce qui nous
confère quelques possibilités d’action. D’après
les acteurs concernés, l’accompagnement est
indissociable d’une bonne gestion de la mala-
die, de l’optimisation de la prise en charge et de
l’amélioration de la qualité de vie du patient. Il
faut maintenant privilégier la forme collabora-
tive et partenariale tout au long du parcours”.
A la question de la légitimité de Pzer en
tant que soutien à l’accompagnement, Mme
Raynaud a afrmé que, “de par notre connais-
sance des pathologies et traitements dans
lesquels nous sommes experts, nous devons
être partie prenante de l’accompagnement et
nous mpliquer dans l’amélioration de la prise
en charge, via le bon usage, la prévention des
effets secondaires, ou encore la formation des
professionnels de santé. L’accompagnement
est également une façon, pour Pfizer, de pas-
ser d’une industrie pharmaceutique à une in-
dustrie de la santé, et d’une offre produit à une
offre thérapeutique”.
Mme Raynaud a cité l’exemple de la ques-
tion de l’observance : “Beaucoup d’études
montrent que la non-observance concerne 30
à 60% des prescriptions. Cela engendre une
aggravation de la maladie et 10% d’hospitali-
sations supplémentaires et représente un coût
substantiel pour le système de soins. En effet,
selon l’IMS, la non-observance coûte 500 mil-
liards de dollars par an dans le monde et 30
milliards en France. Le fait de travailler sur un
meilleur usage du médicament contribue à l’ef-
ficience du parcours, l’amélioration de la qua-
lité de la prise en charge et la mise en avant
de la juste efficacité d’un traitement. Au final,
nous devons bien entendu être impliqués dans
l’accompagnement, et cela doit être reconnu
et soutenu”.
Madame Véronique Lacam-Denoël, Directrice
Services médicalisés et e-santé chez Malakoff
Médéric, a, elle aussi, répondu à la question
de la légitimité de l’implication d’organismes
d’assurance : “C’est un rôle récent et peu dé-
veloppé, que l’on mène encore sous la forme
d’expérimentations, même s’il est vrai que les
mutuelles ont toujours fait de la prévention.
Le contexte particulier de la protection sociale
et de la complémentaire santé nous pousse à
nous impliquer. Notre objectif est de ne pas
simplement rembourser les frais de santé, mais
également de proposer des actions en amont
pour réduire la survenue des pathologies et
complications”.
Selon Mme Lacam-Denoël, la légitimité de
Malakoff Médéric tient dans sa position de
• “Patient acteur” & accompagnement •

6ème Forum Patients Pfizer• 4 •
partenaire naturel des entreprises pour la cou-
verture santé des salariés. De plus, l’entreprise
représente une opportunité idéale pour déve-
lopper des actions de prévention, de dépistage
et d’accompagnement, permettant de toucher
une large population et de cibler plus spéci-
quement certains critères.
Ainsi, le programme de dépistage de
l’hypertension en entreprise, appelé Vigisanté,
a été déployé dans 50 entreprises, auprès de 22
000 salariés concernés par le dépistage, et 700
d’entre eux orientés vers leur médecin traitant
pour conrmer le diagnostic. Les taux de satis-
faction des participants atteignent les 85%, et
la majorité des médecins traitants afrment
que les patients ont tiré un vrai bénéce mé-
dical de ce programme, avec un changement
de comportement santé dans près de 70% des
cas. Le programme Vigisanté a, dès le départ,
intégré les patients, et devrait prochainement
les intégrer davantage en amont.
Pour Mme Lacam-Denoël “Il reste encore
des progrès à faire, principalement
sur l’adaptation du programme au
profil et aux motivations de chacun,
et sur l’élargissement à d’autres
pathologies”.
Suite à cet exemple très concret, M. Donnart a
mis en exergue les actions d’Alliance Maladies
Rares : “Grâce aux actions de l’Alliance, neuf
pathologies rares disposent maintenant d’un
programme d’ETP agréé par les ARS. 80% des
associations de malades souhaitent s’investir
dans l’ETP, et 90% souhaitent que l’Alliance
les accompagne dans l’élaboration de leur pro-
jet ETP. Notre objectif est de promouvoir l’ETP
dans les maladies rares et de développer la
transversalité de ces programmes”.
Malgré l’existence de nombreux blocages,
au niveau des ARS et du Ministère, les choses
réussissent à avancer depuis peu, a témoigné
M. Donnart, avec notamment l’organisation de
colloques en région, grâce à l’action des asso-
ciations implantées sur ces territoires.
Pour sa part, Mme Raynaud a présenté le
programme d’accompagnement PACT Onco,
lancé en 2011, qui vise à informer les différents
acteurs du parcours de soins oncologique, de
l’hôpital au domicile, en passant par le mé-
decin traitant et le pharmacien. La logique
d’accompagnement de PACT Onco concerne
les professionnels de santé, et vise à favoriser
le bon usage, à soutenir l’information utile à
leur pratique quotidienne et à développer des
liens avec eux pour assurer une continuité des
soins, à l’aide d’outils tels que des formations,
sites internet, livrets mis à leur disposition. Pour
Mme Raynaud, les programmes du type PACT
Onco peuvent s’adapter à toutes les patho-
logies, selon les besoins d’accompagnement
exprimés par les malades. Néanmoins, cela né-
cessite un cadre plus souple.
Mme Tourette-Turgis a, à son tour, présenté
ses actions exemplaires mises en place : “Les
malades sont producteurs de savoir et d’ex-
pertise. J’ai donc réservé 30% des places dans
les diplômes d’ETP que je dirige aux malades.
C’est une première en France, une équipe
pédagogique mixte composée en partie de
malades qui enseignent. Nous avons actuel-
lement 93 malades concernés. Le but est de
pouvoir développer ces cursus diplômants dans
d’autres universités”.
Selon Mme Tourette-Turgis, le problème de
l’accompagnement est qu’il est actuellement
assuré par les proches et l’entourage, des per-
sonnes dont ce n’est pas le métier initial. Ils le
font sans reconnaissance sociale et sans valo-
risation économique. “Toute personne formée
peut être accompagnateur. Il faut maintenant
réfléchir à la façon de matérialiser une recon-
naissance sociale et une valorisation écono-
mique”.
Mme Tourette-Turgis a clôturé la première table
ronde : “Il faut réussir à faire avancer la
démocratie sanitaire en même temps
que la démocratie clinique. Une chose
est sûre : si l’on veut faire reconnaître
l’accompagnement, chacun doit s’y
mettre, à son échelle”.
• “Patient acteur” & accompagnement •

21 novembre 2013 • 5 •
Monsieur Patrick Malléa, Directeur du CNR
Santé à domicile et Autonomie, a introduit la
seconde table ronde dédiée à l’autonomie.
Selon lui, l’autonomie est un enjeu clé, car il
représente le seul sujet d’innovation dont nous
disposons encore. Comparé au progrès techno-
logique qui se fait tout seul, et qui a envahi nos
vies et modié nos comportements, le terrain
qui reste à gagner est celui de l’autonomie.
De fait, il est assez facile d’imaginer ce qui peut
améliorer l’avenir, mais il faut consacrer du
temps et des moyens pour mettre en œuvre ces
idées. De plus, l’innovation la mieux à même
d’améliorer la qualité de vie, c’est bien celle de
la loi, a-t-il précisé. “Nous devons être vigilants
là-dessus. On prescrit un certain nombre de
règles qui deviennent exécutables et qui créent
de nouvelles valeurs permettant de vivre dans
ce système compliqué. L’innovation que nous
voulons a un coût, elle ne peut pas être juste
transposée en essayant d’inventer un nouveau
mot à la mode”.
M. Malléa a insisté sur la nécessité de
vigilance face aux changements qui sont amor-
cés pour améliorer l’autonomie. En particulier
dans le contexte des débats à venir sur l’adop-
tion d’une loi pour faire face aux enjeux du
vieillissement. Selon lui, une partie des prélè-
vements sociaux devrait nancer l’innovation
et les changements nécessaires, plutôt que de
réformer dans le vide.
Pour M. Malléa : “L’innovation, c’est une
nouveauté popularisée. En effet, si quelques
personnes prennent conscience de ce qui
peut être bien et bénéfique pour des millions
d’autres personnes, la question qui se pose
est : comment faire pour mettre à disposition
de millions de personnes le savoir de quelques
uns, via un simple projet ?”.
Pour progresser individuellement, l’appareil
collectif doit permettre aux usagers d’exercer
cette nouvelle connaissance ; cela passe par
l’intégration, dans les organisations, des mé-
tiers liés au patient expert et à l’ETP. Le CNR
Santé représente un moyen de réponse aux
enjeux actuels liés à l’autonomisation indivi-
duelle.
Les technologies permettent de populariser
les services dont les usagers ont besoin, en
garantissant qu’elles fonctionnent bien au
moment où elles sont nécessaires. Ces techno-
logies représentent des ponts reliant chaque
usager dans sa case individuelle, et sont
vecteurs de réponses urgentes. Pour nir cette
présentation, M. Malléa a afrmé : “Le secteur
de la santé ne pourra pas résister longtemps à
la volonté des citoyens de gagner en autono-
mie. Et si l’autonomie souhaitée ne peut pas
s’obtenir par la porte classique, la réponse
devra faire appel aux nouvelles technolo-
gies que nous avons financées. Nous avons la
responsabilité de trouver des réponses”.
En regard du point de vue de M. Malléa,
Monsieur Bernard Auchère, de la Fédération
nationale de malades France AVC, a donné sa
vision, en tant que patient, de la notion d’auto-
nomie : “Il faut d’abord savoir que l’autonomie
n’est jamais totale, elle n’est que partielle. Elle
dépend entièrement de la notion de prise de
risques et de volonté de la part du malade?”.
“Patient acteur” & autonomie
Focus
• “Patient acteur” & autonomie •
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%