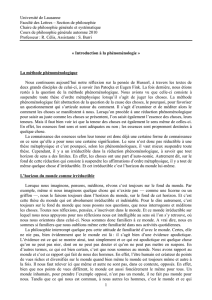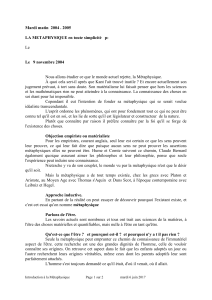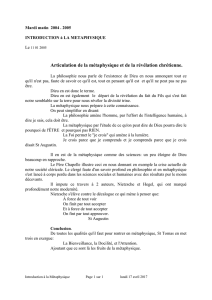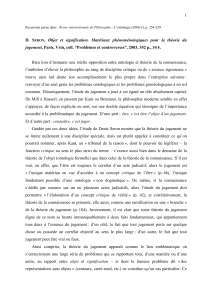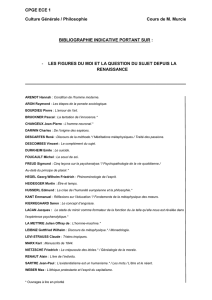Bulletin d’analyse phénoménologique

Bulletin d’analyse
phénoménologique
Revue électronique de phénoménologie publiée par l’unité de recherche « Phénoménologies » de
l’Université de Liège
Volume I, numéro 2 http://www.bap.ulg.ac.be/index.htm
Septembre 2005 ISSN : 1782-2041
Sommaire
Denis SERON
Métaphysique phénoménologique 3-173


Métaphysique
phénoménologique
1. Métaphysique systématique et métaphysique constitutive...................................12
2. Méthode.............................................................................................................................28
3. Le paradoxe de l’analyse ..............................................................................................40
4. L’idéalisme phénoménologique..................................................................................51
5. Catégories.........................................................................................................................63
6. La définition de la vérité et l’idée d’une théorie de la constitution....................67
7. Domaines thématiques...................................................................................................79
8. Les relations de dépendance ontologique.................................................................87
9. Le parallélisme logico-ontologique............................................................................94
10. (suite) Autres remarques sur le parallélisme logico-ontologique...................105
11. Critique de la théorie des états de choses d’Armstrong....................................113
12. Les états de choses négatifs et le problème du maximalisme.........................129
13. Les universaux sont-ils des objets dépendants ou indépendants ?.................148
14. Faut-il naturaliser les états de choses ?.................................................................152
15. La structure des états de choses..............................................................................164
Bibliographie......................................................................................................................169
D. Seron, « Métaphysique phénoménologique », Bulletin d’analyse phénoménologique, I/2, septembre 2005, p. 3-173

Le but de cette étude est de tracer quelques lignes directrices en
vue d’une application de la méthode phénoménologique en méta-
physique. Ma conviction initiale est que la phénoménologie n’est
d’abord ni une doctrine, ni un « mouvement », mais une méthode, et
que cette méthode peut servir à résoudre certains problèmes métaphy-
siques. La phénoménologie n’est pas tout d’abord un ensemble de
thèses qu’on pourrait tenir pour vraies ou rejeter comme fausses,
démontrer ou réfuter, etc., mais bien une attitude de recherche. Une
telle attitude doit alors être distinguée des résultats qu’elle permet
d’atteindre. Elle ne serait ni vraie ni fausse, mais elle pourrait être
qualifiée d’efficace ou d’inefficace, de valide ou de non valide, etc.
Évidemment ce point de vue doit être nuancé. La pratique de la
phénoménologie comme méthode s’accompagne nécessairement d’un
certain nombre de croyances, qui peuvent éventuellement être justi-
fiées par la recherche phénoménologique elle-même. On ne peut pas
dire sans plus que la phénoménologie serait une méthode ni vraie ni
fausse, donc indémontrable et irréfutable, mais la phénoménologie est
une méthode qui repose sur un certain nombre de thèses : la connais-
sance est possible, il existe un donné phénoménal et ce donné phéno-
ménal est connaissable, etc.
Quoi qu’il en soit, ce caractère méthodique de la phénoménologie
engendre certaines conséquences fondamentales. En particulier, quand
on parle de méthode, on a généralement en vue une méthode pour.
Une méthode, c’est quelque chose qui sert à quelque chose. Une
méthode sert à atteindre quelque chose et elle se définit ainsi par une
finalité déterminée. Or la phénoménologie, prise comme une méthode,
présente sur ce point une particularité qui doit être soulignée : c’est
qu’elle n’a pas sa finalité en elle-même. Les méthodes utilisées en
mathématique ou en psychologie servent à résoudre des problèmes de
mathématique ou de psychologie. Mais il n’en est pas ainsi de la
phénoménologie. Celle-ci ne sert pas d’abord à résoudre des
problèmes de phénoménologie, mais à répondre à certaines questions
de nature philosophique.

METAPHYSIQUE PHENOMENOLOGIQUE
D. Seron, « Métaphysique phénoménologique », Bulletin d’analyse phénoménologique, I/2, septembre 2005, p. 3-173
5
La phénoménologie est ainsi une méthode philosophique, une
méthode en vue de la philosophie. Qu’est-ce que cela signifie ? Il faut
encore s’entendre sur ce que signifie philosophie. Le terme de
philosophie a connu d’innombrables significations au cours des
siècles, mais la philosophie ne doit pas pour autant rester une idée
ambiguë et mystérieuse qu’on ne prendrait plus la peine de définir.
Nous pouvons adopter dès le départ une définition minimale de la
philosophie. D’abord, nous dirons que philosophie est une abréviation
pour philosophie première. La philosophie est en ce sens l’épistémé
prôté, la science qui vient avant toutes les autres sciences. En d’autres
termes, la philosophie est la science qui est présupposée par toutes les
autres sciences. Que veut dire présupposition ? Cette conceptualité a
son origine dans la théorie platonico-aristotélicienne de la division.
Diviser un genre, c’est le spécifier en lui adjoignant des différences.
Par exemple quand j’ajoute la différence « motorisé » au genre
« véhicule », je produis deux espèces du genre véhicule, à savoir
« véhicule motorisé » et « véhicule non motorisé ». C’est en référence
à ce schéma de la division que la philosophie est qualifiée tradition-
nellement de science première. Ce qui est plus général – donc le genre
relativement à ses espèces – est antérieur au sens où il vient avant
dans l’ordre de la division. D’où, à plus forte raison, ce qui est le plus
général est antérieur à tout le reste, donc premier. La philosophie est
une science première au sens où elle a affaire au genre ou aux genres
premiers, les plus généraux, à un genre ou à des genres dont tous les
autres genres sont des espèces. En termes scolastiques, la
connaissance philosophique est une connaissance transcendantale. Ce
qui veut dire : une connaissance qui se rapporte à un ou plusieurs
genres qui transcendent tous les autres genres. Chez Aristote, ce genre
est le genre de l’étant en général – de l’ousia – avec ses différences.
Ainsi la physique n’est pas la science première, parce qu’elle se
rapporte à l’étant mobile, qui est une espèce de l’étant en général. Elle
est une « philosophie seconde » postérieure à la science de l’ousia en
général, etc.
Mais en quel sens parle-t-on alors de présuppositions ? Pourquoi
doit-on dire ici que la philosophie première serait présupposée par les
autres sciences, par exemple par la physique ? Cette problématique de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
1
/
173
100%