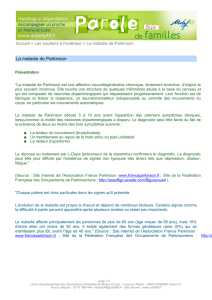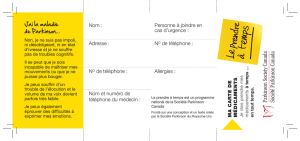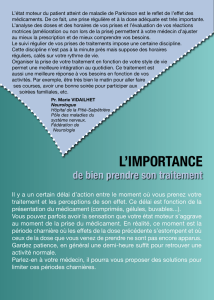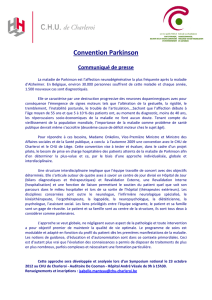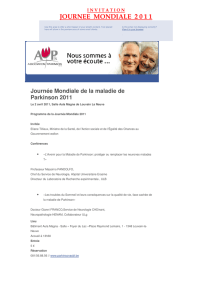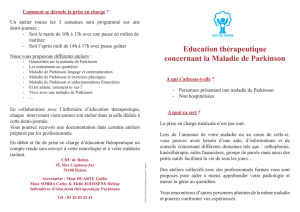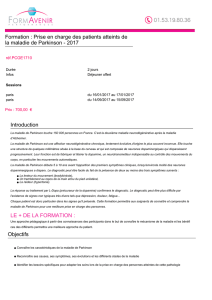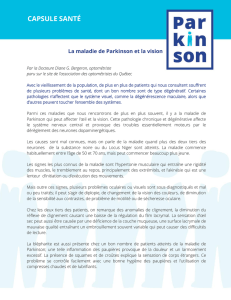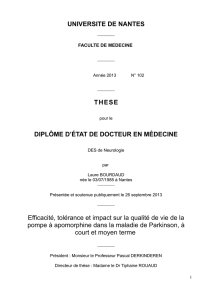biblio-opinion Biblio- Opinion D

La maladie
de Parkinson et les
autres syndromes
parkinsoniens
Le diagnostic de mala-
die de Parkinson est un
diagnostic clinique,
puisque nous ne dispo-
sons à l’heure actuelle
d’aucun examen de
routine qui nous per-
mette d’avoir une certi-
tude diagnostique. Si le
plus souvent, pour le neurologue, le
diagnostic ne pose pas de problème, il
est des cas où les atypies cliniques font
mettre en doute le diagnostic.
Certains examens, comme l’étude des
mouvements oculaires ou l’électro-
myographie sphinctérienne anale, peu-
vent l’orienter mais parmi les examens
facilement accessibles, il y a l’IRM
dont l’indication reste discutée.
L’article de A. Schrag (1), sur les ano-
malies IRM que l’on peut voir dans les
syndromes parkinsoniens autres que la
maladie de Parkinson, est fort intéres-
sant, car il refait le point sur 35 cas de
paralysie supranucléaire progressive
(PSP), 54 cas d’atrophie multisystéma-
tisée (MSA) et 5 cas de dégénérescen-
ce cortico-basale (DCB). Les princi-
pales anomalies retrouvées et
discriminantes sont rassemblées dans
le tableau ci-contre. D’après les
auteurs, les signes IRM sont plus dicri-
minants pour différencier PSP et MSA-C
(ancienne atrophie olivopontocérébel-
leuse). En effet, 70 % des
PSP et 80 % des MSA-C
sont reconnues comme
telles et classées correc-
tement (aussi bien avec
une IRM de 0,5 Tesla
qu’avec 1,5 Tesla). Le
diagnostic radiologique
est plus délicat lorsqu’il
s’agit de MSA-P (ancien-
ne dégénérescence stria-
to-nigrique, avec seule-
ment 50 % de bon
classement). Dans le cas
de DCB, les auteurs
n’ont pas mis en éviden-
ce d’anomalie bien évocatrice, l’atro-
phie corticale diffuse ne pouvant être
considérée comme spécifique. Dans
Act. Méd. Int. - Neurologie (1) n° 2, mai 2000 63
* Service de neurologie,
hôpital Delafontaine, Saint-Denis.
Dans “Biblio-opinion”, nous vous exposons chaque mois, la
bibliographie non exhaustive et commentée d’articles
parus sur un thème donné de la neurologie.
Les hasards du calendrier ont fait coïncider, à quelques
semaines près, le choix de la maladie de Parkinson, avec une
conférence de consensus qui lui a été consacrée
le 3 mars dernier. Pour passionnant qu’il soit, le compte rendu
d’une telle manifestation n’entre pas dans le cadre d’une
rubrique plus orientée vers l’actualité factuelle.
C’est donc, par propos délibéré, et non par omission, que nous
avons choisi de n’en point parler.
biblio-opinion
Biblio-Opinion
Parkinson hors consensus
S. Sangla*
Synthèse
thématique
d’articles
commentés
PSP MSA-P MSA-C
Diamètre des pédoncules Hypersignal putaminal Dilatation
<17 mm sur coupes axiales (bord externe) du 4e ventricule
Hypersignal pédonculaire Hypersignal putaminal* Atrophie du bulbe,
noyau dentelé,
pédoncules cérébelleux moyens
pont, olives
Dilatation du 3eventricule Atrophie du noyau dentelé Hypersignal dans le cervelet,
pédoncules cérébelleux moyens,
pont (aspect en croix), olives
Atrophie temporale ou frontale Dilatation du 4eventricule
Hypersignal dans le pallidum* Augmentation du signal
dans le cervelet,
les pédoncules cérébelleux
moyens, le pont
(en forme de croix)
Atrophie ou hypersignal
du noyau rouge
* visible sur un 0,5 Tesla uniquement.
PSP : Paralysie supranucléaire progressive.
MSA-P : MSA avec signes parkinsoniens prédominants.
MSA-C : MSA avec signes cérébelleux prédominants.
Tableau. Anomalies de l’IRM dans les syndromes parkinsoniens.

Act. Méd. Int. - Neurologie (1) n° 2, mai 2000 64
l’étude, il y avait trop peu de cas de
DCB (5 cas) pour tirer des conclusions.
Cet article a le mérite de nous rappeler
qu’il existe tout de même quelques ano-
malies que l’on peut facilement voir sur
une simple IRM et qui peuvent nous
orienter vers un diagnostic plutôt qu’un
autre.
Bien que le plus rare des syndromes par-
kinsoniens atypiques (incidence exacte
inconnue), la dégénérescence cortico-
basale est très en vogue, car elle fait la
jonction entre les démences et les syn-
dromes parkinsoniens. C. Özsancak (2),
dans la Revue neurologique, a fait un
excellent travail de synthèse de littératu-
re sur le sujet, depuis 1968, date de la
première description par Rebeiz, en étu-
diant les 398 cas colligés depuis lors.
L’affection débute vers 60 ans, avec une
présentation asymétrique, dans deux
tiers des cas, au membre supérieur, le
plus souvent décrite comme une mal-
adresse. Les signes cardinaux sont pré-
sents en 2 à 5 ans, associant des signes
corticaux et sous-corticaux qui restent
toujours asymétriques (le syndrome par-
kinsonien étant clairement doparésis-
tant). L’évolution se fait vers un état gra-
bataire et un décès en 6 à 8 ans. Aucun
examen complémentaire n’est réelle-
ment discriminant, seul l’examen anato-
mopathologique du cerveau permet le
diagnostic, mais trop tard pour que le
patient puisse en retirer un bénéfice ; de
toute façon, les médicaments proposés
sont généralement inefficaces. L’article
de Özsancak est une bonne synthèse
où l’on trouvera les réponses aux
questions posées sur cette affection.
P. S. Mathuranath et coll. (3) ont étudié
la DCB à partir de deux cas cliniques
atypiques qui en imposaient pour une
démence fronto-temporale et qui ont été
affirmés par l’autopsie (l’autopsie a per-
mis de redresser un AS). Cet article per-
met de voir la DCB par son aspect
démentiel et non extrapyramidal avec
une étude nosologique des différentes
démences non-Alzheimer et une
approche nosologique des affections
neurodégénératives et de leurs fron-
tières.
1. Schrag A., Good D.C., Miszkiel K.
et coll. Differentiation of atypical
Parkinsonian syndromes with routine MRI.
Neurology 2000 ; 54 : 697-702.
2. Özsancak C., Auzou P., Hannequin D. La
dégénérescence corticobasale. Rev Neurol
1999 ; 155 : 12, 1007-20.
3. Mathuranath P.S., Xuereb J.H., Bak T.,
Hodges J.R. Corticobasal ganglionic dege-
neration and/or frontotemporal demential ?
A report of two overlap cases and a review
of the literature. J Neurol Neurosurg
Psychiatry 2000 ; 68 : 304-12.
Influence de la grossesse
sur la maladie de Parkinson
Les patientes parkinsoniennes en âge de
procréer sont rares mais pas exception-
nelles et, surtout dans les Parkinson
juvéniles, elles ont toutes les chances
d’avoir déjà un traitement antiparkinso-
nien que l’on pourra être amené à modi-
fier. L’article de L. Shulman (4) rappor-
te l’histoire d’une grossesse chez une
femme de 33 ans avec une maladie de
Parkinson évoluant depuis 3 ans, traitée
par carbidopa/lévodopa. Le déroule-
ment de la grossesse ainsi que l’accou-
chement n’ont pas été mentionnés, l’en-
fant est dit normal à 2 ans. La maladie,
quant à elle, s’est aggravée durant la
grossesse. Elle a eu une dépression du
postpartum nécessitant un traitement
spécifique. Quinze mois après l’accou-
chement, elle n’a pas retrouvé son état
antérieur à la grossesse. L’association
carbidopa/lévodopa ne semble pas
avoir d’effet sur le fœtus, le bensérazi-
de et la carbidopa ne passent pas la bar-
rière fœtomaternelle, la lévodopa est
métabolisée par le fœtus sans retentis-
sement apparent. L’amantadine est
tératogène, surtout en début de grosses-
se, malgré le petit nombre de cas
publiés (4), elle est à éviter. Le pergoli-
de, la bromocriptine, le lisuride n’ont
pas montré de risque particulier chez
des femmes traitées mais qui n’étaient
pas parkinsoniennes. Le mécanisme de
l’aggravation clinique de la maladie de
Parkinson n’est pas connu. On sait que
les œstrogènes entraînent une baisse
des besoins en dopamine du fait de l’in-
hibition de la catéchol-O-méthyltrans-
férase (COMT), mais cela n’expli-
querait qu’une aggravation du
postpartum. D’après l’article, la gros-
sesse aurait donc un effet aggravant non
réversible sur la maladie de Parkinson,
la dopathérapie et les agonistes dopami-
nergiques peuvent être poursuivis sans
risque tératogène particulier.
4. Schulman L.M., Minagar A.,
Weiner W.J. The effect of pregnancy in
Parkinson’s disease. Movement disorders
2000 ; 15 : 132-5.
Une possibilité thérapeutique
dans les douleurs
de la maladie de Parkinson
L’apomorphine est le plus puissant des
agonistes dopaminergiques, mais c’est
un antiparkinsonien mal aimé. Est-ce
son nom qui rappelle la morphine (avec
laquelle il n’a rien à voir) qui fait peur,
ou le fait qu’elle soit injectable, et que
les médecins, comme leurs patients,
n’aiment pas les piqûres ? Toujours est-
il que c’est un excellent médicament et
qu’il a une place dans le traitement de
la maladie, comme nous le rappelle
Steward Factor (5). Dans cet article, il
rapporte l’efficacité d’injections quoti-
diennes d’apomorphine sur les douleurs
rebelles et tenaces chez une patiente de
75 ans ayant une maladie de Parkinson
évoluant depuis treize ans. Elle présen-
biblio-opinion
Biblio-Opinion

65
te des douleurs thoraciques atroces
durant certains épisodes off, évoluant
depuis sept ans et ayant résisté à tous
les changements thérapeutiques dans le
cadre de la maladie, mais aussi aux très
nombreux traitements antalgiques pro-
posés. On ne comprend pas bien la phy-
siopathologie de ses douleurs, ni la
logique des traitements proposés
puisque initialement, c’était un sevrage
en dopa et en fin de compte un agonis-
te dopaminergique. On est aussi un peu
étonné qu’il ait fallu sept ans pour pro-
poser l’apomorphine. Mais seul compte
le résultat, car la patiente était suicidai-
re, avec des attaques de panique liées
aux douleurs et avec le traitement, elle a
pu reprendre une vie sociale. Trois ans
et demi après, les douleurs sont tou-
jours là, mais calmées en quelques
minutes par l’apomorphine. Face à des
douleurs en phase off, même très inha-
bituelles, après avoir optimisé le traite-
ment antiparkinsonien, il faut penser à
la possibilité d’une amélioration par
l’apomorphine.
5. Factor S.A., Brown D.L., Molho
E.S. Subcutaneous apomorphine
injections as a treatment for intractable pain
in Parkinson disease. Movement disorders
2000 ; 15 : 167-9.
Parkinson :
retour de bistouri
Le traitement de la maladie de
Parkinson a d’abord été chirurgical,
avec, dans les années 50, le développe-
ment de la chirurgie lésionnelle, thala-
motomies, pallidotomies et même sub-
thalamotomies. L’avènement de la
dopathérapie, à la fin des années 60,
entraîna un net déclin de la chirurgie,
car on pensait alors avoir trouvé le trai-
tement de la maladie de Parkinson. La
survenue de complications à distance
de la maladie traitée et les difficultés à
gérer celles-ci au fil du temps, la
découverte d’un modèle expérimental
de la maladie avec le MPTP ont permis
à la chirurgie de retrouver une place
dans la thérapeutique de la maladie de
Parkinson. Il a fallu néanmoins
attendre les années 90 pour voir réap-
paraître des publications sur la chirur-
gie de Parkinson avec des techniques
lésionnelles, mais aussi des stimula-
tions cérébrales profondes, elles aussi
thalamiques initialement, puis palli-
dales internes et sous-thalamiques. La
polémique entre les partisans de la chi-
rurgie lésionnelle et ceux de la stimula-
tion est toujours d’actualité dans la lit-
térature anglo-saxonne. Pour ce qui est
de la France, l’équipe grenobloise
semble avoir convaincu tout le monde
de la suprématie de la stimulation bila-
térale du noyau sous-thalamique par
rapport aux autres méthodes. D.
Caparros-Lefebvre (6) a essayé de
comprendre pourquoi les résultats cli-
niques sur le tremblement et les dyski-
nésies provoquées par la L-Dopa de
deux équipes (à Grenoble et à Lille)
étaient différents, alors que les tech-
niques de stimulation chronique du tha-
lamus semblaient identiques. C’est en
fait que la position des plots actifs des
électrodes ne sont pas les mêmes ; les
plots lillois stimuleraient le noyau cen-
tro-médian et parafasciculaire, alors
que les grenoblois stimuleraient le
noyau ventral intermédiaire. Le rôle du
noyau parafasciculaire et ses
connexions avec le noyau sous-thala-
mique sont évoqués, expliquant ainsi
les meilleurs résultats lillois sur les
dyskinésies. L’intérêt pour la compré-
hension de la physiopathologie des
dyskinésies de milieu de dose de cet
article est certain ; pour ce qui est de la
cible à choisir, la polémique n’est sûre-
ment pas au sein du thalamus, car la
stimulation sous-thalamique donne de
meilleurs résultats sur les dyskinésies
mais également sur la triade de la mala-
die, avec l’avantage de pouvoir être
bilatérale. A. Schrag (7), encore lui,
dans un autre article, rapporte les résul-
tats à un an de la pallidotomie unilaté-
rale chez 20 patients. L’amélioration
des dyskinésies controlatérales à la
lésion persiste, avec encore 55 % de
bons résultats à 1 an. Toutefois, les
autres paramètres améliorés à 3 mois
ont perdu leur pertinence à 1 an. La
morbidité (4 complications graves et
10 mineures) et la mortalité (2 décès)
sont assez élevées, ce qui, compte tenu
du bénéfice qui a perdu 12 % en neuf
mois, ne nous encourage pas à proposer
cette solution thérapeutique. Cela dit, il
est important de publier les résultats de
toutes les études, afin de nous per-
mettre de proposer à chaque patient la
chirurgie qui lui sera la plus bénéfique.
6. Caparros-Lefebvre D., Blond S.,
Feltin M.P. et coll. Improvement of
levodopa induced dyskinesias by thalamic
deep brain stimulation is related to slight
variation in electrode placement : possible
involvement of the centre median and para-
fascicularis complex. J Neurol Neurosurg
Psychiatry 1999 ; 67 : 308-14.
7. Schrag A., Samuel M., Caputo E. et coll.
J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999 ; 67 :
511-7.
biblio-opinion
Biblio-Opinion
1
/
3
100%