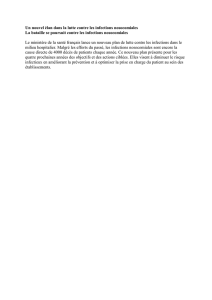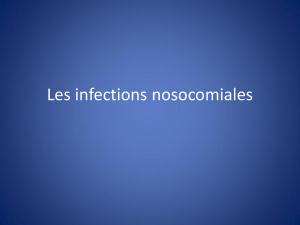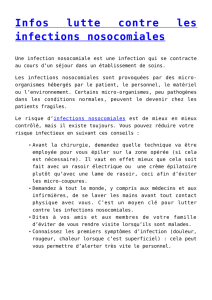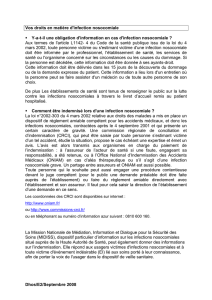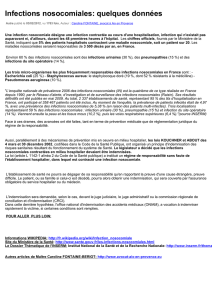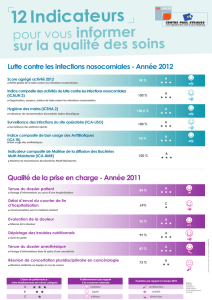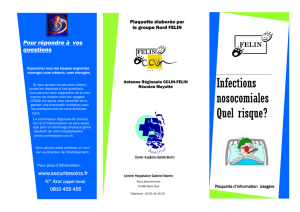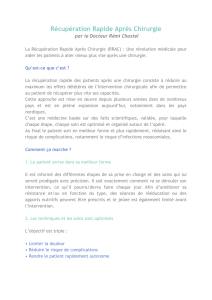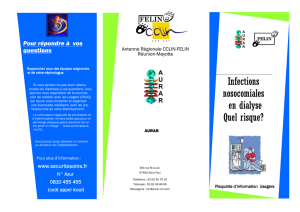Régime d`indemnisation

Olivier Saumon
Avocat au Barreau de Paris
Ancien membre du Conseil de l’Ordre
12 rue d’Astorg – 75008 Paris
http://www.vatier-associes.com
L’indemnisation des infections nosocomiales en
France

Importance du phénomène
Selon la dernière enquête menée par l’Institut de veille sanitaire (InVS) en 2006, 4,97 % des
patients pris en charge dans 2 337 établissements de santé (soit environ 95 % des lits
d’hospitalisation) présentaient une voire plusieurs infections nosocomiales, soit 1 patient sur 20.
Par rapport à 2001, ce taux a diminué de 8 %.
Les infections urinaires (30,3 %) sont les plus fréquentes devant les pneumopathies infectieuses
(14,7 %) et les infectons du site opératoire (14,2 %). Sont ensuite touchées la peau et les tissus
mous (10,2 %), puis les voies respiratoires supérieures (6,4 %).
Les trois micro-organismes les plus fréquemment responsables des infections nosocomiales en
France sont Escherichia coli (25 %), Staphylococcus aureus (19 %, dont 52 % résistants à la
méticilline) et Pseudomonas aeruginosa (10 %).
À l’échelle mondiale, l’OMS (2008) estime que 1,4 million de personnes souffrent à tout
moment d’une infection contractée à l’hôpital. Les prévalences maximales sont rapportées en
Méditerranée orientale (11,8 %), en Asie du Sud-Est (10,0 %) et en Pacifique occidental (9,0 %).

I. Définition des infections nosocomiales
1. La notion d’infection nosocomiale
- Absence de définition de la notion dans la loi n°2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
-En l’absence de définition épidémiologique de la notion d’infection
nosocomiale, l’utilisation de cette notion renvoi à son sens étymologique, en
l’occurrence à celui d’événement directement imputable à une pratique ou une
prise en charge de soins.

Toutefois, certaines tentatives de définitions de la notion d’infection nosocomiale peuvent être
citées, notamment celles prévues dans :
•Une circulaire de 1988 relative à l'organisation de la surveillance et de la prévention des
infections nosocomiales et définissant les infections nosocomiales comme étant : «
toutes
maladies provoquées par des micro-organismes et contractées dans un établissement
de soin par un patient après son admission pour hospitalisation ou soin ambulatoire
».
•Circulaire DGS/DHO S/E n°2000-645 du 29 décembre 2000 relative à l’organisation de la
lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé, faisant ressortir que
les infections nosocomiales sont les infections contractées dans un établissement de santé
et qui étaient absentes au moment de l’admission du patient.
•Le rapport de la CTINILS (Comité Technique des Infections Nosocomiales et des Infections
Liées aux Soins) de mai 2007 portant sur l’actualisation des définitions des infections
nosocomiales présentent ces dernières comme étant
« les infections contractées dans un
établissement de santé, quel que soit leur mode d’acquisition et ne permettant pas de
rendre compte des infections acquises via un processus de soins et pour lesquelles des
mesures de prévention très proches peuvent être mises en place »
.
•Décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 codifiant l’article R. 6111-6 du code de la santé
publique définit les infections nosocomiales comme étant
« les infections associées aux
soins contractées dans un établissement de soins »
.

2. La distinction entre les différentes infections
nosocomiales
A. Distinction entre IN endogènes et IN exogènes
L’intérêt de la distinction repose sur le fait que pendant des années, les établissements de soins pouvaient s’éxonérer
de leur responsabilité en cas d’infection nosocomiale endogène.
•Critère de distinction : le mode de transmission
- Les infections nosocomiales endogènes sont celles où le malade s’infecte avec ses propres germes, à la faveur
d’un acte invasif et/ou en raison d’une fragilité particulière.
- Les infections nosocomiales exogènes sont celles dues à une transmission d’un malade à l’autre par les
mains/instruments de travail du personnel médical ou paramédical ,ou provoquées par des germes portées par
le personnel médical, ou liées à la contamination de l’environnement hospitalier (eau/ air/ matériel/
alimentation).
- Dans un soucis indemnitaire, les juridictions font abstraction de cette distinction, (Civ, 1ère, 4 avril 2006, n° 04-
17491) et CE, 10 oct. 2011, Centre hospitalier universitaire d’Angers, n°328500)
La Cour de Cassation considère en effet que même si le patient est porteur d’un germe, celui-ci ne s’est révélé que par le biais des actes de
soins invasifs réalisés.
Le Conseil d'Etat a résisté jusqu‘en 2011 en refusant de retenir la faute dans l'organisation du fonctionnement du service hospitalier
lorsque que le patient présentait une infection nosocomiale endogène (Conseil d'Etat 27 septembre 2002).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%