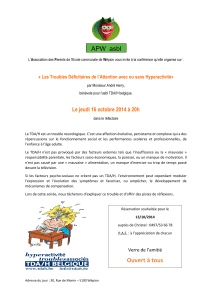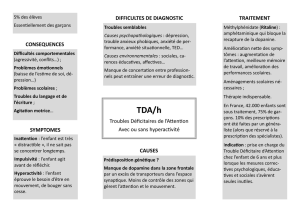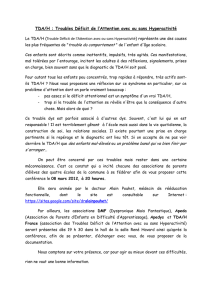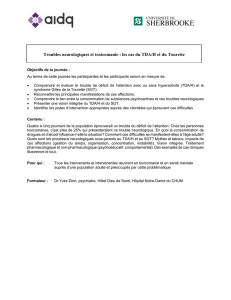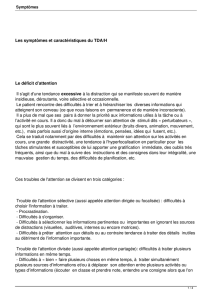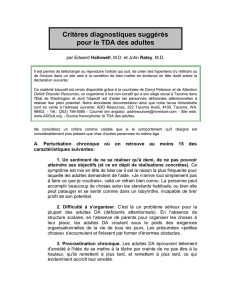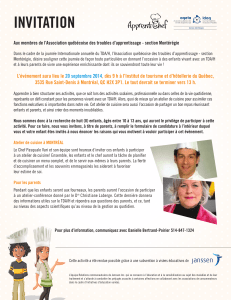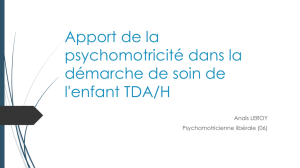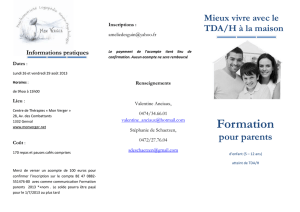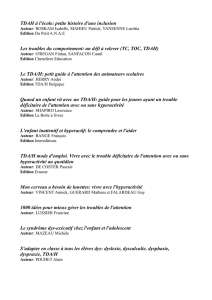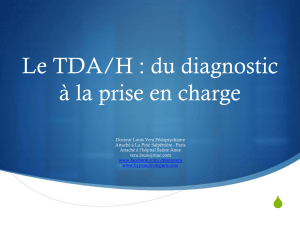Favoriser l'amélioration des mécanismes d'apprentissage chez un élève TDA/H : un exemple

32 - © ENTRETIENS DE BICHAT 2010
Entretiens de
Psychomotricité
2010
Université de Versailles
St-Quentin, Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris,
Service des Urgences
Médico-chirurgicales,
Favoriser l'amélioration des
mécanismes d'apprentissage
chez un élève TDA/H : un exemple
de collaboration Psychomotricien-
Professeur des Ecoles
F. Puyjarinet*, P. Madramany**
* Psychomotricien, email : f[email protected]
** Professeur des Écoles - Académie de Montpellier
Psychomotricité n
L'élève souffrant d'un Trouble Déficit de l'At-
tention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H)
présente une altération plus ou moins impor-
tante des fonctions exécutives indispensables
aux apprentissages, notamment l'attention, la
planification, la flexibilité, ou la mémoire de
travail (Barkley, 1998, 2000, 2005 ; Marquet-
Doléac, Soppelsa, Albaret, 2008 ; Albaret,
2010). Ces dysfonctionnements freinent gran-
dement ses capacités d'adaptation aux exi-
gences scolaires et la mise en place de
stratégies de résolution de problème, contrai-
rement aux enfants sans trouble attentionnel
qui peuvent plus facilement extraire et mani-
puler les informations essentielles en prove-
nance de leur environnement.
Nous proposons dans cet article d'évoquer
les aspects théoriques actuels qui rendent
compte de l'altération des mécanismes d'ap-
prentissage chez l'enfant TDA/H, puis nous
présenterons un exemple de collaboration
entre psychomotricien et professeur des
écoles qui vise à une meilleure généralisation
dans la sphère scolaire des techniques travail-
lées en rééducation psychomotrice.
INTRODUCTION
Les fonctions attentionnelles occupent une
place prépondérante dans les mécanismes
d'apprentissage du jeune enfant, et intervien-
nent dans la plupart des tâches cognitives.
Elles participent en grande partie à son adap-
tation au milieu. Les enfants porteurs d'un
TDA/H montrent, en plus des manifestations
classiques de la triade symptomatique décrite
dans la CIM-10 ou le DSM-IV-TR un ensemble
de déficits neuropsychologiques qui sont sou-
vent regroupés sous le terme de « fonctions
exécutives » (Barkley, 1997), et qui constituent
les troubles internalisés, plus difficiles à mettre
en évidence que les symptômes externalisés
(agitation motrice, non adhésion au traite-
ment, intolérance aux frustrations, etc.) mais
dont l'impact sur les situations d'apprentis-
sages peut être désastreux. Les fonctions exé-
cutives englobent les capacités de pensée
abstraite, de planification, d'initiation et d'exé-
cution de séquences d'action ainsi que le
contrôle et l'arrêt d'un comportement com-
plexe. L'altération des fonctions exécutives est
le plus souvent hétérogène chez un enfant
TDA/H, ce qui justifie une évaluation psycho-
motrice et neuropsychologique fine, en plus
de l'investigation d'éventuelles comorbidités
(Soppelsa, Albaret, & Corraze, 2009 ; Rapport
Collectif INSERM, 2007). C'est dans ce cadre
d'évaluation psychométrique pluridisciplinaire
(neuropsychologue, psychomotricien et ortho-
phoniste notamment, sans négliger le recueil
de questionnaires remplis par les parents et
l'enseignant), que s'inscrit la compréhension
du profil particulier de chaque enfant TDA/H.
Les altérations des fonctions attentionnelles et
exécutives peuvent être différentes selon les
profils d'enfants TDA/H, ce qui signifie que les
prises de décisions thérapeutiques doivent être
adaptées à chaque patient. Le psychomotri-

© ENTRETIENS DE BICHAT 2010 -33
Psychomotricité n
cien a donc le choix entre plusieurs tech-
niques, notamment d'inspiration cognitivo-
comportementale (Douglas, 1972 ; Corraze,
& Albaret, 1996) afin de fournir aux enfants
agités et distraits des méthodes de contrôle
personnalisées et adaptées à leur âge et à leur
pathologie, dans l'optique de lui permettre
d'apprendre à apprendre.
LES DÉFICITS SPÉCIFIQUES EN LIEN
AVEC LES APPRENTISSAGES
Les différents modules attentionnels et exécu-
tifs indispensables aux apprentissages sont
pour plusieurs auteurs directement reliés à
leurs substrats neuro-anatomiques, c'est à dire
qu'ils renvoient à des réseaux cérébraux diffé-
rents (Mirsky, Anthony, Duncan, Ahearn, &
Kellam, 1991 ; Posner, & Fan, 2008 ; Posner,
& Petersen, 1990 ; Van Zomeren, & Brouwer,
1994). Les études et les outils d'évaluation qui
leur sont consacrés sont variés, c'est pourquoi
la compréhension et la mesure des fonctions
attentionnelles et exécutives sont loin d'être
aisées, d'autant que les modèles théoriques
qui tentent de rendre compte des altérations
du TDA/H sont eux-mêmes en perpétuel re-
nouvellement. Nous nous limiterons à définir
quelques dimensions des fonctions attention-
nelles d'un point de vue neuropsychologique,
leurs altérations et leurs manifestations com-
portementales possibles dans le cadre du
TDA/H (selon les principaux modèles théo-
riques actuels), et nous citerons un ou deux
tests standardisés qui permettent de mettre en
évidence quelques-unes de ces altérations (voir
Albaret, 2010 pour une revue plus détaillée).
Le déficit d'attention
L’attention est appréhendée aujourd'hui
comme un concept qui regroupe des sous-
processus imbriqués, et qui s’exerce sur des re-
présentations cognitives, perceptives,
conceptuelles ou motrices. Elle n’est pas, à elle
seule, un mécanisme unique, mais correspond
à un ensemble d’opérations et de capacités
neuropsychologiques en inter-relation (Couil-
let, Leclercq, Moroni, & Azouvi, 2002). Plu-
sieurs types d'attention qui interagissent ont
été identifiés et peuvent être plus ou moins
déficitaires et mis en évidence chez le sujet
TDA/H à l'aide de tests standardisés.
L'attention soutenue est le fait de maintenir sur
la durée et avec efficacité son niveau d'atten-
tion et de vigilance pendant au moins 10 mi-
nutes. Plusieurs épreuves de barrages visent
l'évaluation de l'attention soutenue : le D2
(Brickenkamp, 1967) ou le T2B (Zazzo, 1960).
L'attention sélective, qui est la capacité à main-
tenir l'attention sur une cible malgré des dis-
tracteurs, est évaluée par le test de Stroop
(Albaret & Migliore, 1999). L'attention divisée
consiste à gérer ses ressources attentionnelles
en partageant ou en changeant rapidement la
focalisation de l'attention afin de traiter une si-
tuation de double tâche notamment. L'épreuve
d'attention divisée du TEA-Ch est conçue spé-
cifiquement pour évaluer ce module.
L'attention visuelle est la capacité à établir et
maintenir une attitude performante de traite-
ment visuel des informations. Le subtest At-
tention Visuelle de la NEPSY (Korkman, Kirk &
Kemp, 2003) évalue cette dimension atten-
tionnelle. L'attention auditive est la capacité à
établir et maintenir une attitude d'écoute en
portant intention aux messages sonores. La
NEPSY et la batterie d'évaluation du TEA-Ch
(Manly, Robertson, Anderson, & Mimmo-Smi-
thy, 2004) y consacrent un de leurs subtests.
L'inattention est reconnue comme l'un des
trois piliers du syndrome avec l'impulsivité et
l'agitation motrice. Ses manifestations com-
portementales sont en général rapidement re-
pérées par les enseignants, puisque toute
situation d'apprentissage nécessite un mini-
mum d'attention. L'élève TDA/H est décrit
comme étant « dans la lune », multiplie les
oublis ou les erreurs par manque d'écoute et
d'observation, a le plus grand mal à terminer
un exercice sans se laisser distraire par les ca-
marades ou le bruit des pas de la personne qui
passe dans le couloir, etc. Une des priorités du
psychomotricien sera d'améliorer la qualité du
soliloque par des techniques d'auto-instruc-
tion (Meichenbaum & Goodman, 1969,
1971), en encourageant l'enfant à verbaliser
les stratégies utilisées afin de mieux focaliser
son attention et affiner secondairement ses
capacités de résolution de problème.

34 - © ENTRETIENS DE BICHAT 2010
Psychomotricité n
Le déficit des fonctions exécutives
Il est communément admis que le concept de
fonctions exécutives est un terme « parapluie »
qui englobe un ensemble d'habiletés de haut
niveau nécessaires à la réalisation d'un com-
portement dirigé vers un but, sous la dépen-
dance essentiellement du lobe frontal et de ses
réseaux (Luria, 1966 ; Shallice, 1982 ; Stuss &
Benson, 1986). Barkley (1997) propose un mo-
dèle explicatif des fonctions exécutives chez
l'enfant TDA/H et met l'accent sur la pauvreté
de l'inhibition comportementale. Ce déficit pri-
maire de l'inhibition aurait des répercussions
sur quatre fonctions exécutives : la mémoire de
travail non verbale, l'internalisation du langage
en lien avec la mémoire de travail verbale, l'au-
torégulation des motivations et de l'éveil, la re-
constitution ou capacité à organiser des
éléments d'une façon originale. Ce quadruple
dysfonctionnement va engendrer à son tour
une réduction du contrôle de la motricité qui
va donner au TDA/H sa dimension psychomo-
trice (Corraze, 1999). Les fonctions exécutives,
dans leur aspect global, peuvent être évaluées
à la faveur du Laby 5-12 (Marquet-Doléac,
Soppelsa & Albaret, 2010).
Depuis le modèle proposé par Barkley, d'au-
tres auteurs ont avancé des modèles explica-
tifs qui tentent également de rendre compte
des conséquences comportementales et des
anomalies du sujet TDA/H.
L'aversion du délai (ou incapacité à attendre)
serait, d'après Sonuga-Barke (2003), le socle
des manifestations observées chez l'enfant
TDA/H (Figure 1) et entretiendrait des liens
étroits avec les mécanismes de renforcements
et de récompenses de l'environnement (fami-
lial, éducatif). Le rôle de l'enseignant auprès
de l'enfant TDA/H apparaît ici comme essen-
tiel pour permettre à l'élève d'apprendre à at-
tendre en utilisant par exemple le retrait
d'attention, ou en utilisant avec finesse les
mécanismes bien connus d'extinction des
comportements inadaptés que sont les renfor-
cements (Corraze, 1999).
Sonuga-Barke (2003) propose un modèle à
deux voies, regroupant les deux modèles pré-
cédents (déficit des fonctions exécutives et
aversion du délai).
Figure 1 - Modèle de l’aversion du délai (So-
nuga-Barke, 2003).
La mémoire de travail réduite
Il semblerait que la mémoire de travail soit un
facteur commun à l’ensemble des fonctions
exécutives. La mémoire de travail permet non
seulement le maintien et la manipulation des
informations pertinentes pendant la tâche en
cours (cognitive ou motrice), mais aussi le
maintien des buts et des étapes de la planifi-
cation. Le modèle de Baddeley reste un des
plus aboutis à ce jour (Baddeley & Hitch,
1974 ; Baddeley 1986). Celui-ci postule que
deux systèmes « esclaves », la boucle phono-
logique et le calepin visuo-spatial, sont contrô-
lés par un administrateur central qui
coordonne l'ensemble. La mémoire de travail
est indispensable à la réalisation de tâches
complexes. Plusieurs auteurs (Kuntsi, Ooster-
laan, & Stevenson, 2001 ; Hinson, Jameson, &
Whitney, 2003) ont mis en lumière un déficit
de la mémoire de travail non verbale chez des
sujets TDA/H. La déficience en mémoire de
travail pourrait expliquer que ces enfants
soient davantage influencés par les évène-
ments ayant des conséquences immédiates
que par des événements dont les retombées
sont plus distantes dans le temps. Leur
conduite pourrait être caractérisée comme
une façon de vivre dans « l'ici et maintenant ».
Cela les amènerait à prendre le premier choix
sans considérer minutieusement chaque alter-
native possible.
L'épreuve des blocs de Corsi (De Agostini, Kre-
min, Curt, & Dellatolas, 1996) mesure l'empan
de la mémoire de travail visuo-spatiale. La mé-
moire de travail verbale, elle, sera évaluée par
les épreuves du WISC-IV (Wechsler, 2005) re-
groupées dans l'indice Mémoire de Travail.
L'élève TDA/H présente des lacunes lorsqu'il
s'agit de conserver en mémoire suffisamment

© ENTRETIENS DE BICHAT 2010 -35
Psychomotricité n
longtemps des informations en provenance de
l'environnement. Il peut oublier les consignes
de l'exercice qui ont été lues il y a à peine
quelques secondes, il ne tient plus compte des
recommandations orales de l'enseignant au
bout de quelques instants, oublie en classe le
matériel pour les devoirs du lendemain, etc.
L'insuffisance des capacités de
planification
La planification est une activité cognitive qui
consiste à élaborer et coordonner une sé-
quence d'actions visant l'atteinte d'un but.
Cela implique également de savoir modifier les
stratégies pour aboutir au même résultat et
éviter ainsi les persévérations infructueuses.
Ainsi, pour planifier efficacement, il est néces-
saire d’avoir une représentation adéquate de
la situation et du but à atteindre, d’élaborer un
ensemble de stratégies appropriées à la situa-
tion et au but visé, et de superviser l’exécution
du plan afin de s’assurer que les actions stra-
tégiques choisies contribuent effectivement à
l’atteinte du but (Haith, 1997 ; Scholnick &
Friedman, 1987). De nombreux travaux ont
démontré que des déficits dans la capacité de
planification et d’organisation de l’activité cog-
nitive sous-tendent très souvent les difficultés
d’apprentissage, et que ces déficits sont aussi
associés au trouble déficitaire de l’attention.
Le test de la Tour de Londres (Mc Carthy &
Shallice, 1982), et l'épreuve de la Tour de la
NEPSY (avec une sensibilité moindre) évaluent
spécifiquement les capacités de planification.
L'élève TDA/H a en général beaucoup de dif-
ficultés à planifier ses actes. Il peut se perdre
dans un exercice qui requiert des capacités de
résolution de problème, peut avoir du mal à
s'organiser et à organiser son matériel, à pré-
voir les conséquences de ses actes, à faire le
lien entre les connaissances nouvelles et celles
qui sont plus anciennes, à évaluer en temps
réel la pertinence des actions à privilégier pour
résoudre une situation-problème. Il présente
en résumé des lacunes lorsqu'il faut établir la
priorité des informations importantes à traiter
de façon séquentielle en fonction des dé-
marches futures à mener.
Le déficit de flexibilité/fluence
La flexibilité ou fluence est la capacité à passer
rapidement et d'une manière fluide d'une
tâche à une autre, ou d'une réponse compor-
tementale à une autre, en fonction des exi-
gences de l'environnement.
L'épreuve de Fluidité de Dessins de la NEPSY
pour la fluence figurale, et le test du classe-
ment des cartes du Wisconsin (Heaton, Che-
lune, Talley, Kay, & Curtiss, 2002) pour la
flexibilité cognitive évaluent cette dimension
des fonctions exécutives.
L'élève TDA/H présente la plupart du temps
une flexibilité réduite. Il réitère souvent plu-
sieurs fois d'affilée ses mauvais choix (persé-
vérations), et peut notamment avoir des
difficultés à passer d'une stratégie de résolu-
tion de problème infructueuse à une plus ef-
ficace.
Le déficit d'inhibition et l'insuffisance
du délai de la réponse
L'inhibition permet l'arrêt d'une réponse en
cours, et le remplacement d'une réponse auto-
matisée par une réponse contraire ou inverse.
Le test d'Appariement d'Images évalue les ca-
pacités d'inhibition cognitive (Marquet-Do-
léac, Albaret, & Bénesteau, 1999), alors que
l'épreuve de la Statue de la NEPSY donnera
des indications sur les capacités d'inhibition
motrice de l'enfant.
Le sujet TDA/H ne peut se ménager un temps
de réflexion entre la présentation d’un stimu-
lus et la réponse qu’il fournira afin qu’elle soit
de la meilleure qualité possible en tenant
compte des alternatives existantes. Il présente
un déficit dans la gestion des distracteurs ex-
ternes à la tâche. Cela se traduit par exemple
sur le plan comportemental par des difficultés
à attendre son tour lorsque l'enseignante in-
terroge d'autres camarades de classe à l'oral.
L'enfant TDA/H coupe souvent la parole et in-
terrompt les autres en se montrant très impa-
tient, donne des réponses automatiques (et le
plus souvent erronées) parfois même avant la
fin de la question posée.
Les déficits relatifs au sens subjectif du
temps
De nombreuses études ont mis en lumière un
cumul d'incapacités en lien avec la perception

36 - © ENTRETIENS DE BICHAT 2010
Psychomotricité n
subjective du temps chez l'enfant TDA/H, elle-
même en étroite relation avec la mémoire de
travail (Bronowski, 1977 ; Fuster, 1989). Il en
résulte notamment des difficultés à percevoir
le rapport de cause à effet entre ses actes et
ses conséquences futures : plus la consé-
quence (positive ou négative) d'un événement
est différée loin dans le temps, moins l'enfant
TDA/H fait le lien entre les deux. Cela explique
en grande partie la forte nécessité de les ren-
forcer positivement ou négativement immédia-
tement après l'apparition d'un comportement
adapté ou non.
L'estimation des durées prospectives et rétros-
pectives est perturbée chez le sujet TDA/H qui
trouve que le temps passe plus lentement
qu'en réalité et présente une grande prédis-
position à l'ennui si la nouveauté n'intervient
pas régulièrement dans les situations d'ap-
prentissage. L'agitation motrice dans le TDA/H
serait d'après certains modèles théoriques la
conséquence de ce type de déficits temporels.
Les anomalies du circuit de la
motivation
Les comportements adaptés des enfants
TDA/H dépendront des renforcements immé-
diats puisque les renforcements différés ne
sont pas pour eux une source motivationnelle
efficace, comme l'ont évoqué certains auteurs
(Sonuga-Barke, 2002) qui considèrent que les
manifestations comportementales observées
chez certains enfants TDA/H dans des tâches
de délai de gratification sont à mettre en rela-
tion avec une perturbation des processus mo-
tivationnels.
Les difficultés d'accès à la
métacognition
L'utilisation efficace de stratégies d'apprentis-
sage demande une prise de conscience de son
propre fonctionnement cognitif de la part de
l'élève (Dignath, Büttner, & Langfeldt, 2008).
Cette prise de conscience est aussi appelée
métacognition, ou métaconnaissance (Flavell,
& Wellman, 1977) et joue un rôle important
dans le processus d'apprentissage. La métaco-
gnition est étroitement liée aux capacités de
planification et de contrôle. L'élève TDA/H, lui,
ne se rend souvent pas compte de l'inefficacité
de sa démarche et persiste dans une manière
de procéder infructueuse, sans chercher à mo-
difier les stratégies de résolution de problème
inefficaces, ou à généraliser les stratégies per-
tinentes à d'autres contextes d'apprentissages.
L'élève TDA/H présente donc un déficit de la
prise de conscience de ses propres activités
stratégiques et de leurs effets.
Des stratégies de résolution de
problème inefficaces
Pour D’Zurilla et Goldfried (1971), la résolution
de problèmes est un processus comportemen-
tal qui rend valable une variété de réponses
potentielles pour faire face à la problématique
d’une situation, et qui augmente les probabi-
lités de sélection de la réponse la plus efficace
parmi ces différentes alternatives. Chez l'en-
fant TDA/H, ces stratégies sont déficitaires.
L'analyse des informations dont il dispose est
insuffisante, tout comme la mémoire de travail
qui permet de maintenir les sous-objectifs
fixés avant d'arriver au résultat final. Enfin, la
dernière étape de la résolution de problème,
à savoir la vérification, est souvent abrégée ou
absente chez le sujet TDA/H, ce qui entraîne
une indifférence aux résultats des actions (in-
suffisance du rétrocontrôle).
L'ÉLÈVE TDA/H ET L'ENSEIGNANT
Généralités
Il est aujourd'hui admis qu'environ 5,5 % des
enfants présenteraient un TDA/H, soit 1 en-
fant en moyenne par classe. Les professeurs
des écoles connaissent donc bien ces enfants
qui ne semblent pas écouter, qui se distraient
au moindre bruit, qui sont incapables de se
concentrer suffisamment longtemps, qui
s'agitent et parlent exagérément (TDA/H de
type hyperactif ou mixte), ou qui sont calmes,
mais « dans leur monde », « physiquement
présents mais ailleurs dans leur tête » (TDA/H
à dominance inattention). C'est d'ailleurs sou-
vent le milieu scolaire qui alerte les familles
face aux comportements de l'élève, ou face à
la gestion des situations d'apprentissage qui
se révèle souvent mystérieuse (« il ne travaille
que lorsqu'il veut », ou encore « il est doué,
mais très immature ! »).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%