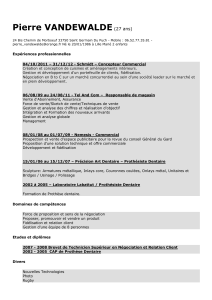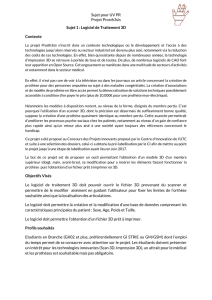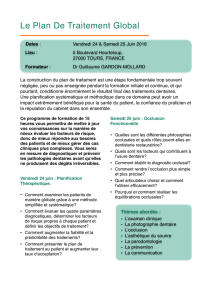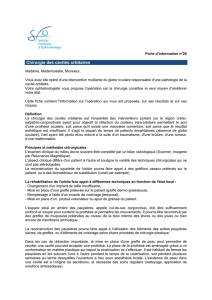M Réhabilitation par épithèse faciale CAS CLINIQUE Mots-clés

CAS CLINIQUE
▼ Figure 2. Épithèse nasale fixée aux lunettes par des aimants (2005).
◀ Figure 1.
Patient en 2000,
ancrage osseux
sur 2 fixtures.
La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 334 - juillet-août-septembre 2013 | 13
Mots-clés
Épithèse faciale – Anaplastologie.
Keywords
Facial prosthesis – Anaplastology.
Réhabilitation par épithèse faciale
A rehabilitation case: facial prosthesis
A.M. Riedinger*, P. Hémar**
* Centre d'épithèses faciales, Strasbourg.
** ORL, CHU de Strasbourg.
M
onsieur C, né en 1931, est suivi par le service
ORL de Strasbourg depuis 2000. Il a été amputé
de la pyramide nasale à la suite d'un carcinome
baso cellulaire. Une épithèse nasale à ancrage osseux (3 fixtures)
a été réalisée (1). La lente évolution de la tumeur a progres-
sivement entraîné la perte des implants, puis d’une partie du
maxillaire supérieur, et enfin de l’œil gauche. La réhabilitation
par épithèse faciale pour ce patient a dû à chaque fois être
adaptée aux configurations existantes.
Observation
En 2000, 3 fixtures ont été insérées pour une réhabilitation
par épithèse à ancrage osseux (2). À la suite d'une récidive,
2 années plus tard, les implants ont été repositionnés plus
favorablement (3) et une nouvelle épithèse nasale à ancrage
osseux a été réalisée (figure 1). En 2005, une nouvelle tumeur
a été traitée par radiothérapie mais a entraîné la perte des
implants. Une épithèse nasale collée a alors été confectionnée.
Contraignante pour le patient, elle a été remplacée par une
épithèse sur lunettes. Mais l’ensemble, plus lourd, permettait un
mouvement de bas en haut. Afin d’alléger le poids de l’épithèse
sur lunettes, une épithèse très fine sur montures à fixation
aimantée a alors été réalisée. Elle assurait un maintien sûr, était
très fonctionnelle puisqu’elle permettait au patient de respirer
normalement et était facile d’usage et d’entretien (figure 2).
Progressivement, le carcinome a eu raison de la partie centrale
du maxillaire supérieur (en 2007), puis de la plus grande partie
de la lèvre supérieure. Une attention particulière a été portée à
la conservation d’une bride labiale afin d’assurer au patient un
contact naturel des lèvres. Une épithèse fixée à l’obturateur a
alors été une solution acceptable pour le patient, bien que la pro-
thèse dentaire mobile n’ait pas permis la stabilité de l’épithèse,
qui est mobile de haut en bas lorsque le patient mange ou parle.
Plus récemment, l’œil gauche a été atteint et le patient a dû être
énucléé, ce qui a laissé une cavité orbitaire très peu profonde.

CAS CLINIQUE
▼ Figure 5. Application de silicones colorés dans le moule.
▼ Figure 4. Modelage de la maquette naso-orbitaire.
▲ Figure 3. Patient
en 2013 après éviscération
de l’œil gauche.
14 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 334 - juillet-août-septembre 2013
Quelle réhabilitation est encore
possible pour ce patient ?
L’étendue de la cavité comprend à présent la lèvre supérieure,
le nez et l’orbite (figure 3). Il existe une très large communi-
cation entre la cavité buccale et la cavité nasale, également
élargie vers les joues et partiellement comblée par une pro-
thèse dentaire mal ajustée, mobile et complétée d’un obtu-
rateur. L’ensemble bouge quand le patient mange ou parle. Il
reste en effet très peu de maxillaire supérieur, sans beaucoup
de reliefs, et les muqueuses très fragiles de ces cavités ont
tendance à saigner facilement et n’ont de ce fait pas permis
un maintien stable de la prothèse dentaire.
On se retrouve ainsi avec une base dentaire mobile, une lèvre
supérieure très fine (quelques millimètres de hauteur seu-
lement) et une cavité orbitaire peu profonde. Les solutions
habituelles de maintien d’une prothèse sont évoquées (4) :
ancrage osseux, maintien sur la prothèse dentaire, sur les
montures de lunettes, dans les rebords de la cavité ou par
adhésif biologique.
Étant donné l’évolution lente et progressive des lésions, la
mise en place d’implants pour une épithèse à ancrage osseux
n’est plus envisageable. Par ailleurs, la mobilité de la prothèse
dentaire et l’étendue du defect ne permettront pas une fixa-
tion collée. Enfin, la rétention dans les rebords des cavités est
également exclue du fait de la sensibilité et de la tendance
aux saignements des muqueuses. De plus, le maintien sur les
lunettes est aléatoire à cause de l’étendue de la mutilation et
de la mobilité de l’ensemble. L’épithèse serait assez lourde et
reposerait horizontalement sur les oreilles alors que, vertica-
lement, la stabilité ne serait pas assurée.
Une solution mixte a de ce fait été retenue, et l’épithèse
médiofaciale a été divisée en 2 parties. La première partie
prolonge la lèvre supérieure, elle est fixée par 2 aimants sur
l’obturateur et placée de façon frontale. Cette lèvre est très
légère et permet de fermer la partie inférieure de la cavité en
épousant le filet de lèvre supérieure existant sans gêner le
patient. La seconde est l’épithèse naso-orbitaire. Une résine a
été ajustée dans la cavité afin de bloquer le mouvement vers
le haut et un gros aimant a été fixé horizontalement sur le
haut de l’obturateur afin de retenir le mouvement vers le bas.
La prothèse oculaire a ensuite été positionnée dans l’orbite,
ajustée sur le patient, et le modelage du nez et des paupières
a été réalisé en respectant le regard naturel du patient. La
maquette a été ajustée sur le patient, le modelage a été finalisé
et les bords de l’épithèse ont été adaptés aux contours de la
cavité. L’ensemble est stable (figure 4).
Deux moules ont ensuite été conçus et réalisés (5). Les parties
mobiles ont été placées dans les moules (résines et aimants,
prothèse oculaire). Deux types de silicones ont été sélectionnés :
un silicone très résistant pour respecter les fines couches
externes et un silicone plus souple pour les sous-bases. Ils ont
été soigneusement mélangés avec les pigments naturels et
avec des floquages afin de respecter les teintes et la plus ou
moins grande transparence de la peau des différentes régions,
puis ils ont été appliqués dans les moules selon chaque teinte

CAS CLINIQUE
▼ Figure 8. Patient portant les épithèses faciales et les lunettes.
Figure 7. ▶
Patient portant
les épithèses faciales.
◀ Figure 6.
Épithèses lèvre
supérieure et naso-
orbitaire.
La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 334 - juillet-août-septembre 2013 | 15
et en fines couches successives qui révéleront la texture de la
peau (figure 5). Les moules ont ensuite été cuits au four à 70 °C
pendant 3 heures. Après le refroidissement, ils ont été ouverts
et les épithèses soigneusement découpées, essayées et ajustées
(figure 6).
Le patient teste l’épithèse de lèvre supérieure, et l’épithèse
naso-orbitaire est positionnée par-dessus. Un léger mouve-
ment est possible entre les 2 épithèses qui glissent légèrement
l’une sur l’autre de façon très naturelle. Tout point sensible
est identifié et soigneusement évidé sur la partie arrière de
l’épithèse. La prothèse dentaire est bloquée par l’aimant qui
fixe l’épithèse naso-orbitaire.
Des montures complètent l’ensemble afin d’assurer une sécu-
rité complémentaire au patient (figures 7 et 8), bien que la
stabilité de l’ensemble soit atteinte sans les lunettes.
Le patient gère facilement la mise en place des épithèses en
2 clics et les trouve confortables. Veuf depuis 2 ans, il se sent
revivre une fois de plus et a laissé entendre qu’il souhaitait
repartir au bled et éventuellement se remarier.
Conclusion
La réhabilitation de chaque patient est unique selon ses lésions
et se fait sur mesure (6). Dans un cas de carcinome évolutif,
l’adaptation à toute nouvelle situation et la créativité sont
primordiales. De plus, une excellente collaboration chirurgien/
épithésiste et un constant dialogue avec le patient sont capi-
taux dans le processus de réhabilitation pour des situations
complexes (7, 8). La réhabilitation est réussie si le patient
porte son épithèse, s’il a repris confiance en lui et mène une
vie sociale normale, s’il passe inaperçu en public et si l’épithèse
lui assure un maintien sûr, est facile à mettre en place et à
entretenir. Ainsi, grâce à son épithèse, le patient doit pouvoir
retrouver une vie sociale aussi normale que possible. ■
1. Disant F. Place de l’épithèse dans les réhabilitations des pertes de subs-
tances de la face. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 1997;118(2):109-12.
2. Charpiot A, Chambres O, Herve JF et al. Implants cranio-faciaux
ostéo-intégrés, à propos de 49 patients. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord)
2006;127(4):217-22.
3. Hémar P, Riedinger AM. Optimal surgical procedures following tumor
resection for successful prosthetic rehabilitation by means of osseointegrated
craniofacial implants. Int J Anaplastology 2009;3:8.
4. Brånemark PI, Ferraz De Oliveira M. Craniofacial prostheses - Anaplasto-
logy and osseointegration. Göthenbourg, (Sweden) : Quintessence Publishing
Co, 1997.
5. Thomas KF. The art of clinical anaplastology. Londres : S. Thomas,
2006:58-77.
6. Tjellström A, Jansson K, Brånemark PI. Craniofacial defects. In: Worthington
P, Brånemark PI. Advanced osseointegration surgery, applications in the maxil-
lofacial region. Chicago (USA) : Quintessence Publishing Co, 1992:293-312.
7. Tjellström A, Portmann D. Implants ostéo-intégrés pour les prothèses
faciales et auditives. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 1992;113(5):439-45.
8. Wolfaardt J, Wilkes GH, Granström G et al. Craniofacial reconstructions.
In: Brånemark PI. The osseointegration book. From calvarium to calcaneus.
Chicago (USA) : Quintessence Publishing Co, 2007:387-418.
Références bibliographiques
A.M. Riedinger déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.
1
/
3
100%