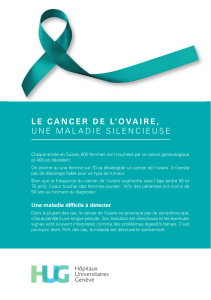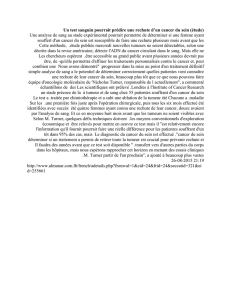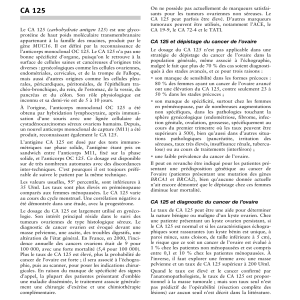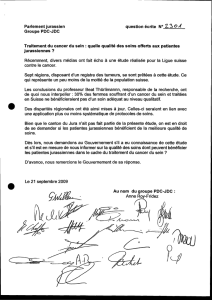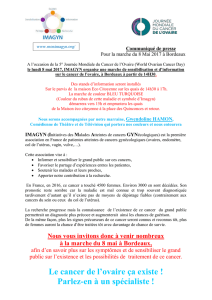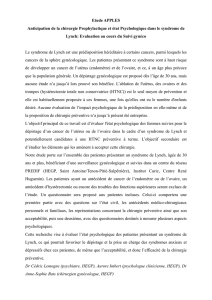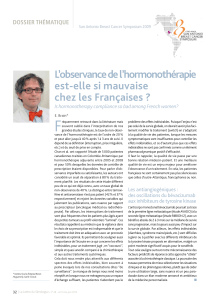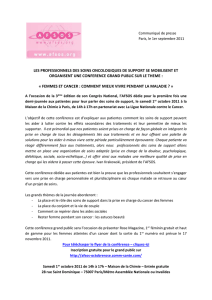L Actualités gynécologiques Current gynecologic news

462 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXII - n° 11 - décembre 2013
Actualités gynécologiques
Current gynecologic news
P. Pautier*, C. Lhommé*
* Institut Gustave-Roussy, Villejuif.
L
e congrès de l’ESMO était particulièrement inté-
ressant en gynécologie cette année, surtout
pour ce qui concernait la prise en charge du
cancer de l’ovaire. En effet, 4 late-breaking abstracts
ont été présentés en séance plénière, de même que
des études positives à la session orale.
Angiogenèse
et cancers de l’ovaire
L’effi cacité de l’approche antiangiogénique dans le
cancer de l’ovaire, que ce soit en première ligne ou en
cas de rechute sensible, a été confi rmée par l’arrivée
de 2 nouvelles molécules. L’effet réel du bévacizumab
sur la survie en première ligne ou en rechute semble
se préciser grâce à l’étude de sous-groupes.
Bévacizumab
en cas de récidive résistante au platine
D’après Witteveen P et al., abstr. LBA5
Les résultats de SG de l’étude AURELIA ont été
présentés. Cette étude de phase III randomisée
pose la question de l’intérêt de l’adjonction du
bévacizumab (15 mg/kg) à la CT (paclitaxel hebdo-
madaire, topotécan hebdomadaire ou doxorubicine)
chez les patientes qui présentent un carcinome
ovarien en rechute résistant au platine (récidive
moins de 6 mois après la CT à base de platine),
l’objectif principal étant l’augmentation de la SSP
(selon les critères RECIST). Il y avait une stratifica-
tion en fonction de la CT associée au bévacizumab,
de l’utilisation antérieure d’un antiangiogénique
et de l’intervalle libre sans platine (0-3 mois et
3-6 mois). Les premiers résultats de l’étude ont
été présentés au congrès américain en oncologie
clinique de 2012 et ont montré globalement un
doublement de la SSP avec le bévacizumab ; même
si la puissance de l’étude n’a pas été choisie pour
détecter une différence en SG, d’une part, et si 40 %
des patientes du bras sans bévacizumab en ont reçu
lors de la progression, d’autre part, les résultats de
SG nous ont été présentés. Sur l’ensemble de la
population, la médiane de SG est de 13,3 mois avec
la CT seule, et de 16,6 mois avec le bévacizumab
(RR = 0,85 ; p = 0,174), sans différence, mais si l’on
s’intéresse uniquement aux patientes qui ont reçu
du paclitaxel hebdomadaire (n = 115), la survie
passe de 13,2 à 22,4 mois (HR = 0,65). La SG dans
les 3 bras avec CT seule étant la même, l’effet du
bévacizumab semble supérieur avec le paclitaxel
hebdomadaire.
Bévacizumab en première ligne
D’après Oza AM et al., abstr. LBA6
On attendait également avec impatience les données
de SG de l’étude ICON7, qui étudiait le bévacizumab
(7,5 mg/kg) en association avec la CT, puis en entre-
tien chez 1 528 patientes qui présentaient un cancer
de l’ovaire initialement traité par chirurgie. L’étude a
été construite pour montrer une différence de SSP,
mais également de SG. La médiane de SSP augmente
signifi cativement de 17,5 à 19,9 mois (+ 2,4 mois) sur
la population globale, mais surtout dans la popula-
tion dite “à haut risque” (502 patientes atteintes de
cancers de stade III ou IV et ayant une maladie rési-
duelle), où elle passe de 10,5 à 16 mois (p = 0,001).
De la même façon, alors qu’il n’y a pas d’allongement
signifi catif de la SG avec l’adjonction du bévaci-
zumab dans la population globale de l’étude (58,6
[CT seule] versus 58 mois [CT + bévacizumab]), il
existe une amélioration nette de la médiane de
survie dans le groupe des patientes à haut risque
(de 30,3 à 39,7 mois). Ces résultats confirment
que les patientes qui semblent le plus bénéfi cier
du bévacizumab en première ligne sont celles qui
ont une maladie avancée, soit inopérable, soit avec
un résidu tumoral important. L’augmentation de
Actualités
au 38e ESMO

La Lettre du Cancérologue • Vol. XXII - n° 11 - décembre 2013 | 463
Résumé
Le congrès de l’ESMO, cette année, s’est particulièrement intéressé aux cancers de l’ovaire. Les études
ICON6 et TRINOVA-1 ont montré l’importance d’une approche antiangiogénique de ces cancers, dans
lesquels, en outre, l’effet sur la survie du bévacizumab se précise. Inhibiteurs de PARP et vintafolide ont
aussi été évoqués, ainsi que les liens entre traitements hormonaux substitutifs combinés et risque de
cancer de l’endomètre.
Mots-clés
Cancer del’ovaire
Traitements
antiangiogéniques
Traitement hormonal
substitutif
Risque de cancer
Summary
This year, the ESMO Congress
took a particular interest in
ovarian cancers. The ICON 6
and TRINOVA-1 studies have
shown the importance of an
antiangiogenic approach to
these cancers. Moreover, in
these patients, the effect on
survival of bevacizumab treat-
ment is being confi rmed. PARP
inhibitors and vintafolide were
also discussed, as well as the
relation between combined
hormone replacement thera-
pies and the risk of endometrial
cancer.
Keywords
Ovarian carcinoma
Antiangiogenic therapy
Hormonal substitutive
therapy
Risk ofcancer
la SSP sur la population globale ne se traduit pas
par une augmentation de la SG, probablement en
raison de l’adjonction du bévacizumab lors des lignes
ultérieures.
Autres antiangiogéniques
D’après Ledermann JA et al., abstr. LBA10 ;
Monk BJ et al., abstr. LBA41
L’étude OVAR 14 nous avait montré que d’autres
antiangiogéniques anti-VEGF anti-ITK utilisés en
maintenance seule étaient actifs dans le cancer de
l’ovaire en première ligne. L’étude ICON 6, présentée
par J.A. Ledermann (abstr. LBA10), qui étudie le
cédiranib, et l’étude TRINOVA-1, présentée par
B.J. Monk (abstr. LBA41), qui étudie le trébananib,
ont montré que l’approche antiangiogénique, qu’elle
utilise une action anti-VEGF ou d’autres voies, est
une démarche essentielle dans la prise en charge du
cancer de l’ovaire.
L’étude ICON 6 a subi différents changements :
amendements multiples ; changement d’objectif
principal en cours d’étude (SSP plutôt que SG) ;
modifi cation de la dose de cédiranib après l’inclu-
sion des 30 premières patientes (de 30 à 20 mg) ;
changement de schéma en cours d’étude. Cepen-
dant, elle nous a apporté une importante confi r-
mation en cas de rechutes sensibles. En effet, en
ajoutant du cédiranib, un puissant inhibiteur oral
de VEGFR-2 (inhibiteur d’ITK), ICON 6 a confi rmé
les résultats précliniques et ceux, prometteurs,
d’études de phase II en monothérapie. Dans cette
étude de phase III internationale qui a inclus
456 patientes en rechute sensible au platine, les
patientes étaient randomisées (2:3:3) entre CT à
base de platine (carboplatine + paclitaxel, carbo-
platine + gemcitabine ou carboplatine ou cispla-
tine seuls) + placebo suivis de placebo en entretien,
versus CT + cédiranib suivis de placebo en entre-
tien versus CT + cédiranib suivis de cédiranib en
entretien pendant 18 mois. L’objectif était d’étudier
l’intérêt de la molécule en association avec la CT,
puis en entretien. Les patientes qui avaient reçu
du bévacizumab antérieurement pouvaient être
incluses. Les résultats montrent que l’adjonction
de cédiranib à la CT et en entretien augmente la
SSP d’environ 3 mois (de 9,4 à 12,6 mois), et la SG
de 2,7 mois (de 17,6 à 20,3 mois ; HR = 0,70) chez
les patientes qui présentent une rechute de cancer
de l’ovaire sensible au platine. L’augmentation de
la SSP est également signifi cative lorsque le cédi-
ranib n’est utilisé qu’en concomitance avec la CT
(2 mois). Une augmentation signifi cative des effets
indésirables habituels des ITK (diarrhées, hypo-
thyroïdie et fatigue) et vasculaires (hypertension
artérielle, hémorragies et protéinurie) est associée
à l’utilisation du cédiranib, mais c’est la première
étude qui, en utilisant des antiangiogéniques dans
le cancer de l’ovaire, a démontré un gain en SG dans
la population générale.
Les résultats de l’étude TRINOVA-1 étaient égale-
ment attendus, puisque celle-ci testait l’effi cacité
d’un inhibiteur des angiopoïétines 1 et 2, autre voie
de l’angiogenèse tumorale. Les résultats de l’étude de
phase II randomisée dans une population en rechute
étaient très encourageants, et sont confi rmés par
les résultats de cette étude de phase III qui teste
l’adjonction du trébananib (15 mg/kg/sem. i.v. en
continu) ou d’un placebo au paclitaxel hebdo-
madaire (80 mg/m
2
/sem., 3 semaines sur 4) chez
des patientes qui présentent un cancer de l’ovaire
en rechute moins de 12 mois après une dernière
ligne de platine (stratifi cation selon intervalle libre
sans platine, maladie mesurable et topographie)
jusqu’à progression. Au total, 919 patientes ont été
incluses dans cette étude, dont l’objectif principal
était l’augmentation de la SSP : 50 % des patientes
environ présentaient une rechute résistante (inter-
valle libre sans platine [ILP] inférieur à 6 mois). Les
résultats sont positifs, avec une augmentation de
33 % de la SSP (la médiane passe de 6 à 8 mois)
avec le trébananib, et une augmentation du taux
de réponse (de 30 à 38 %) ; les données ne sont pas
matures sur la survie (actuellement : 17,3 mois sans
trébananib, et 19 mois avec). L’étude est positive
dans tous les sous-groupes étudiés (ILP inférieur ou
supérieur à 6 mois, par exemple). Le profi l de toxicité
est différent de celui du bévacizumab.
L’atout de cette molécule est l’absence d’effets
indésirables de type vasculaire (pas d’hypertension
artérielle, pas de protéinurie et pas de perforations
digestives) ; les principaux effets indésirables sont
des œdèmes (57 versus 26 %).

464 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXII - n° 11 - décembre 2013
Actualités gynécologiques
Le problème majeur réside dans l’utilisation hebdo-
madaire par voie veineuse, qui constitue bien sûr
un obstacle lorsqu’il s’agit de l’utiliser en entretien,
ce qui est actuellement testé en première ligne
(en association avec la CT, puis en entretien seul
dans l’étude TRINOVA-2).
Inhibiteurs de PARP
D’après Oza AM et al., abstr. 3002
C’est une classe de médicaments très intéressants
dans la prise en charge des cancers de l’ovaire de haut
grade et, surtout, lorsqu’il existe une anomalie d’un
des gènes de réparation BRCA1 ou BRCA2 (qu’elle
soit somatique ou germinale, ou qu’il y ait une inacti-
vation épigénétique de BRCA1 ou des anomalies de la
voie de la recombinaison homologue indépendantes
de BRCA1 et de BRCA2, ce qui représente environ
50 % des tumeurs de haut grade).
A.M. Oza a présenté les résultats de l’étude concer-
nant l’association CT + olaparib, suivie d’olaparib en
entretien dans les cancers de l’ovaire de haut grade
en rechute sensible dans le groupe des patientes qui
présentaient une anomalie de BRCA. L’olaparib a
montré son effi cacité chez les patientes porteuses
d’un cancer de l’ovaire en rechute, et qui présentaient
une mutation germinale d’un gène BRCA (1). Cette
étude de phase II randomisée, dont les résultats
ont déjà été présentés lors du congrès américain en
oncologie clinique de 2012, comparait une associa-
tion de carboplatine (AUC6) + paclitaxel pendant
6 cycles, puis arrêt, à une association de même
type carboplatine (AUC4) + paclitaxel + olaparib,
suivie d’olaparib en entretien jusqu’à progression
(400 mg/j), dans une population de patientes qui
présentaient une tumeur de l’ovaire de haut grade
en rechute sensible avec une augmentation signi-
fi cative de la SSP. Le statut BRCA était connu chez
35 patientes sur 162 à l’inclusion. Le statut tumoral
de BRCA a été déterminé rétrospectivement chez
91 patientes sur des blocs de tumeur. Le statut BRCA
était ainsi fi nalement connu chez 107 patientes sur
les 162, parmi lesquelles 41 (38 %) présentaient une
anomalie de BRCA ; dans 7 cas, il s’agissait d’une
mutation de BRCA de signifi cation inconnue. Chez
les 41 patientes mutées, la médiane de SSP était de
9,7 mois dans le bras CT seule, et n’était pas atteinte
dans le bras avec olaparib (HR = 0,21 ; p = 0,0015),
démontrant ainsi une nouvelle fois l’effi cacité de
cette molécule dans cette population de patientes
avec une mutation d’un gène BRCA.
Des études sont en cours en première et deuxième
lignes (études SOLO) dans une population de
patientes porteuses d’une mutation de BRCA afi n
d’obtenir une AMM. Il reste qu’une partie de la popu-
lation des patientes atteintes de cancers de l’ovaire
de haut grade qui ne présentent pas une mutation
germinale de BRCA, mais des modifi cations soma-
tiques, pourrait bénéfi cier de cette molécule : il est
donc urgent de trouver les moyens simples de les
identifi er pour les faire bénéfi cier de ces inhibiteurs.
Vintafolide
et cancers de l’ovaire
D’après Naumann RW et al., abstr. 3001
Les résultats de l’étude de phase II randomisée
PRECEDENT comparant doxorubicine + vintafolide
et doxorubicine seule chez les patientes qui présen-
taient une rechute d’un carcinome ovarien montrent
un bénéfi ce en termes de SSP à l’adjonction de vinta-
folide à la doxorubicine dans cette situation, ce qui
a conduit à mettre en place une étude de phase III
(PROCEED), en cours dans la même indication.
Dans l’étude PRECEDENT, une scintigraphie à l’acide
folique marqué était systématiquement réalisée, et
les premiers résultats suggéraient qu’une expres-
sion importante de la tumeur était corrélée à une
meilleure effi cacité de l’association. Les résultats de
l’étude en fonction de la répartition de la fi xation
selon la tumeur (100 % de la tumeur ou moins) ont
été présentés à l’ESMO. Il est clairement établi que
le bénéfi ce de l’association est plus important dans
le sous-groupe FR 100 %, patientes dont 100 % de
la tumeur fi xe à la scintigraphie, et que l’expression
des récepteurs aux folates est un facteur de mauvais
pronostic (les FR 100 % dans le bras doxorubicine
seule vont moins bien). L’étude PROCEED prévue
initialement quel que soit le statut d’expression
scintigraphique du RF (récepteur aux folates) a été
fi nalement réservée aux patientes présentant une
expression des RF détectée à la scintigraphie.
Traitements hormonaux
substitutifs combinés et risque
de cancer de l’endomètre
D’après Chlebowski RT et al., abstr. LBA13
R.T. Chlebowski a rapporté les résultats d’une étude
randomisée en double aveugle contre placebo du
Actualités
au 38e ESMO

Sous l’égide de Directeur de la publication : Claudie Damour-Terrasson
Rédacteur en chef : Pr Jean-François Morère (Bobigny et Villejuif)
Attention, ceci est un compte-rendu de congrès et/ou un recueil de résumés de communications de
congrès dont l’objectif est de fournir des informations sur l’état actuel de la recherche ; ainsi, les
données présentées sont susceptibles de ne pas être validées par les autorités de santé françaises
et ne doivent donc pas être mises en pratique.Le contenu est sous la seule responsabilité du
coordonnateur, des auteurs et du directeur de la publication qui sont garants de son objectivité.
Avec le soutien institutionnel de
DIAPORAMA
www.edimark.fr/diaporamas/ASCOGI/2013
ဓ
Actualités
sur le cancer du pancréas
San Francisco, 16-18 janvier 2014
d’après le 11e congrès de
Expert : Éric François
(Nice)
l’ ASCO® GI
La Lettre du Cancérologue • Vol. XXII - n° 11 - décembre 2013 | 465
Women’s Health Initiative (WHI). Les 16 608 femmes
ménopausées issues de 40 centres américains
incluses avaient entre 50 et 70 ans, n’avaient pas
subi d’hystérectomie, avaient une biopsie endomé-
triale normale et recevaient soit une association
estroprogestative (0,625 mg d’estrogène équin +
acétate de médroxyprogestérone 2,5 mg), soit un
placebo.
L’étude montre tout d’abord une relation étroite
entre obésité et cancer de l’endomètre : les femmes
avec un IMC supérieur à 35 kg/m
2
ont en effet un
risque multiplié par 7 de développer un cancer de
l’endomètre. Elle montre également que l’utilisation
continue d’estrogènes et de progestatifs réduit le
risque de cancer de l’endomètre de façon signifi cative
(35 %), et ce, d’autant plus que l’IMC est élevé, mais
augmente le risque de cancer du sein, d’accidents
thromboemboliques et d’événements cardiaques.
En revanche, lorsqu’on utilise les estrogènes seuls
(deuxième étude du WHI, non présentée ici, mais
dont a parlé le discutant, qui a randomisé plus de
10 000 femmes aux antécédents d’hystérectomie
entre estrogènes et placebo), on augmente le risque
de cancer de l’endomètre, mais on réduit le risque de
cancer du sein. La solution serait peut-être d’utiliser
chez les patientes n’ayant pas subi d’hystérectomie
des estrogènes en continu (aux plus petites doses
possibles) associés à du lévonorgestrel en dispo-
sitif intra-utérin (stérilet Mirena®), ce qui rédui-
rait probablement le risque des cancers du sein et
de l’endomètre, tout en ayant un THS. Le temps
d’utilisation devrait cependant rester limité pour
ne pas augmenter le risque des autres pathologies
associées. ■
P. Pautier déclare
ne pas avoir deliens d’intérêts.
C. Lhommé n’a pas précisé
seséventuels liens d’intérêts.
Actualités
au 38e ESMO
1. Ledermann J, Harter P, Gourley C
et al. Olaparib maintenance
therapy in platinum-sensitive
relapsed ovarian cancer. N Engl J
Med 2012;366(15):1382-92.
Référence
bibliographique
1
/
4
100%