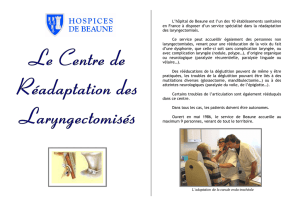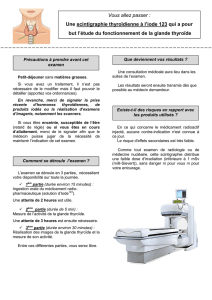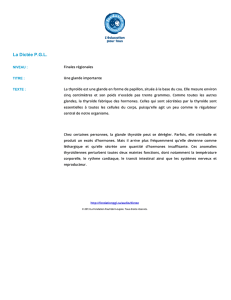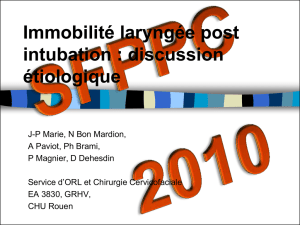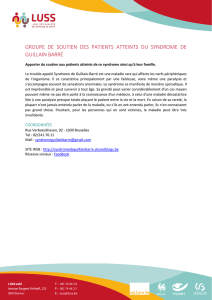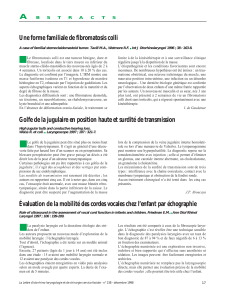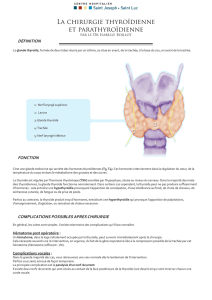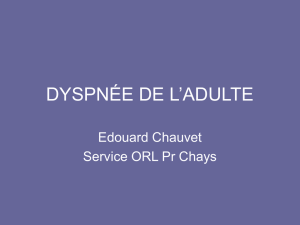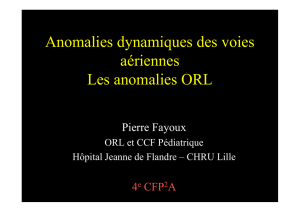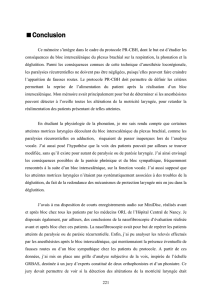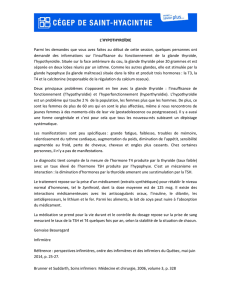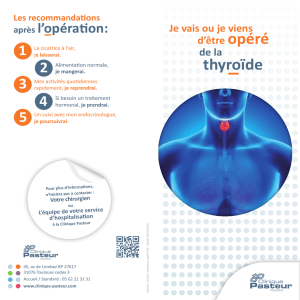Paralysie laryngée unilatérale après chirurgie de la glande thyroïde

DOSSIER
12
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no299 - juillet-août 2005
PHYSIOLOGIE
Diverses théories ont été proposées pour expliquer les différentes
conformations laryngées observées en présence d’une paralysie
laryngée unilatérale après chirurgie de la glande thyroïde. Il est
ainsi classique de lire que l’absence d’atteinte du contingent ner-
veux véhiculé par le nerf laryngé supérieur, et donc l’intégrité de
fonction du muscle crico-thyroïdien conduisent la corde vocale
paralysée à adopter une position paramédiane. Les Drs Wood-
son, Koufman et al. (1, 2) ont cependant récemment démontré
qu’il est en réalité impossible de standardiser le positionnement
de la corde vocale paralysée en fonction du niveau anatomique
(intracérébral, tronc du nerf pneumogastrique, nerf laryngé infé-
rieur) de l’atteinte. Par ailleurs, la classique théorie de Semon est
à l’heure actuelle abandonnée au profit de la théorie de la réin-
nervation aberrante avec syncinésies (3). Selon cette théorie, les
facteurs qui influent sur l’aspect morphologique de l’hémilarynx
paralysé après chirurgie de la glande thyroïde sont le degré
d’innervation résiduelle et le degré d’atrophie de dénervation et
de fibrose musculaire, chacun de ces facteurs étant largement
influencé par le type d’atteinte (compression, étirement, dévas-
cularisation, section partielle ou totale) que subissent les fibres
nerveuses lors du traumatisme initial et par les capacités de régé-
nération nerveuse propres à chaque individu, d’ou :
–une grande variabilité dans les conformations anatomiques ren-
contrées ;
–une évolution de l’aspect morphologique du larynx paralysé
dans le temps. Enfin les syncinésies laryngées observées au
niveau de l’hémilarynx paralysé (corde vocale, bande ventricu-
laire et/ou aryténoïde), qui se définissent comme des “mouve-
ments anormaux survenant dans un groupe musculaire à l’occa-
sion d’un mouvement volontaire ou réflexe d’une autre partie du
corps”, témoignent du processus de réinnervation aberrante des
muscles abducteurs du larynx par des fibres nerveuses à visée
adductrice (et vice versa) et ont pour corollaire une incoordina-
tion neuro-musculaire lors du cycle respiratoire (3).
ÉPIDÉMIOLOGIE
La revue de la littérature, sur ces vingt dernières années, note une
modification sensible des étiologies de la paralysie laryngée uni-
latérale. En effet, si, en 1984, Yamada et al. (4) notaient que les
étiologies les plus fréquentes de la paralysie laryngée unilatérale
étaient la cause idiopathique et la chirurgie de la glande thyroïde,
Benninger et al. (5), en 1994, notaient une augmentation des étio-
logies en rapport avec un geste chirurgical non thyroïdien et/ou
une affection tumorale et une diminution relative des étiologies
idiopathiques et postchirurgicales thyroïdiennes. Une étude
récente menée dans notre service a confirmé cette tendance (6).
En présence d’une paralysie laryngée unilatérale après chirurgie
de la glande thyroïde, deux étiologies sont classiquement discu-
tées : l’intubation endotrachéale et le geste chirurgical. La res-
ponsabilité de l’intubation trachéale dans la genèse d’une para-
lysie laryngée unilatérale est une notion qui a été très longtemps
Paralysie laryngée unilatérale
après chirurgie de la glande thyroïde
Unilateral laryngeal nerve paralysis after surgery
of the thyroid gland
●
O. Laccourreye*, L. El Sharkawy*, S. Hans*
*Service ORL et chirurgie cervico-faciale, hôpital européen Georges-Pompidou,
Paris.
Résumé : Cette mise au point aborde les données récentes concernant la physiologie, l’épidémiologie, le diagnostic, le pronostic
et le traitement de la paralysie laryngée unilatérale après chirurgie de la glande thyroïde.
Mots-clés : Paralysie laryngée unilatérale - Thyroïde.
Summary: In this report, the authors analyse and summarize recent reported data documenting the physiology, the epidemio-
logy, the diagnosis, the outcome, and the treatment of unilateral laryngeal nerve paralysis after surgery of the thyroid gland.
Keywords: Unilateral laryngeal nerve paralysis - Thyroid gland.

controversée. Cette étiologie est extrêmement rare ; en 1985, seu-
lement 36 cas de paralysie laryngée postintubation avaient été
colligés dans la littérature (7). Récemment, Friedrich et al. (7),
dans une étude sur 210 patients opérés sous anesthésie générale
avec intubation trachéale pour un acte chirurgical, sans aucun
rapport anatomique avec les nerfs laryngés et/ou pneumogas-
triques, notaient trois cas de paralysie laryngée, avec une récu-
pération de la mobilité laryngée en moins de 6 mois dans 75 %
des cas. L’étude anatomique ancienne réalisée par Cavo (8) sou-
ligne qu’une telle complication lors de l’intubation laryngée est
possible. Le mécanisme de survenue de la paralysie laryngée uni-
latérale serait la compression de la branche antérieure adductrice
du nerf laryngé inférieur entre la lame cartilagineuse thyroïdienne
et le ballonnet d’intubation. Le point de compression se situerait
au niveau de la sous-glotte latérale 6 à 10 mm sous le bord infé-
rieur de la corde vocale à hauteur de son tiers postérieur. Pour
éviter cette complication, plusieurs manœuvres ont été propo-
sées en peropératoire : intubation atraumatique, pas de surgon-
flement des ballonnets gonflés avec les gaz utilisés pour réaliser
l’anesthésie, dégonflement régulier des ballonnets, et surtout,
absence de mise en hyperextension du rachis cervical (pour évi-
ter toute ascension incontrôlée du ballonnet de la sonde d’intu-
bation) (8).
DIAGNOSTIC
En présence d’un patient avec une immobilité laryngée unilaté-
rale secondaire à un geste chirurgical (avec un risque potentiel
pour la dixième paire crânienne et/ou le nerf laryngé inférieur)
réalisé sous intubation (par exemple, chirurgie de la glande
thyroïde), l’oto-rhino-laryngologiste se doit de faire la distinction
entre ankylose crico-aryténoïdienne et paralysie laryngée unila-
térale. Cette distinction est importante sur le plan thérapeutique ;
les ankyloses crico-aryténoïdiennes diagnostiquées précocement
(au stade d’arthrite) peuvent évoluer favorablement sous traite-
ment associant antibiotiques et anti-inflammatoires. Par ailleurs,
les interventions de médialisation ont une efficacité largement
supérieure lorsque l’immobilité laryngée est secondaire à une
paralysie et non à une ankylose.
Les données de l’interrogatoire, de l’examen clinique et du bilan
endoscopique peuvent orienter le praticien. Cependant, force est
de constater que, bien souvent, une telle distinction est difficile.
Pour de nombreux auteurs tels Crumley (9), l’électromyographie
laryngée peut aider le laryngologiste. Le processus de dégéné-
rescence que subit le neurone périphérique de tout nerf trauma-
tisé est dénommé “dégénérescence wallérienne”. Lors de la réa-
lisation d’un examen électromyographique, ce processus est
visualisé dans le muscle paralysé testé par l’apparition d’un
microvoltage (fibrillation voltage pour les Anglo-Saxons). Ce
microvoltage, qui apparaît dans un délai variable (de 3 jours à
3semaines suivant l’intensité du traumatisme), persiste jusqu’à
ce qu’une réinnervation ou une importante atrophie musculaire
se produise. L’apparition de potentiels d’action di- ou tripha-
siques de très grande amplitude dans le muscle testé paralysé
témoigne de la réinnervation. Ce signe est en rapport avec la réap-
parition d’unités motrices au sein des fibres musculaires endola-
ryngées. Au décours du processus de réinnervation, la forme de
ces potentiels d’action tend à se normaliser pour se rapprocher
de l’aspect monophasique des potentiels d’action “normaux”.
Malheureusement, l’apparition de potentiels de régénération di-
ou triphasiques n’est absolument pas corrélée à la reprise de mobi-
lité de la corde vocale paralysée. Aussi, en présence de poten-
tiels de régénération chez un patient qui présente une immobilité
cordale, quatre hypothèses théoriques doivent être évoquées :
–une immobilité par ankylose crico-aryténoïdienne,
–une insuffisance du nombre d’unités motrices régénérées,
–une régénération aberrante des fibres nerveuses qui aboutit à la
contraction simultanée de groupes musculaires antagonistes,
–une combinaison des trois facteurs suscités.
L’ensemble de ces données et le fait que les tracés obtenus lors
de l’électromyographie laryngée soient très largement dépendants
du type d’électrode utilisé, du positionnement intralaryngé de ces
électrodes et de l’expérience de l’opérateur font que, à l’heure
actuelle, l’électromyographie laryngée n’est pas considérée
comme un examen complémentaire à réaliser systématiquement
en présence d’une immobilité laryngée unilatérale après chirur-
gie de la glande thyroïde. Cette notion a été récemment confir-
mée par Sataloff et al. (10), qui, en 2004, dans une revue de type
evidence-based medicine sur le rôle de l’électromyographie laryn-
gée pour distinguer entre paralysie et ankylose, ont conclu à
l’absence de données scientifiques valides permettant de répondre
à cette question.
PRONOSTIC
Après chirurgie de la glande thyroïde, le taux de paralysie laryn-
gée unilatérale en postopératoire immédiat (un mois) varie de
0,5 % à 8,3 % dans les séries comportant plus de 500 patients et
publiées depuis 1990. Ce risque est considéré comme d’autant
plus élevé qu’il s’agit d’une reprise chirurgicale ou d’une exérèse
chirurgicale pour goitre, cancer ou maladie de Basedow. Il est
aussi classique de lire que le taux de survenue de paralysies laryn-
gées unilatérales définitives est d’autant plus élevé que le tronc
du nerf laryngé inférieur n’a pas été repéré préalablement à l’exé-
rèse de la glande thyroïde. Cette dernière affirmation est cepen-
dant contredite par Koch et al. (11), qui, dans une étude prospec-
tive randomisée portant sur 800 interventions de la glande
thyroïde, ont noté que le taux de paralysie laryngée unilatérale ne
variait pas, que l’opérateur ait ou non recherché le tronc du nerf
laryngé inférieur préalablement à l’exérèse de la glande thyroïde.
Par ailleurs, aucune étude à l’heure actuelle n’a pu démontrer que
l’utilisation d’un neurostimulateur lors de la chirurgie de la glande
thyroïde facilitait le repérage du nerf laryngé inférieur et/ou rédui-
sait le risque de survenue d’une paralysie laryngée unilatérale
définitive.
L’analyse de l’évolution des patients avec une paralysie laryn-
gée unilatérale secondaire à un acte chirurgical au niveau de la
glande thyroïde note une restitution ad integrum dans 43,4 % des
cas, une récupération partielle dans 3,7 % des cas, et une absence
de récupération dans 52,9 % des cas (12), avec, comme l’ont
démontré Kirchner et plus récemment Gacek (13), une absence
de survenue d’ankylose au niveau de l’articulation crico-
13
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no299 - juillet-août 2005

aryténoïdienne ipsilatérale au décours de l’évolution d’une para-
lysie laryngée unilatérale. Enfin, la mise en évidence, lors de
l’électromyographie laryngée, de potentiels d’action témoignant
d’une réinnervation est considérée par certains comme un élé-
ment pronostique favorable quant à la possible récupération de
la motricité laryngée (5).
TRAITEMENT
À l’heure actuelle, la rééducation orthophonique est la méthode
non invasive la plus utilisée dans le monde occidental pour
pal
lier les conséquences de la paralysie laryngée unilatérale
secondaire à un acte chirurgical au niveau de la glande thyroïde.
Cependant, la question de la place, de l’apport et des limites de
la rééducation orthophonique est loin d’être close ; aucune don-
née dans la littérature médicale ne précise le nombre de séances,
la méthodologie à suivre et la durée de rééducation nécessaire.
Par ailleurs, Kelchner et al. (14), dans une étude récente bien
conduite, ont souligné que la rééducation orthophonique :
–était d’autant plus réalisée que la symptomatologie dont se plai-
gnait le patient était faible ;
–avait une efficacité réduite, comparativement aux interventions
de médialisation, dès lors que la symptomatologie était sévère.
Les méthodes chirurgicales sont schématiquement regroupées en
deux grandes familles : les techniques de réinnervation laryngée
et les techniques de médialisation cordale.
Les techniques de réinnervation laryngée
La réinnervation laryngée a fait l’objet ces dernières années de
nombreux travaux tant expérimentaux que cliniques. Les tech-
niques de réinnervation laryngée se divisent schématiquement en
deux groupes : les techniques “neuronales” et les techniques “neuro-
musculaires”.
●
●Les techniques neuronales ont pour substratum la réalisation
d’une suture nerveuse entre un nerf afférent, soit moteur pour le
larynx paralysé (portion proximale du nerf récurrent lésé), soit
mis en jeu lors de la phonation (branche cervicale ansa cervica-
lis, le tronc du pneumogastrique) ou lors de l’inspiration (nerf
phrénique), et la portion distale du nerf récurrent lésé ou la
branche de division adductrice de celui-ci.
●
●Les techniques neuromusculaires visent à transférer directe-
ment au sein du muscle thyro-aryténoïdien paralysé une greffe
neuromusculaire (fragment du muscle omo-hyoïdien pédiculé sur
sa branche nerveuse) ou une branche nerveuse (nerf du muscle
omo-hyoïdien). L’hétérogénéité des populations (âge, étiologies,
degré de régénération, symptomatologie...), le faible nombre de
patients étudiés (en général moins d’une dizaine, à l’exception
d’une série rapportée par Tucker), la multiplicité des méthodes
thérapeutiques, l’absence de codification des méthodes d’ana-
lyse et des durées de suivi (en général moins de un an) font que
les résultats obtenus avec ces diverses techniques de réinnerva-
tion laryngée sont très difficiles à apprécier. L’ensemble des
auteurs s’accorde pour reconnaître qu’aucune de ces techniques
ne permet d’obtenir une récupération de la mobilité cordale et
que la preuve formelle de l’utilité de la réinnervation laryngée en
pratique clinique reste à faire. Les partisans de ces techniques
soutiennent cependant que la réinnervation laryngée favorise le
maintien de la masse musculaire, ainsi qu’un positionnement
paramédian de la corde vocale paralysée, et qu’elle évite la dégra-
dation des résultats, ainsi que la malposition du cartilage aryté-
noïde paralysé ; ils ajoutent qu’aucune de ces techniques, surtout
lorsqu’elles sont associées à un repositionnement mécanique de
la corde vocale et/ou de l’aryténoïde paralysé (thyroplastie,
adduction aryténoïdienne), n’a aggravé la situation phonatoire
ou respiratoire des patients traités.
Les techniques de médialisation cordale
Les interventions de médialisation de la corde vocale paralysée
sont séparées en deux grandes familles : les injections intracor-
dales, d’une part, et les abords chirurgicaux transcutanés, aussi
dénommés thyroplasties de type I, d’autre part (3, 5).
●
●Les injections intracordales sont réalisées sous anesthésie
générale dans la majorité des cas. Cependant, certains auteurs,
japonais et nord-américains en particulier, les effectuent sous
anesthésie locale par voie transorale ou par voie transcutanée
(intercrico-thyroïdienne ou transcartilagineuse transthyroïdienne
ipsilatérale) (3, 5). Lors de ces injections intracordales, divers
matériaux plus ou moins résorbables sont mis en place au sein
de la corde vocale paralysée. À l’heure actuelle, les matériaux à
fort taux de résorption qui sont utilisés sont le Gelfoam®, le col-
lagène et la graisse autologue (3, 5). Le Gelfoam®injecté est une
pâte constituée pour un cinquième de poudre de Gelfoam®et pour
quatre cinquième de solution saline. Ce matériau est injecté dans
le muscle thyro-aryténoïdien mais se résorbe quasi totalement en
4 à 5 semaines. En raison du risque immuno-allergique (princi-
palement aux télopeptides), de l’incertitude actuelle concernant
l’utilisation thérapeutique de produits d’origine bovine quant à
la transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et de la non-
reconnaissance de ce produit par la Food and Drug Administra-
tion nord-américaine, la majorité des équipes qui utilisaient le
collagène d’origine bovine pour pallier les conséquences de la
paralysie laryngée unilatérale se sont progressivement orientées
vers l’utilisation du collagène autologue. Les travaux de l’équipe
du Dr Ford ont souligné que le collagène injecté persistait au
moins 6 mois mais qu’il semblait être remplacé progressivement
par un collagène synthétisé par le receveur. Cette dernière don-
née conduit les auteurs à suggérer que cet implant doit au mieux
être placé en de multiples points d’injection dans la lamina pro-
pria, qui est extrêmement riche en collagène. La graisse auto-
logue, éventuellement mélangée à du fascia autologue, est un
autre matériau résorbable particulièrement intéressant. L’absence
de contre-indication à son utilisation, sa disponibilité, son coût,
qui est nul, et sa simplicité d’utilisation en font à l’heure actuelle
un matériau partiellement résorbable de choix pour pallier les
conséquences phonatoires de la paralysie laryngée unilatérale
(15). Les matériaux à faible taux de résorption actuellement uti-
lisés sont le Téflon®et le silicone (3, 5). Le Téflon®est constitué
d’une pâte stérile composée de 50% de glycérine et de 50% de
particules de polytétrafluoroéthylène (5 à 95µm). La résorption
de la glycérine conduit à une diminution de 50% du volume
injecté, résorption partiellement compensée par la réaction
inflammatoire aiguë puis chronique induite par l’implantation au
DOSSIER
14
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no299 - juillet-août 2005

sein du muscle thyroaryténoïdien de particules de polytétrafluo-
roéthylène. Les réactions aiguës connues faisant suite à une injec-
tion intracordale de Téflon®sont l’érythème et l’œdème de la
corde vocale (au moins un cas clinique de décès par asphyxie
dans les 48heures suivant une injection intracordale de Téflon®
a été documenté dans la littérature, et le pourcentage de trachéo-
tomies postinjection est estimé à 0,5%), les douleurs cervicales,
l’odynophagie, la toux et l’apparition d’adénopathies cervicales.
À ce jour, aucune réaction de type allergique et aucune cancéri-
sation n’a été documentée après injection intracordale de Téflon®.
La principale complication rencontrée après la réalisation d’une
injection intracordale de Téflon®pour pallier les conséquences
d’une paralysie laryngée unilatérale est la survenue d’un granu-
lome. La réaction chronique au Téflon®consiste en un granulome
à corps étranger avec cellules géantes. La formation d’un tel gra-
nulome témoigne d’une réaction à corps étranger intracordale et
a pour conséquence une altération importante de la vibration
muqueuse du bord libre de la corde vocale qui conduit à un mau-
vais résultat phonatoire. Pour Gardner et al. (16), cette compli-
cation est notée dans 36% des cas et apparaît d’autant plus fré-
quemment que le délai qui fait suite à l’injection est important.
Le silicone a été largement utilisé au Japon en raison de l’impos-
sibilité pour les oto-rhino-laryngologistes japonais de se procu-
rer le Téflon®lors de l’apparition de ce matériau (15, 16). Selon
Iwatake et al. (17), le volume de silicone à injecter varie de 0,5
à 2ml (valeur médiane: 0,8ml). Le silicone injecté ne doit pas
être placé près du bord libre de la corde vocale mais, comme le
Téflon®, au sein du muscle thyro-aryténoïdien.
La thyroplastie de type I est une intervention qui consiste en la
mise en place d’un implant rigide au travers de l’aile cartilagi-
neuse thyroïdienne ipsilatérale au décours d’une cervicotomie (3,
5). Le très grand avantage de cette méthode est sa réalisation sous
anesthésie locale, permettant ainsi au patient et au chirurgien
d’évaluer en temps réel le résultat phonatoire. Les troubles de la
coagulation sont la seule contre-indication relative à la réalisa-
tion d’une thyroplastie, en raison du risque de survenue d’un
hématome intralaryngé. À l’heure actuelle, divers matériaux non
résorbables (silastic, silicone, hydroxylapatite, Gore-tex®, Vital-
lium®, titane) sont utilisés pour médialiser la corde vocale para-
lysée lors de la réalisation d’une thyroplastie et ont très avanta-
geusement remplacé le cartilage autologue initialement employé.
Plusieurs études récentes soulignent la qualité et la stabilité du
résultat phonatoire après thyroplastie (3, 5). Le résultat “défini-
tif” est obtenu dès la fin du premier mois postopératoire, une fois
que l’inflammation induite par l’abord chirurgical et la mise en
place de l’implant phonatoire a régressé.
La réalisation d’une thyroplastie se heurte cependant à deux situa-
tions difficiles : le positionnement incorrect du cartilage aryté-
noïde, qui conduit à une mauvaise fermeture de la glotte posté-
rieure en phonation, et le défaut de fonctionnement du muscle
crico-thyroïdien ipsilatéral (présent lors de l’atteinte simultanée
des nerfs laryngés supérieur et inférieur), qui entraîne une flac-
cidité et un raccourcissement de la corde vocale paralysée limi-
tant l’étendue du timbre. Pour pallier ces limitations, plusieurs
techniques peuvent être associées à la thyroplastie. Le défaut de
fermeture de la glotte postérieure peut être traité par la réalisa-
tion d’une adduction aryténoïdienne ou par la mise en place d’un
implant dont la conformation agit sur le cartilage aryténoïde ipsi-
latéral paralysé, tel l’implant mis au point par le Dr Montgomery.
L’atteinte du muscle crico-thyroïdien peut aussi être compensée
par la réalisation d’une subluxation crico-thyroïdienne ipsilaté-
rale. Enfin, en présence d’une atteinte isolée du nerf laryngé supé-
rieur lors de la chirurgie thyroïdienne (en particulier chirurgie
des goitres thyroïdiens) responsable d’une altération de la sensi-
bilité pharyngo-laryngée (favorisant la survenue de fausses routes
à la déglutition, en particulier des liquides) et d’une paralysie du
muscle crico-thyroïdien ipsilatéral (objectivée par l’impossibi-
lité pour le patient de réaliser une montée dans les aigus et par
une rotation du larynx du côté non paralysé), un travail récent de
la Mayo Clinic aux États-Unis suggère que la combinaison d’une
thyroplastie de type IV (suture antérieure du cricoïde au thyroïde)
et de la mise en place d’un implant phonatoire (thyroplastie de
type I) permettrait d’améliorer la symptomatologie (18).
Les complications après thyroplastie de type I sont rares. Wein-
man et al. (19), dans une série de 332 patients, ont souligné que
le pourcentage de trachéotomies était nul après thyroplastie de
typeI isolée, mais atteignait 3,5 % lorsqu’une thyroplastie de type I
était associée à une adduction aryténoïdienne ipsilatérale. Dans
tous les cas, le problème respiratoire survenait dans les 24 pre-
mières heures postopératoires. Ces données leur ont fait conclure
que la thyroplastie de type I isolée pouvait être réalisée sans
crainte en hôpital de jour alors que la combinaison thyroplastie
de type I et adduction aryténoïdienne nécessitait une hospitali-
sation de 24 heures (19).
Quelle stratégie chirurgicale faut-il adopter ?
La multiplicité des techniques disponibles à l’heure actuelle rend
difficile la systématisation de la stratégie chirurgicale à adopter
pour pallier les conséquences phonatoires d’une paralysie laryn-
gée unilatérale survenant après chirurgie de la glande thyroïde.
De nombreux facteurs (âge, profession, comorbidité, type de trau-
matisme initial, position du larynx paralysé, présence de synci-
nésies, troubles de la déglutition associés, évolutivité de l’affec-
tion responsable de la paralysie laryngée, délai par rapport au
traumatisme initial) ainsi que l’état psychologique du patient et
l’expérience des opérateurs doivent être pris en compte.
Quelle que soit la méthode employée, le praticien doit :
–faire comprendre aux patients que l’amélioration symptoma-
tique postopératoire portera avant tout sur la réduction de l’essouf-
flement et de la fatigue vocale et seulement parfois sur les troubles
de la déglutition ;
–souligner que la rééducation orthophonique reste une solution
non invasive alternative ;
–évoquer les risques exceptionnels (en particulier les risques de
trachéotomie et d’infection) ainsi que les risques inhérents à la
réalisation d’une anesthésie, qu’elle soit locale ou générale.
Schématiquement, la réalisation d’une injection intracordale d’un
matériau plus ou moins résorbable sous anesthésie générale
semble tout à fait indiquée chez le grand enfant (le petit enfant
et le nourrisson doivent être mis à part ; les risques d’obstruction
respiratoire sont au premier plan et il résulte de ce risque que
même les matériaux à faible taux de résorption ne sont pas indi-
15
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no299 - juillet-août 2005

qués) et l’adulte si une récupération de la mobilité cordale est
envisageable, et ce d’autant qu’il existe des troubles de la déglu-
tition, mais non pas de contre-indications ou de risque majeur à
la réalisation d’une anesthésie générale, et que le délai par rap-
port au traumatisme initial est court. À l’opposé, chez l’adulte,
lorsque la paralysie est secondaire à une section ou à une résec-
tion, que la dysphonie est sévère et/ou que la profession néces-
site la meilleure qualité vocale possible, que l’anesthésie géné-
rale est contre-indiquée et que la paralysie est ancienne, la
réalisation d’une thyroplastie semble la meilleure option théra-
peutique (15, 20).
Il convient enfin de préciser qu’en présence de syncinésies défa-
vorables qui génèrent une importante diminution de la surface
glottique lors de l’inspiration (secondaire à un déplacement
médial aberrant de l’aryténoïde et de la corde vocale du côté para-
lysé), le traitement ne repose pas sur la réalisation d’une média-
lisation de la corde vocale paralysée mais fait appel aux tech-
niques visant à paralyser les muscles adducteurs (par exemple en
réalisant des injections de toxine botulique de type A au sein des
muscles adducteurs ou en sectionnant la branche adductrice du
nerf laryngé inférieur et en suturant son extrémité proximale à
l’extrémité distale de la branche abductrice afin de favoriser une
régénération neuromusculaire favorisant le muscle crico-aryté-
noïdien postérieur).
■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1.Woodson GE. Configuration of the glottis in laryngeal paralysis. I – Clini-
cal study. Laryngoscope 1993;103:1227-34.
2.Koufman JA, Walker FO, Joharji GM. The cricothyroid muscle does not
influence vocal cord position in laryngeal paralysis. Laryngoscope 1995;105:
368-72.
3.Hartl DM, Brasnu D. Les paralysies récurrentielles : connaissances
actuelles et traitements. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 2000;117:60-84.
4.Yamada M, Hirano M, Ohkubo H. Recurrent laryngeal nerve paralysis. A
10-year review of 564 patients. Auris Nasus Larynx 1983;10(Suppl.):1-15.
5.Benninger MS, Crumley RL, Ford CN. Evaluation and treatment of the uni-
lateral paralyzed vocal cord. Otolaryngol Head Neck Surg 1994;111:497-508.
6.Laccourreye O, Papon JF, Kania R, Ménard M, Brasnu D, Hans S. Paraly-
sies laryngées unilatérales : données épidémiologiques et évolution thérapeu-
tique. Presse Médicale 2003;17:781-6.
7.Friedrich T, Hansch U, Eichfeld U. Recurrent laryngeal nerve paralysis as
intubation injury? Chirurg 2000;71:539-44.
8.Cavo JW. True vocal cord paralysis following intubation. Laryngoscope
1985;95:1352-9.
9.Crumley RL. Unilateral recurrent laryngeal nerve paralysis. J Voice
1994;8:79-83.
10. Satalofff RT, Mandel SA, Mann EA, Ludlow CL. Practice parameter:
laryngeal electromyography (an evidence-based review). J Voice
2004;18:261-74.
11. Koch B, Boettcher M, Huschitt N, Hulsewede R. Must the recurrent nerve
in thyroid gland resection always be exposed? A prospective randomized
study. Chirurg 1996;67:927-32.
12. Hockauf H, Sailer R. Postoperative recurrent nerve palsy. Head Neck
Surg 1982;4:380-4.
13. Gacek MR, Gacek RR. Cricoarytenoid joint mobility after chronic vocal
cord paralysis. Laryngoscope 1996;106:1528-30.
14. Kelchner LN, Stemple JC, Gerdeman B, Le Borgne W, Adam S. Etiology,
pathophysiology, treatment choices, and voice results for unilateral adductor
vocal fold paralysis: a 3-year retrospective. J Voice 1999;13:592-601.
15. Laccourreye O, Papon JF, Kania R, Crevier-Buchman L, Brasnu D, Hans S.
Intracordal injection of autologous fat in patients with unilateral laryngeal
nerve paralysis : long-term results from the patient’s perspective. Laryngo-
scope 2003;113:541-5.
16. Gardner GM et al. Status of the mucosal wave postvocal cord injection
versus thyroplasty. J Voice 1991; 5:64-73.
17. Iwatake H, Iida J et al. Transcutaneous intracordal silicon injection for
unilateral vocal cord paralysis. Acta Otolaryngol 1996;522(Suppl.):133-7.
18. Nasseri SS, Maragos RE. Combination thyroplasty and the “twisted
larynx”: combined type IV and type I thyroplasty for superior laryngeal nerve
weakness. J Voice 2000;14:104-11.
19. Weinman EC, Maragos NE. Airway compromise in thyroplasty surgery.
Laryngoscope 2000;110:1082-5.
20. Nouwen J, Hans S, DeMones E, Crevier-Buchman L, Brasnu D, Laccour-
reye O. Thyroplasty type I without arytenoid adduction in patients with unila-
teral laryngeal nerve paralysis: Montgomery versus the Gore-tex implant. Acta
Otolaryngol 2004;124(6):732-8.
DOSSIER
16
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no299 - juillet-août 2005
Les articles publiés dans “La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale”
le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.
© janvier 1985 - EDIMARK SAS - Imprimé en France - DIFFERDANGE - 95100 Sannois - Dépôt légal : à parution.
1
/
5
100%