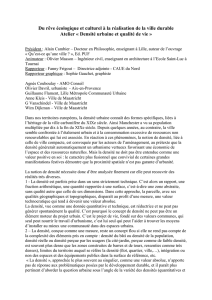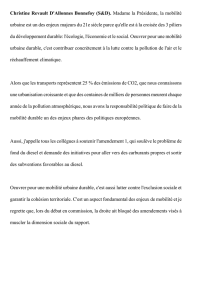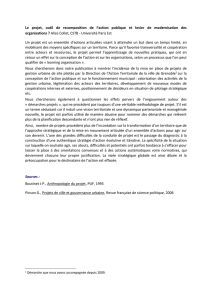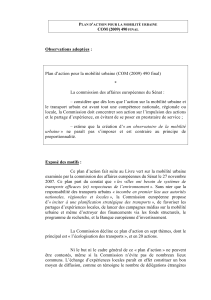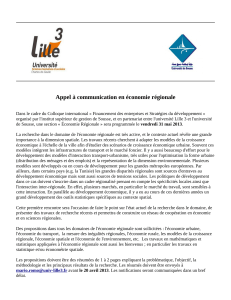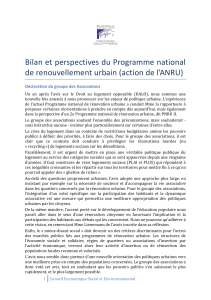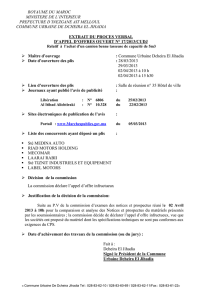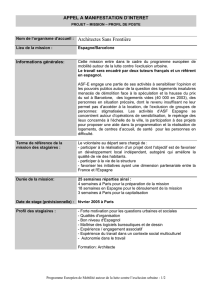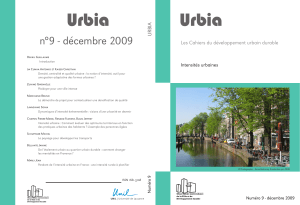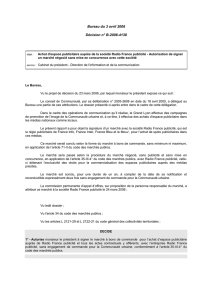Télécharger le fichier


Septembre 2008 | Guide de qualité urbaine et d’aménagement durable de la Communauté urbaine de Bordeaux | a’urba | 3
Ouvrage produit par la communauté urbaine de Bordeaux,
conçu et réalisé par l’a-urba sous la direction de Francis Cuillier
Rédaction en chef
Pierre Lascabettes architecte urbaniste, chef de projet
Équipe projet
Dephine Comte architecte urbaniste
Romain Deux ingénieur urbaniste
Emilie Jeanniot ingénieur urbaniste
Catherine Le Calvé architecte urbaniste
Avec la participation de Nicolas Drouin, Vincent Schoenmakers et Jean-Christophe Chadanson
Hélène Dumora iconographe
Nadine Gibault communication
Raymonde Ducazeaux assistante
Réalisation des schémas
Kathy Harvey architecte urbaniste
Conception graphique
Olivier Chaput infographiste
Avec la collaboration
de la direction du développement urbain et de la planification de la communauté urbaine de Bordeaux
et de Agnès Berland-Berthon, architecte et urbaniste, maître de conférence à l’Institut d’aménagement,
de tourisme et d’urbanisme de l’université de Bordeaux, pour le texte introductif « La qualité urbaine
dans le projet communautaire »
Les crédits photographiques sont portés sur les index photographiques de chaque partie de cet ouvrage.
a’urba © 2008
guide de qualité urbaine
et d’aménagement durable
de la communauté urbaine de Bordeaux

4 | a’urba | Guide de qualité urbaine et d’aménagement durable de la Communauté urbaine de Bordeaux | Septembre 2008
LA QUALITÉ URBAINE DANS LE PROJET COMMUNAUTAIRE
Avant-propos : la commande et ses enjeux
Pour un urbanisme du cadre de vie
Des dispositifs spatiaux pour une ville continue, aérée et densifiée
Une ville dense et intense
Une ville différenciée valorisant ses diversités urbaines et paysagères
Une ville composée et lisible
Les déclinaisons spatiales du guide de qualité urbaine et d’aménagement durable
Le quartier et la ville
L’îlot et la rue
Le cœur d’îlot et la parcelle
Mode d’emploi des fiches thématiques
1 | LE QUARTIER ET LA VILLE, L’ESPACE PERÇU
A | Composition urbaine et paysagère
A1 | Les composantes du site | paysage | relief | exposition |
A2 | Le traitement des limites urbaines | lisières | fronts urbains | interface |
A3 | La distribution des quartiers | continuités | hiérarchisation | cheminement |
A4 | L’adaptation des formes bâties au contexte | diversité | fonction | transition |
A5 | La structuration du paysage urbain | échelle | densité | épannelage |
A6 | La composition des tracés urbains | axes | perspectives | repères |
A7 | L’usage du végétal | espaces verts | squares | plantations |
Index photographique de la partie A
B | Gestion urbaine durable
B1 | L’usage de la ville | déplacements | organisation | proximité |
B2 | L’écologie urbaine | nature | biodiversité | paysage |
B3 | Le confort urbain | composition | orientation | climat |
B4 | La gestion de l’eau | perméabilité | assainissement | stockage |
B5 | La gestion de l’énergie | réseaux | mutualisation | rendement |
B6 | L’acoustique urbaine | bruit | protection | écran |
B7 | Le cycle des déchets | ramassage | stockage | recyclage |
Index photographique de la partie B
Sommaire
p | 06
p | 06
p | 06
p | 09
p | 15
p | 17
p | 19
p | 21
p | 22
p | 24
p | 26
p | 28
p | 30
p | 32
p | 34
p | 36
p | 39
p | 40
p | 42
p | 44
p | 46
p | 48
p | 50
p | 52
p | 54

Septembre 2008 | Guide de qualité urbaine et d’aménagement durable de la Communauté urbaine de Bordeaux | a’urba | 5
2 | L’ÎLOT ET LA RUE, L’ESPACE VÉCU
C | Insertion urbaine
C1 | Le traitement des rez-de-chaussée | fonctions | ouvertures | matériaux |
C2 | Le traitement des accès | entrées | porches | garages |
C3 | La délimitation des îlots | clôtures | murs | haies |
C4 | L’aménagement des marges de recul | usage | plantations | traitement |
C5 | Le traitement des volumes bâtis | épannelage | rythmes | adjonctions |
C6 | La disposition des bâtiments | avant | arrière | angle |
C7 | L’intégration des éléments techniques | coffrets | locaux techniques | gaines |
Index photographique de la partie C
D | Aménagement des espaces publics
D1 | La desserte des quartiers | partage | ambiance | aménité |
D2 | Le traitement des voies vertes | liaisons | perméabilité | usage |
D3 | Les aménagements de voiries | mobilier | protection | seuils |
D4 | Les espaces publics végétalisés | typologie | technique | pratiques |
D5 | La palette des matériaux | teintes | modules | textures |
D6 | Le choix des essences | végétaux | milieux | ambiances |
D7 | L’éclairage nocturne | luminaires | ambiances | éclairement |
Index photographique de la partie D
3 | LE CŒUR D’ÎLOT ET LA PARCELLE, L’ESPACE APPROPRIÉ
E | Organisation paysagère et architecturale
E1 | La recomposition de la trame urbaine | desserte | trame parcellaire | typologies |
E2 | Les spécificités de la parcelle | vues | orientation | voisinage|
E3 | L’implantation des constructions | espace libre | retrait | emprise |
E4 | La végétalisation des espaces extérieurs | usages | jardins | végétaux |
E5 | L’intégration du stationnement | aires | parkings | garages |
E6 | La composition des façades | modénatures | proportions | percements |
E7 | L’usage des matériaux | signification | pérennité | diversité |
Index photographique de la partie E
F | Préconisations environnementales
F1 | Les énergies renouvelables l chauffage l climatisation l électricité l
F2 | Le confort thermique l orientation l isolation l protection l
F3 | La qualité sanitaire des constructions l lumière l ventilation l matériaux l
F4 | Le traitement de l’eau l assainissement l filtrage l recyclage l
F5 | La gestion des risques naturels l inondation l incendie l stabilité des sols l
F6 | Les matériaux de construction l structure l performances l filière l
F7 | L’adaptabilité du bâti l évolutivité l pérennité l maintenance l
Index photographique de la partie F
ANNEXES
Index des références réglementaires
Le zonage du PLU communautaire
Recueil des données climatiques et naturelles locales
p | 57
p | 59
p | 60
p | 62
p | 64
p | 66
p | 68
p | 70
p | 72
p | 74
p | 77
p | 78
p | 80
p | 82
p | 84
p | 86
p | 88
p | 90
p | 92
p | 95
p | 97
p | 98
p | 100
p | 102
p | 104
p | 106
p | 108
p | 110
p | 112
p | 115
p | 116
p | 118
p | 120
p | 122
p | 124
p | 126
p | 128
p | 130
p | 132
p | 133
p | 134
p | 136

6 | a’urba | Guide de qualité urbaine et d’aménagement durable de la Communauté urbaine de Bordeaux | Septembre 2008
Avant-propos : la commande et ses enjeux
Il n’y a pas de société, pas de territoire, sans espace.
Produit de notre organisation sociale, la ville est politique, idéologique et stratégique, mais c’est
la vie en commun, faite d’inter-relations et les conditions matérielles de leur mise en oeuvre qui
façonnent le social, c’est-à-dire notre être-ensemble.
Pour relever les défis de l’attractivité durable des villes et développer le projet politique d’une ville
pluraliste et démocratique, un projet d’organisation spatiale de la grande ville doit l’accompagner.
Ce projet a pour objet la mise en œuvre d’un cadre de vie socialement équitable, à la fois stable
et plastique, respectueux des impératifs écologiques et de la prégnance historique, et capable
d’agréger qualitativement les différents espaces et les intérêts particuliers.
Le plan local d’urbanisme (PLU) a été voté le 21 juillet 2006 par les 27 communes qui constituent
la communauté urbaine de Bordeaux. Il s’agit pour ses élus, ses techniciens et son administration
de mettre en œuvre les valeurs urbaines et les objectifs opérationnels communautairement validés
à cette occasion. La volonté de se donner les moyens de la maîtrise qualitative d’une croissance
urbaine nécessaire et attendue, l’engagement à soutenir un développement diversifié et équilibré
des différents quartiers et communes de l’agglomération bordelaise et à poser la variété de
l’existant comme une valeur urbaine ajoutée en sont les principes majeurs de référence.
Au-delà de la volonté locale d’une consolidation des atouts urbains de l’espace de vie
communautaire bordelais et de son adaptation aux transformations de notre société, ce projet
de ville s’inscrit dans une perspective plus large. L’attractivité des régions urbaines, et des villes
auxquelles elles s’identifient, est en effet largement considérée comme une condition essentielle
de leur inscription pérenne sur l’échiquier économique et politique européen. Pour assurer leur
avenir, il s’agit de valoriser leurs atouts (diversité, caractère agrégatif tant du point de vue social
que spatial, ancrage patrimonial), de défendre leur identité et de renforcer leur attractivité fondée
en grande partie sur la qualité de leur cadre de vie.
Considérée comme un bien commun, économique, social et culturel qui doit être transmis aux
générations futures, la ville est le moteur et le creuset des forces d’innovation et d’intégration
sociale, et la mobilisation est grande à tous les niveaux décisionnels, de l’Union Européenne aux
communes, pour maintenir et développer cet héritage.
Au-delà des contingences locales, la réalisation de ce guide de qualité urbaine et d’aménagement
durable de la communauté urbaine de Bordeaux est à inscrire dans cette démarche générale.
Pour un urbanisme du cadre de vie
De la ville à l’agglomération
Dans un article célèbre écrit en 19721, Françoise Choay dénonçait le caractère abstrait de la
ville post-industrielle et l’inadéquation désormais patente entre « les mots et les choses »,
le terme de ville perdurant dans le langage courant alors que l’urbain semblait pour sa part
réduit – ou étendu – à un espace indéfinissable. Le constat de l’éclatement des formes urbaines
traditionnelles considérées comme socialement organisatrices a créé le sentiment d’avoir perdu la
compréhension des lois et des mécanismes profonds de la ville. On est ainsi passé avec un certain
fatalisme de l’usage du mot ville à celui d’agglomération. L’agglomération urbaine est souvent
définie aujourd’hui par son étendue et l’arbitraire apparent de la tenue ensemble des éléments qui
la composent. Elle donne alors le sentiment d’évoluer selon des forces et des logiques plurielles
qui agitent, transforment, durcissent ou désagrègent ce qui fait office de cadre de vie. Cet usage
banalisé du terme d’agglomération est révélateur de la difficulté à penser la ville-espace comme
un tout, les formes et règles de la complexité et de la diversité qui la constituent semblant faire
défaut.
La qualité urbaine
dans le projet communautaire
1. CHOAY Françoise, « Sémiologie et urbanisme», in « Le sens de la ville », 1972, éditions du Seuil.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
1
/
138
100%