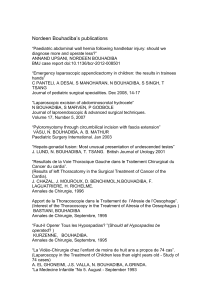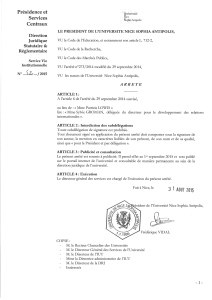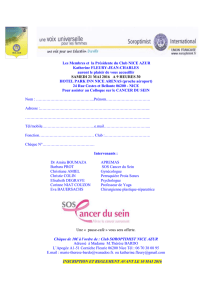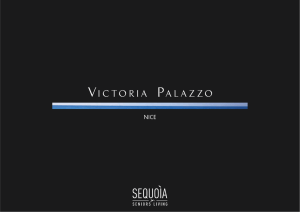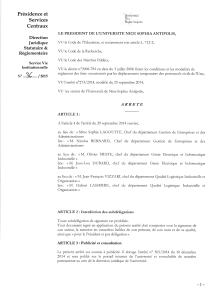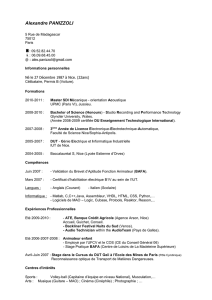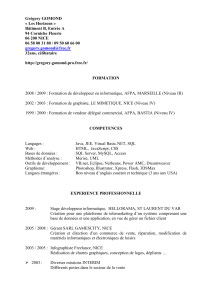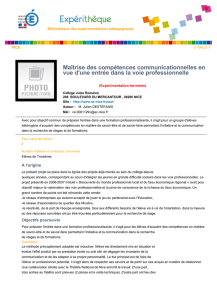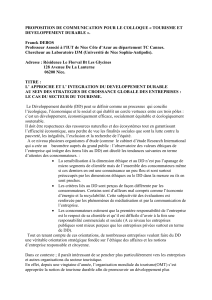Intégration de la simulation

Journal
de
Chirurgie
Viscérale
(2012)
149,
55—63
Disponible
en
ligne
sur
www.sciencedirect.com
ARTICLE
ORIGINAL
Intégration
de
la
simulation
dans
la
formation
des
internes
en
chirurgie.
Programme
pédagogique
du
centre
de
simulation
médicale
de
la
faculté
de
médecine
de
Nice夽
The
place
of
simulation
in
the
surgical
resident
curriculum.
The
pedagogic
program
of
the
Nice
Medical
School
simulation
center
J.
Bréauda,∗,
D.
Chevalliera,
E.
Benizria,
J.-P.
Fourniera,
M.
Carlesa,
J.
Delottea,
N.
Venissaca,
A.
Myxa,
A.
Ianellia,
J.
Levrauta,
D.
Jonesb,
D.
Benchimola
aCentre
de
simulation
médicale,
faculté
de
médecine
de
Nice,
université
de
Nice
Sophia-Antipolis,
06000
Nice,
France
bCarl
Shapiro
Simulation
Centre,
Beth
Israël
Deaconess
Hospital,
Harvard
Medical
School,
Boston,
États-Unis
Disponible
sur
Internet
le
11
février
2012
MOTS
CLÉS
Enseignement
;
Simulation
;
Cœliochirurgie
;
Facultaire
Résumé
Introduction.
—
L’enseignement
de
la
chirurgie
repose
sur
un
enseignement
facultaire,
un
ensei-
gnement
au
bloc
opératoire
et
au
lit
du
malade
associé
éventuellement
à
une
formation
au
sein
des
laboratoires
d’anatomie
ou
de
chirurgie
expérimentale.
Celui-ci
peut
être
complété
par
un
apprentissage
utilisant
les
différentes
techniques
de
simulation.
L’apprentissage
par
simulation,
largement
répandu
outre-atlantique,
permet,
sans
aucun
risque
pour
les
patients,
d’intervenir
sur
plusieurs
éléments
de
la
formation
chirurgicale.
Méthodes.
—
Le
curriculum
développé
au
centre
de
simulation
de
la
faculté
de
médecine
de
Nice
Sophia-Antipolis
concerne
l’ensemble
des
internes
en
chirurgie
de
la
faculté
de
médecine.
Résultats.
—
Chaque
interne
bénéficie
d’une
formation
théorique
(initiation
à
la
check-list
de
bloc
opératoire),
une
formation
aux
scenarii
médicochirurgicaux
sur
mannequin
haute-fidélité
et
une
formation
aux
gestes
techniques
de
chirurgie
ouverte
et
cœlioscopique
sur
deux
ans,
suivie
d’un
examen
de
validation
d’aptitude
technique.
Ce
curriculum
a
été
accrédité
par
l’American
College
of
Surgeons,
constituant
le
premier
programme
de
ce
type
en
France.
Conclusion.
—
Ce
programme
constitue
un
modèle,
répondant
aux
vœux
de
l’Académie
de
chirurgie
de
voir
l’émergence
d’écoles
de
chirurgie.
©
2012
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.
DOI
de
l’article
original
:
10.1016/j.jviscsurg.2011.12.007.
夽Ne
pas
utiliser,
pour
citation,
la
référence
franc¸aise
de
cet
article,
mais
celle
de
l’article
original
paru
dans
Journal
of
Visceral
Surgery,
en
utilisant
le
DOI
ci-dessus.
∗Auteur
correspondant.
Adresse
e-mail
:
(J.
Bréaud).
1878-786X/$
—
see
front
matter
©
2012
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.
doi:10.1016/j.jchirv.2011.09.007

56
J.
Bréaud
et
al.
KEYWORDS
Training;
Laparoscopic
simulation;
Academic
teaching
Summary
Introduction.
—
Surgical
training
relies
on
medical
school
lectures,
practical
training
in
patient
care
and
in
the
operating
room
including
instruction
in
anatomy
and
experimental
surgery.
Training
with
different
techniques
of
simulators
can
complete
this.
Simulator-based
training,
widely
used
in
North
America,
can
be
applied
to
several
aspects
of
surgical
training
without
any
risk
for
patients:
technical
skills
in
both
open
and
laparoscopic
surgery,
the
notion
of
teamwork,
and
the
multidisciplinary
management
of
acute
medico
surgical
situations.
Method.
—
We
present
the
curriculum
developed
in
the
Simulation
Center
of
the
Medical
School
of
Nice
Sophia-Antipolis.
All
residents
in
training
at
the
medical
school
participate
in
this
curriculum.
Results.
—
Each
medical
student
is
required
to
pursue
theoretical
training
(familiarization
with
the
operating
room
check-list),
training
in
patient
management
using
a
high
fidelity
manne-
quin
for
various
medical
and
surgical
scenarios,
and
training
in
technical
gestures
in
open
and
laparoscopic
surgery
over
a
2-year
period,
followed
by
an
examination
to
validate
all
techni-
cal
aptitudes.
This
curriculum
has
been
approved
and
accredited
by
the
prestigious
American
College
of
Surgeons,
making
this
the
first
of
its
kind
in
France.
Conclusion.
—
As
such,
it
should
be
considered
as
a
model
and,
in
accordance
to
the
wishes
of
the
French
Surgical
Academy,
the
first
step
toward
the
creation
of
true
schools
of
surgery.
©
2012
Elsevier
Masson
SAS.
All
rights
reserved.
Le
cursus
national
de
chirurgie
recommandé
par
l’Académie
de
chirurgie
repose
sur
une
triade
associant
un
enseigne-
ment
facultaire,
une
formation
pratique
hospitalière
au
bloc
opératoire
et
au
lit
du
patient
et
un
apprentissage
au
sein
des
laboratoires
d’anatomie,
de
chirurgie
expérimentale
ou
bien
encore
sur
simulateurs
[1].
L’enseignement
au
lit
du
malade
et
au
bloc
opératoire
représente
la
pierre
de
voûte
de
la
formation
des
internes
en
chirurgie,
a
fortiori
en
tenant
compte
de
la
complexi-
fication
croissante
des
patients.
Toutefois,
la
rentabilité
de
celui-ci
semble
moins
évidente
par
la
conjonction
de
plusieurs
facteurs.
Parmi
eux,
nous
pouvons
citer
la
dimi-
nution
de
l’impact
didactique
des
stages
hospitaliers
en
raison
de
leur
hétérogénéité
[2],
du
défaut
d’encadrement
[3]
et
surtout
du
manque
d’évaluation
de
l’enseignement
[3].
L’apparition
du
repos
compensateur
réglementaire
qui
a
considérablement
réduit
le
temps
d’apprentissage
hospita-
lier
[4].
L’efficacité
didactique
de
l’apprentissage
pratique
au
bloc
opératoire
qui
est
sérieusement
remise
en
question
[5].
Même
si
la
notion
d’enseignement
par
simulation
est
ancienne
[6],
les
techniques
d’apprentissage
par
simula-
tion
ont
eu
ces
dernières
années
un
essor
considérable,
notamment
par
le
développement
de
la
cœlioscopie
et
des
nouvelles
technologies.
Le
concept
d’enseignement
par
simulation
repose
sur
la
définition
d’un
cursus,
le
développement
de
supports
tech-
niques
plus
ou
moins
complexes
et
la
mise
en
place
de
systèmes
d’évaluation
de
l’enseignement.
L’apprentissage
de
la
chirurgie
se
prête
tout
particuliè-
rement
à
ce
type
d’enseignement
pour
différents
aspects.
L’aspect
technique
avec
la
possibilité
via
des
simulateurs
de
développer
une
aptitude
technique
pérenne
[7]
sur
certains
gestes
(gestuelle
cœlioscopique
[8—10],
endoscopique,
de
chirurgie
ouverte).
L’aptitude
au
raisonnement
devant
cer-
taines
situations
cliniques
et
la
notion
de
travail
en
équipe.
Enfin,
l’évolution
des
pratiques
chirurgicales
doit
intégrer
une
dimension
médicolégale
et
la
notion
de
certification
et
de
formation
continue.
Ainsi,
outre-atlantique,
l’impact
médicolégal
[11]
et
économique
[12]
d’une
formation
sur
simulateur
avant
certification
pour
certaines
spécialités
ou
techniques
«
à
risque
»
est
maintenant
reconnu.
Les
patients
sont
rassurés
que
les
praticiens
qui
s’apprêtent
à
pratiquer
des
actes
invasifs
sur
eux
aient
été
formés
sur
simulateurs
[13].
Plusieurs
sociétés
savantes
ont
débuté
une
politique
d’accréditation
des
centres
de
simulation
[14].
Des
agences
de
santé,
telles
que
le
National
Health
Service
anglais
ou
la
Haute
Autorité
de
Santé
franc¸aise
sont
en
train
d’intégrer
la
simulation
dans
leurs
recommandations
pour
la
forma-
tion
médicale
initiale
ou
le
développement
professionnel
continu.
De
même,
un
consensus
européen
d’intégration
de
la
simulation
dans
l’apprentissage
cœlioscopique
a
été
proposé
[15].
Outre-atlantique,
la
place
de
la
simulation
dans
l’apprentissage
de
la
chirurgie
est
clairement
définie,
sous
forme
notamment
aux
États-Unis
du
programme
Fundamen-
tals
of
Laparoscopic
Surgery,
développé
par
la
Society
of
American
Gastrointestinal
and
Endoscopic
Surgeons
[16]
dont
la
validation
est
recommandée
pour
obtenir
une
cer-
tification
en
chirurgie
digestive
[17]
ou
bien
encore
par
le
développement
du
programme
d’accréditation
des
centres
de
simulation
médicale
(Accredited
Education
Institutes)
sous
l’égide
de
l’American
College
of
Surgeons.
L’objectif
principal
de
ce
travail
est
de
présenter
le
pro-
gramme
d’intégration
de
la
simulation
dans
la
formation
des
internes
en
chirurgie
mis
en
place
à
la
faculté
de
médecine
de
Nice
Sophia-Antipolis.
Après
avoir
exposé
les
bases
conceptuelles
d’un
appren-
tissage
par
simulation
et
la
méthodologie
utilisée
à
Nice,
le
cursus
développé
sera
présenté.
Les
différents
aspects
de
ce
programme
ainsi
que
les
évolutions
ultérieures
seront
alors
abordés.
Matériel
et
méthode
Bases
conceptuelles
de
l’enseignement
par
simulation
La
simulation
peut
être
définie
comme
un
processus
édu-
catif
qui
remplace
la
rencontre
avec
de
vrais
patients
par

Intégration
de
la
simulation
dans
la
formation
des
internes
en
chirurgie
57
des
modèles
artificiels,
des
acteurs
ou
des
malades
virtuels
[18].
Son
but
est
de
recréer
des
scenarii
ou
des
appren-
tissages
techniques
dans
un
environnement
réaliste,
avec
comme
double
objectif
le
retour
d’expérience
immédiat
et
l’évaluation
des
acquis.
La
simulation
médicale
s’appuie
sur
des
bases
concep-
tuelles
issues
des
sciences
de
l’éducation.
Plusieurs
modèles
y
participent
:
le
modèle
de
Kolb
qui
détaille
plusieurs
stratégies
d’apprentissage
[19],
le
concept
de
pratique
volontaire
[20],
le
concept
d’éducation
des
adultes
(andra-
gogie)
[14],
ainsi
que
l’apprentissage
en
milieu
réaliste
[21]
pour
ne
citer
que
les
principaux.
Les
grands
principes
régissant
tous
ces
modèles
sont
les
suivants
:
•un
apprentissage
actif,
clairement
identifié
en
tant
que
tel
par
les
étudiants,
la
motivation,
la
définition
claire
d’objectifs
d’apprentissage
pertinents,
un
niveau
de
dif-
ficulté
approprié
et
croissant,
des
activités
ciblées
et
répétées,
l’acquisition
de
connaissances
bâti
sur
les
connaissances
antérieures
et/ou
les
erreurs,
un
ensei-
gnement
tenant
compte
de
la
diversité
des
étudiants
et
de
leur
connaissances
antérieures,
l’articulation
avec
les
sciences
fondamentales,
des
mesures
précises,
le
retour
d’expérience
immédiat
avec
un
environnement
réaliste,
une
approche
multidisciplinaire
et
la
réflexion
dans
l’action
[14,20,21]
;
•les
techniques
de
simulation
permettent
en
outre
une
amélioration
de
la
communication
au
sein
d’équipes
mul-
tidisciplinaires
(bloc
opératoire
par
exemple)
[18].
Leur
application
en
médecine
est
directement
issue
du
concept
d’analyse
d’accidents
survenus
dans
des
domaines
aussi
variés
que
l’industrie
aéronautique
ou
nucléaire.
Il
existe
d’ailleurs
un
très
grand
parallélisme
entre
les
problèmes,
leurs
origines
et
leurs
solutions
entre
la
médecine
et
l’industrie
aéronautique
[22].
Méthodologie
développée
pour
la
conception
du
programme
de
simulation
Une
équipe
d’enseignants
universitaires
(JPF,
JL,
DC,
JB)
a
été
impliquée
par
l’institution
dans
la
création
et
le
développement
du
centre
de
simulation
de
la
Faculté
de
Médecine
de
Nice.
Cette
équipe
a
bénéficiée
de
deux
périodes
d’immersion
au
sein
de
centres
de
simu-
lations
reconnus
(Carl
Shapiro
Simulation
Centre—Beth
Israël
Hospital—Harvard
Medical
School
Boston
États-Unis)
et
d’une
collaboration
active
entre
la
faculté
de
médecine
de
Nice
et
Harvard
Medical
School.
À
l’issue
de
cette
période
un
projet
architectural
et
péda-
gogique
a
été
élaboré
au
sein
de
la
faculté
de
médecine
de
Nice,
financé
par
la
faculté
et
le
conseil
général
des
Alpes-Maritimes
par
deux
appels
à
projets
successifs.
Le
programme
pédagogique
a
été
élaboré
par
le
comité
de
pilotage
du
centre
de
simulation,
composé
des
respon-
sables
du
centre
de
simulation
(JB,
DC,
JL)
et
des
membres
du
département
de
pédagogie
médicale
de
la
faculté
de
médecine
de
Nice
Sophia-Antipolis
(JB,
DC,
JPF).
Aspect
architectural
Le
centre
de
simulation
de
la
faculté
de
médecine
de
Nice
Sophia-Antipolis
dispose
actuellement
de
trois
salles
identiques,
comportant
chacune
une
partie
«
médicale
»
(salle
d’urgence
totalement
reconstituée,
pourvue
de
tout
le
matériel
médical
réel
(permettant
un
apprentissage
en
contexte
authentique),
une
partie
«
pédagogique
»
(tables,
chaises,
écran
interactif,
tableau,
équipements
audiovi-
suels)
pour
le
retour
d’expérience
et
une
partie
«contrôle
»
(pilotage
des
mannequins,
enregistrement,
diffusion).
Une
quatrième
salle
accueille
le
matériel
de
simulation
chirurgicale.
Matériel
de
simulation
Le
choix
des
différents
supports
de
simulation
s’est
porté
après
une
analyse
de
la
littérature,
des
possibilités
tech-
niques
de
chaque
simulateurs
ainsi
que
de
leur
diffusion
afin
d’obtenir
à
long
terme
des
données
comparables
et
repro-
ductibles.
Les
supports
pour
la
simulation
médicale
sont
:
•plusieurs
supports
pour
gestes
techniques
simples
(tronc
pour
drainage
thoracique
et
introduction
de
voies
vei-
neuses,
têtes
d’intubation.)
;
•trois
mannequins
informatisés
«
haute
fidélité
»
(Simman®
société
Laerdal®)
pouvant
interagir
avec
la
salle,
pré-
sentant
des
signes
cliniques,
des
paramètres
vitaux
modifiables.
.
.(Fig.
1).
Les
supports
pour
la
simulation
chirurgicale
sont
:
•cinq
dispositifs
extrêmement
simples
pour
l’apprentissage
de
la
chirurgie
ouverte
permettant
un
apprentissage
des
sutures
et
des
ligatures
(Fig.
2)
;
•trois
simulateurs
de
gestes
cœlioscopiques
simples
uti-
lisant
des
instruments
réels.
Le
choix
s’est
porté
sur
dispositif
F.L.S®qui
est
le
plus
largement
répandu
(Fig.
3)
;
Figure
1.
Mannequin
haute-fidélité
SimMan®.
Figure
2.
Dispositif
pour
exercices
de
chirurgie
ouverte.

58
J.
Bréaud
et
al.
Figure
3.
Simulateur
Fundamentals
of
Laparoscopic
Surgery®.
•trois
simulateurs
cœlioscopiques
en
réalité
virtuelle
dont
un
permet
un
apprentissage
de
la
chirurgie
robotique
(Simsurgery®)
et
un
est
doté
d’un
retour
de
force
(LapMentor®Simbionix®)
(Fig.
4).
Le
Tableau
1
présente
le
matériel
disponible
au
centre
de
simulation
de
la
faculté
de
médecine
de
Nice.
Équipe
pédagogique
Les
responsables
du
développement
des
cursus
médicaux
et
chirurgicaux
en
simulation
bénéficient
d’une
forma-
tion
continue
et
d’une
collaboration
internationale
dans
le
domaine
de
la
simulation
médicale
et
chirurgicale.
Sept
chirurgiens
exerc¸ant
au
CHU
de
Nice
sont
impliqués
dans
la
formation
des
internes
en
chirurgie.
Ils
sont
spéciali-
sés
en
chirurgie
pédiatrique
(JB),
chirurgie
urologique
(DC),
chirurgie
thoracique
(NV),
chirurgie
digestive
(EB,
AI,
AM)
et
gynécologie-obstétrique
(JD).
Chacun
d’entre
eux
pos-
sède
une
expérience
en
cœlioscopie
(plus
de
100
procédures
et
une
activité
chirurgicale
régulière
cœlioscopique
sur
des
procédures
spécifiques
[15])
ainsi
qu’une
formation
adminis-
trée
par
les
responsables
du
centre
de
simulation
(JB,
DC,
JPF)
sur
l’utilisation
des
simulateurs
et
leurs
implications
pédagogiques.
Population
ciblée
Les
internes
en
chirurgie
concernés
par
le
programme
péda-
gogique
sont
:
•les
internes
de
première
et
deuxième
année
quelque
soit
leur
spécialité
future
;
Figure
4.
Simulateur
LapMentor®.
•les
internes
en
chirurgie
générale,
chirurgie
thoracique,
chirurgie
infantile,
gynécologie-obstétrique
et
urologie
de
troisième
ou
quatrième
année.
Validation
du
centre
de
simulation
et
du
programme
élaboré
Le
centre
de
simulation
de
la
faculté
de
médecine
de
Nice
a
été,
à
la
suite
d’un
processus
de
certification,
reconnu
comme
centre
de
simulation
certifié
(American
Educational
Institute)
par
l’American
College
of
Surgeons
et
fait
partie
des
61
centres
de
simulations
certifies
comme
tel
de
par
le
monde.
Ce
processus
de
validation
porte
sur
plusieurs
volets,
Tableau
1
Matériel
disponible
au
centre
de
simulation
médicale
de
la
faculté
de
médecine
de
Nice.
Matériel
disponible
Type/nom
Nombre
Figure
no
Gestes
techniques
usuels
Tête
d’intubation
2
Bras
de
perfusion
2
Thorax
pour
drainage
thoracique
1
Pelvis
pour
drainage
vésical
2
Mannequins
haute-fidélité
Mannequin
SimMan®3
1
Technique
chirurgicale
Dispositif
pour
chirurgie
ouverte 5
2
Simulateur
F.L.S®33
Simulateur
réalité
virtuelle 2
(Simsurgery®)
1
(LapMentor®)
4

Intégration
de
la
simulation
dans
la
formation
des
internes
en
chirurgie
59
qu’ils
soient
architecturaux,
organisationnels,
techniques
ou
bien
encore
éducatifs.
La
validation
des
différents
exercices
et
items
du
pro-
gramme
d’enseignement
complémentaire
par
simulation
repose
sur
une
analyse
de
la
littérature
et
une
sélection
des
exercices
ayant
déjà
fait
l’objet
de
validation
(exercices
du
module
F.L.S®,
exercices
du
simulateur
LapMentor®),
ou
le
cas
échéant
de
normes
de
validations
établies
par
experts
(JB,
DC,
JD).
Résultats
Présentation
du
programme
d’enseignement
par
simulation
Le
programme
d’enseignement
s’articule
autour
de
trois
axes
:
•un
apprentissage
technique
aux
gestes
techniques
usuels,
aux
gestes
chirurgicaux
conventionnels
et
cœliosco-
piques
;
•un
apprentissage
au
travail
en
équipe
(exemple
du
bloc
opératoire)
;
•un
apprentissage
clinique
à
la
gestion
multidisciplinaire
de
situations
médicochirurgicales
aiguës
aux
urgences.
Apprentissage
technique
Apprentissage
technique
aux
gestes
techniques
usuels
Il
repose
sur
une
formation
en
ateliers
thématiques
:
rappels
anatomiques
et
techniques,
entraînement
sur
simu-
lateur
dédié
(pieds
de
porc
frais
pour
les
sutures,
têtes
d’intubation.
.
.)
sous
la
conduite
de
moniteurs
avec
retour
d’expérience
immédiat
et
répétition
du
geste
jusqu’à
la
maîtrise
complète.
Les
gestes
techniques
concernés
sont
la
pose
de
voie
veineuse
périphérique
et
centrale
(y
compris
le
repérage
échographique)
;
l’abord
des
voies
aériennes
supérieures
;
le
drainage
thoracique
;
le
cathétérisme
vésical
;
les
tech-
niques
simples
de
suture.
Apprentissage
de
la
gestuelle
chirurgicale
Plusieurs
gestes
techniques
ont
été
retenus.
Ils
sont
tous
enseignés
pendant
les
deux
premières
années
d’internat.
Certains
d’entres
eux
constituent
les
exercices
à
valider
par
les
internes
en
troisième
année
ou
plus.
Les
exercices
retenus
pour
le
cursus
continu
(deux
premières
années
d’internat)
sont
Les
exercices
sont
:
•pour
la
chirurgie
ouverte
:
réalisation
de
points
simples
et
de
Blair
Donati,
de
surjet
et
de
ligatures
simples
et
appuyées,
réalisation
d’une
anastomose
digestive
termino-terminale
et
termino-latérale
(sur
prothèse
en
mousse)
et
d’une
suture
vasculaire
sur
modèles
synthé-
tiques
(LifeLike
Bio
Tissue®)
;
•pour
la
chirurgie
cœlioscopique
:
les
différents
exercices
de
la
validation
F.L.S®[16],
des
exercices
de
manipu-
lation
de
camera
à
0
et
30◦(simulateur
SimSurgery®),
des
exercices
visant
à
développer
la
coordination
bima-
nuelle
et
le
repérage
dans
l’espace
(exercices
Place
Arrow
et
Retract
and
dissect
tissue
du
module
Tissu
Manipu-
lation
[simulateur
SimSurgery®],
exercice
Basic
Task
6
[simulateur
LapMentor®]),
la
coagulation
(exercice
Basic
Task
8
[simulateur
LapMentor®]),
ainsi
que
la
réalisation
d’une
cholécystectomie
cœlioscopique
non
compliquée
(Fig.
5
:
patient
1
module
Cholecystectomy
[simulateur
LapMentor®]).
Les
exercices
retenus
pour
l’examen
validant
la
formation
(internes
en
troisième
ou
quatrième
année)
sont
La
réalisation
d’une
anastomose
vasculaire
et
digestive
(termino-terminale
et
termino-latérale)
pour
la
chirur-
gie
ouverte,
validation
de
tous
les
exercices
du
module
F.L.S®,
la
validation
de
l’exercice
de
manipulation
de
caméra
à
30◦et
la
réalisation
d’une
cholécystectomie
cœlioscopique
(ou
d’une
cure
de
grossesse
extra-utérine
pour
les
internes
en
gynécologie),
cette
procédure
résu-
mant
la
plupart
des
gestuelles
cœlioscopiques
usuelles
(exposition—dissection—ligature—coagulation).
Le
Tableau
2
présente
l’ensemble
du
cursus
à
réaliser,
les
critères
de
validation
et
d’échec
de
chaque
exercice,
leur
provenance
(référence
ou
donnée
interne)
et
les
exercices
figurant
pour
l’examen
validant.
Apprentissage
au
travail
en
équipe
Un
film
réalisé
au
sein
du
centre
de
simulation
sur
l’application
de
la
check-list
préopératoire
de
l’Organisation
Mondiale
de
la
Santé
[23].
Il
est
présenté
à
chaque
nou-
vel
interne.
Il
décrit
l’accumulation
potentielle
d’accidents
(erreur
de
patient,
patient
non
à
jeun,
fonctionnement
défectueux
de
l’aspiration,.
.
.)
en
l’absence
d’utilisation
de
la
check-list
et
au
contraire
une
procédure
préopéra-
toire
sans
encombre
en
cas
d’utilisation.
Ce
film
a
été
conc¸u
grâce
à
une
collaboration
multidisciplinaire
(chi-
rurgien,
anesthésistes,
qualiticiens,.
.
.),
interprété
par
des
professionnels,
chacun
dans
son
rôle
et
tourné
au
centre
de
simulation.
Figure
5.
Cholécystectomie
virtuelle
Patient
1
module
Cholecys-
tectomy
(simulateur
LapMentor®).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%