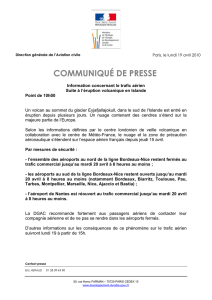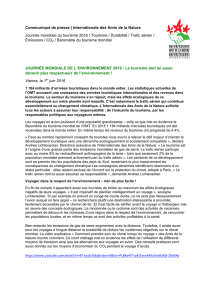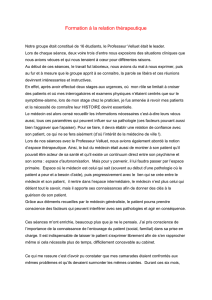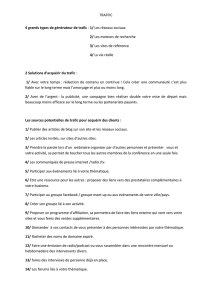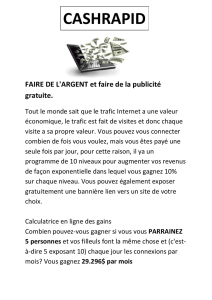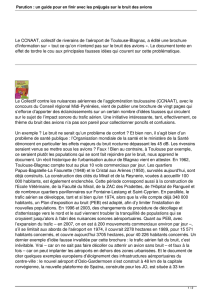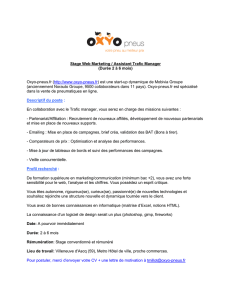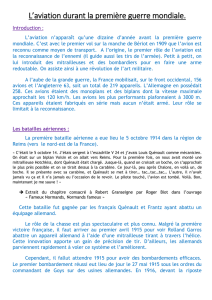APPLICATION, Introduction aux actes du colloque aéronautique, Introduction_aux_actes_du_colloque_aéronautique.pdf, 34 KB

Introduction générale
par l’équipe du CETCOPPRA
Le CETCOPRA : 20 ans d’exploration du monde aéronautique
Les cadres de la recherche : la modernité à hauteur d’homme
Les travaux de recherche du CETCOPRA depuis une vingtaine d’années, dans le domaine de
l’aéronautique, ont permis de constater que l’implémentation des nouveaux automates dans
les divers milieux professionnels, aussi bien dans les postes de pilotage que dans les salles de
contrôle en route, chez les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ou
encore chez les policiers aux frontières qui interviennent dans les aéroports, était toujours
l’occasion d’un affrontement entre deux logiques de travail : une logique de type analogique
reposant sur des savoir-faire pour ainsi dire « bricolés » et néanmoins efficaces, forgés au plus
près du réel, impossibles à mettre en algorithmes et en procédures, et une logique de type
digital embarquée dans les systèmes informatisés.
La ligne de fracture apparaît clairement, elle est politique : d’un côté, des pratiques
professionnelles solidement établies mais peu contrôlables par des instances extérieures, parce
que peu formalisables et peu traçables, ce qui signifie une grande autonomie opérationnelle
dans les équipes ; de l’autre côté, une mainmise des instances dirigeantes sur les équipes par
le biais de procédures imposées, par le biais aussi de systèmes techniques rendant l’activité
des opérateurs transparente et donc contrôlable.
On se méprendrait complètement si l’on comprenait cet affrontement comme un face à face :
en réalité il a toujours lieu, non pas entre deux forces extérieures l’une à l’autre qui finissent
par se télescoper, mais à l’intérieur même du cadre de référence imposé par la logique des
automates. Les opérateurs ne « résistent pas au changement », comme on dit souvent à tort, ce
qui supposerait chez eux la possibilité de conserver une position d’extériorité par rapport à la
logique des automates : c’est de l’intérieur même de cette logique qu’ils s’efforcent de
maintenir vivante, sinon intacte, les conditions d’une autre voie possible. Disons-le
franchement, cet effort a souvent l’air d’un combat d’arrière-garde, perdu d’avance donc,
même s’il dessine des lignes de fracture, des fragmentations possibles dans une logique qui, il
faut le dire, n’est pas forcément celle des systèmes techniques eux-mêmes mais qui est plutôt
une logique de calibrage de toutes les activités humaines selon les critères du management.
C’est cette situation que pointe la notion de macro-système technique, qui a servi de référence
conceptuelle forte aux travaux des chercheurs du centre. L’aéronautique civile possède la
particularité de s’être construite dès l’origine sur ce modèle général, cette gigantesque
machine à gérer les flux, née avec le chemin de fer couplé au télégraphe. Tout en reliant ce
point de vue global à l’observation de la manière dont l’acteur ressent les contraintes et
participe à la gestion du système dans sa pratique professionnelle. Rappelons comment se
définit grossièrement un macro-système technique qui est :

a- un système technique hétérogène ;
b- composé de machines complexes et de structures physiques organisées sous formes de
réseaux (le contrôle, les balises et satellites, les radiocommunications, etc.) en relation par un
ensemble d'interfaces avec d'autres systèmes qui constituent son environnement (l'électricité
fournit l'énergie aux systèmes de communications, le pétrole arrive par un ensemble complexe
jusque dans les réservoirs, etc.) ;
c- qui comporte un territoire interne fait de flux où les flux matériels (même ceux d'une
matière subtile telle l'électricité) y sont gérés à distance tandis que le contrôle s'exerce au
moyen d'un appareil de surveillance généralisée sur l'ensemble de ce territoire.
Le MST aéronautique correspond très exactement à la phase contemporaine de l'évolution
sociale que Zygmund Bauman décrit comme « monde liquide » ou mieux il en est la forme
institutionnelle. Il représente ainsi la machine la plus en connivence avec le désir
contemporain de « mobilité infinie », selon le mot du philosophe allemand Peter Sloterdijk.
Ceci est un fait et toute l’histoire de l’aviation civile depuis 1944 se comprend sur ce modèle.
La création de l’OACI permet l’existence d’un premier instrument de régulation qui se donne
vocation à réguler les échanges sur la planète entière. Certes, le modèle se complexifie et
prend diverses formes, par exemple celle du « hub and spoke » depuis une quinzaine
d’années, mais il reste sous-tendu par cette obligation première de gérer des flux dans lesquels
les électrons libres que sont les avions doivent être relativement dépendants du sol. Sophie
Poirot-Delpech a inventé pour qualifier ce mode de fonctionnement l’image de « Icare et
l’oiseau mécanique ».
Cette dialectique se reproduit sans cesse sous diverses formes et l’automatisation présentée
comme un moyen de soulager le pilote des tâches fastidieuses est aussi un moyen de faire
monter le sol à bord tandis que les projets d’avenir qui, au nom de la « fluidification »
enchaînent la machine et l’asservissent dans toutes les phases du vol (par exemple le projet
ITARS), sont d’autres éléments du mécano aéronautique. Il n’y pas là une volonté de critiquer
mais simplement l’illustration de la manière dont l’avenir de l’objet avion est surdéterminé
par des contraintes systémiques
Mais on peut aussi comprendre le macro-système technique comme une organisation
sociotechnique capable d’intégrer, sans toutefois les dissoudre complètement, les éléments de
« résistance » susceptibles de la menacer du dehors. On peut penser par exemple à
l’importance que les interfaces informatiques, labellisées « interfaces naturelles », accordent
aux « retours sensoriels », intégrant du coup des éléments susceptibles de venir perturber le
fonctionnement d’automates qui seraient demeurés trop étrangers aux logiques propres du
corps.
Le point capital est le suivant : l’individu n’est pas un sujet formé à l’extérieur du macro-
système et susceptible d’entrer, du dehors, en résistance contre lui ; il est façonné par les
logiques macro-systémiques (on comprend la raison pour laquelle les travaux du centre
pointent en direction des origines même de la sociologie : la sociologie durkheimienne repose
déjà sur la conviction que l’individu est au point de convergence de forces, qu’il est la
résultante de forces qui se télescopent ; en outre, Durkheim avait compris que l’exercice d’une
contrainte ne suffit pas pour maintenir l’ordre : le macro-système repose aussi sur des
stratégies de séduction, de fascination, de captation des consciences, ce que les travaux du
CETCOPRA n’ont pas cessé de souligner). Le macro-système est donc avant tout un
dispositif d’individuation, de subjectivation comme disait Foucault.
La sociologie des usages pratiquée au CETCOPRA est une voie d’entrée dans ces dispositifs
de subjectivation qui font intervenir des mécanismes de pouvoir traversant les individus (et les
constituant du même coup, on pense par exemple à la façon dont les logiciels d’identification
biométrique requalifient les individus comme unités de flux, c’est-à-dire de manière purement

opératoire), des stratégies de catégorisation (les « vieux » qui « résistent au changement » et
qui polluent les plus « jeunes », récemment sortis des écoles et mieux disposés à l’égard des
systèmes informatisés etc.), mais aussi des savoirs sur les individus (on peut de ce point de
vue considérer que les chercheurs en sciences humaines impliqués dans les projets de
développement industriel ont un rôle qui est requis par le dispositif lui-même : la production
du savoir n’est pas l’irruption d’une critique « du dehors » dans l’ordonnancement du
dispositif, elle est un élément fonctionnel du dispositif).
En expliquant ce que Foucault entendait par « dispositif », Deleuze confiait à la fin des années
80 que la tâche léguée par Foucault à ses successeurs était en définitive de poursuivre
l’investigation des nouveaux modes de subjectivation dans les sociétés de contrôle. Les
travaux du CETCOPRA peuvent aussi être lus comme des contributions à cette investigation.
Un monde en mutation : la question des limites
Il y a une vingtaine d’années, au début de nos travaux sur l’aviation civile, une automatisation
totale du système était annoncée, elle semblait à portée de main, presque imminente. La figure
de l’automate s’incarnait en particulier dans les glass-cockpits et les pilotes de ces avions
qu’on appelait alors de « nouvelle génération » se présentaient parfois à nous comme « une
espèce en voie de disparition ». Ce moment d’innovation favorisait une dramatisation de la
situation, une polarisation des imaginaires. L’automatisation signifiait, pour les uns, la
perspective d’une sécurité accrue, elle annonçait pour, les autres, la fin d’un monde, celui où
les hommes gouvernaient les machines. Les fameuses courbes de Boeing attribuant 70% des
accidents au facteur humain, c’est-à-dire à la faillibilité humaine, renforçaient d’ailleurs
simultanément ces deux points de vue.
Au fur et à mesure que les usages s’installaient, cet horizon d’une automatisation totale
reculait —sans jamais, pour autant, s’effacer complètement— et la place de l’homme se
redéfinissait. Les recherches labellisées « facteur humain » y ont largement contribué, y
compris sur le plan réglementaire : l’humain n’est plus seulement celui qui commet des fautes
ou des erreurs, il est aussi celui qui rattrape les situations dangereuses.
La figure de l’automate fait son retour à chaque fois que l’innovation technique se glisse dans
des dispositifs nouveaux, et contraint à une recomposition du macro-système y compris dans
sa trame la plus locale. Ainsi, aujourd’hui, le drone apparaît-il comme l’une des figures
radicales ouvrant sur de nouveaux possibles et réactualisant l’imaginaire d’une automatisation
globale. Le drone est un objet volant dont les applications sont aussi bien militaires que
civiles et qui présente une caractéristique essentielle par rapport à l’avion : il n’y a pas
d’humain à bord. Le drone est piloté à distance depuis un centre de commandement. Cet
« oiseau mécanique » est-il —encore— un avion ? Dans quelle catégorie d’objets doit-il être
placé ? L’enjeu est de taille, comme dans tout processus de classification, car intégrer ou non
le drone dans la classe des avions —ce qui semble être en train de se produire— revient à
décider d’admettre (ou à le refuser) que la présence humaine à bord pour conduire le dispositif
n’est pas un élément déterminant de sa définition. Banaliser l’idée d’un avion sans pilote
devient alors non seulement possible, mais probable.
On pourrait interroger avec intérêt ce retour récurrent de la perspective d’une automatisation
totale, de la vision du monde qu’il porte et de la situation sociale ultime qu’il décrit. Et
d’abord, quelle est cette totalité supposée ? Quels sont les fondements imaginaires qui, dans le
monde aéronautique, nourrissent cette perspective ? Qu’est-ce qui plus précisément dans le
processus d’innovation produit le fait que son horizon se rapproche ou s’éloigne ? Cet horizon
constitue-t-il un moteur pour l’action ? Agit-il différemment selon les groupes sociaux qui
l’investissent ? Quelle place occupe-t-il dans la cohésion des collectifs ?

Les visions du futur qui alimentent aujourd’hui les discours des acteurs du transport aérien
renvoient par exemple à des imaginaires opposés, Icare ou « oiseau mécanique ». Dans les
projets d'évolution du service de contrôle du trafic aérien, Icare a peut-être pris une longueur
d'avance. Cependant, au-delà des batailles qui opposent encore les uns et les autres, nous
voudrions plutôt insister maintenant sur une caractéristique commune : ces visions se
projettent dans un futur qui refuse de penser vraiment une limite à la croissance du trafic
aérien. Si les problèmes environnementaux sont évoqués, ils semblent cependant ne pas être à
même d'infléchir une augmentation du trafic dont on ne modifie pas les prévisions depuis
longtemps annoncées.
Dans la plupart des écrits, des plus officiels aux rapports les plus techniques, produits par les
chercheurs et les ingénieurs du domaine, une croissance régulière du trafic aérien est
annoncée. On lit régulièrement, par exemple, que « l'on peut s'attendre à une augmentation
de trafic de 4 à 5 % par an jusqu'à 2025 » Le projet SESAR se donne l'objectif de répondre
à une « augmentation de 73 % du trafic d'ici à 2020 ». Les aspects environnementaux sont
pourtant évoqués : comment pourraient-ils être totalement ignorés lorsque l'on sait le poids du
transport aérien dans les Le Macro-Système-Technique est, ne l’oublions-pas, une méga-
machine thermique, et outre les réacteurs de l’avion, les autres éléments du système
consomment une grande quantité d’énergie en raison même des exigences de sécurité, de la
régulation des flux au sol et du contrôle d’approche ? La crise de l’énergie ne va donc pas
frapper seulement le gros gourmand qu’est l’avion mais elle va aussi imposer de nouveaux
modes de fonctionnement au sol dont pour l’instant personne ne semble se soucier.
Peut-être aussi des répercussions se feront-elles sentir sur les relations sol-bord aussi bien que
sur les formes d’organisation commerciale fondées sur le captage des flux de passagers pour
les redistribuer, le « hub and spoke» ? Il parait difficile de croire que quelles que soient les
évolutions du marché du pétrole ce sera seulement l’avion en tant que tel qui changera en
conséquence, c’est bien sûr le macro-système tout entier qui devra s’adapter. Or pour l’instant
prise dans l’euphorie de la croissance la réflexion sur la totalité se fait peu dans l’aéronautique
civile.
Cette situation n’est jamais évoquée comme un facteur limitatif pouvant porter un véritable
coup d'arrêt ou mener à un infléchissement net et structurel à la croissance du trafic. Le projet
SESAR par exemple définit « un objectif politique de permettre une réduction de 10% des
effets que les vols ont sur l'environnement ». Mais aucun horizon temporel ne semble indiqué,
et les mesures associées sont plutôt floues.
Ainsi, à une vision souvent autonome de la technique (dans laquelle les choix opérés sont
toujours parés d'un caractère d'inéluctabilité), se combine l'autonomie d'un trafic aérien qui
semble désormais augmenter sans intervention humaine, en tout cas en dehors de toute
volonté humaine. Le trafic aérien paraît dans ces discours souvent quasiment naturalisé : une
nature bien sûr ici pensée comme pure extériorité, une nature autonome, qui suit ses lois
propres. En face de cette croissance inéluctable, l'action humaine se réduit à une pure réponse
à ces exigences : il faut mettre en place des solutions organisationnelles, techniques capables
de répondre à cette demande de trafic, capables de faire décoller, voler, atterrir un nombre
d'avions toujours plus important.
Ainsi, lorsque la notion de limite est évoquée, elle n'est pas envisagée comme un point au
delà duquel il ne sera plus possible de faire voler davantage d'avions. Elle est toujours celle
du service de gestion du trafic aérien qui se voit assigner la tâche de « répondre » purement et
simplement à la demande des compagnies aériennes. Dans les attentes des utilisateurs du
futur système de gestion du trafic aérien, on lit par exemple :”le futur système ATM devrait
fournir la capacité de répondre à la demande quand et où cela est nécessaire ”. Le rapport
d'études d'Eurocontrol « Challenges to growth » suggère que, dans les circonstances les plus
optimistes, la capacité aéroportuaire en Europe est capable d'absorber au maximum deux fois
la demande de trafic de l'année 2003. A ces taux, la barrière de capacité serait atteinte autour
de 2017. Il faut repousser cette barrière, permettre à toujours plus d'avions de voler. Pourtant,
peut-on sérieusement penser que le nombre d'avions volant dans nos cieux pourrait croître

infiniment ? Ne peut-on imaginer le moment où l'on décidera : pas un de plus dans cette
portion d'espace ? Formulé de cette façon, la réponse paraît frappée du sceau de l'évidence.
On peut imaginer beaucoup plus d'avions. Les imaginaires du futur qui s'offrent à nous vont
de la vision un tant soit peu cauchemardesque d'aéroports tentaculaires d'où s'envoleraient et
atterriraient des avions, jour et nuit, dans un mouvement sans fin, toutes les quelques minutes,
à des images aimables d'un futur high tech, d'un petit train d'avions se touchant presque : ce
sera alors un futur qui pensera avec condescendance à cette époque post moyenâgeuse où les
turbulences de sillage existaient encore … Mais pour gigantesque qu'il devienne, on ne peut
imaginer un nombre infini d'avions.
En miroir de ce monde virtuellement sans limites, l'homme, lui, est souvent figuré comme
seul porteur de limites. Les approches « Facteurs Humains » d'inspiration Anglo Saxonne
insistent particulièrement sur les limites cognitives du cerveau humain, qui ne peut traiter
qu'un nombre fini d'informations à la fois. « Nos ressources cognitives sont limitées »
martèlent les formations à la sécurité destinées aux pilotes et aux contrôleurs : il importe donc
de ne pas oublier cette limite dans l'approche de prise de conscience des mécanismes
mentaux mis en jeux lors de ces tâches complexes exercées par ces professionnels qui sont
souvent les derniers garants de la sécurité du macro système aéronautique. Tous en
conviennent. Mais n'est-il pas frappant de voir peu à peu se dessiner la figure d'un humain
avant tout doté de limites ?
A.Koyré nous a montré comment nous étions passés du « monde clos » et fini aristotélicien, à
l'univers infini de la modernité. Mais si l'univers est désormais infini, le ciel où peuvent voler
les avions, est, lui, bien fini : les avions volent à des niveaux de vol liés à leurs performances
leur niveau de vol demandé correspond à un optimum pour leur motorisation). Au niveau des
zones TMA près des aéroports, les avions se concentrent peu à peu pour terminer par se
grouper dans un espace très limité : les zones de roulage et de parking d'un aéroport. Cet
imaginaire d'un monde infini est-il tellement fort dans la modernité que nous répugnions
désormais à penser la limite de notre monde ? Le trafic aérien qui croit inexorablement serait
l'une des figures d'un monde où la limite ne peut plus être pensée.
La rupture introduite par l’introduction des technologies numériques est-elle au final
responsable de ce qui apparaît comme une démesure échappant à tout contrôle, du sentiment
de pouvoir s’émanciper de toute forme de contrainte, y compris sociales ? Une fois encore
le recul nous oblige à la prudence en nous incitant à réouvrir d’anciens débats.
Cette définition apparaît aujourd’hui problématique et finalement réductrice. Elle montre plus
qu’elle n’explique et ne rend que très partiellement compte de ce que la société désigne par
« virtuel ». La psychologisation du rapport au travail à laquelle participent les acteurs du
système, tout comme l’affirmation, aujourd’hui banale, de l’opposition entre les émotions,
l’informel, l’affect d’un côté, et une réglementation de plus en plus tatillonne et abstraite de
l’autre, mettent bien l’accent sur l’insuffisance de notre première approche. Cela constitue en
même temps la nouvelle topologie à l’intérieur de laquelle la question du virtuel mérite
semble-t-il d’être ressaisie.
Dans cette perspective, le virtuel ne s’oppose ni au réel ni à l’actuel, comme on l’entend
habituellement. Il traduit plutôt un état d’ébranlement, la dilution des frontières symboliques,
la menace d’indifférenciation, à l’intérieur même des cadres sociaux et des limites qui
permettent à chacun de trouver sa place, de savoir où il se trouve. Il résulte à la fois de règles
qui ne donnent plus le sentiment de protéger, mais seulement de contraindre, et d’un besoin
inextinguible et indéfini de reconnaissance, qui n’est plus régulé ou encadré par des collectifs.
L’attitude qui consiste à dénoncer le risque d’une confusion entre le réel et le virtuel (le
monde coproduit par les technologies numériques et l’écran) est bien trop massive et
superficielle pour aborder le fond des choses. Fondamentalement, ce qui mérite d’être
souligné, c’est la crise qui affecte le statut du réel, de la croyance à laquelle il est adossé et
que les nouvelles technologies rendent plus aigu, mais ne créent pas.
 6
6
1
/
6
100%