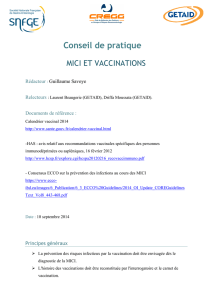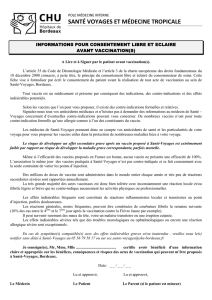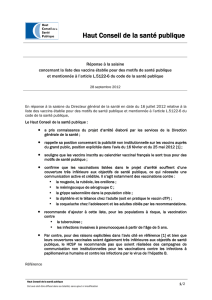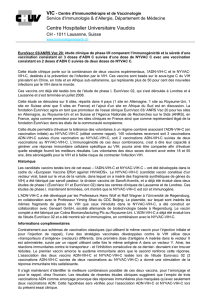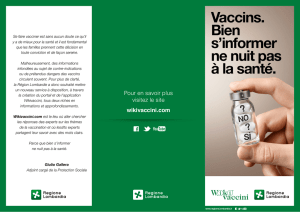1. EPIDEMIOLOGIE ET PREVENTION DES MALADIES TRANSMISSIBLES 2-32 •

1. EPIDEMIOLOGIE ET PREVENTION DES MALADIES TRANSMISSIBLES 2-32
• Notions d’épidémiologie générale
• Surveillance des maladies transmissibles
• Prévention
• Investigation d’une épidémie dans une collectivité
• Conclusion
2. RISQUES SANITAIRES LIES A L’EAU ET A L’ALIMENTATION 34-50
• Risques sanitaires liés à l’eau
• Risques sanitaires liés à l’alimentation
• Toxi-infections alimentaires collectives
3. LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 52-64
• Définitions & importance du problème
• Epidémiologie
• Critères diagnostiques
• Comment détecter une épidémie ?
• Les moyens de lutte contre les infections nosocomiales
• Conclusion
4. EVALUATION DES EXAMENS COMPLEMENTAIRES DANS 66-72
DANS LA DEMARCHE MEDICALE
• Apport diagnostique, risques et coût d’un examen complémentaire
• Analyse critique d’un compte-rendu d’examen
• Référentiels médicaux
• Demande d’examen complémentaire
• Etablir une collaboration
5. PRINCIPES D’UNE DEMARCHE D’ASSURANCE QUALITE 74-85
• Principes d’une démarche d’assurance qualité
• Les méthodes et outils des démarches d’assurance qualité
• L’évaluation des pratiques professionnelles dans le système de santé
6. RISQUES SANITAIRES LIES AUX IRRADIATIONS ET 87-102
RADIOPROTECTION
• Rayonnements ionisants
• Rayonnements ultra-violets
7. LES PERSONNES AGEES 104-120
• Introduction
• Aspects démographiques
• Aides économique et sociale
• Institutions sanitaire et sociale
• Conclusion

Santé Publique – DCEM2-DCEM3 – Année 2011-2012
8. AUTOUR DE LA CONCEPTION 122-128
• Planification familiale
• Interprétation volontaire de grossesse
• Certificat Prénuptial
9. SANTE ET PRECARITE 130-150
• Santé des immigrés
• Santé des détenus
• Les chômeurs
• Loi n°98-657 du 29 juillet 1998

EPIDEMIOLOGIE ET PREVENTION
DES MALADIES TRANSMISSIBLES
SANTE PUBLIQUE
DCEM 3

2
Épidémiologie et prévention des maladies
transmissibles : méthodes de surveillance.
- Préciser les bases de l’épidémiologie des maladies transmissibles et les mesures de
surveillance et de prévention.
- Déclarer une maladie transmissible.
Globalement, la mortalité et la morbidité des maladies transmissibles ont
considérablement régressé en France comme dans la plupart des pays développés
Cependant, si les maladies infectieuses ne représentent “ que ” 2 % environ de
l’ensemble des causes de décès en 1996 en France selon les données statistiques de
l’INSERM, ce type de pathologie reste d’actualité en santé publique en raison :
- de leur nature transmissible, qui justifie et oblige la mise en place de systèmes de
surveillance et de politiques de prévention adaptées selon les situations
épidémiologiques ;
- de la multiplication des situations à risque (augmentation des gestes invasifs, du
nombre de patients immunodéprimés, développement des voyages internationaux, de
la mobilité sexuelle, vieillissement de la population…) ;
- de l’émergence de nouvelles pathologies (fièvre hémorragique d’Ebola en 1976,
légionellose en 1976, hépatite D en 1980, Sida en 1981, encéphalopathie
spongiforme bovine en 1986, hépatite C en 1989, fièvre hémorragique vénézuélienne
en 1991, fièvre hémorragique brésilienne en 1994…), ou de la réapparition de
maladies “ anciennes ” que l’on croyait pouvoir vaincre (tuberculose).
I ) NOTIONS D’EPIDEMIOLOGIE GENERALE (figure 1)
1/ La chaîne épidémiologique de transmission
Une maladie infectieuse transmissible est la résultante de l’interaction entre un agent
pathogène défini et la sensibilité d’un hôte récepteur. Cette relation réalise la chaîne
épidémiologique de transmission et comporte plusieurs maillons (l’agent causal et son
réservoir le mode de transmission l’hôte récepteur). La plupart des maladies
infectieuses sont contagieuses, c’est-à-dire transmissibles d’un sujet atteint à un sujet
indemne, mais certaines ne le sont pas (tétanos, légionellose), et le terme de maladies
contagieuses est alors, dans leur cas, inapproprié.
Chaîne modifiée par les changements climatiques et la mondialisation.

3
1.1 L’agent causal
Les agents infectieux potentiels peuvent être : des parasites (unicellulaires ou
pluricellulaires), des champignons, des bactéries, des virus, des agents transmissibles
non conventionnels (prions).
Ils sont caractérisés par :
- leur pathogénicité, définie comme la capacité d’un micro-organisme à engendrer une
maladie ;
nombre de sujets infectés et malades
Pathogénicité = ----------------------------------------------
nombre de sujets infectés asymptomatiques
La pathogénicité du virus de la rage est par exemple élevée, celle des virus de la polio
plus faible.
- leur virulence, (plus ou moins synonyme de pathogénicité), correspondant à l’aptitude
de l’agent à occasionner des troubles morbides, (jusqu’au décès). La virulence est
plus spécifiquement évaluée par le taux de létalité, indice de gravité de l’infection ;
nombre de sujets infectés décédés
Létalité = -------------------------------------
nombre total des sujets infectés
- leur pouvoir envahissant, qui exprime la capacité de multiplication et de diffusion d’un
agent infectieux chez un sujet (le bacille de la tuberculose a ainsi un fort pouvoir
envahissant) ;
- leur contagiosité, ou “ aptitude à la transmission ” d’un agent pathogène, estimée par
le taux d’incidence.
nombre de nouveaux cas pendant une période donnée
Incidence cumulée = ---------------------------------------------------
population à risque au cours de la même période
(effectif moyen de la population)
nombre de nouveaux cas dans une population
durant une période donnée
(généralement courte)
Taux d’attaque = ----------------------------------------------------------------------
nombre de sujets susceptibles de la population durant la même période
nombre de nouveaux cas pendant une période donnée
Densité d’incidence = -----------------------------------------------------------
somme des personnes-temps* à risque pendant la même période
*un sujet suivi 2 mois représente 2 personnes.mois, tandis qu’un sujet suivi 5 mois représente 5 personnes.mois.
La densité d’incidence permet d’évaluer l’incidence lorsque la population est instable
c’est-à-dire lorsque la durée de participation est variable d’une personne à l’autre. Elle
s’exprime en nombre de cas par personne.temps.
La contagiosité de la méningite à méningocoque est par exemple faible comparativement
à la contagiosité des virus de la grippe ou de la rougeole.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
1
/
152
100%