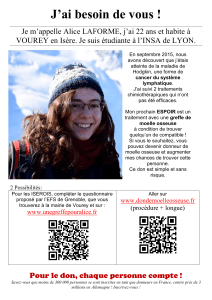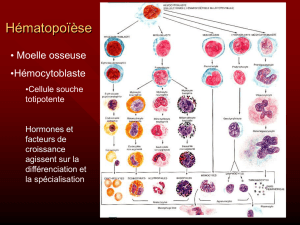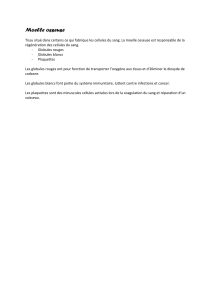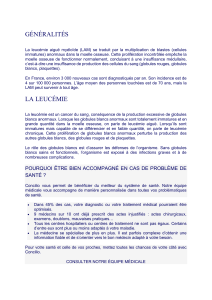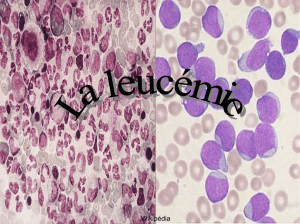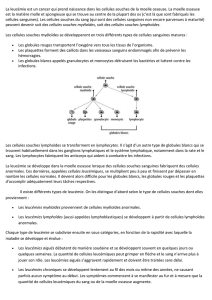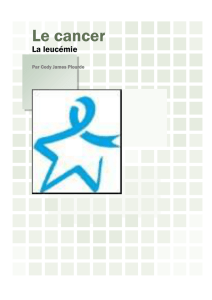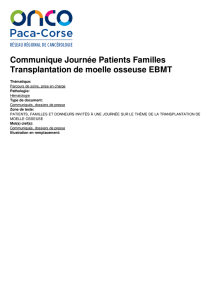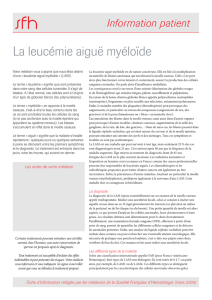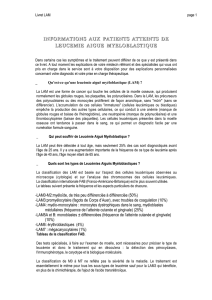Les leucémies infantiles lymphoblastiques aiguës décrites

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 31, Juillet 2007, Santé
1
Les leucémies infantiles lymphoblastiques aiguës décrites de manière
médicale et sociale
Travail de Maturité réalisé au Lycée Jean Piaget de Neuchâtel
sous la direction de Mme Katia Piccolo Bottari
Carole Giroud
1. Introduction
Dans le cadre du travail de maturité, je me suis intéressée à une maladie infantile
potentiellement mortelle : la leucémie aussi appelée cancer du sang.
J’ai choisi cette maladie car je désirais en découvrir une et non en décrire une que j’avais déjà
contractée.
De plus, cette maladie infantile, contrairement à beaucoup d’autres, n’affecte pas que le corps
mais entraîne aussi un traumatisme et des changements comportementaux et relationnels.
Cet aspect psychologique est particulièrement frappant. Il m’a donc semblé captivant de voir
comment un enfant réagit devant un tel obstacle. Par ailleurs, les cancers m’ont toujours
beaucoup impressionnée, le mot en lui-même possède déjà une accablante signification.
Mon travail porte plus précisément sur les leucémies infantiles lymphoblastiques aiguës car ce
type se rencontre le plus fréquemment chez les enfants. Il correspond à 80 % des leucémies
lymphoblastiques aiguës.
Mon texte se divise en deux parties bien distinctes mais liées :
- Une médicale
- Une sociale
La première détaille biologiquement la maladie. Cette partie représente, en quelque sorte, la
carte d’identité ou la définition très détaillée de ce type de leucémie. Elle me permet donc de
définir et préciser la leucémie lymphoblastique aiguë.
Premièrement, je décris brièvement les autres types de leucémies puis les causes d’une telle
maladie. Je m’intéresse ensuite aux dérèglements provoqués et les symptômes qu’ils
entraînent. Finalement, je me penche sur les aspects un peu plus techniques, c’est-à-dire, les
contrôles médicaux, les traitements et les recherches en cours pour les améliorer.
De nombreuses lectures m’ont permis de rédiger au mieux cette partie ainsi que des précisions
apportées par le Dr Diezi et le Dr Quarroz que j’ai tous deux rencontrés au CHUV.
Dans la deuxième partie, je me suis consacrée à une approche plus concrète au niveau de
l’expérience de vie du malade. Il est important de garder en tête que le vécu de l’enfant
occupe une place fondamentale.
Comme je désirais décrire cette maladie de la manière la plus complète possible, j’ai trouvé
essentiel de relater le parcours d’un jeune malade. Concrètement, j’ai cerné l’impact d’une
leucémie sur la vie d’un enfant malade.
Celui-ci, se révèle énorme : le cancer affecte les occupations, les relations, le corps,… du
malade.
Je présente aussi les appuis qui aident l’enfant à franchir cet obstacle ainsi que les
transformations qui surviennent dans sa vie au quotidien. Cette partie se veut objective car
chacun réagit à sa façon.

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 31, Juillet 2007, Santé
2
Au départ, j’aurais aimé rencontrer un enfant et sa famille puis raconter leur histoire mais cela
s’est avéré impossible à cause de la confidentialité imposée. Finalement, je pense que c’est
préférable de ne pas se centraliser uniquement sur un vécu.
Les discussions avec un oncologue et une psychologue m’ont confirmé cette idée : chaque
cancer est unique !
La ligue contre le cancer ainsi qu’une rencontre avec la psychologue Mme Santarelli m’ont
permis de rendre cette approche encore plus réaliste.
2. Partie médicale
Présentation
La leucémie est un cancer du sang. Elle représente la forme la plus fréquente de cancer chez
l'enfant. En Europe, les leucémies correspondent à un tiers des cancers infantiles.
Cette maladie touche tout l’organisme du jeune malade par l’intermédiaire de la circulation
sanguine. En effet, les cellules du sang sont atteintes et deviennent anormales en cas de
leucémie. Le cancer se situe dans la moelle osseuse qui est un tissu hématopoïétique, cela
signifie que cet organe produit les cellules sanguines.
La moelle osseuse constitue, d’ailleurs, la plus grande fabrique de cellules sanguines. La
moelle osseuse se trouve aux extrémités des os longs de l’enfant et on en trouve une plus
grande quantité chez les enfants que chez les adultes car ces derniers ont terminé leur
croissance et en nécessitent moins.
La moelle osseuse est divisée en deux parties :
- La moelle rouge qui fabrique les éléments sanguins.
- La moelle jaune faite de graisse.
En cas de maladie, la production des éléments sanguins par la « partie rouge » est altérée.
Différents types de leucémies infantiles
Ils existent différents types de leucémies que l'on classe selon:
1) Les globules blancs concernés:
- les lymphocytes qui sont en cause lors d'une leucémie lymphoblastique (ou lymphoïde)
- les monocytes ou granulocytes qui sont touchés lors d'une leucémie myéloblastique
(myéloïde).
2) L’évolution et la maturité:
- si le globule blanc est touché très jeune, cela donne naissance à une leucémie aiguë lors de
laquelle l'état du patient se dégrade rapidement.
- si la cellule touchée est plus mature la leucémie se nomme chronique et se développe plus
lentement.
Les leucémies chroniques chez l'enfant sont extrêmement rares et sont uniquement des
leucémies chroniques myéloblastiques. Elles ne représentent que 4 à 5 % des leucémies
infantiles.
15 à 20% des leucémies infantiles sont des leucémies aiguës myéloblastiques et touchent
surtout les enfants de plus de douze ans.

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 31, Juillet 2007, Santé
3
La majorité des leucémies qui frappent les enfants, soit environ 80%1, sont des leucémies
aiguës lymphoblastiques.
C'est cette forme que je vais décrire car elle se rencontre bien plus fréquemment que les
autres.
Causes
Dans la majorité des cas, les causes sont inconnues. Mais il existe tout de même des facteurs
de risques:
- Pour les enfants trisomiques 21, les leucémies sont 20 fois plus courantes.
- Le vrai jumeau d'un leucémique risque lui aussi d'être atteint.
- Les enfants exposés à des substances chimiques, surtout le benzène, et à des radiations
ionisantes ont un risque accru. Les explosions de Nagasaki et d'Hiroshima l'ont prouvé. Mais
cela constitue une cause très rare.
- Le risque augmente aussi si le nourrisson a un poids élevé à la naissance.
- Certaines maladies, comme la mucoviscidose, l’anémie de Fanconi,… prédisposent aux
leucémies.
Dysfonctionnements
Lors d’une leucémie lymphoblastique aiguë, les globules blancs ou leucocytes sont touchés,
plus précisément les lymphocytes.
Les globules blancs normaux, mûrissent selon une chronologie rigoureuse. Ils deviennent
matures dans un délai précis qui varie selon le type de globules blancs. Pendant leur
formation, ils ne sont pas fonctionnels. Dès qu’ils sont prêts, ils vont accomplir leurs
fonctions puis meurent.
Lymphocyte sain et mature
Lors d’une leucémie, leurs maturations, leurs vies ainsi que leurs morts sont déréglées. Les
cellules souches s'accumulent et ne deviennent pas des cellules matures. Ces cellules jeunes
n'arrivent pas à fonctionner normalement.
1 Ces pourcentages proviennent de www.uptodate.com, site découvert grâce au Docteur Diezi.

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 31, Juillet 2007, Santé
4
Les globules blancs sont alors stoppés à un stade de maturation précédant l’état d’une cellule
T ou B mature et vont proliférer. Ces leucocytes malades s’appellent blastes.
En fait, les blastes sont présents chez tout le monde, mais ils représentent seulement 1%1 de
nos cellules. Lors d’une leucémie, ce nombre augmente car les blastes se multiplient.
La leucémie se définit donc par une prolifération exagérée, désordonnée de lymphocytes
jeunes, anormaux non encore complètement formés dans les organes les fabriquant. Ils
empêchent donc la moelle osseuse de fabriquer des cellules normales vu que les cellules qui
s'y trouvent sont cancéreuses. Ces cellules immatures vont ensuite atteindre d'autres organes.
On les distingue à cause de trois défauts :
- Elles restent immatures, ne terminant donc pas leur formation. Elles demeurent semblables
alors qu’elles devraient chacun avoir des caractères différents.
- Elles ne meurent pas.
- Elles ne sont pas ordonnées comme elles le devraient.
Ces caractéristiques sont néfastes pour l’organisme humain car elles démontrent que des
blastes sont présents.
Les spécialistes sous-classent ces leucémies lymphoblastiques aiguës, ci-après LLA, pour
mieux les combattre.
Tout d’abord, ils font la différence entre les LLA B qui concernent les lymphocytes B et les
LLA T qui touchent donc les lymphocytes T. 84% des LLA sont des LLA B. Ils utilisent pour
identifier les blastes des anticorps qui réagissent contre les antigènes qui se trouvent sur ces
cellules malades. Les LLA T apportent un moins bon pronostic que les LLA B.
Une deuxième détermination permet d’établir la maturation des blastes. Les médecins en
tiennent compte pour choisir au mieux les traitements. Certains stades d’évolution des blastes
apportent un meilleur pronostic que d’autres. En fait, plus un certain type de blaste se
rencontre fréquemment, plus il est possible de le traiter car les spécialistes le connaissent
mieux.
Une dernière précision est apportée selon la morphologie des blastes. On distingue les blastes
qui sont petits (LLA 1) de ceux qui ont une plus grande taille (LLA 2) et encore ceux qui
correspondent au type LLA 3 et qui sont grands avec des caractéristiques particulières. Ce
genre de blastes est extrêmement rare. 85 à 89% des LLA sont des LLA 1.
Signes caractéristiques et symptômes
Un signe, souvent plusieurs, tel que de la pâleur, des douleurs ou de la fatigue démontrent la
chute de la production des globules sanguins.
Les blastes se déplacent et commencent alors à envahir le sang. Lorsque les cellules
leucémiques infiltrent les organes, on peut observer certaines conséquences :
- Les ganglions lymphatiques, la rate ainsi que le foie prennent de l’ampleur. Les ganglions
sont alors nommés adénopathies vu qu’ils augmentent beaucoup de volume.
- Des douleurs osseuses et articulaires surviennent, car la moelle de certains os est touchée,
ainsi que des douleurs abdominales et musculaires. Elles peuvent être assez violentes et
1 Ce pourcentage ainsi que les deux suivants proviennent de Mr Quarroz, hématologue en laboratoire
au CHUV

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 31, Juillet 2007, Santé
5
dérangent l'enfant lors de son sommeil ou de son déplacement. Les douleurs aux jambes sont
les plus fréquentes. En fait, comme le nombre de blastes est important, la moelle osseuse est
en quelque sorte si remplie qu'elle s'étire. C'est cela qui provoque ces douleurs.
- La propagation des leucocytes anormaux touche aussi d’autres parties du corps comme les
testicules et les reins.
- Les lignées sont étouffées. Normalement, elles produisent les globules rouges et blancs ainsi
que les plaquettes mais, lors d’une leucémie, la moelle osseuse n’en produit plus
suffisamment, on parle d’aplasie médullaire.
- Comme les globules rouges sont atteints et diminuent, une anémie survient et la quantité
d’hémoglobine1 dans le sang baisse. L’anémie se manifeste par de la pâleur, de la fatigue, des
maux de tête, de l’asthénie2, des difficultés à respirer, des palpitations3 et de l'amaigrissement.
- Les infections (= angines, bronchites,…) deviennent répétitives car les globules blancs
normaux ne sont plus formés.
- La baisse des plaquettes, que l'on appelle thrombopénie, provoque des hémorragies. Celles
ayant lieu sous la peau, occasionnent des taches rouges foncées que l’on nomme purpura.
Purpura affectant les jambes d’un jeune garçon (source : http://www.inrp.fr)
D'autres hémorragies qui peuvent être du nez, de la bouche,… sont difficiles à arrêter. Ces
hémorragies se rencontrent chez un malade sur deux. Ces symptômes fréquents peuvent avoir
été précédés de faibles anomalies hématologiques comme la leucopénie (= diminution du
nombre de globules blancs dans le sang), la thrombopénie, l’aplasie médullaire (= absence de
développement de la moelle osseuse), etc.
Examens et diagnostic
Parfois les signes de la maladie sont si explicites que la leucémie peut être reconnue avant
même les examens sanguins. Mais ils seront, bien sûr, tout de même effectués.
1 L’hémoglobine est véhiculée par le globule rouge et sert au transport de l’oxygène dans le sang, vers les tissus
de l’organisme.
2 L’asthénie est une sorte de fatigue chronique qui ne se soulage pas en se reposant. Elle correspond aussi à une
diminution de l’excitabilité et du pouvoir fonctionnel.
3 Les palpitations se caractérisent par des battements de cœur plus forts et plus rapides que dans l’état normal.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%