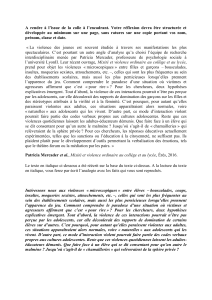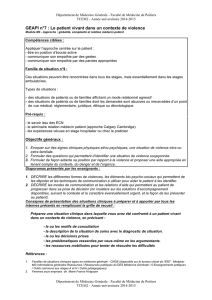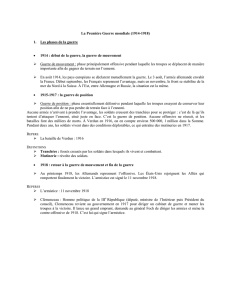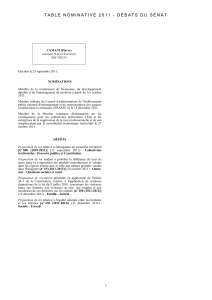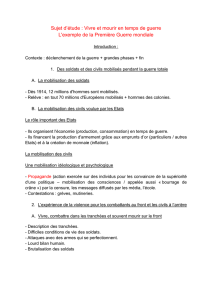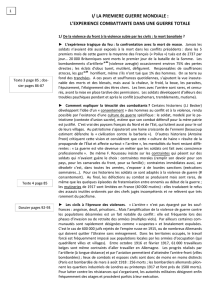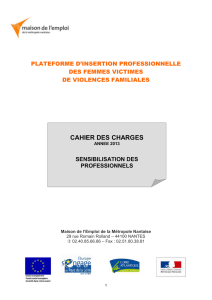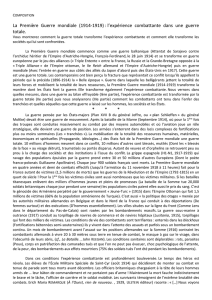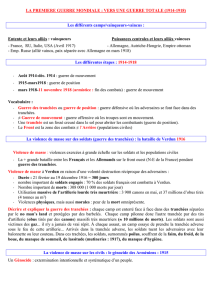La « Grande Guerre » et la « brutalisation » des consciences

Justine Baeyens – ILFM formation complète 1
re
année - fiche n°5
1
La « Grande Guerre » et la « brutalisation » des
consciences
La Première Guerre mondiale va entrainer la planète entière dans un conflit majeur qui marquera les
générations futures. Sa dimension mondiale, son caractère total impliquant les civils et le corps
d’armée, les différentes formes de violences qu’elle va prendre notamment à travers les combats
dans les guerres de tranchées impliquant plusieurs millions de soldats sur une durée longue de près
de quatre années (1915-1918), le premier cas de génocide du XXe siècle perpétré par les turcs à
l’encontre du peuple arménien (1915), la Révolution russe (1917) induite directement par la Grande
Guerre et qui aboutira à la dictature stalinienne, a amené certains historiens à se pencher sur les
conséquences de ces violences de guerre. Les millions d’hommes qui ont vécu directement ces
évènements ont-ils à la fois été victimes et coupables de violences, au point de reproduire et de
radicaliser cette dernière pendant la Seconde Guerre mondiale ? C’est ce qu’affirme l’historien
américain G. Mosse à travers la notion de « brutalisation », introduite dans son ouvrage traduit de
l’anglais : « De la Grande Guerre au totalitarisme, la brutalisation des sociétés européennes » (1999).
D’après lui, la Grande Guerre est le point de départ d’une « culture de guerre » qui, en banalisant la
violence, entrainera le franchissement du seuil de violence et sa transposition dans le champ
politique, en particulier au début de l’Allemagne de Weimar puis dans l’Allemagne nazi. Cette
nouvelle approche est reprise et développée par un ensemble d’historiens travaillant au Centre de
recherche du musée de l’Historial de Péronne.
De fait l ‘étude historique de la Grande Guerre ne se limite plus à l’énumération d’une succession
d’évènements chronologiques qui débuteraient le 28 juillet 1914 pour s’achever le 11 novembre
1918. Mais si l’on se penche sur l’étude de ses origines, de ses causes, on découvre des faits de
violences antérieures, déjà teintés de nationalisme et de luttes territoriales, et dont certaines sont à
l’origine même de violences perpétrées pendant la Première Guerre, ce qui nous amène donc à
nuancer le concept de « brutalisation » des consciences par la Grande Guerre comme lien de cause à
effet avec la Seconde Guerre mondiale.
Après l’étude des origines de la Grande Guerre et des violences qui ont marquées la fin du XIXe siècle
et le début du XXe, après l ‘examen des actes de violences concrets auxquels ont été confrontés les
civils et les militaires pendant la guerre, il conviendra de nuancer la notion de « brutalisation » des
consciences comme étant la cause, selon certains historiographes, de la brutalité de la seconde
guerre.
I – Les origines de la Première Guerre mondiale
1 - Les forces en présence :
Fruit de la défaite de Waterloo et du congrès de Vienne, l’Europe est
au XIXe siècle le théâtre de l’émergence de grandes puissances. Au centre et à l’est se trouvent les
Empires allemands, austro-hongrois et russe. Plus au sud, l’Empire Ottoman domine l’Asie Mineure
et le Moyen-Orient. Enfin à l’ouest de l’Europe se situent les deux états les plus puissants et les plus
riches : le Royaume-Uni et la France.
2 – Ambitions territoriales et nationalisme :
Les ambitions territoriales et les rivalités
économiques qui animent les grandes puissances s’accentuent. Il reste quelques territoires à
coloniser et les puissances européennes se les disputent. En 1905 et 1911, par exemple, la France et
l’Allemagne évitent deux fois une guerre à propos du Maroc qu’elles convoitent l’une et l’autre.

Justine Baeyens – ILFM formation complète 1
re
année - fiche n°5
2
L’Angleterre, elle, voit d’un mauvais œil la concurrence commerciale allemande de plus en plus vive.
La France n’a pas abandonné l’espoir de retrouver l’Alsace-Lorraine perdue lors de sa défaite contre
Bismarck en 1871. L’Autriche-Hongrie et la Russie veulent étendre leur influence dans les Balkans, se
heurtant à la Serbie, qui encourage les Slaves du Sud à se détacher de l’Empire austro-hongrois pour
former avec eux un Etat yougoslave. L’Italie veut recouvrer des territoires peuplés d’italiens en
Autriche-Hongrie. Quant à l’Empire ottoman, il est composé majoritairement de turcs tournés vers
un nationalisme agressif en butte avec le désir
d’indépendance de la population arménienne. Ce
sentiment nationaliste est d’ailleurs présent partout : au sein des empires et des différentes
nationalités à l’intérieur même des empires et des Etats. On retrouvera ce nationalisme pendant la
Grande Guerre, puis après, en particulier dans l’Allemagne nazi.
3 – Guerres coloniales et conquêtes de territoires :
De nombreux conflits coloniaux ou
territoriaux, caractérisés par une violence inédite, ont eu lieu avant la Première Guerre. Il apparait
alors que cette dernière n’a pas le monopole de la violence extrême, celle qui aurait rendu les
hommes brutaux. On peut citer parmi ces conflits la lutte territoriale qui a opposé la Russie au Japon
pour le contrôle de la Mandchourie en Chine et de la Corée, état alors indépendant. Cet
affrontement va durer un an et demi et se soldera par une défaite russe (1904-1905). Les Espagnols,
à Cuba, introduisent pour la première fois des camps de concentration, et les anglais font de même
pendant la guerre coloniale des Boers (1899-1902), en Afrique du Sud, qui oppose les émigrés
hollandais aux britanniques. Ces violences à l’encontre de civils sont accentuées par le sentiment de
supériorité ethnique qui habite les puissances européennes et en particulier l’Allemagne. Les guerres
coloniales sont présentées comme des missions civilisatrices envers des peuples jugés inférieurs.
Cette idée de race supérieure et inférieure sera reprise en Allemagne par Hitler. Quant aux Turcs, ils
ont été eux-mêmes les victimes d’une guerre contre les russes en 1877-1878, entrainant des
massacres envers leur population.
4 – Alliances défensives et course à l’armement :
C’est donc dans un climat déjà tendu à
l’extrême que deux systèmes d’alliances militaires défensives se forment à la fin du XIXe siècle : la
Triple-Entente réunit la France, le Royaume-Uni et la Russie tandis que les Empires allemand, austro-
hongrois et l’Italie s’allient autour de la Triple-Alliance. Le principe est simple : en cas d’agression
contre un des Etats, ses alliés doivent lui venir en aide. Chacun semble ainsi se préparer à une guerre,
notamment en augmentant fortement ses dépenses militaires.
5 – L’assassinat de François-Ferdinand à Sarajevo :
Le fait que la Grande Guerre s’ouvre sur un
acte de violence à visée nationaliste montre en lui-même la tension internationale qui règne à l’aube
de cette guerre. L’héritier de l’Empire austro-hongrois est donc assassiné le 28 juin 1914 par un
étudiant nationaliste serbe. C’est l’étincelle qui met le feu aux poudres. En conséquence, l’Autriche-
Hongrie déclare la guerre à la Serbie, et le mécanisme des alliances se met en place, entrainant tout
d’abord dans le conflit la Russie, l’Allemagne, la France et l’Angleterre, puis le Japon (1914), l’Italie
(1915) et enfin les Etats-Unis (1917), ces trois pays rejoignant ceux de l’Entente.
II – Les violences de la Grande Guerre
1 – D’une guerre de mouvement à une guerre de position : le plan incliné vers les
tranchées :
La guerre débute alors sur deux fronts : à l’ouest les allemands envahissent la Belgique,
violant sa neutralité, et pénètrent en France. A l’est, sur le front oriental, les armées russes entrent

Justine Baeyens – ILFM formation complète 1
re
année - fiche n°5
3
en Prusse. En France, l’offensive allemande, qui, conformément au plan Schlieffen, tablait sur une
guerre de mouvement et l’anéantissement rapide et soudain de l’armée française, échoue. Le
général Joffre parvient en effet à arrêter l’invasion allemande et remporte la bataille de la Marne.
Quant aux troupes russes, battues à Tannenberg, elles sont contraintes de reculer.
Un front qui va de la mer du Nord à la Suisse sépare les deux armées qui s’enterrent dans des
tranchées. Les offensives vont se succéder de 1915 à 1917, se soldant à chaque fois par des échecs
sanglants : les allemands lancent en 1916 une offensive à Verdun qui va durer 10 mois, sans succès :
elle tue et blesse plus d’un demi-million de soldats. Puis une offensive anglo-française débute dans
la Somme en juillet 1916 et se prolonge pendant cinq mois, mais elle échoue : cette bataille, la plus
sanglante, fait près d’un million de tués ou blessés, pour une avancée de 10 km. Nivelle, qui remplace
Joffre, lance le 16 avril 1917 celle sur le Chemin des Dames, qui est un échec total : 30 000 soldats
français y laissent leur vie en à peine dix jours. Ces offensives gourmandes en vies humaines ont un
résultat à chaque fois nul. Leur ampleur, le nombre important d’hommes qui y participent,
impliquent un engagement humain énorme inégalé de près de soixante-dix millions de soldats en
quatre ans.
3 – La guerre des tranchées :
Pour ce qui est du front ouest, les soldats allemands, français et
britanniques vont rester terrés dans des kilomètres de tranchées reliés par des boyaux pendant
quatre ans. Tandis que les Etats-majors mènent une guerre d’usure ponctuée de sanglants assauts,
les hommes sont confrontés à une violence extrême. La réalité de cette guerre des tranchées nous
apparait à travers les témoignages des poilus. La description qu’ils font de leur vie quotidienne nous
montre un véritable enfer. Ils voyaient leurs camarades mourir et vivaient l’attente du prochain
assaut dans la peur, conscient de leurs chances réduites d’en réchapper. Ils étaient à la merci des
déluges d’obus et des attaques de gaz. La boue, la terre, les rats, la pluie, le froid, la proximité des
cadavres… accentuent l’horreur dans laquelle ils sont. La mort est leur quotidien. Ainsi la guerre des
tranchées est celle qui incarne la Grande Guerre, celle où les hommes ont été confrontés à une
dureté extrême, celle qui les aurait donc « brutalisés ».
4 – Une guerre totale : les violences subies par les civils :
A mesure que la guerre se prolonge
dans le temps, les civils y sont de plus en plus impliqués : les femmes surtout, qui vont travailler dans
les usines d’armement et dans les champs, où elles remplacent les hommes partis au combat. Les
colonies aussi apportent de nombreux soldats à la France et au Royaume-Uni. Elles fournissent
également de la main d’œuvre dans l’industrie d’armement. A l’arrière, la population manque de
tout et souffre de l’inflation, ils subissent les bombardements, les pénuries d’aliments et de biens de
première nécessité, tout en travaillant dur pour l’effort de guerre. Ceux qui se trouvent dans les
régions occupées, en Belgique ou dans le nord de la France, souffrent de violences perpétrées par les
envahisseurs (travaux forcés, réquisitions, exécution des récalcitrants).
5 – déportation et génocide :
Dans un contexte où l’antisémitisme est grandissant notamment en
Russie et en Pologne, des accusations de collaboration avec l’ennemi et de trahison sont portées
contre les juifs de Russie, entrainant leur déportation de la zone du conflit en 1915. Six cent mille
juifs sont ainsi déplacés.
Le gouvernement des « Jeune-Turcs » fraîchement élu est porté par un nationalisme exacerbé.
Entrés en guerre contre les russes, au côté de l’Allemagne et de l’Autriche, ils profitent du désordre
mondial pour amorcer le génocide arménien, afin de récupérer le territoire d’Asie mineure qu’ils
considèrent comme leur. Le génocide est soigneusement planifié, par un décret du 30 mai 1915, et
organisé. La déportation des arméniens vers Alep, une ville de la Syrie ottomane, se fait soit à pied,

Justine Baeyens – ILFM formation complète 1
re
année - fiche n°5
4
soit dans des wagons à bestiaux. Au bout de la route se trouvent des camps de concentration qui
« accueillent » les survivants qui succombent rapidement. Ce premier génocide du XXe siècle fait un
million deux cent mille morts. Le gouvernement allemand, allié aux turcs, censure ce génocide et
accueille certains responsables du génocide. Les arméniens ont ainsi clairement été les victimes
d’une violence non pas due à la Grande Guerre, mais à un sentiment nationaliste exacerbé bien
antérieur à celle-ci, puisque des persécutions et des massacres contre les arméniens commis par les
turcs ont eu lieu au tout début du XXe siècle.
6 – Révolution russe : « brutalisation » ou lutte des classes ?
Début 1917, Les russes sont
affamés et épuisés par la guerre. Un hiver rude et la famine contribuent à entretenir un climat déjà
très hostile à la guerre, ponctué de défaites militaires. En février 1917, une manifestation de femmes
réclamant du pain dégénère et tourne à l’affrontement. Quelques mois plus tard, ce sera la
Révolution d’Octobre, puis le régime totalitaire avec la Terreur rouge, la création de l’Armée rouge,
les camps de concentrations que Soljenitsyne dénoncera plus tard. Les russes, qu’ils soient civils ou
militaires, ont souffert des violences occasionnées par la Grande Guerre, mais le massacre des
officiers qui suivirent février 1917 par les soldats-paysans ne révèle-t-il pas la question d’une lutte
déjà ancienne entre les paysans moujiks et les classes supérieures ?
III – La Grande Guerre a-t-elle générée une « brutalisation » des
consciences ?
1 – Une approche anthropologique et culturelle :
C’est en tout cas ce qu’affirment les historiens
du Centre de recherche de l’Historial de Péronne dont Stéphane Audouin-Rouzeau, Annette Becker,
Christian Ingrao, Henry Rousso, dans la lignée de l’américain G.L Mosse. Pour eux, les violences de la
Grande Guerre, entretenues par une « culture de guerre », ont amené les hommes qui l’ont vécue au
plus proche, c’est-à-dire dans les tranchées, à banaliser son intensité et même à y «consentir»,
expliquant en partie le franchissement du seuil de la violence pendant cette guerre et préfigurant la
brutalité de celle de 39-45. Ces hommes ont ainsi été « rendus brutaux », avec une transposition de
cette brutalité dans le champ politique, d’où la montée du nazisme en Allemagne, du fascisme en
Italie et du régime totalitaire soviétique. Mosse écrit : « La grande Guerre est bien restée jusqu’à la
fin une guerre de consentement (…) » présentant les hommes ainsi coupables d’actes violents autant
que victimes, et les historiens de Péronne reprennent la même idée, établissant un lien de cause à
effet entre les deux guerres mondiales. Cette approche a eu une grande influence sur le programme
d’histoire dès la 3
ème
, puisqu’il est demandé aux enseignants d’introduire cette notion de
« brutalisation » dans l’étude de la Grande Guerre, tout en insistant sur son aspect total et sur la
« résonnance profonde et traumatique sur le siècle qui commence », comme si cette guerre était
fondatrice d’une nouvelle forme de violence extrême et globale des guerres du XXe siècle.
2 – Une approche nuancée :
Certains historiens, dont Antoine Prost et Frédéric Rousseau, ont
nuancé cette approche d’une part en opposant à l’idée de consentement celle de contrainte
inhérente à l’armée : l’obéissance du soldat à son supérieur est une réalité qu’on ne peut ignorer ; et
d’autre part en récusant la théorie du soldat des tranchées qui tue sauvagement l’ennemi, puisque
« rendu brutal » par la culture de guerre, pour lui opposer l’argument de l’utilisation massive de
l’artillerie lourde et des gaz, principaux responsables de la mort des soldats dans les tranchées. Là où
les historiens se rejoignent, c’est sur le degré élevé atteint par la violence pendant la Grande Guerre.
Mais des violences, qu’elles soient à l’encontre des sociétés européennes, des colonies, ou même à
l’intérieures même d’un pays, ont pourtant été commises avant 1914, et elles ont elles-mêmes

Justine Baeyens – ILFM formation complète 1
re
année - fiche n°5
5
préfiguré les violences de la Première Guerre.
Le problème principal que pose la notion de « brutalisation » est son caractère généraliste. En
résumé les belligérants ont été confrontés à la même violence, donc tous ont subi cette
« brutalisation » et par conséquent, toujours si on se réfère à la thèse des historiens de Péronne,
tous ont été également « rendus brutaux ». D’où les régimes totalitaires qui se sont formés après la
guerre. D’où la Seconde Guerre mondiale et l’extrême brutalité de celle-ci à travers notamment le
génocide perpétré par les allemands ; mais voilà, tous n’ont pas cédé à la dérive du totalitarisme.
L’Angleterre et la France n’ont pas connu de régime totalitaire d’après-guerre à l’instar de
l’Allemagne, ou de la Russie, ou encore de l’Italie. Au contraire, la France a manifesté après cette
guerre un fort sentiment pacifiste, véhiculé par une majorité de français désireux de retrouver la paix
et de la conserver.
Pour ajouter une nuance supplémentaire à la « brutalisation »,
si l’on prend
l’exemple de l’Allemagne, qui a basculé après la guerre dans le régime totalitaire nazi certes
extrêmement brutal, peut-on réellement affirmer que c’est la « brutalisation » des hommes par la
Grande Guerre qui l’a poussée dans cette voie ? N’est-ce pas ignorer le passé de l’Allemagne au XIXe
siècle, composé de guerres tendant à son unification pour en faire un Empire à la tête duquel se
trouve le chancelier Bismarck, artisan de cette unification, et qui ne cache pas son ambition de
rendre son Empire toujours plus fort. « Nous serons plus forts si et seulement si nous agissons
ensemble »(Bismarck) ? N’est-ce pas ignorer également la signature du Traité de Versailles après leur
défaite en 1918, vécu comme un « dictat » par les allemands qui n’ont jamais accepté la défaite et
sont restés, dans leur esprit, en état de guerre ? La brutalité allemande pendant la Seconde Guerre
mondiale s’expliquerait alors par un ensemble de faits antérieurs et postérieurs à la Grande Guerre.
Il semblerait donc qu’il faille nuancer la notion de « brutalisation » des consciences par la Grande
Guerre, procéder à son étude en amont, en respectant les différences culturelles propres à chaque
nation, et en aval : « Chaque société lit l’expérience de la guerre à la lumière de sa culture » (Antoine
Prost).
Les acteurs du débat :
Stéphane Audouin-Rouzeau, « La guerre au XXe siècle. L’expérience combattante » et Anne Duménil, « La
guerre au XXe siècle. L’expérience des civils », Documentation Photographique, n°8041 et n°8043, 2004
Stéphane Audouin-Rouzeau, Annette Becker, Christian Ingrao, Henry Rousso (dir), La Violence de guerre, 1914-
1945, Bruxelles, Complexe, 2002
G.L.Mosse, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Paris, Hachette,
1999.
Antoine Prost, « Brutalisation des sociétés et brutalisation des combattants », in Les sociétés en guerre, 1911-
1946, Bruno Cabanes et Edouard Husson (ss coord.), Armand Colin, 2003.
Bibliographie :
G. Duby : Histoire de la France (Bibliothèque historique Larousse) réédition 2007.
Les sites Wikipédia, Hérodote, Sens-Public, books-google La violence de guerre, 1914 – 1945 : approches
comparées des deux conflits mondiaux par Stéphane Audoin-Rouzeau,Henriette Assé
1
/
5
100%