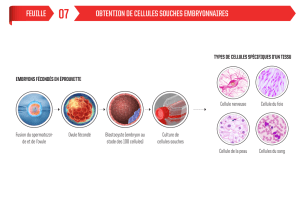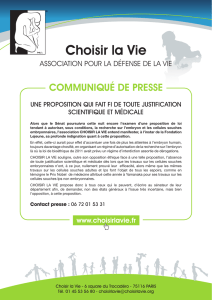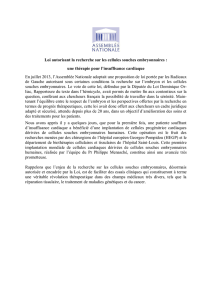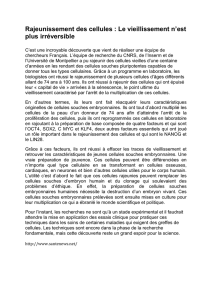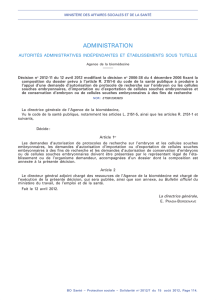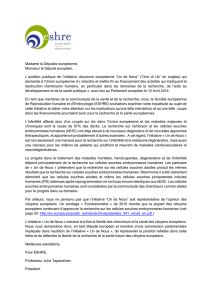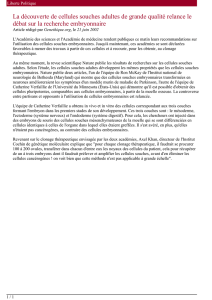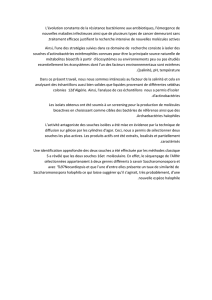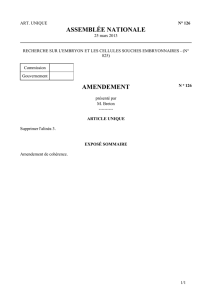I.R.H. 06 Numéro

I.R.H.
Magazine de culture scientique de l’Institut Robert Hooke/ Université Nice Sophia Antipolis
irh.unice.fr - [email protected]/ Publication gratuite - Mai 2008
Numéro
06
De la cellule au
médicament

6
9
Biochimie. Pleins feux sur les protéines
I.R.H.
Magazine de culture
scientifique de
l’Institut Robert
Hooke
Université
Nice Sophia Antipolis
Siège de la
publication
I.R.H.
28 av. Valrose
06103 NICE CEDEX 2
Tél : 04 92 07 64 60
Courriel :
Site : irh.unice.fr
Directeur de la
publication
Albert Marouani
Directeur
scientifique
Pierre Coullet
Rédacteur en chef
Pierre Coullet et
Laurie Chiara
Rédaction
Laurie Chiara
Crédit
photographique
Laurie Chiara
Gautier Damiens
Maquette
Laurie Chiara
Impression
SAS OLLANE
61 route de Grenoble
06200 Nice
04 93 71 80 79
ISSN1952-9341
Copyright
La reproduction des
textes, illustrations,
partiellement ou
dans leur totalité est
interdite, sauf accord
préalable de la
rédaction
2
Alzheimer. A la recherche du temps perdu
médecine nucléaire. La radioactivité
c’est bon pour la santé 14
11
4
Depuis le sida, les médias sonnent l’alerte dès qu’une potentielle maladie
infectieuse pointe le bout de son nez. Car la découverte, en 1983, du
V.I.H. a confronté l’opinion publique aux limites de la science à élabo-
rer un vaccin face à une entité d’une extrême complexité. Mais, dans
le même temps, des essais menés en laboratoire ouvrent sans cesse de
nouvelles perspectives pour venir à bout du virus. Et déjà, en hôpital, de
nouvelles thérapies se préparent (...)
Sorte de boîte noire de l’organisme, les cellules souches constituent, pour
les chercheurs, une fenêtre sur le passé. Matière naïve, elles précèdent
toutes les anomalies survenues lors du développement d’un individu.
Dès lors, les observer à la loupe depuis le top départ de leur spécia-
lisation en cellule mature permet aux scientiques de répondre à des
questions aussi cruciales que «pourquoi?» et «comment?» (...)
maladies infectieuses. Aller le plus loin possible
Après avoir misé gros sur le décryptage de la sacro-sainte molécule
d’ADN humain, séquencée (écrite noir sur blanc) en 2003, les cher-
cheurs xent de nouveau leur attention sur les protéines. Car avec les
bons outils, ces unités du vivant, sortes de petites briques de l’organisme,
peuvent en dire long sur les erreurs de programmation à l’intérieur du
corps (...)
Véritables mouchards au service de la médecine, les traceurs radioactifs
s’inltrent dans des zones stratégiques de l’organisme pour repérer le
plus tôt possible des maladies aussi lourdes que le cancer (...)
SOMMAIRE
cellules souches. Retour vers le futur
Ultra médiatisée, Alzheimer, la « maladie de l’âge », révèle petit à petit
ses secrets sans encore se laisser dompter. Sous le microscope elle se
manifeste au moyen de deux lésions cérébrales, les plaques séniles et
la dégénérescence neurobrillaire. Mais en amont de ces stigmates, la
pathologie semble naître de dysfonctionnements d’enzymes (...)

3
L’histoire commence par un geste anodin mais inspiré. Un jour de 1965, James
Schlatter, chimiste à la société Searl fait tomber sur son pouce un peu d’un
intermédiaire de synthèse destiné à élaborer un anti-ulcéreux.
Au lieu de s’essuyer machinalement la main il « goûte » le produit. Trente ans
plus tard l’aspartame a achevé d’envahir les marchés internationaux.
Dans la même veine, le 3 septembre 1928, un chercheur du St Mary’s Hospital de
Londres un peu distrait s’aperçoit qu’il a oublié pendant les vacances ses cultures
de staphylocoques sur sa paillasse, à côté des moisissures de son voisin.
Alexander Flemming s’étonne alors de voir que le champignon en question, le
Penicillium Notatum, semble empêcher la prolifération de ses bactéries… Il sera
le premier à soupçonner l’existence d’une substance antibactérienne appelée
pénicilline.
« Le hasard favorise l’esprit préparé », disait Louis Pasteur...
Aujourd’hui, la « médecine de laboratoire » cherche à reculer les pendules du
développement cellulaire sans toujours trop savoir ce qu’elle va trouver.
Prêts à se laisser surprendre, les scientiques regardent le vivant évoluer sous leurs
microscopes, en quête de nouvelles pistes pour la médecine.
Lorsqu’ils pensent tenir quelque chose, ils élaborent des modèles in vitro où mettre
en exergue l’action d’un gène, d’une protéine.
Grâce aux progrès concomitants des biotechnologies, la recherche fondamentale
réalise ainsi de belles avancées dans le domaine des cellules souches ou de la
maladie d’Alzheimer.
Mais les appareils les plus modernes, s’ils protent à la recherche contre le cancer
ou le diabète, servent aussi à faire avancer des travaux moins médiatisés et ce
dans des disciplines parfois très éloignées. En témoigne la plate-forme protéomi-
que de la faculté de médecine Pasteur, à Nice, utilisée, entre autres, pour enquêter
sur la pollution marine et sur la synthèse organique.
Il s’agit évidemment d’exemples choisis parmi bien d’autres, sur lesquels le maga-
zine de l’Institut Robert Hooke s’arrête dans ce numéro. La rédaction a également
voulu savoir comment la médecine progresse sur le plan thérapeutique face au
éau du Sida, quand la perspective d’un traitement capable d’éradiquer le virus
n’est pas à l’ordre du jour.
Car sur des questions de santé publique aussi préoccupantes que le cancer ou les
pathologies liées à l’âge, la prise en charge du malade, l’évaluation de l’efcacité
thérapeutique, l’ajustement éventuel du traitement ont toute leur importance, en
particulier pour les familles et les patients, contraints de faire avec l’existant.
La médecine nucléaire, avec la tomographie par émissions de positons, permet en
ce sens d’avancer encore un peu plus loin dans la précocité et dans la précision du
diagnostic. Utilisée aujourd’hui en cancérologie ou en cardiologie, cette technolo-
gie pourrait d’ailleurs bientôt s’étendre à certaines maladies neurodégénératives.
L’Édito
« Le hasard favorise
l’esprit préparé » (Louis Pasteur)

4
•I.R.H. Magazine Actualité
Alzheimer
A la recherche du
temps perdu
Ultra médiatisée, Alzheimer, la « maladie de l’âge », révèle petit à petit ses secrets sans encore se laisser
dompter. Sous le microscope elle se manifeste au moyen de deux lésions cérébrales, les plaques séniles et
la dégénérescence neurobrillaire. Mais en amont de ces stigmates, la pathologie semble naître de dysfonc-
tionnements d’enzymes. Le Dr. Frédéric Checler, chercheur à l’IPMC (Institut de Pharmacologie Moléculaire et
cellulaire) de Valbonne, a donc naturellement « glissé », entre 1994 et 1995, de ses travaux d’enzymologie vers
cette démence si particulière.
Quel modèle avez-vous mis en place
pour étudier la formation de plaques β-
amyloïdes (dites plaques séniles) chez
les malades Alzheimer ?
F.C : Nous créons des cellules mutantes
qui miment certaines formes « agressi-
ves » (1) de la maladie. Ces cas, d’origine
génétique, représentent moins de 1%
de toutes les formes d’Alzheimer mais
grâce à eux nous apprenons aussi sur
les formes majoritaires, ou « sporadi-
ques » (2). Nous exacerbons en eet des
processus qui ne sont pas très diérents
dans les deux cas. Nous avons ainsi
pu étudier les enzymes capables de
fabriquer le peptide A bêta, dont l’accu-
mulation dans le cerveau constitue le
cœur des plaques séniles. Nous avons
également réussi à comprendre ce qui
se passe lors de la formation, à partir
de la protéine APP (Amyloid Protein
Precursor), des diérentes formes de ce
peptide. Car il existe des formes tron-
quées solubles sans doute plus toxiques
et qui s’agrègent encore davantage
que les formes généralement générées
(3). Précisément, nos cellules de labora-
toire sur-expriment une forme mutée
de l’APP ou bien des mutants des pré-
sénilines (4). Nous disposons enn de
souris transgéniques doubles ou triples
mutantes, développées au Canada et
en Californie
Des chercheurs remettent aujourd’hui
en question le rôle des plaques amy-
loïdes dans le déclenchement de la
maladie d’Alzheimer. Comment vous
positionnez-vous par rapport à cela ?
F.C : C’est sûrement vrai. Personne n’a
jamais dit que les plaques donnaient la
maladie. Mais cela ne veut pas dire non
plus que le peptide amyloïde produit
avant l’apparition des plaques séniles
et dont on sait qu’il peut s’accumuler
dans les neurones et les tuer, n’a rien à
voir avec la maladie d’Alzheimer. La sur-
production de ce peptide est en outre
le seul dénominateur commun observé
suite à diverses mutations responsables
de formes agressives de la maladie. Il y a
donc bien un lien entre le peptide amy-
loïde et la pathologie. Personnellement
je pense que lorsqu’il est produit à des
niveaux physiologiques, le peptide a
un rôle protecteur. Tout le monde en
fabrique mais à un moment, pour des
raisons encore mal connues mais qui
font sans doute intervenir des facteurs
environnementaux, on passe un seuil
de production où le peptide A bêta
n’est plus soluble et « inerte ». On ini-
tie alors un processus d’agrégation, de
toxicité, accompagné d’inammation,
de dégénérescence neurobrillaire, de
mort neuronale et qui se termine en
tableau de démence clinique.
(1) Cette forme d’Alzheimer rare a une origine génétique et se caractérise par la précocité d’apparition de la maladie. Certains cas ont été
identiés chez des patients de moins de 25 ans mais en général l’Alzheimer est diagnostiqué autour de 50 ans.
(2) Il s’agit des formes sans cause monogénique identiée. Elles se déclarent en général chez les personnes âgées de plus de 65 ans.
(3) La bêta-amyloïde 40 et la bêta-amyloïde 42. Les indices 40 et 42 sont relatifs au nombre d’acides aminés du peptide, donc à sa
longueur.
(4) La préséniline est une des enzymes impliquées dans la coupure « gamma » de l’APP. Ce clivage particulier de la protéine transmembranaire
va libérer le peptide bêta amyloïde dans le cerveau.
ci-dessus le Dr. Frédéric Checler à l’IMPC de Valbonne

ci-dessus le Dr. Frédéric Checler à l’IMPC de Valbonne
5
•I.R.H. Magazine Actualité
Chercher un vaccin dirigé contre les pla-
ques amyloïdes est-il donc judicieux ?
F.C : Ce n’est pas parce qu’un vaccin,
d’un point de vue phénotypique, net-
toie complètement le cerveau des
plaques séniles, qu’il ne fait rien avant,
notamment au niveau du peptide A
bêta qui lui, pourrait être toxique. Les
animaux qui ont fabriqué des anticorps
contre les plaques ont aussi récupéré
de leurs décits cognitifs d’apprentis-
sage et de mémorisation… Donc on ne
peut pas abandonner une piste aussi
prometteuse. Elle s’avèrera peut-être
insusante, elle ne permettra peut-
être de ne gagner « que » deux ou trois
ans. En ce moment on ne
guérit pas du sida mais on
peut rester stabilisé pen-
dant des années. En tous
cas dire qu’on se trompe
de cible me semble aussi
manichéen que d’armer
que tout est dû au pep-
tide amyloïde. En revanche,
peut-être que lorsque nous
nous attaquons aux formes
« A40 » et « A42 » du pep-
tide, il est déjà trop tard.
De plus, comme certains
de ces peptides sont fabri-
qués naturellement dans
l’organisme, les anticorps
synthétisés sont dirigés contre des
protéines du « soi », ce qui peut poser
problème. Enn, il faut trouver des anti-
corps capables de passer la barrière
hémato-encéphalique.
Des liens entre les deux types de lésions
caractéristiques d’Alzheimer ont-ils été
établis ?
F.C : Oui, grâce aux souris transgé-
niques. Il s’est avéré que seules les
souris mutantes à la fois sur la bAPP,
les protéines tau (5) et les présénilines
présentaient les deux lésions (plaques
séniles et dégénérescences brillaires)
à la fois. Les lésions amyloïdes sem-
blent réduites quand nous réduisons
génétiquement les allèles (les copies
d’un gène) codant pour la protéine
tau. Or le phénomène de dégénéres-
cence neurobrillaire s’accompagne
d’une hyper phosphorylation de tau.
Les modèles cellulaires ont également
pu montrer que le peptide A bêta pou-
vait jouer sur cette phosphorylation de
tau… Certains chercheurs ne sont pas
d’accord pour dire lequel interviendrait
en premier mais cela dépend en réalité
aussi des aires corticales touchées.
Toutefois si, comme on le pense, le
peptide amyloïde est responsable
de perturbations calciques, de pro-
blèmes d’apoptose (mort cellulaire
programmée), de production de réac-
tifs oxygénés, d’inammation, nous
devrions, en jouant sur l’expression de
A bêta, avoir des répercussions sur tous
ces phénomènes. Voilà, au laboratoire,
notre hypothèse. Nous essayons dans
cette logique de développer des anti-
corps un peu originaux dans le sens
où ils vont cibler des formes tronquées
du peptide. Pour cela il faut identier
les formes qui apparaissent le plus
précocement, celles qui « marquent »
éventuellement le glissement d’une
forme modérée d’Alzheimer vers une
forme avérée de la maladie.
Travaillez-vous également sur d’autres
voies thérapeutiques ?
F.C : Nous étudions aussi les inhibiteurs
de bêta et de gamma sécrétases (6) et
l’activation d’enzymes qui inhibent le
peptide A bêta sans pour autant don-
ner les formes tronquées toxiques. Mais
nous pourrions aussi envisager une
multi-thérapie avec des anti-inamma-
toires, un suivi de la pression artérielle,
du cholestérol, une indication pour une
activité physique et intellectuelle
régulière, la prise d’anti-oxydants, un
régime alimentaire adéquat etc. Deux
personnes avec la même mutation sur
une préséniline peuvent présenter des
âges d’apparition de la maladie dié-
rents, cela prouve qu’il doit y avoir des
aspects environnementaux amplica-
teurs ou au contraire protecteurs.
Des cas ont été relatés de défunts ne
présentant aucun symptôme d’Alzhei-
mer avant leur mort et dont l’autopsie a
révélé de nombreuses lésions typiques
de la maladie. Faut-il y voir un phéno-
mène de résistance ?
F.C : Il faut imaginer les ressusciter et
voir dans dix ans ce qui se serait passé !
Comment voulez-vous savoir si une per-
sonne n’était pas en train de développer
la maladie ? Il n’est pas impossible non
plus que les plaques aient un rôle
protecteur jusqu’à un stade de « trop
plein ».
Vous travaillez également sur le front
du diagnostic, puisque vous cherchez
à identier un marqueur de la patholo-
gie. De quoi s’agit-il ?
F.C : Ce sont les fameuses formes tron-
quées du peptide A bêta dont j’ai
déjà parlé. Des anticorps monoclo-
naux dirigés contre ces entités vont
servir à « screener » diérents uides
biologiques de personnes normales ou
présentant une forme modérée ou avé-
rée de la maladie d’Alzheimer pour voir
si la forme tronquée reconnue est eec-
tivement un marqueur d’un glissement
d’une forme à l’autre.
Si c’est le cas, nous aurons identié
naturellement un marqueur mais aussi
le type d’anticorps qu’il faut pour un
processus de vaccination.
Enn selon le chercheur Pat McGreen,
de l’université de Vancouver, la prise
d’anti-inammatoires déjà sur le mar-
ché pourrait sure à protéger l’individu
contre la maladie. Qu’en pensez-vous ?
F.C : Il s’agit d’anti-inammatoires non
stéroïdiens. Le problème c’est que les
études épidémiologiques n’ont abso-
lument pas conrmé cela. Ceci dit, ça
ne doit pas faire de mal d’en prendre
un peu comme d’autres prennent de la
mélanine, des vitamines ou vont faire
un jogging.
(5) Comme le peptide A bêta, tau est une molécule normale de l’organisme. Phosphorylée, elle empêche le fonctionnement neuronal et tue les
neurones en destabilisant les microtubules.
(6) L’APP transmembranaire peut subir deux clivages distincts. Sous l’action des alpha et gamma sécrétases, la protéine est dégradée sans effet
nocif. En revanche l’action conjointe des enzymes bêta et gamma libère le peptide A bêta.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%