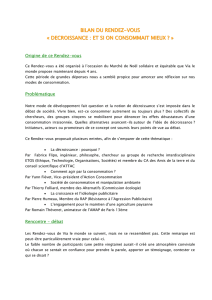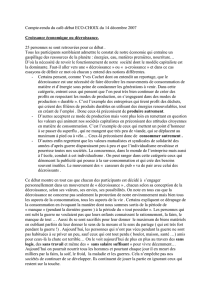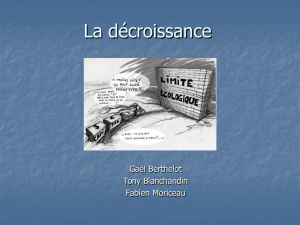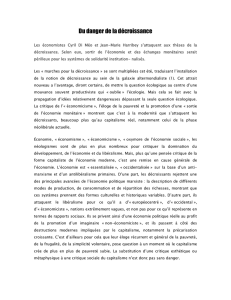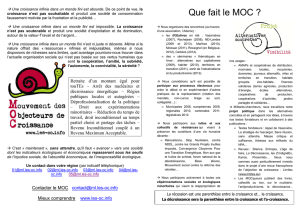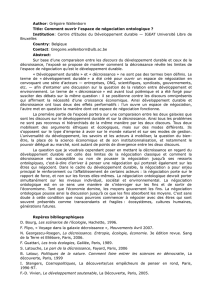D ECROISSANCE

Page | 1
DECROISSANCE
ET CRITIQUES DU DEVELOPPEMENT
1 – Pour une société de décroissance – Serge Latouche
2 – En finir une fois pour toutes avec le développement – Serge Latouche
3 – Le développement n’est pas le remède à la mondialisation, c’est le problème ! – Serge
Latouche
4 – L’occidentalisation du monde (Préface 2005) – Serge Latouche
5 – E la décroissance sauvera le Sud… – Serge Latouche
6 – Des alternatives à l’économie de marché - Le marché, l'agora et l'acropole : Se
réapproprier le marché – Serge Latouche
7 – Décoloniser l’imaginaire – Serge Latouche
8 – Les déraisons de la raison économique de Serge Latouche (Compte rendu)
9 – La métaphysique du progrès – Serge latouche
10 – De Monterrey à Johannesburg : quel développement ? – Serge Latouche
11 – Pour une alternative au développement – Serge Latouche
12 – La pauvreté, mauvaise conscience des âmes sensibles et invention des maîtres du monde
– Serge Latouche
13 – La décroissance comme préalable et non comme obstacle à une société conviviale. –
Serge Latouche.
14 – Consommateurs de tous les pays, unissez-vous ! ou le défi du commerce ethique – Serge
Latouche.
15 – A bas le développement durable ! Vive la décroissance conviviale – Serge Latouche
16 – Catastrophes, genèse d’une décolonisation de l’imaginaire ? – Serge Latouche &
Christopher Yggdre
17 – Les effets culturels de la mondialisation : universalisme cannibale terrorisme identitaire –
Serge Latouche
18 – La décroissance, un enjeu électoral – Serge Latouche
19 – Sortir de l’économie, sortir du développement ? - Pour en finir avec la marchandisation –
Serge Latouche
20 – Les illusions de la techno-démocratie de marché mondialisé – Serge Latouche
21 – La décroissance, une utopie ? La croissance, un concept pervers ? – Serge Latouche
22 – La mégamachine – Serge Latouche
23 – La mégamachine et la destruction du lien social – Serge Latouche
24 – Si la mégamachine s’emballe – Pascale Guéricolas

Page | 2
25 – Le développement durable : mystification et boniments – Pascale Guéricolas
26 – En finir avec la religion de la croissance – Patrick Piro
27 – Engager une politique de décroissance – Vincent Cheynet
28 – Contre le développement durable – Vincent Cheynet
29 – Décroissance ou décélération ? – Vincent Cheynet
30 – Quels savois critiques contre l’économie dominante ? – Vincent Cheynet
31 – Décroissance et démocratie – Vincent Cheynet
32 – La pub, machine à casser – Vincent Cheynet
33 – La décroissance soutenable – Bruno Clémentin & Vincent Cheynet
34 – 10 objections majeures au « commerce équitable » – Bruno Clémentin & Vincent
Cheynet
35 – 10 objections majeures contre la civilisation de l’automobile indiividuelle – Bruno
Clémentin
36 – La croissance n’existe pas – Bruno Clémentin
37 – Le développement durable, un concept toxique ! » (Bruno Clémentin) – Matthieu
Auzanneau
38 – La « décroissance » : renaissance d'un concept révolutionnaire – Matthieu Auzanneau
39 – 10 conseils pour entrer en résistance par la décroissance – Casseurs de Pub (Vincent
Cheynet)
40 – La décroissance, un mot-obus – Paul Ariès
41 – La pub ou l’anti-culture – Paul Ariès
42 – Les manipulations mentales au sein de la mondialisation – Paul Ariès
43 – Petit dico de la pub – Paul Ariès
44 – Vers la simplicité volontaire – Serge Mongeau
45 – Pour une société de frugalité – François Brune
46 – Violence de l’idéologie publicitaire – François Brune
47 – La publicité : les vecteurs de l’idéologie – François Brune
48 – La pub, nouveau visage du totalitarisme – François Brune
49 – L’« antipub », un marché porteur – François Brune
50 – Pour une sobriété heureuse – Pierre Rabhi
51 – De l’humanisme : Pour une décroissance idéaliste – Michel Dias & La décroissance est-
elle un humanisme ? – Réponse de Serge Latouche
52 – Les trois niveaux de l’écologie – Denis Cheynet
53 – Automobile et décroissance – Denis Cheynet
54 – De quelques mensonges bien intentionnés sur l’agriculture contemporaine – Philippe
Godard

Page | 3
55 – L’impasse citoyenniste – Contibution à une critique du citoyennisme – « En
attendant… »
56 – La décroissance soutenable est-elle valable pour l'ensemble du globe ? – Réponse de
Festival résistances, 10 mai 2005.
57 – Le développement est-il la solution aux problèmes de l’humanité ? – Thomas Marshall
58 – Georgescu-Roegen : Bioéconomie et biosphère – Jacques Grinevald
59 – A la conquête des biens relationnels – Mauro Bonaïuti
60 – Point d’efficacité sans sobriété. Mieux vaut débondir que rebondir – François Schneider
61 – L’altermondialisme : un nouveau mouvement émancipateur qui ne peut se ramener aux
anciennes catégories – Fabrice Flipo
62 – La décroissance, une solution pour notre temps – Fabrice Flipo
63 – L’invention du développement – Gilbert Rist
64 – Gilbert Rist répond aux contradicteurs de la décroissance
65 – Des partisans de la... ou des réactionnaires ? Les deux mon capitaine ! Réponses à
MM. Oxley, Métellus, Cyril di Meo, Vereycken. – Clément Homs
66 – L’Eglise des illusions du progrès et les objecteurs de croissance. – Clément Homs
67 – Economie de croissance, économie de gavage généralisé – Jeuf
68 – Le Monde publie une chronique diffamant les objecteurs de croissance... et affiche sa
bêtise.
69 – Des territoires en reconversion : les faux espoirs de la croissance. – Jacques Pradès
70 – Sur les traces du « phénomène technique ». – Jacques Pradès
71 – L'homo œconomicus et la déraison scientifique. Essai anthropologique sur l'économie et
la technoscience – Jacques Prades
72 – Machines célibataires – May Livory
73 – Développement ne rime pas forcément avec croissance – Jean-Marie Harribey
74 – Les impasses de la croissance et de la décroissance infinies – Jean-Marie Harribey
75 – Déconnecter développement et croissance économique – Jean-Marie Harribey
76 – Décroissance ou développement durable ? – Guillaume Duval
77 – La décroissance soutenable. Une idée qui fait son chemin – Christian Weber
78 – Libéralisme économique et mondialisation, Critique d’une étude de l’Economic Freedom
Network – Martin poirier
79 – Qu’est-ce que la décroissance ?
80 – Décoloniser notre imaginaire de croissance ? Ça urge ! – Bernard Guibert
81 – Stop la croissance ! – Jacques Veillard et Emmanuel Poncet

Page | 4
ABSURDITE DU PRODUCTIVISME ET DES GASPILLAGES
Pour une société de décroissance
Mot d’ordre des gouvernements de gauche comme de droite, objectif affiché de la
plupart des mouvements altermondialistes, la croissance constitue-t-elle un piège ?
Fondée sur l’accumulation des richesses, elle est destructrice de la nature et génératrice
d’inégalités sociales. « Durable » ou « soutenable », elle demeure dévoreuse du bien-être.
C’est donc à la décroissance qu’il faut travailler : à une société fondée sur la qualité
plutôt que sur la quantité, sur la coopération plutôt que la compétition, à une humanité
libérée de l’économisme se donnant la justice sociale comme objectif.
Par Serge Latouche
Professeur émérite d’économie de l’université de Paris-Sud, président de la
Ligne d’horizon (association des amis de François Partant). Dernier
ouvrage publié : Survivre au développement. De la décolonisation de
l’imaginaire économique à la construction d’une société alternative, Editions
Mille et une nuits, Paris, 2004
« Car ce sera une satisfaction parfaitement positive que de manger
des aliments sains, d’avoir moins de bruit, d’être dans un
environnement équilibré, de ne plus subir de contraintes de circulation,
etc. »
Jacques Ellul (1)
Le 14 février 2002, à Silver Spring, devant les
responsables américains de la météorologie, M. George W.
Bush déclarait : « Parce qu’elle est la clef du progrès
environnemental, parce qu’elle fournit les ressources
permettant d’investir dans les technologies propres, la
croissance est la solution, non le problème. (2) » Dans le fond, cette position est largement
partagée par la gauche, y compris par de nombreux altermondialistes qui considèrent que la
croissance est aussi la solution du problème social en créant des emplois et en favorisant une
répartition plus équitable.
Ainsi, par exemple, Fabrice Nicolino, chroniqueur écologique de l’hebdomadaire parisien
Politis, proche de la mouvance altermondialiste, a récemment quitté ce journal au terme d’un
conflit interne provoqué par... la réforme des retraites. Le débat qui s’en est suivi est
révélateur du malaise de la gauche (3). La raison du conflit, estime un lecteur, est sans doute
d’« oser aller à l’encontre d’une sorte de pensée unique, commune à presque toute la classe
politique française, qui affirme que notre bonheur doit impérativement passer par plus de
croissance, plus de productivité, plus de pouvoir d’achat, et donc plus de consommation (4) ».
Après quelques décennies de gaspillage frénétique, il semble que nous soyons entrés dans
la zone des tempêtes au propre et au figuré... Le dérèglement climatique s’accompagne des
guerres du pétrole, qui seront suivis de guerres de l’eau (5), mais aussi de possibles
pandémies, de disparitions d’espèces végétales et animales essentielles du fait de catastrophes
biogénétiques prévisibles.
Dans ces conditions, la société de croissance n’est ni soutenable ni souhaitable. Il est donc
urgent de penser une société de « décroissance » si possible sereine et conviviale.
La société de croissance peut être définie comme une société dominée par une économie de
croissance, précisément, et qui tend à s’y laisser absorber. La croissance pour la croissance
devient ainsi l’objectif primordial, sinon le seul, de la vie. Une telle société n’est pas

Page | 5
soutenable parce qu’elle se heurte aux limites de la biosphère. Si l’on prend comme indice du
« poids » environnemental de notre mode de vie l’« empreinte » écologique de celui-ci en
superficie terrestre nécessaire, on obtient des résultats insoutenables tant du point de vue de
l’équité dans les droits de tirage sur la nature que du point de vue de la capacité de
régénération de la biosphère. Un citoyen des Etats-Unis consomme en moyenne 9,6 hectares,
un Canadien 7,2, un Européen moyen 4,5. On est donc très loin de l’égalité planétaire, et plus
encore d’un mode de civilisation durable qui nécessiterait de se limiter à 1,4 hectare, en
admettant que la population actuelle reste stable (6).
Pour concilier les deux impératifs contradictoires de la croissance et du respect de
l’environnement, les experts pensent trouver la potion magique dans l’écoefficience, pièce
centrale et à vrai dire seule base sérieuse du « développement durable ». Il s’agit de réduire
progressivement l’impact écologique et l’intensité du prélèvement des ressources naturelles
pour atteindre un niveau compatible avec la capacité reconnue de charge de la planète (7).
Que l’efficience écologique se soit accrue de manière notable est incontestable, mais dans
le même temps la perpétuation de la croissance forcenée entraîne une dégradation globale.
Les baisses d’impact et de pollution par unité de marchandise produite se trouvent
systématiquement anéanties par la multiplication du nombre d’unités vendues (phénomène
auquel on a donné le nom d’« effet rebond »). La « nouvelle économie » est certes
relativement immatérielle ou moins matérielle, mais elle remplace moins l’ancienne qu’elle
ne la complète. Au final, tous les indices montrent que les prélèvements continuent de
croître (8).
Enfin, il faut la foi inébranlable des économistes orthodoxes pour penser que la science de
l’avenir résoudra tous les problèmes et que la substituabilité illimitée de la nature par l’artifice
est concevable.
Si l’on suit Ivan Illich, la disparition programmée de la société de croissance n’est pas
nécessairement une mauvaise nouvelle. « La bonne nouvelle est que ce n’est pas d’abord pour
éviter les effets secondaires négatifs d’une chose qui serait bonne en soi qu’il nous faut
renoncer à notre mode de vie comme si nous avions à arbitrer entre le plaisir d’un mets
exquis et les risques afférents. Non, c’est que le mets est intrinsèquement mauvais, et que nous
serions bien plus heureux à nous détourner de lui. Vivre autrement pour vivre mieux (9). »
La société de croissance n’est pas souhaitable pour au moins trois raisons : elle engendre
une montée des inégalités et des injustices, elle crée un bien-être largement illusoire ; elle ne
suscite pas pour les « nantis » eux-mêmes une société conviviale, mais une anti-société
malade de sa richesse.
L’élévation du niveau de vie dont pensent bénéficier la plupart des citoyens du Nord est de
plus en plus une illusion. Ils dépensent certes plus en termes d’achat de biens et services
marchands, mais ils oublient d’en déduire l’élévation supérieure des coûts. Celle-ci prend des
formes diverses, marchandes et non marchandes : dégradation de la qualité de vie non
quantifiée mais subie (air, eau, environnement), dépenses de « compensation » et de
réparation (médicaments, transports, loisirs) rendues nécessaires par la vie moderne, élévation
des prix des denrées raréfiées (eau en bouteilles, énergie, espaces verts...).
Herman Daly a mis sur pied un indice synthétique, le Genuine Progress Indicator,
indicateur de progrès authentique (IPA), qui corrige ainsi le produit intérieur brut (PIB) des
pertes dues à la pollution et à la dégradation de l’environnement. A partir des années 1970,
pour les Etats-Unis, cet indicateur stagne et même régresse, tandis que celui du PIB ne cesse
d’augmenter (10). Il est regrettable que personne en France ne se soit encore chargé de faire
ces calculs. On a toutes les raisons de penser que le résultat serait comparable. Autant dire
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
 293
293
 294
294
 295
295
 296
296
 297
297
 298
298
 299
299
 300
300
 301
301
 302
302
 303
303
 304
304
 305
305
 306
306
 307
307
 308
308
 309
309
 310
310
 311
311
 312
312
 313
313
 314
314
 315
315
 316
316
 317
317
 318
318
 319
319
 320
320
 321
321
 322
322
 323
323
 324
324
 325
325
 326
326
 327
327
 328
328
 329
329
 330
330
 331
331
 332
332
 333
333
 334
334
 335
335
 336
336
 337
337
 338
338
 339
339
 340
340
 341
341
 342
342
 343
343
 344
344
 345
345
 346
346
 347
347
 348
348
 349
349
 350
350
 351
351
 352
352
 353
353
 354
354
 355
355
 356
356
 357
357
 358
358
 359
359
 360
360
 361
361
 362
362
 363
363
 364
364
 365
365
 366
366
 367
367
 368
368
 369
369
 370
370
 371
371
 372
372
 373
373
 374
374
 375
375
 376
376
 377
377
 378
378
 379
379
 380
380
 381
381
 382
382
 383
383
 384
384
 385
385
 386
386
 387
387
 388
388
 389
389
 390
390
 391
391
 392
392
 393
393
 394
394
 395
395
 396
396
 397
397
 398
398
 399
399
 400
400
 401
401
 402
402
 403
403
 404
404
 405
405
 406
406
 407
407
 408
408
 409
409
 410
410
 411
411
 412
412
 413
413
 414
414
 415
415
 416
416
 417
417
 418
418
 419
419
 420
420
 421
421
 422
422
 423
423
 424
424
 425
425
 426
426
 427
427
 428
428
 429
429
 430
430
 431
431
 432
432
 433
433
 434
434
 435
435
 436
436
 437
437
 438
438
 439
439
 440
440
 441
441
 442
442
 443
443
 444
444
 445
445
 446
446
 447
447
 448
448
 449
449
 450
450
 451
451
 452
452
 453
453
 454
454
 455
455
 456
456
 457
457
 458
458
 459
459
 460
460
 461
461
 462
462
 463
463
 464
464
 465
465
 466
466
 467
467
 468
468
 469
469
 470
470
 471
471
 472
472
1
/
472
100%