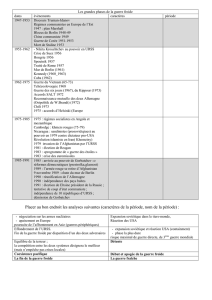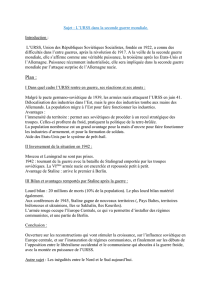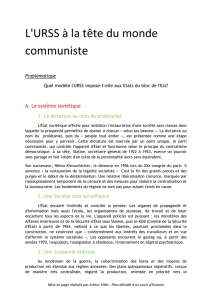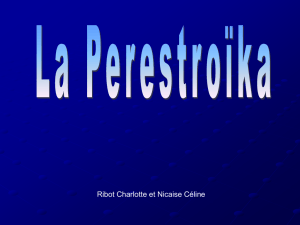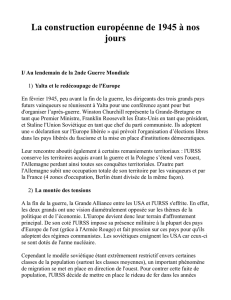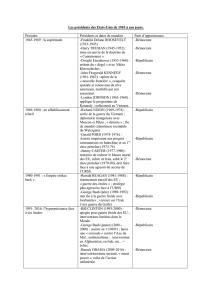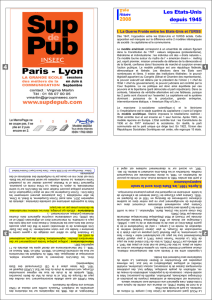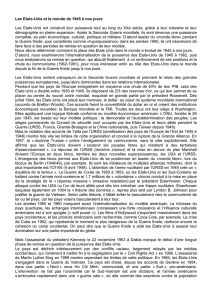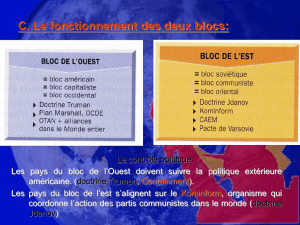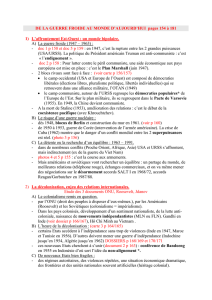Thème 1 - Les relations internationales depuis 1945

Thème 1 - Les relations internationales depuis 1945
Question obligatoire – Le jeu des puissances dans un espace
mondialisé de 1945 à nos jours
On peut distinguer trois périodes dans les relations
internationales depuis la fin de la 2GM. De 1945 à 1989, la guerre
froide entre les USA et l'URSS a donné lieu à un monde bipolaire.
Les relations internationales sont alors structurées par les rivalités
entre le bloc capitaliste et le bloc communiste. Depuis la chute du
mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'URSS en 1991, un
nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place. On a
d'abord parlé d'un monde unipolaire car les Etats-Unis
apparaissaient en 1991 comme l'unique superpuissance. Mais
depuis les années 2000, il semble qu'on s'oriente plutôt vers un
monde multipolaire car la puissance américaine est remise en
question et de nouvelles puissances s’affirment.
I) Un monde bipolaire (1945-1989)
1) Comment en arrive-t-on à la bipolarisation du monde (1945-1949) ?
Les USA et l’URSS incarnent deux modèles opposés et influents en
1945
C’est en 1941 que l’URSS rejoint le RU contre l’Allemagne nazie,
lorsqu’ Hitler se lance à la conquête de l’URSS, rompant le pacte de
non-agression qu’il avait signé avec Staline en 1939. Et les Etats-
Unis entrent en guerre à leurs côtés en décembre 1941, suite à
l’attaque japonaise de Pearl Harbor. Jusqu’en 1945, même si
l’armée britannique continue à jouer un rôle majeur dans la
défaite allemande, ce sont les Américains et les Soviétiques qui
entreprennent les offensives les plus spectaculaires :

débarquements américains en Méditerranée et en Normandie,
avancée soviétique à travers l’Europe centrale pour repousser les
Allemands. Si bien qu’en 1945, USA et URSS apparaissent comme
les deux « grands » vainqueurs du nazisme, ce qui leur vaut un
immense prestige auprès des populations européennes qu’ils ont
libéré. Mais ils représentent deux modèles politique, économique
et social opposés :
USA
URSS
Politique
Démocratie libérale (garantissant
les libertés) et pluraliste (plusieurs
partis)
Officiellement une démocratie, mais en en
réalité une dictature totalitaire, celle de
Staline, qui règne sur un parti unique.
Economique et social
Economie capitaliste, fondée sur la
propriété privée et la liberté
d’entreprendre, et valorisant la
réussite individuelle
Economie communiste, fondée sur la
propriété collective (terres collectivisées,
entreprises nationalisées) et la planification
de l’économie par l’Etat.
En quoi ils « fascinent »
les Européens marqués
par la guerre, les
pénuries et l’inflation
d’après-guerre ?
Niveau de vie le plus élevé du
monde, donnant naissance à
l’american way of life fondé sur la
société de consommation.
Idéal d’égalité sociale, d’une société sans
riches ni pauvres, où l’Etat assure le bien-être
de la population. La propagande laisse croire
au succès de cette société.
De la méfiance à la rupture entre les deux Grands (1945-1947)
Les premières tensions apparaissent à propos des pays d’Europe
de l’Est que l’URSS a libéré. Lors de la conférence de Yalta, il avait
été décidé entre Churchill, Roosevelt et Staline que les pays libérés
choisiraient librement leur régime politique. Or en Europe de l’Est
Staline est en train d’aider les leaders communistes à écarter leurs
rivaux et mettre en place des dictatures sur le modèle soviétique.
C’est ce que dénonce Churchill dès 1946 (Discours de Fulton Hatier
p17, carte Hatier p. 16) en parlant d’un « rideau de fer » en train de
couper l’Europe en deux. Selon lui, il s’agit d’une forme
d’impérialisme (volonté d’un Etat d’étendre sa sphère d’influence
par une domination politique, économique et culturelle d’autres
Etats) contre laquelle il est nécessaire de lutter.
Cette méfiance croissante conduit à la rupture entre les deux
grands en 1947, lorsque le président Truman définit la politique
américaine de « containment », c’est-à-dire « d’endiguement du

communisme », politique surnommée « doctrine Truman », à
laquelle Staline réplique par la « doctrine Jdanov ».
Fiche « La rupture : doctrine Truman contre doctrine Jdanov »
Doctrine Truman
Doctrine Jdanov
Valeurs justifiant la
lutte contre
l’adversaire
Démocratie
Liberté
Développement éco
Démocratie
Anti-impérialisme
Anti-colonialisme
Reproches adressés
à l’adversaire
Dictature, terreur, absence de liberté
Absence de démocratie
Impérialisme
Colonialisme
Moyens de lutte
contre l’adversaire
Aide financière pour relancer l’économie
en Europe et éviter que la misère incite la
population à se rapprocher du
communisme : c’est le plan Marshall
L’URSS soutient les partis communistes et
les syndicats des pays sous influence
américaine, notamment pour mener des
actions de propagande. Elle soutient
également les rébellions contre la
colonisation
La constitution de deux blocs opposés à partir de 1947
Par des alliances passées avec les pays de leur sphère
d’influence, les deux Grands deviennent les leaders de deux blocs
économiques, politiques et militaires.
Type
d’alliance
Bloc de l’Ouest ou bloc capitaliste
Bloc de l’Est ou bloc communiste
Economique
OECE (organisation européenne de
coopération économique) en 1948 pour
répartir l’aide du plan Marshall entre les
pays d’Europe de l’Ouest et faciliter le
commerce avec les USA.
CAEM (Conseil d'assistance économique
mutuelle) créé en 1949 pour faciliter le
commerce entre l’URSS et les pays d’Europe de
l’Est.
Politique
Alliance atlantique signée en 1949 entre les
USA, le Canada et les pays d’Europe de
l’Ouest pour lutter contre le communisme.
Kominform (« bureau d’information et de
liaison des partis communistes ») créé en 1947
pour dicter aux « partis communistes frères »
(ceux qui dirigent les pays d'Europe de l'Est) la
politique fixée par Moscou.
Militaire
OTAN (Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord) créée en 1949 pour
coordonner les armées de l’Alliance
atlantique et placer l’Europe de l’Ouest sous
la protection américaine.
Pacte de Varsovie signé en 1955 pour
coordonner les armées de l’URSS et des pays
d’Europe de l’Est et placer celle-ci sous la
protection soviétique.

2) Qu’est-ce qui caractérise la guerre froide entre les deux blocs ?
• Le cas de la crise de Berlin (1948-1949)
Raconter puis distribuer polycopié
Suite à la défaite d’Hitler en 1945, l’Allemagne avait été divisée en quatre zones d’occupation par les
Alliés (Carte Nathan p. 24) : américaine, britannique et française à l’ouest, soviétique à l’est. Berlin,
située dans la zone soviétique, était elle-même divisée en quatre secteurs. Tandis que les Occidentaux
entreprennent de faire de l’Allemagne de l’Ouest une démocratie libérale à économie capitaliste, les
Soviétiques imposent un régime communiste en Allemagne de l’Est.
Les rivalités sont de plus en plus fortes et débouchent sur une crise en juin 1948, lorsque les
Occidentaux décident de rapprocher leurs zones en créant une monnaie unique, le deutschemark.
Staline y voit une première étape vers la création d’un Etat ouest-allemand, et riposte par le blocus de
Berlin ouest : il fait couper les routes et voies ferrées qui permettaient aux Alliés de ravitailler leurs
secteurs respectifs. Il entendait ainsi forcer les Occidentaux à quitter la ville pour en faire la « vraie »
capitale d’un Etat est-allemand communiste. Mais pour les Américains, il est inconcevable
d’abandonner Berlin-ouest car ils veulent en faire une vitrine du capitalisme à l’intérieur du monde
communiste. Ils organisent donc un pont aérien (photo Magnard) entre les aéroports de Berlin-ouest
et l’Allemagne de l’Ouest, et parviennent à acheminer chaque jour les 13 000 tonnes de marchandises
nécessaires aux 2 M d’habitants.
Staline n’ose pas faire tirer sur les avions par crainte de déclencher la guerre. Au bout de 11 mois, il
fait cesser le blocus tandis qu’à l’ouest la République fédérale d’Allemagne (RFA) est proclamée en mai
1949. Staline réplique en accélérant la naissance de la République démocratique allemande (RDA), en
octobre 1949.
Crises et conflits périphériques au temps de la guerre froide
Cette crise de Berlin est tout à fait caractéristique de la guerre
froide : chacun des deux camps tente de prendre l’avantage sur
l’autre, mais en évitant de déclencher un conflit armé direct. En
effet, à partir de 1949, l’URSS possède elle aussi l’arme nucléaire
donc une guerre entre les deux grands risquerait d’aboutir à la
destruction mutuelle : c’est « l’équilibre de la terreur », qui va
permettre d’éviter la guerre directe entre les deux blocs malgré
des crises et des conflits périphériques.
Carte guerre froide dans le monde Bréal Tle p. 60
Après la crise de Berlin, la tension entre les deux grands atteint
un nouveau sommet lors de la crise de Cuba en 1962 (carte Cuba
Bordas p. 28). Fidel Castro y a pris le pouvoir en 1959 et les USA
tentent par différents moyens de faire échouer son régime

communiste : embargo sur ses exportations de sucre, soutien aux
opposants du régime. Le leader cubain se tourne alors vers l’URSS
pour équiper son île de missiles capables d’atteindre les USA. La
crise éclate en 1962 lorsqu’un avion américain photographie des
rampes de lancement de missiles. Le président Kennedy réagit en
instaurant le blocus de Cuba et en annonçant dans un discours
télévisé que tout tir de missile cubain serait considéré comme une
attaque soviétique susceptible d’entraîner une riposte nucléaire.
Le monde entier craint alors l'éclatement d'une troisième guerre
mondiale mais un accord est finalement trouvé avec le dirigeant
soviétique Khrouchtchev : l'URSS accepte de retirer les missiles de
Cuba, et en échange les USA s'engagent à ne pas renverser Castro.
Les deux blocs s’affrontent aussi dans des conflits périphériques
comme la guerre de Corée (1950-1953) et la guerre du Vietnam
(1964-1973), mais en évitant à chaque fois de s’affronter
directement.
II) La fin de la guerre froide : vers un monde unipolaire
(1989-2001)
1) L’effondrement du bloc communiste (1989-1991)
Des difficultés croissantes
Dès les années 1950, le système communiste entraîne des
désillusions en Europe de l’Est. En effet, comme en URSS,
l’industrie lourde est privilégiée au détriment des biens de
consommation (vêtements, électroménagers, automobile…) et de
l’agriculture, si bien que les rayons des magasins sont souvent
vides. Les ouvriers et les paysans ont beaucoup de mal à gagner
leur vie. Or toute critique du régime peut conduire son auteur en
prison. Donc des révoltes finissent par éclater, réprimées par
l’armée soviétique, comme en Hongrie en 1956 ou en
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%