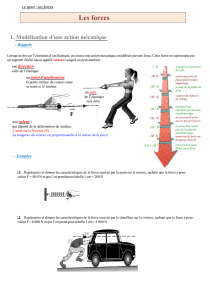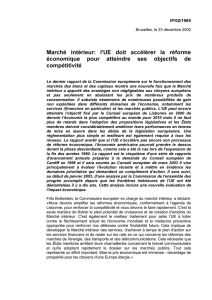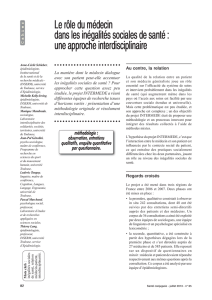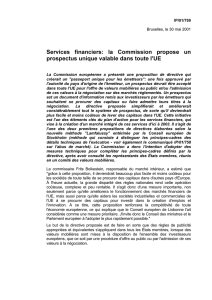n° 118 - L`Humanité

)RQGDWHXUV-DFTXHV'HFRXUIXVLOOÆSDUOHVQD]LVHW-HDQ3DXOKDQ
'LUHFWHXUV&ODXGH0RUJDQ/RXLV$UDJRQ-HDQ5LVWDW
/HV/HWWUHVIUDQÄDLVHV
GXVHSWHPEUH1RXYHOOHVÆULHQ
ZZZOHVOHWWUHVIUDQFDLVHVIU
3LHUUH%RXUJHDGH
3DU-HDQ5LVWDW
'5
-XOLHQ%ODLQHSDU$PLQD'DPHUGML
¦ULF9XLOODUGSDU9LFWRU%ODQF
%LODQGX)HVWLYDOGp$YLJQRQSDU-HDQ3LHUUH+DQ
Autoportrait,
par Pierre Bourgeade, 1995.

,,
/
(6
/
(775(6
)5$1¤$,6(6
6(37(0%5(6833/¦0(17
/
p+
80$1,7¦
'86(37(0% 5(
/(775(6
3LHUUH%RXUJHDGHHVWXQJUDQGÆFULYDLQ1RXVVRPPHV
TXHOTXHVXQV½OHSHQVHU½OpÆFULUH½OHGLUH'HSOXVHQ
SOXVQRPEUHX[MHOHFURLVMHOpHVSÅUH6DPRUWHQ
QpDSDVIDLWODXQHGHQRVTXRWLGLHQVHWFHUWDLQVLQGLYLGXVuMH
QHSHX[OHVTXDOLILHUGHFULWLTXHVOLWWÆUDLUHVGUÑOHGpH[SUHV
VLRQuDXUDLHQWPLHX[IDLWGHVHWDLUHSOXWÑWTXHGHOHWUDLWHU
GHJUDSKRPDQH2VHUDLHQWLOVDSSHOHU3URXVWXQSLVVHFRSLH"
Ce n’est pas impossible…
Les Lettres françaises
ont rendu
compte régulièrement de la publication de ses livres, en
particulier d’
Éloge des fétichistes
en 2009, et lui ont rendu
hommage en lui consacrant la une de l’un de ses numéros.
L’édition d’un inédit ne pouvait — à tout le moins — qu’exciter
notre curiosité. Dès réception de l’ouvrage,
Venezia
donc, j’ai
suspendu toute activité pour le lire. Je dois avouer que sa
lecture m’a, un long temps, littéralement coupé le soue. Il
m’a fallu quelques heures pour retrouver un peu de calme.
Aucun livre ne m’a bouleversé à ce degré d’intensité proche
du malaise, pas même dans mon adolescence certains romans
de Georges Bataille, pas même évidemment Sade… Livre
majeur, fascinant, douloureux, sarcastique, violent, comment
rendre compte de
Venezia
?
Dans leur excellente préface, « Bourgeade, maestro », les
éditeurs,
« prosélytes que nous sommes »
, font remarquer
que sur dix lecteurs interrogés, les réactions vont du rejet
violent (une fois sur dix) ou du rejet embarrassé (deux fois sur
dix) au coup de foudre pour la plupart d’entre eux. Il m’a
semblé, puisque Tristram, en même temps que
Venezia
, re-
publiait dans sa petite collection « Souple » un autre roman
de Bourgeade,
Ramatuelle
(2007), qu’il fallait d’abord parler
de ce dernier. Pourquoi ? Peut-être pour préparer le lecteur
à la lecture de
Venezia
…
L’intrigue de
Ramatuelle
est relativement simple. Elle se
noue, se développe et se clôt en sept jours, du dimanche 24 juin
au samedi 30 juin-dimanche 1er juillet. Sept jours de la vie
d’une jeune femme, Françoise d’Elbée, trente-cinq ans. Elle
fait partie de la bourgeoisie parisienne : un père médecin, un
mari banquier, deux enfants, une fille et un garçon. Elle habite
à côté du parc Monceau. Le roman est constitué du journal
qu’elle a écrit, la dernière nuit, pour raconter la semaine
pendant laquelle sa vie a basculé, c’est-à-dire, pour reprendre
une définition du dictionnaire, est passée brusquement d’un
état à un autre de façon irréversible.
Beau mariage donc. Voyage à Venise, au fameux Hôtel des
Bains. Elle ne connaît rien des rapports sexuels jusqu’à cette
nuit de noces qui ne semble lui avoir laissé aucun souvenir
particulier.
« Pendant une dizaine d’années, mon mari a
dormi plus ou moins régulièrement avec moi, puis il a cessé
de me toucher, et je crois que j’ai préféré ça. »
La « vie » fa-
miliale est terne et étouante. Il y a les dîners, le seul repas
en commun, où le maître d’hôtel, André,
« glisse comme une
ombre derrière nous, retirant nos assiettes de ses mains gan-
tées, plaçant les suivantes »
. On ne s’aperçoit de rien. Le mari,
Charles, ne cesse de parler. Elle a compris très vite qu’il ne
fallait pas le contredire. Naturellement, les enfants n’ont
qu’une hâte, celle d’aller dans leur chambre… Ils sont bien
élevés et rongent leur frein en silence. Ensuite, les adultes
passent au salon. Monsieur boit du café et fume le cigare,
madame ne prend qu’un décaféiné. Dans la chambre
« laquée
de blanc comme tout le reste de l’appartement »,
ils ont
chacun leur lit. Charles, avant de s’endormir, lit un journal
financier et Françoise, un roman…
« Il faut situer les personnages, les lieux, dire les choses
comme elles sont arrivées. »
Ce que Pierre Bourgeade fait
avec sobriété, concision, froideur : son héroïne ne s’épanche
pas, elle semble dénuée de sentiment. Elle ne donne signe de
vie, si l’on peut dire, que lorsqu’elle avoue aimer conduire
— et vite — son Austin pour passer une semaine à Ramatuelle
dans la propriété que ses parents lui ont léguée. Une semaine
de solitude avant l’arrivée du mari et des enfants…
« C’est
l’unique occasion où je voyage seule et c’est quelque chose
que j’aime. Je passe le péage, le soleil apparaît, le ciel est rouge.
J’aime beaucoup cette maison de Ramatuelle. »
Le récit de la deuxième journée montre comment la vie de
Françoise bascule. J’emploie de nouveau le verbe basculer,
non sans raison. Sur la route des Maures, à une centaine de
kilomètres de Ramatuelle, elle s’arrête pour laisser reposer le
moteur de sa voiture.
« Je prends un plaid sur le siège arrière,
je l’étends du côté de la route, sous les pins, là où les taillis
sont le plus épais, j’enlève mes chaussures, je m’allonge, et à
peine allongée, épuisée, je m’endors. »
Réveillée par des cris, elle assiste à une scène de violence
inouïe : deux jeunes gens s’emparent d’une femme dans sa
voiture
« arrêtée à l’extrême droite de la route, presque inclinée
au-dessus du ravin »
. Ils la frappent, la violent, la rejettent
dans la Clio, «
ils basculent la voiture dans le ravin, explosion »
.
Pourquoi, lorsque la police arrive, ne dénonce-t-elle pas les
jeunes gens ? Pourquoi invente-t-elle une thèse selon laquelle
elle était là avant l’accident ? La Clio a manqué son virage, les
jeunes gens sont arrivés trop tard… Pourquoi leur propose-t-
elle de les emmener chez elle ? Les événements des journées
qui vont suivre ne sont jamais que la conséquence de son geste
initial : elle est prise dans un engrenage infernal sadomasochiste
dans lequel elle découvre son corps, la jouissance. Elle n’est
pas seulement une petite-bourgeoise qui aime à se faire peur
en compagnie de jeunes voyous. Même si elle participe à
l’attaque d’une fourgonnette du Crédit agricole, son rôle reste
limité, mais néanmoins complice d’un second crime :
« J’at-
tendrai, sous un bouquet de pins, à quelque cent mètres de
là. Je serai au point mort, moteur en marche, prête à foncer. »
Le convoyeur de fonds est mort dans l’explosion de son vé-
hicule.
« Julien a vu son visage s’enflammer comme du
papier. »
À me relire, je vois bien que je n’ai montré que l’aspect le
plus « rocambolesque » du roman, en quelque sorte son
squelette. Je me garderai bien de raconter l’épilogue qui peut
s’analyser — mais ce n’est qu’une hypothèse — comme un
retour à l’ordre, une expiation, ou la manifestation d’une
perversité qui fait, selon Baudelaire,
« que l’homme est sans
cesse à la fois homicide et suicide, assassin et bourreau ».
Ramatuelle
pourrait fort bien se prêter à une adaptation
cinématographique. Françoise n’écrit-elle pas :
« Maintenant
c’est dimanche. J’ai écrit toute la nuit, au fil de la plume. La
semaine qui est en train de s’achever s’est déroulée dans ma
tête comme un film dont je n’ai eu qu’à relater rapidement
les épisodes. »
L’écriture de Bourgeade est visuelle : il sait nous faire voir,
sans fioriture, avec une précision des plus rares, quasi anato-
mique, des paysages, des corps, des situations — je veux dire,
sans faire de la littérature —, ce que les éditeurs ont raison de
souligner :
« (Il) nous a montré, au fil du temps, comment ce
qui est trop littéraire est nuisible à la littérature. »
À sa manière, l’écriture de Bourgeade est une histoire de
l’œil. Non pas comme celle de G. Bataille qui reste imprégnée
de judéo-christianisme, mais toujours à distance, froide,
souvent parodique. Ainsi ce passage où Françoise rentre dans
la chambre — Julien est réveillé et lui demande de s’approcher
du lit :
« Mon ventre est à la hauteur de son visage. “Écarte”,
dit-il. J’obéis. “Encore.” J’obéis. Ses doigts s’ajoutent aux
miens. Il veut tout voir. Tout voir au plus profond. Mais quoi ? »
Ces quelques lignes qui terminent la quatrième journée sont
précédées d’une étonnante scène où Françoise, devant son
miroir, regarde
« son visage étranger »
:
« Je cligne l’œil droit,
il cligne à gauche. »
Puis elle retourne ses paupières supérieures
vers le haut et
« apparaît une sorte de boule blanchâtre, ré-
pugnante et stupide »
.
Le dernier roman de Pierre Bourgeade,
Venezia
, met en scène
le directeur d’un palace vénitien, le signor Tardelli, le jeune
gigolo, Larry Dawson, de Mrs Springfield, une milliardaire
appelée la Contessa. Miss Carrington, milliardaire elle aussi,
accompagnée de Miss Ingrid Lindstrom
« qui a l’honneur de
pousser son fauteuil à roulettes »
, cinq actionnistes du Village
à New York (quatre hommes et une femme)… et Khadjik…
L’histoire est simple : Mrs Springfield, la Contessa, est une
octogénaire richissime qui a décidé de mourir à Venise au
terme d’une
« performance »
dont elle a réglé à cette fin les
moindres détails.
Miss Carrington, née prématurée,
« avait été condamnée,
dès l’âge de sept ans, au fauteuil roulant »
. Là encore, comme
dans
Ramatuelle
, les traumatismes de l’enfance vont décider
d’un destin. Larry, qui, à première vue, l’avait comparée à
« une orchidée qu’on aurait écrasée d’un coup de talon »
, à
mieux l’observer la voit un peu diéremment :
« Elle était
bronzée, elle portait une saharienne noire largement décolletée,
par l’échancrure de laquelle on apercevait deux seins en
pomme, clairs, à demi dénudés. »
La jeune fille qui l’accom-
pagne, habillée d’une robe transparente, n’a
« pas plus de
poitrine qu’un garçon »
.
On comprend très vite que la Miss est son
« chaueur-
soure-douleur personnel »
, autrement dit, son esclave.
« Je
ne me contente pas d’enfoncer des aiguilles dans les mains
de cette jeune personne, je lui en enfonce aussi dans les fesses,
les bras, et dans les seins. Elle ne se plaint jamais. C’est mon
esclave »
, confie à Larry la dominatrice Barbara
Carrington.
Larry attend Mrs Springfield qui, de jour en jour, par fax,
renvoie à plus tard son arrivée à Venise. Elle a découvert,
dit-elle, un groupe d’actionnistes berlinois… Larry quant à
lui passe son temps avec
« l’orchidée broyée »
et son esclave.
On le voit, par exemple, participer à une séance
« uro »
dans
la chambre de ces dames. Il est allongé nu dans la baignoire,
Ingrid au-dessus de lui et
« l’infirme, clouée dans son fau-
teuil, qui nous regarde, le sourire aux lèvres »
…
Mais là n’est pas l’important. Sade nous en a raconté
d’autres… L’histoire de
Venezia
va prendre un autre cours
avec l’arrivée de la Contessa,
« quatre-vingt-trois ans depuis
six mois, un mètre quatre-vingt, cent treize kilos, (elle)
venait de passer trois semaines furieuses à Berlin, où elle
s’était éclatée ».
Que faisait-elle donc à Berlin ? Le tour des abattoirs, chaque
soir, en compagnie des actionnistes dont elle ne pouvait plus
se séparer après les avoir découverts à Manhattan. Ils l’avaient
alors fouettée jusqu’au sang. Nous apprenons que la mère
de Mrs Springfield est morte dans un camp de concentration.
Elle engage les cinq actionnistes :
« Je veux sourir par vous,
en raison de ce que ma mère y a souert. »
Puis, soudain,
elle décide de retourner à Venise, à l’hôtel Gubbio. Elle dispose
de sa suite habituelle, trois appartements. Celui du milieu
sera réservé «
aux fêtes qu’elle comptait donner. Elle savait
lesquelles, elle n’en dit mot ».
La fête, car il n’y en aura qu’une, sera celle de sa mise à
mort.
« À Berlin, vous m’avez fait revivre les premières
étapes de la passion, ici, j’arriverai au terme. (…) Je voudrais
donc, demain, que vous m’attachiez sur la croix et que vous
me frappiez à mort. »
Je ne parlerai pas de ce Golgotha. Il faut laisser au lecteur,
s’il en a la curiosité, la possibilité d’y monter à son tour.
Là encore, dans ce roman, le cinéma a sa place. Celui de
Pasolini, par exemple, et son dernier film,
La Ricotta,
que
« la démocratie chrétienne ne lui a pas pardonné »
, pas plus
que
Salo ou les 120 journées de Sodome
.
Je ne peux souscrire tout à fait aux propos des éditeurs,
pour lesquels
« le traitement de (cette obscénité totale) est
celui de la comédie, du sketch, de la bande dessinée »
. Certes,
il y a de tout cela dans
Venezia
. On citera bien sûr ce passage
où Bourgeade décrit Miss Lindstrom et Barbara Carrington
traversant le hall de l’hôtel. Attardons-nous un instant sur
l’accoutrement de Barbara
« recroquevillée sur le fauteuil
roulant »
:
« Elle était coiée d’une casquette de base-ball
rouge portant l’insigne des New York Yankees, et avait les
yeux cachés par d’immenses lunettes noires en ailes de
papillon. (…) Ses jambes décharnées étaient maintenues par
de hautes guêtres de cuir sombre et ses pieds disparaissaient
dans d’extraordinaires chaussures orthopédiques, aussi
larges que longues, quasiment cubiques, qui ressemblaient
moins à des chaussures qu’à d’incompréhensibles boîtes de
fer-blanc. »
Grand livre, certes. Beau, drôle parfois, tragi-comique,
d’une violence à couper le soue, je le répète. Dans son
écriture d’un classicisme impeccable, il nous laisse des images
inoubliables.
Allez, je vais être un peu provocateur à mon tour : dirais-tu,
mon cher Pierre, toi aussi : Venise, du sang, de la volupté et
de la mort ?
Jean Ristat
Ramatuelle, de Pierre Bourgeade. Éditions Tristram,
88 pages, 5,90 euros.
Venezia, de Pierre Bourgeade. Éditions Tristram,
118 pages, 6,95 euros.
Voir aussi dans les Lettres françaises n°43
l’entretien entre Pierre Bourgeade et Franck Delorieux.
/D3DVVLRQ½9HQLVH
/DSXEOLFDWLRQGHOpXQLTXHLQÆGLWSRVWKXPHGH3LHUUH%RXUJHDGH
9HQH]LD
SDUOHVÆGLWLRQV7ULVWUDP
HVWOpXQGHVÆYÆQHPHQWVPDMHXUVGHODUHQWUÆHOLWWÆUDLUH(WELHQDXGHO½

/
(6
/
(775(6
)5$1¤$,6(6
6(37(0%5(6833/¦0(17
/
p+
80$1,7¦
'86(37(0%5(,,,
/(775(6
Thymus,
de Julien Blaine. Le Castor astral, 196 pages, 18 euros.
7K\PXVQPH[FURLVVDQFHFKDUQXHHQODWLQGHUQLHU
OLYUHGH-XOLHQ%ODLQH4XHOHQRPEUHGHOLYUHVÆFULWV
SDU-XOLHQ%ODLQHTXHVDUHQRPPÆHQpHPEDUUDVVHQW
SDVVDSUÆVHQWDWLRQFUÆDWHXUGHODUHYXHSRÆWLTXH
'RFNV
HQ
SRÅWHHQJDJÆGDQVODSRÆVLHDFWLRQHWODSHUIRUPDQFH
FUÆDWHXUGX&HQWUHLQWHUQDWLRQDOGHSRÆVLHGH0DUVHLOOHSRÅWH
GÆJULQJRODQWHWYRFLIÆUDQWSRÅWHHQJDJƽOpH[WUÇPHJDXFKH
SRÅWHTXLDHX½FzXUGHVRUWLUODSRÆVLHGXOLYUHVDQVUÆFXVHU
QLOpLPDJHQLODPÆWDSK\VLTXH9RLO½TXLQpHVWFHUWHVSDVWRXW
PDLVGÆM½ELHQVXIILVDQW
2UJDQHJODQGXODLUHVLWXƽODSDUWLH
LQIÆULHXUHGXFRXFRPSRVÆGHGHX[OREHVWUÅVGÆYHORSSÆVSHQ
GDQWOpHQIDQFHHWUÆJUHVVDQWDSUÅVODSXEHUWÆ
QRXVLQIRUPH
ODTXDWULÅPHGHFRXYHUWXUH$LQVLDSUÅVDYRLUGLW
%\HE\HOD
SHUI
ODSDUROHGH-XOLHQ%ODLQHVHPEOHVpDPDVVHUSUÅVGHVHV
FRUGHVYRFDOHVIDLVDQWUHMDLOOLUGHOpHQIDQFHVRQWKXPRV(Q
HIIHW
7K\PXV
HVWWRXWHQWLHUXQHUÆIOH[LRQVXUODPÆPRLUHHQ
OLHQDYHFOHGLUHXQHDXWRELRJUDSKLHQLFKÆHGDQVODJRUJH&HWWH
SDUROHUHQWUÆHDPDVVÆH½OpLQWÆULHXUGXFRUSVGRQQHOLHX½XQH
IRUPHGHFRQIHVVLRQ-XOLHQ%ODLQHOpÆFULWDXGÆEXWGXOLYUH
/½SRXUODSUHPLÅUHIRLVGHPDYLHGDQVPRQÆFULWXUHMH
YDLVVRUWLUGHODSRÆVLHSRXUUDFRQWHUIDLUHGHVFRQILGHQFHV
0DLVVRUWLOYUDLPHQWGHODSRÆVLH"
Dès son seuil,
Thymus
s’éventre, s’interrogeant sur la
possibilité d’une parole poétique, exposant ses premiers
échafaudages. Puis le seuil s’épaissit dans le redoublement
de la page de garde qui caractérise le livre à la fois comme
« autoportrait »
et comme
« carnet du malheur ordinaire ».
L’écriture autobiographique fonctionne en eet à partir de
photographies, de portraits et d’autoportraits qui déclen-
chent la mémoire et son écriture. Ni les « je me souviens »
superposés de Georges Perec, ni le temps retrouvé dans une
madeleine, Julien Blaine l’écrit :
« Et me revoilà à réfléchir
aux dépens de Georges et de Marcel… »
Réfléchir, c’est
activer les miroirs internes de la mémoire et en subir les
ressacs. Toute une partie de
Thymus
est un album de pho-
tographies commentées où le poète entreprend de reproduire
le vrai mouvement de la mémoire qui n’est pour lui ni
chronologique ni ordonné. Au départ, cela semble simple :
on trouve une photographie sur la page de gauche, le souvenir
qu’elle déclenche sur la page de droite. Toutefois, chaque
page de droite reprend systématiquement les souvenirs
précédents, si bien qu’à la cinquième photographie, la page
ne peut plus contenir tous les souvenirs : elle laisse alors
tomber le plus ancien qui glisse à nouveau dans l’oubli, hors
du livre. Ce ressac de souvenirs,
a fortiori
dans un livre privé
de pagination, berce le lecteur parfois jusqu’à le plonger
dans un mal de mer partagé par l’auteur qui confesse :
« Je
relis le texte / et je me sens si futile que j’ai la gerbe / mais
à 163 pages, là / là, au moment où j’écris / autant en finir… »
Et parmi ces photographies, on trouve des membres de sa
famille, des amis, des lettres reçues… Comme il l’écrivait
déjà en 2009,
« quand on demande aux poètes et aux artistes
une note biographique, les premiers citent leurs livres, les
autres leurs expositions. On pourrait aussi bien énumérer
nos accidents d’automobile, nos baignades interdites ou les
noms de nos amis ». Thymus
convoque les images et les
mots des autres, de ceux dont le chemin croise celui du
poète et qu’il inclut généreusement dans sa situation sin-
gulière d’écriture. On retrouve des mots proprement blai-
niens :
« hui »
qui se passe du
« aujourd’ », « bécile »
coupé
de son préfixe.
Cette provocation du souvenir opère comme une résistance
à la mort. Thanatos, personnification de la mort dans la
mythologie grecque, est évoqué ici dans un autre sens :
comme synonyme de la soumission. Ce glissement séman-
tique inhabituel nous invite à nous interroger sur le voisinage
de la mort et de la soumission : Julien Blaine ne nous incite-
t-il pas ainsi à la révolte ? Pour être vivant, ne jamais se
soumettre. Ici, Thanatos quitte la statuaire grecque pour
prendre la forme d’idéogrammes dont le montage poétique
est significatif. Courir et sauter sont un même idéogramme,
tandis que le dessin figurant l’immobilité ressemble forte-
ment à un saut. En un sens, courir, sauter et être immobile
ne seraient pas la même chose ? Et si, à force de course, on
sombrait dans l’immobilité ? Dans le contexte de notre
société où la vitesse (de production, de consommation, des
échanges) semble être un critère de conduite, la poésie de
Julien Blaine propose de revoir l’ecacité de cette course
en avant.
On ne rendrait sans doute rien de
Thy-
mus
sans évoquer sa teneur visuelle. Cette
poésie tout entière traversée par l’image
se nourrit d’un travail incessant sur la
typographie, la police, la maquette. Les
polices et les tailles foisonnent, les mots
sont parfois coupés par la page ou au
contraire redoublés en miroir. Cette lé-
gèreté ludique, parfois teintée d’humour,
ne verse toutefois jamais dans la franche
rigolade.
Thymus
contient plus généra-
lement une multitude de jeux mais qui
ne sont jamais insignifiants et gratuits.
J’en tiens pour preuve le jeu de « des »
au centre du livre, qui n’est pas sans rap-
peler les célèbres Bimots de notre auteur.
Le procédé est simple : un mot est associé
à son homonyme précédé du préfixe
« de », ce même préfixe que l’on trouve
dans le verbe latin
desum,
faire défaut :
« ordre » est ainsi associé à « désordre »,
« faïence » à « défaillance »… En bous-
culant l’ordre courant de la langue, ce
montage poétique ouvre le chemin d’une
véritable réflexion sur le monde, qui se
passe de toute emphase. C’est aussi un
retour vers l’étymologie et cette com-
munauté de racines à laquelle on ne prend
plus garde : qui de nous entend encore le mot chaîne dans
« déchaîner » ?
Enfin, si je devais caractériser en un mot la poésie de
Thymus,
je prononcerais le terme d’
« attention ».
L’écriture de Julien
Blaine semble attentive à tout : aux signes, à leur forme, leur
taille, leurs sonorités, leurs sens, aux choses. Même à ceux
qui paraissent à première vue insignifiants. En témoignent
de longs passages sur des insectes, notamment celui où un
coléoptère est recueilli dans la main :
« J’ai ramassé un ma-
gnifique coléoptère aux élytres verts comme un métal vernis
à l’émeraude, c’est celui qu’enfant nous gardions toute la
journée sur nos gilets de laine (…). Il gisait mort sur le goudron
noir, si beau, je le cueillis et le nichai au creux de ma main,
puis je le portai à mon regard pour mieux l’observer. Je le fis
tourner, ventre articulé, pattes recroquevillées puis dos
luisant, bijou animal ; je le fis rouler dans ma paume pour
admirer ses élytres sirop de menthe (…). Dans un premier
délire, je sentis ses pattes remuer sur ma peau, au creux de
ma main ; j’ouvris la main : quelle sensation stupide ! Il était
là, définitivement immobile et mort, bloqué entre ma ligne
de vie et ma ligne de chance. »
Puis, lorsque le poète ouvre
une seconde fois sa main, l’animal
« déploie ses ailes mem-
braneuses et s’envole »
. Ranimé par la poésie. Julien Blaine
a fait part bien souvent de son extrême méfiance à l’égard
des monothéismes : là, il semble pratiquer l’attention ensei-
gnée par Bouddha.
Amina Damerdji
/HVDSSDULWLRQVGH)UDQFLV0DVVHGDQVODEDQGHGHVVL
QÆHVHVRQWUDUÆILÆHVGHSXLVOHVDQQÆHV$XWHXU
HWGHVVLQDWHXUGHUÆIÆUHQFHLODUHQRXYHOÆOHJHQUHDX
WDQWJUDSKLTXHPHQWTXHGDQVVDIDÄRQGpDERUGHUOHVVXMHWV
VRXYHQWVFLHQWLILTXHVHWWRXMRXUVWHLQWÆVGpDEVXUGLWÆ0DVVH
VpHVWGHSXLVWRXUQÆYHUVODVFXOSWXUHHWOHGHVVLQGpDQLPDWLRQ
GÆODLVVDQWXQSHXXQPÆGLDGDQVOHTXHOLODORQJWHPSVIDLW
ILJXUHGpDYDQWJDUGH
L’association vient de publier
Elle
dans la collection « Es-
pôlette », neuf ans après qu’elle a réédité
On m’appelle
l’Avalanche. Elle,
c’est celle qu’on ne verra jamais, mais
que le personnage principal, seul, enfermé dans une prison
dont on ne sait si elle est réelle ou mentale (ou les deux ?),
ne cesse d’attendre, de fantasmer. Comme souvent chez
Masse, on ne peut s’empêcher de songer à Beckett. Il n’y
a que deux personnages dans
Elle
, le prisonnier et son
maton, qu’on ne voit jamais mais qui répond parfois à celui
qui attend, dans ce langage particulier qui ressemble au
nôtre mais appauvri, vidé de ses règles grammaticales
complexes. Il y a donc cet homme qui attend, un béret
planté sur la tête, enfermé dans une prison en forme de
siège qui s’ouvre parfois sur la mer ou le métro, et, pour
l’accompagner, du café et des cigarettes. Six cases par page,
et l’impossibilité totale d’en échapper. Au fur et à mesure
que les planches s’accumulent, on pense encore à Woyzeck
qui tue Marie d’un trop-plein d’amour et de son incapacité
à s’adapter à ce monde violent et injuste, on pense aussi à
Kafka et sa description d’une justice arbitraire dont personne
ne peut tout à fait comprendre les arcanes.
Elle
est un bel exemple de la force du neuvième art ; en six
cases, Masse ne raconte pas une histoire mais semble révéler
tout ce qui fait notre monde, dans son absurdité, sa violence,
son incompréhension, son appauvrissement.
« Tout le
dehors du monde est maintenant retourné comme une
chaussette dans le dedans de sa prison »,
peut-on lire dans
l’introduction. Cette phrase décrit parfaitement ce qui est
en jeu dans
Elle
, à la fois tout et pas grand-chose. La sim-
plicité apparente du trait, des situations, de leur enchaî-
nement, donne à voir l’essence même de l’art de la bande
dessinée. Masse joue avec le format, comme il sait si bien
le faire, et avec le lecteur ;
« faire spectacle 6 cases… toujours
pareilles, pas pareilles »,
dit le personnage, renvoyant le
lecteur à sa position. Comme chez Beckett, en refermant
les livres de Masse, on ne sait plus très bien qui est le plus
absurde, le livre, ou le monde qui se tient derrière.
Elle, de Masse. L’Association, collection « Espôlette »,
14 euros, 82 pages en noir et blanc, sortie août 2014.
-XOLHQ%ODLQHXQHSRÆVLHGHOpDWWHQWLRQ
CHRONIQUE BD DE SIDONIE HAN
SURSRVGp
(OOH
'5

,9
/
(6
/
(775(6
)5$1¤$,6(6
6(37(0%5(6833/¦0(17
/
p+
80$1,7¦
'86(37(0% 5(
/(775(6
Jack Bilbo, Rebelle par passion,
traduit de l’allemand par Alexia Valembois.
Préface d’Henry Miller. Éditions les Fondeurs
de briques, 444 pages, 23 euros.
'
LIILFLOHGHGÆPÇOHUODYLHGHOpzXYUH
FKH]%LOER
SUÆYLHQWOpÆGLWHXU
6pLO
HVWÆWDEOLTXpLOQDTXLWHQ½%HUOLQ
HWTXpLODSDUFRXUXOHPRQGHULHQQHFHUWLILHTXH
WRXVOHVÆYÆQHPHQWVUDFRQWÆVGDQVFHWWHDXWR
ELRJUDSKLHVRLHQWWRWDOHPHQWH[DFWV
&pHVWOH
PRLQVTXpRQSXLVVHGLUH/HWRQHVWGRQQÆGÅV
OHVSUHPLÅUHVOLJQHV/HQDUUDWHXUYRLWXQDYLV
GHUHFKHUFKH
-HIL[DLOHSRUWUDLWGXJDUÄRQ
UHFKHUFKÆ&pÆWDLWOHPLHQ-HUDPDVVDLGRQF
XQHERXWHLOOHGHELÅUHYLGHODFDVVDLHWPHUD
VDLOHFU¿QHDYHFOHVWHVVRQV
$ORUV%LOERFH
UHEHOOHSDUSDVVLRQVHODQFH½OpDVVDXWGXYDVWH
PRQGHtTXLSHLQHELHQWÑW½OHFRQWHQLU&HQW
SDJHVSOXVWDUGLODGÆM½ÆWÆDXWHXU½VXFFÅV
UHSRUWHULPSUHVDULRFORZQGRPSWHXUHWDUQD
TXHXU3XLVLOVHIDLWJDUGHGXFRUSVGp$O&DSRQH
FRQWUHEDQGLHUDX[%DOÆDUHVIRQGHGHV
DWHOLHUV
FRVPÆWLTXHVSRXUIDEULTXHUXQHFUÅPHDSKUR
GLVLDTXH½EDVHGHUDFLQHVGHPDQGUDJRUH
FURLVH%UDTXHHW3LFDVVR'ÆFLGDQWGHSHLQGUH
½VRQWRXULOH[ÆFXWHWUHQWHVL[WDEOHDX[GpDIIL
OÆH7DQWÑWYDJDERQGGRUPDQWVXUOHVEDQFV
WDQWÑWLQYLWÆDX*UDQG+ÑWHORQQHOXLÆFULWTXH
SRVWHUHVWDQWH1RWUH5RFDPEROHDOHVRXFLGH
GRQQHUOHVHFUHWGpXQHYLHVLULFKHHQDYHQWXUHV
-HQHOHVDLSDVFKHUFKÆHVHOOHVPpRQWFKHUFKÆ
HWTXDQGHOOHVVHSUÆVHQWDLHQWMHPHGÆFLGDLV
WRXMRXUV½OHVDFFHSWHUHQPRLQVGHWHPSVTXpLO
QpHQIDXWSRXUOHGLUH
%LOERWRPEHOHVILOOHV
VHEDWFRPPHXQKRPPHERLWFRPPHXQGXU
WRXWHQFXOWLYDQWXQHPRUDOHOLEHUWDLUHFRQWUHOHV
¦WDWVOHXUVIURQWLÅUHVOHXUVSROLFHV/HVSDVVDJHV
OHVSOXVIRUWVVRQWDXVVLOHVSOXVYUDLVHPEODEOHV
FHX[RÖ%LOERQpDULHQ
2QHUUHVDQVEXWHW
VDQVYRORQWÆGDQVOHVUXHVODQXLW/HVPHPEUHV
VpDORXUGLVVHQWGHSOXVHQSOXVRQWUDËQHHQFRUHOHV
SLHGVMXVTXp½FHTXHTXHOTXHSDUW½XQPRPHQW
GRQQÆRQILQLVVHSDUVpHIIRQGUHU(WO½½FRXS
VØUODSROLFHWRQDPLHJDUGLHQQHGHOpRUGUHVH
WLHQWGÆM½SUÇWH½WHPHWWUHOpDPHQGH
$LQVL
ÆJDOHPHQWGXUÆFLWGHVRQLQWHUQHPHQWFRPPH
UHVVRUWLVVDQWÆWUDQJHUHQ$QJOHWHUUHSHQGDQW
OD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHTXLFRQWLHQWXQH
UDUHSURIXVLRQGHGÆWDLOVGRQQDQWDXSDVVDJH
XQFDUDFWÅUHGpDXWKHQWLFLWÆTXLPDQTXH½EHDX
FRXSGpÆSLVRGHVGHFHOLYUH
&HODVHWURXYDLW
½%XU\GDQVODUÆJLRQGH0DQFKHVWHU/HVLWH
GHOpDQFLHQQHILODWXUHGHMXWHGH:KDUIV0LOO
JDJQÆSDUODPRLVLVVXUHÆWDLWDORUVGÆVDIIHFWÆ
3DUWRXWFHWWHRGHXUGHMXWHSHUVLVWDQWHRÖTXH
OpRQSRV¿WOHSLHGOHSODQFKHUSRXUULVpÆFURXODLW
1RXVDYLRQVUHEDSWLVÆQRWUHFDPS5DWV0LOO
ODILODWXUHGHVUDWV
%LOER\OLYUHXQHFURLVDGH
GÆULVRLUHSRXUOHVGURLWVGHVSULVRQQLHUV'DQVXQ
UDUHPRPHQWGHGÆWUHVVHLOVpDUULPH½VDIRLHQ
ODIRUFHGHODYLH
4XLSHXWGLUHFHTXLOpDWWHQG
DXWRXUQDQW"1HVHUDLWFHTXpXQHVHFRQGHSOXV
WDUGWRXWSHXWÇWUHGLIIÆUHQW
(WFpHVWHQFRUH
ODYRORQWÆGHVXEOLPHUOHUÆHOTXLOHJXLGHTXDQG
LOFUÆHXQWKÆ¿WUHDYHFVHVFRGÆWHQXV'pDXWUHV
SDVVDJHVGXOLYUHVRQWVXSHUIOXV
« Six mois avant qu’Hitler n’accédât au pou-
voir, j’appelai les meneurs des partis antifas-
cistes à se réunir, et je leur soumis le plan que
j’avais élaboré pour supprimer les quarante-
huit dirigeants nazis en l’espace de vingt-
quatre heures, opération à laquelle la révolution
aurait dû immédiatement faire suite. Mais les
représentants des partis redoutaient cette
responsabilité. On ne put ou ne voulut se
résoudre à franchir le pas. »
Est-ce d’avoir
été interné en Angleterre pour la seule
raison qu’il était allemand, en dépit de ses
convictions antifascistes, qui a poussé Bilbo
à ajouter ce genre de fanfaronnades pué-
riles ? Pourtant son ode à la liberté et à la
liberté de l’imagination susait.
Sébastien Banse
/HVLQFUR\DEOHVH[SORLWV
GH-DFN%LOER
Correspondance générale,
d’Alexandre Dumas, tome I. Coll. « Classiques Garnier ».
610 pages, 59 euros.
/HV&ODVVLTXHV*DUQLHUUHSUHQQHQWYLH&HVLQXVDEOHVYR
OXPHVMDXQHFLWURQPDWPXQLVSOXVWDUGGpXQHMDTXHWWH
MDXQHYLILOOXVWUÆHGpXQHYLJQHWWHFDUUÆHHQQRLUHWEODQF
GDQVOpDQJOHHQEDV½GURLWHDSUÅVGHVDQQÆHVGHVRPPHLOYRLO½
SOXVGHYLQJWDQVTXpRQQHOHVWURXYDLWSOXVVXUXQSLOLHUDXVRXV
VROGHODOLEUDLULHFRPPXQLVWHDXFRLQGHODUXH5DFLQHHWGHOD
UXH0RQVLHXUOH3ULQFHGHYHQXHXQHERXWLTXHGHIULQJXHVf
2ÖVRQWWRXVPHVDPDQWV"
DXUDLWFKDQWÆ)UÆKHOUHSUHQQHQW
YLHGLVFUÅWHPHQWYLVLEOHPHQWYRXÆVDX[FRUUHVSRQGDQFHVHW
DXWUHVWUDYDX[TXHOD)UDQFHGX;;,HVLÅFOHGÆM½GHVWLQHDX[
XQLYHUVLWDLUHVFHTXLIDLWUHJUHWWHUGpDYRLUUDPÆSRXUVHSURFXUHU
OpLQWÆJUDOHGHVYLQJWFLQTYROXPHVGH
OD&RUUHVSRQGDQFH
GH
*HRUJH6DQGÆGLWÆVSDUOpDXVWÅUHtRQLPDJLQHt*HRUJH/XELQ
GRQWODQRXYHOOHÆGLWLRQHVWDXMRXUGpKXLGLVSRQLEOHVXU$PD]RQ
Bref, les Classiques Garnier renaissent, ce qui permet au
professeur Claude Schopp, l’inusable inventeur d’Alexandre
Dumas (au sens où l’on invente une grotte, ou le site de
Troie), de publier enfin
la Correspondance générale
qu’il
collectait depuis trente ans sur d’improbables disquettes
vouées à l’eacement et à des erreurs de manipulation
– hormis les lettres qu’il distillait au fil de ses précieuses
éditions des divers romans.
La publication de cette correspondance du plus grand
romancier français du XIX
e
siècle – avec Balzac – et de
l’un des plus universels des classiques de notre littérature,
est évidemment un événement, et l’on regrette, bien sûr,
qu’elle soit passée inaperçue (la date de parution, début
juin, une idée digne du professeur Nimbus, au milieu de
la sortie des futurs best-sellers prévus pour l’été, y est
certainement pour beaucoup).
Quoi qu’il en soit, elle est là, elle existe, et on attend avec
impatience, les volumes II et III.
Le tome I, qui nous mène de 1820 (Dumas a dix-huit ans
et écrit à son ami d’enfance Auguste Boussin,
« employé
aux Droits réunis »
de Villers-Cotterêts) à 1832, et Jean-
Baptiste Porcher, qui avançait de l’argent aux auteurs,
nous donne à voir le Dumas des débuts, au temps où il
était employé aux écritures du duc d’Orléans, futur Louis-
Philippe, à celui où il commence à triompher en inventeur
du drame romantique. Le romancier des
Mousquetaires
est encore loin. Tout au plus eeure-t-on les débuts du
narrateur des
Impressions de voyage
(en Suisse, 1832), un
premier chef-d’œuvre.
La correspondance de Dumas est plus proche de celle de
Stendhal (ennuis administratifs des postes consulaires)
ou de Balzac (qui, sauf lorsqu’il écrit à madame Hanska,
parle essentiellement boutique avec ses créanciers et ses
éditeurs), que de celle de Flaubert, qui devait se douter
confusément qu’il y donnait son grand œuvre, et décor-
setait volontairement sa phrase pour montrer qu’il était
capable d’autre chose que de concocter des dictées de
troisième, comices agricoles et autres, ou d’inspirer les
formalistes d’un autre siècle, cent ans après.
Dumas, toujours, reste naturel, et on prend plaisir à le
lire, mais son abondance est réservée à ses écrits person-
nels, et il ne se laisse pas aller aux eusions romantiques
(hormis, mais là il y a aussi de l’humour à la Gotlib) dans
ses premières lettres, lorsqu’il écrit à son ami Auguste
Boussin :
« Il me serait impossible de vous dire toutes les
conjectures que je formais sur votre silence, tantôt je pensais
que vous trouvant au bord de la mer vous étiez allé chercher
fortune en Amérique et tantôt (je ne m’arrêtais à cette pensée
qu’avec peine) que le désespoir avait abrégé vos jours. »
La plupart des lettres qu’ore ce premier volume sont
riches d’enseignement sur une histoire littéraire qui fait
maintenant partie de l’Histoire tout court. On y découvre
que Dumas a eu des relations amicales très proches avec
Vigny,
« Mon cher Alfred »
, (le moins dumassien et le
moins romancier des romantiques, qui nous inflige, à
propos de Cinq-Mars, un inventaire minutieux des moindres
boutons de guêtre de ses conspirateurs, pathétique élève
de Walter Scott qui lui, au moins, s’abreuvait aux sources
de Shakespeare et avait le mérite d’avoir inventé le roman
historique), avant qu’ils ne s’éloignent, ou qu’il appelait
Hugo
« Victor »,
ce qui, à une époque plus protocolaire
que la nôtre où le tutoiement et le
« Je t’embrasse »
ne
faisaient pas partie des ponts-aux-ânes des écoles de
communication, témoigne d’une réelle proximité. De
Trouville (14 juillet 1831), il lui propose même des douceurs :
« Nous allons vous pêcher un panier de crevettes que nous
vous ferons cuire et vous enverrons en toute diligence :
on nous assure qu’elles arriveront très bonnes à Paris. »
et il signe
« Votre frère/Alex Dumas ».
Il est d’ailleurs assez amusant de voir ces
« têtes de série »
du
Lagarde et Michard
(dont Dumas, au grand dam de
Jacques Laurent, était splendidement absent), se désigner
par leur prénom, comme vous et moi, comme un ancien
président de la République et ses épouses successives à la
une de
France Dimanche :
« Il n’y a dans l’époque que trois
poètes, Lamartine, vous et Victor »
(à Vigny, 22 avril 1831).
Il est touchant de voir la générosité dont témoignent ces
grands écrivains, qui tous apparaissent en même temps
sur la scène littéraire : ils se soutiennent, s’encouragent,
se conseillent. En juin 1831, après avoir vu
la Maréchale
d’Ancre
, de Vigny, Dumas lui dit son enthousiasme, mais
lui donne aussi des conseils :
« Recommandez à George
de faire plus haut à la fin son exhortation à la vengeance,
le public a deviné d’instinct une fort belle scène, mais n’a
rien entendu.
Deux monologues me paraissent trop longs
ou – tranchons – me paraissent inutiles. »
Suit une page d’indications précises, où Dumas se montre
le plus perspicace et le plus attentif des lecteurs, afin de
permettre à son ami d’améliorer sa pièce.
D’autres lettres témoignent de la véritable humanité de
Dumas, qui n’hésite pas à écrire à Louis-Philippe
–
dont
il est un opposant notoire
–
pour lui demander la grâce
d’un condamné aux galères ou celle d’un éditeur d’es-
tampes condamné à six mois de prison.
« Cependant, Sire,
voilà une pauvre femme qui vient à moi sans me connaître,
sans m’avoir jamais vu ; mais elle a su que j’avais obtenu une
grâce, et elle a pensé que j’en pouvais obtenir deux. Et elle a
bien fait de s’adresser à moi plutôt qu’aux hommes en faveur.
Les hommes en faveur ont tant à demander pour eux qu’ils
n’auraient certes rien à demander pour elle. Moi, Sire, je n’ai
au contraire rien que je veuille ou puisse demander pour moi. »
Élégance, dignité, limpidité de l’écriture : la lettre pourrait
être signée d’Athos.
Les lettres les plus personnelles de ce volume, on les
connaissait déjà depuis leur publication par Claude Schopp,
en 1982 : ce sont les lettres à Mélanie Waldor. On y lit
l’histoire vécue d’une grande passion romantique, des
premiers émois à l’accomplissement, puis aux déchire-
ments de la jalousie, à l’amertume de la rupture, puis à
l’apaisement :
« Oh ! Alexandre ! Tu vaux encore mieux que
les autres hommes ! Je te méprisais ; à présent je t’excuse et je
ne rougis plus de t’avoir aimé ! Car, toi, tu as l’âge pour excuse,
tu as ton sang africain, ton âme de feu et quand tu m’as aimée,
tu n’as pas calculé froidement ma perte, tu n’as pas entassé
ruses sur calcul pour m’y amener… »
lui écrit Mélanie en
août 1831. On y voit aussi Dumas au travail –
Antony
est
en répétitions ; Dumas commentant l’actualité politique
– le Paris en feu des Trois Glorieuses ; en jeune ambitieux
balzacien qui se fraie un chemin vers la gloire dans une
société en pleine ébullition.
L’édition de Claude Schopp est évidemment impeccable,
et on lui sait gré d’avoir, dans la mesure du possible, joint
aux lettres de Dumas, celles de ses correspondants. Les
notes sont précises et passionnantes, et font souvent
revivre des personnages – musiciens, acteurs, journalistes
- dont le nom a sombré dans l’oubli, et qui retrouvent
ainsi leur place dans l’histoire d’une époque.
La publication de cette
Correspondance générale
de Dumas
est un événement littéraire de l’année 2014. Souhaitons
que Claude Schopp ne perde pas de temps pour nous en
concocter la suite !
Christophe Mercier
7UÆVRUVÆSLVWRODLUHVPLVDXMRXU

/
(6
/
(775(6
)5$1¤$,6(6
6(37(0%5(6833/¦0(17
/
p+
80$1,7¦
'86(37(0%5(9
/(775(6
Joseph Conrad
,
de Michel Renouard. Folio biographies,
352 pages, 8,90 euros.
,OGÆWHVWDLWOpHDXHWQHVDYDLWSDVQDJHU
,ODYDLWSHXUGHODPHUTXpLOFRPSDUH½
XQHIHPPH
PDJQLILTXHHWGÆQXÆHGH
VFUXSXOHV
TXLWRXUPHQWHVHVDPDQWV,O
HØWSXGHYHQLUOpXQGHVÆFULYDLQVPDMHXUV
GHODQJXHIUDQÄDLVH,OFKRLVLWOpDQJODLVTXpLO
QpDSSUHQGTXp½YLQJWHWXQDQVVXUXQHJRÆ
OHWWHGHFDERWDJHODFLWR\HQQHWÆEULWDQQLTXH
HWDQJOLFLVHVRQSDWURQ\PHSRORQDLV-R]HI
7HRGRU.RQUDG.RU]HQLRZVNLYRLWOHMRXUHQ
GDQVXQH3RORJQHHQJORXWLHSDUOpRJUH
WVDULVWH½%HUGLWFKHYO½PÇPHRÖ%DO]DFD
ÆSRXVÆODVÆPLOODQWHFRPWHVVH+DQVND/H
SÅUHHVWWUDGXFWHXUGH6KDNHVSHDUH'LFNHQV
GX+XJRGHV
7UDYDLOOHXUVGHODPHU
,OFURLW
HQXQH3RORJQHOLEUHLOFRPSORWHVHUHWURXYH
HQSULVRQ/DIDPLOOHHVWFRQGDPQÆH½OpH[LO
HQ6LEÆULH3RXU-R]HIOHGÆUDFLQHPHQW
FRPPHQFHTXLQ]HDQVLOHVWRUSKHOLQ
/HVURPDQVPDULWLPHVHWODPDODGLHVRQW
VHVSUHPLHUVUHIXJHVODKDLQHGHV5XVVHV
\FRPSULVOHVÆFULYDLQV½OpH[FHSWLRQGH
7RXUJXHQLHYOHWHQDLOOHHWODSHUVSHFWLYH
GpXQVHUYLFHPLOLWDLUHGDQVOpDUPÆHWVDULVWH
OpKRUULILHGL[VHSWDQVLOIXLW/HYRLO½½
/\RQSXLV½0DUVHLOOH,ODEHVRLQGpDUJHQW
GHWRXMRXUVSOXVGpDUJHQW+HXUHXVHPHQW
OpRQFOH%REURZVNLULFKHGHVHVIHUPDJHV
Gp8NUDLQHYHLOOHHWÆSRQJHOHVGHWWHV
Depuis Marseille, où son français se colore
de l’accent provençal, le monde s’ouvre.
Les voyages s’enchaînent et la découverte
des mers, des océans, des ports, des pays,
des paysages, et des visages. La Caraïbe,
le Venezuela, la mer Noire, Malte, l’Aus-
tralie, Java, Bangkok sont ses premières
découvertes de matelot. Bornéo le fascine,
comme le golfe de Siam, le Congo et la
Malaisie qui serviront de décor à ses plus
fameux romans :
Lord Jim
,
la Folie Almayer
,
Au cœur des ténèbres
(dont se souviendra
Francis Ford Coppola pour
Apocalypse
Now
),
Un paria des îles
,
la Rescousse
. C’est
en anglais, sa troisième langue, qu’il passe
ses examens d’ocier. Il est lieutenant puis
commandant. Ce qu’il aime, ce sont les
voiliers ; ce qu’il déteste, ce sont les vapeurs.
Conrad reste un homme de l’ancien monde.
Chrétien de culture, il est obsédé par la
chute, la déchéance, la trahison, le men-
songe, la honte, la volonté du rachat, la
rédemption, la loyauté. La jungle qui englue
ses personnages fait souvent vaciller leur
raison, et, sous les tropiques, face à l’in-
connu et dans la folie des tempêtes, le vernis
moral de l’homme occidental est soumis
à de rudes épreuves.
Beaucoup deviennent des parias
Pour ses nombreux commentateurs et
biographes – qui ont cette fâcheuse ten-
dance à parler
« d’un mystère Conrad »
comme il y eut la mode du « mystère Rim-
baud » –, sa vie s’appréhende généralement
en trois actes : la jeunesse et les années de
formation ; la période des navigations et
des découvertes ; puis celle où, en bon
bourgeois anglais atrabilaire et goutteux à
monocle, chapeau melon et grande écharpe,
il puise dans le
« butin »
de ses expériences
pour composer son œuvre de fiction. Ils
s’accordent à ne lui connaître aucun vice,
excepté une addiction au tabac et une pro-
pension à dépenser l’argent qu’il n’a pas.
On sent leur embarras face à cet aventurier
sans aventures (avérées) amoureuses, marié
à une fille de libraire rondelette et bientôt
impotente qui lui donne deux enfants,
excelle dans les tâches domestiques et culi-
naires et l’encombre quand il choisit de se
déplacer en Bretagne, en Suisse, à Capri,
à Cracovie où la déclaration de guerre le
surprend, en Corse où il se documente
d’abondance pour un livre sur Napoléon
qu’il ne terminera pas et la presqu’île de
Giens qu’il arpente avec Edith Wharton et
Paul Bourget et dont il s’inspire pour son
ultime roman,
Frère-de-la-Côte
. Il aimait
accompagner les rééditions et les traduc-
tions de ses livres de notes et de préfaces.
Dans la préface de
l’Agent secret,
il écrit :
« En ce qui concerne tous mes livres, j’ai
toujours fait mon métier. Je l’ai fait en m’y
donnant complètement. Cette armation
n’est pas non plus de la vantardise. Je n’aurais
pas pu faire autrement. Je me serais trop ennuyé
si je m’étais contenté de faux-semblants. »
Il meurt en 1924 quelques semaines avant
que ne soit attribué le prix Nobel de litté-
rature à l’un de ses ex-compatriotes, l’ou-
blié Wladislaw Reymont. Il est inhumé
selon les rites de l’Église catholique à Can-
torbéry. Sur sa stèle, il a souhaité que fus-
sent gravés ces vers d’Edmund Spenser
extraits de
la Reine des fées
(1590) : « Le
sommeil après la peine / Le port après la
mer déchaînée / Le repos après le combat
/ La mort après la vie / Tout cela est fort
plaisant. »
La biographie de Michel Renouard propose
une ecace synthèse rythmée en vingt
chapitres de ce que l’on sait de celui qu’on
s’acharne à considérer comme « un écrivain
de la mer ». Pour le novice, il apporte d’in-
téressants éclairages sur la vie littéraire de
l’Angleterre victorienne, la situation du
Congo saigné par Léopold, les relations de
Conrad avec ses éditeurs (Garnett, Dou-
bleday), ses confrères (John Galsworthy,
Henry James, Stephen Crane, Ford Madox
Ford, H. G. Wells, T. E. Lawrence) et
convives du restaurant Mont-Blanc à
Londres, sa fidélité aux œuvres de Flaubert,
Maupassant et Daudet, ses rencontres avec
Gide et Larbaud, sa relation avec ses tra-
ducteurs français (d’Humières, Néel,
G. Jean-Aubry), sa réception tardive aux
États-Unis. Pour ceux qui rechigneraient
à se lancer dans les épais volumes de l’exi-
geante œuvre romanesque, nous ne saurions
trop conseiller les nouvelles de
Quintette
où se cachent de superbes pépites à moins
qu’ils n’investissent dans le volumineux
Quarto des Nouvelles complètes éditées
par Jacques Darras.
Jean-François Nivet
/HVWURLVYLHVGH-RVHSK&RQUDG
Le Livre des trahisons,
de Philippe Pivion. Le Cherche-Midi éditeur,
504 pages, 21 euros.
/HGHUQLHUURPDQGH3KLOLSSH3LYLRQQH
GÆFHYUDSDVVHVOHFWHXUV,OV\UHWURXYH
URQWOHSRLQWGHYXHTXpLODGÆM½PDQLIHVWÆ
GDQVVHVSUHPLHUVURPDQVWRXVFDUDFWÆULVÆVSDU
XQHIRUWHGLPHQVLRQKLVWRULTXHHWSROLWLTXH
$LQVLORUVTXpLOPRQWUHOHVOLDLVRQVÆWURLWHV
TXLRQWH[LVWÆGDQVOHVDQQÆHVHQWUHOHV
GLIIÆUHQWVJURXSHVIDFWLHX[IUDQÄDLVVXUIRQG
GHELHQYHLOODQFHGHVSDUWLVSROLWLTXHVKRVWLOHV
DXFRPPXQLVPH3KLOLSSH3LYLRQVHGÆYRLOH
DXWDQWTXpLOGLWODYÆULWÆ&DUFpHVWÆYLGHPPHQW
OHVUDLVRQVSURIRQGHVGHFHWWHELHQYHLOODQFHTXL
DWWLUHURQWOpLQWÆUÇW2VDQWPHWWUHHQVFÅQHFHV
ÆYÆQHPHQWVDYHFULJXHXUHWFRXUDJHLOUHGRQQH
GHVFRXOHXUVDXURPDQGHFRPEDWHWDXPRLQV
SRXUFHODVHVRXYUDJHVPÆULWHQWOHGÆWRXU
On ne manquera pas d’objecter que c’est
là davantage travail d’historien que de
romancier, et surtout que les bonnes in-
tentions ne font pas forcément les bons
romans. S’il est vrai qu’un mauvais roman
restera toujours un mauvais roman, de
quelque côté qu’il penche, il n’est nullement
interdit à un romancier de revisiter le passé.
Philippe Pivion n’est pas un historien mais
bel et bien un romancier qui a choisi d’in-
sérer ses personnages dans une période
donnée avec laquelle il entretient des af-
finités, ne serait-ce qu’à cause du rappro-
chement qu’on ne peut manquer de faire
avec les éléments politiques et sociaux qui
favorisent la montée actuelle de l’extrême-
droite. Il ne faut pas lire ses romans comme
des ouvrages d’histoire, même si celle-ci
y est traitée avec un maximum de sérieux
dans son cadre général et dans la docu-
mentation de certains faits.
Ainsi, dans
le Complot de l’ordre noir,
qui
a pour fond historique l’assassinat de Louis
Barthou, Philippe Pivion a mis au jour un
fait jusque-là ignoré : la participation de
la police française dans la mort de Barthou
par des éléments probablement infiltrés
par la Gestapo.
Le Livre des trahisons
procède
lui aussi d’une solide documentation, en
particulier sur le projet de déportation des
juifs à Madagascar, la préparation des ac-
cords de Munich ou la tentative de putsch
militaire des ociers allemands. D’où,
d’ailleurs, le sous-titre du roman : le cré-
puscule des ociers prussiens qui eurent
l’herbe coupée
in extremis
sous les pieds
par la politique d’apaisement de la France
et de la Grande-Bretagne.
Philippe Pivion a l’art de mêler la grande
histoire avec la petite. La grande, ce sont
les faits et gestes des personnages réels qui
s’arontent : Daladier, Léger, Bonnet,
Chamberlain, Schuschnigg, Goering, Hitler,
Litvinov et d’autres, tous montrés comme
vraisemblablement ils étaient. Là, la vérité
vient du romancier et on adhère à ce qu’il
en dit. La petite histoire, elle, concerne le
monde personnel d’Étienne Frottier, di-
plomate chargé des relations avec l’Alle-
magne au Quai d’Orsay. Comme la question
allemande est au cœur de la vie politique,
Frottier en retire une importance certaine,
accrue, il est vrai, par le comportement
versatile d’Alexis Leger (alias Saint-John
Perse), qui n’arrive pas à trouver son point
d’équilibre dans les changements de la
politique étrangère française. Frottier n’est
pas un grand héros mais un homme révulsé
par ce qui se trame. Cela donne à ses réac-
tions un relief et une cohérence éthique
terriblement accusatrice pour les diérents
ministres qu’il est tenu de servir.
Philippe Pivion se garde de tomber dans
l’excès de critique, rétrospectivement facile.
Il reste mesuré et cette mesure rend d’ailleurs
le propos plus accusateur. Ainsi, si Bonnet
fait indiscutablement le jeu de l’Allemagne,
sa part d’incompétence n’est pas occultée.
Alexis Leger, lui, se croyait le sphinx du mi-
nistère, capable de le diriger en sous-main,
il en vient à se paralyser lui-même par ses
propres revirements. Daladier commence
par se révulser à la pensée de céder aux An-
glais, puis accepte de tout céder à Munich et
enfin décide de tirer gloire de sa capitulation.
Le chef de la police allemande, Arthur Nebe,
toujours très professionnel dans tout ce qu’il
entreprend, met toute ses capacités à rendre
possible le putsch militaire, tandis que les
ociers qui vont le réaliser sont montrés
enthousiastes, résolus, naïfs mais finalement
désireux de restaurer l’empire. Le portrait
de Chamberlain, certainement fidèle au per-
sonnage, est le plus implacable tant il montre
la volonté de tout céder à Hitler, pourvu que
celui-ci s’oriente vers l’est.
L’univers du
Livre des trahisons
est très
vaste, de Marseille à Vienne, Londres, Berlin,
Genève, en fait, partout où se joue l’avenir
de l’Europe. Cela favorise plusieurs opéra-
tions intertextuelles qui permettent à l’auteur
de faire se croiser dans les salons de l’hôtel
Adlon, à Berlin, le grand policier Nebe et
Bernie Gunther, jadis chassé de la Kripo,
mais en réalité un important personnage
du romancier anglais Philip Kerr. Cette
petite touche inscrit davantage le roman
dans l’univers mental de ceux qui connais-
sent bien la littérature consacrée à l’Alle-
magne. Il en est de même du député Visconti,
montré participant au congrès radical à
Marseille, alors que ce personnage n’existe
que depuis qu’Aragon l’a créé pour
les Com-
munistes.
On voit clairement chez Aragon
que Visconti finira chez Pétain. La reprise
que Philippe Pivion en fait le place tout à
fait dans cette voie.
Le Livre des trahisons
aide magistralement
à comprendre quels sont ceux qui avaient
intérêt à ce que le feu prenne à l’Europe et
pourquoi.
François Eychart
$YDQWTXHOHIHXQHSUHQQH
/DILQGHODWULORJLHGX
4XDLGp2UVD\
GH3KLOLSSH3LYLRQ
Saint-John Perse.
'5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%