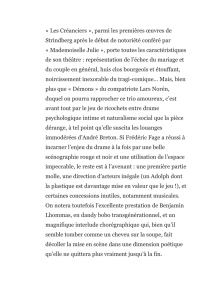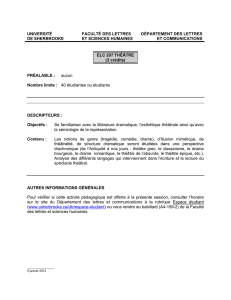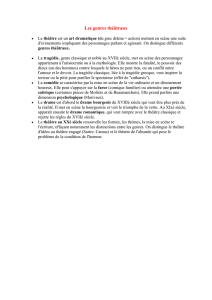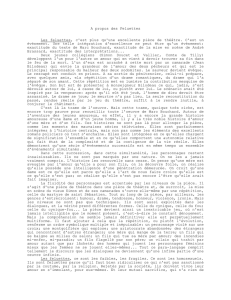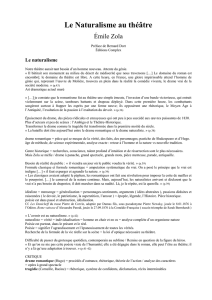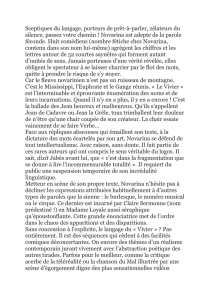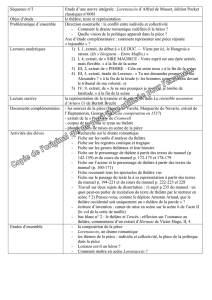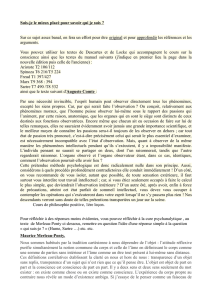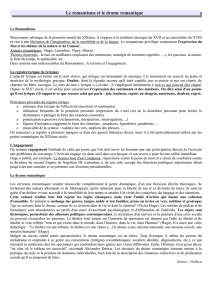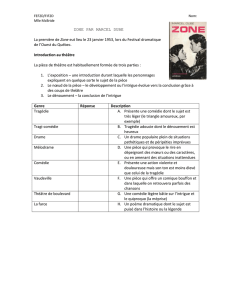« L’Enfant de Destruction »

1
Olivier Dubouclez
« L’Enfant de Destruction »
L’iconoclasme
dans le théâtre de Valère Novarina
Mémoire de DEA de littérature française
Sous la direction de
M. le Professeur Denis Guénoun
Université de Paris IV-Sorbonne
Juin 2002

2
Remerciements à Valère Novarina
pour ses conseils et ses lumières, pour la qualité de son écoute
et sa parole généreuse

3
« L’ENFANT DE DESTRUCTION »
L’ICONOCLASME
DANS LE THEATRE DE VALERE NOVARINA

4
Pratiquer comme un fou furieux,
passer aux actes chaque fois encore une foi et changer tout, signer :
L’Enfant de Destruction.
Pendant la Matière, , CDLVII

5
INTRODUCTION
Représentation et Déprésentation
I. DESTRUCTION
La légitimité esthétique du concept d'iconoclasme
Si l'iconoclasme désigne avant tout la crise religieuse et théologique qui a
éclaté au début du VIIIème siècle et s'est propagée rapidement dans tout
l'empire byzantin, on peut, à la suite d'Alain Besançon1, y voir un concept
essentiel de l'histoire de l'art et comprendre alors l'impératif théologique de la
destruction physique des images comme une mise en question générale du
rapport de l'homme à la représentation. La notion d'iconoclasme, de ce point
de vue, reçoit une double légitimité :
1. Comme concept transhistorique inscrivant la négation au cœur même de
l'histoire des œuvres. La question est alors la suivante : comment l'art se
construit-il dialectiquement sur la base d'une critique de ses concepts
fondamentaux : représentation, image, picturalité ?
2. Comme concept spécifique caractérisant le XXème siècle, apogée de cette
histoire négative — ainsi le suprématisme de Malevitch selon Besançon — et
modèle historico-philosophique d'une destruction radicale alimentant
l'imaginaire contemporain2. L'art d'après-guerre a accentué ce paradoxe d'une
œuvre intériorisant sa propre négativité dans une réduplication infinie du
désastre3.
L'iconoclasme apparaît donc à la fois comme l'accomplissement d'une
entreprise spéculative remettant en cause la validité des codes de la
représentation, et comme une protestation esthétique devant l'événement
tragique de la destruction conduisant, notamment, à une crise de
l'humanisme4.
Qu'est-ce qui toutefois nous permet de recourir à la notion d'iconoclasme
pour qualifier le théâtre de Valère Novarina ? La seule crise de la
1L'image interdite, Une histoire intellectuelle de l'iconoclasme, Paris, Fayard, 1994.
2 On peut renvoyer sur ce point à l'étude que Georges Didi-Huberman a donnée de l'œuvre de Claudio
Parmiggiani, notamment dans son rapport à la catastrophe d'Hiroshima (Génie du non-lieu, Air, poussière,
empreinte, hantise, Paris, Minuit, 2001, p. 24-25).
3 La Delocazione de Parmiggiani est le paradigme d'une telle esthétique des ruines : “ Les Delocazioni ont été
pour moi des travaux vraiment iconoclastes. J'avais enlevé de la galerie les toiles elles-mêmes, ne présentant que
leur absence (presentando solo la loro asseza), des ombres de poussière et de fumée ” (G. Didi-Huberman, op.
cit., p. 53).
4 L'œuvre de Novarina est elle-même concernée par cette réflexion sur l'humanisme et par l'événement moderne
de la destruction : le nucléaire est un “ drame de la matière ”, déclare Jean-François dans Le Drame de la vie,
puis ajoutant : “ Un jour l'homme mangera sa matière et prendra fin ” (DDLV, p. 100). Voir aussi la déclaration
de l'Homme de Sapornéol, p. 100-101.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
1
/
89
100%