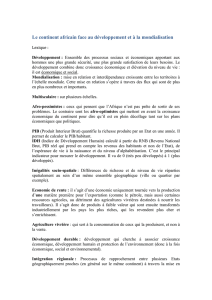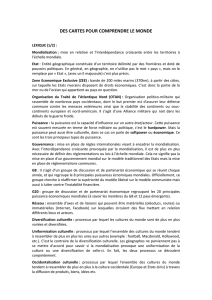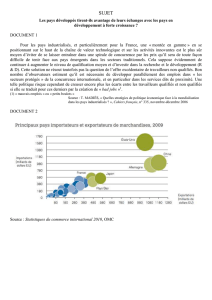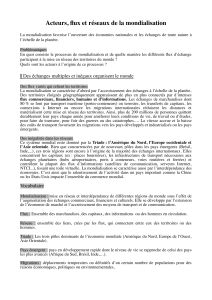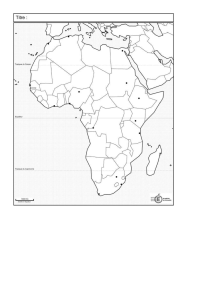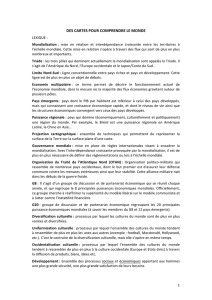LA MONDIALISATION, LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE

1
LA MONDIALISATION, LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE
L’AFRIQUE ET LA SITUATION DES POPULATIONS AFRICAINES.
Par
Professeur Moustapha KASSE
INTRODUCTION : Commençons par lever les quiproquos.
Pour ce faire les questions fondamentales qui se posent sont : la mondialisation
contribue-t-elle vraiment au développement des pays pauvres notamment des pays
de l’Afrique ? Conduit-elle à une plus grande égalité des chances et des conditions?
Quelle est sa contribution en matière de croissance, d’emploi et de lutte contre la
pauvreté ? Contribue-t-elle ou non à l’affaiblissement de l’Etat ? Quelles sont ses
conséquences directes et indirectes sur les différents acteurs ?
I- LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA
MONDIALISATION
1°) La première interdépendance est relative à la production.
Elle se caractérise par une décomposition internationale des processus
productifs qui s’appuie sur un réseau de filiales ou de sous-traitant et le nomadisme
de segments entiers des appareils de production selon la logique des avantages
comparatifs. Ces deux évolutions marquantes sont le fait des firmes multinationales
qui structurent l’espace mondial en réseaux de production. Cette stratégie leur
permet de maximiser leurs profits à partir d’une optimisation de la localisation de
leur production. Ce sont aujourd’hui, quelques 37 000 firmes multinationales de taille
très inégale qui réalisent et contrôlent l’essentiel de la production mondiale de biens
et services. Les 500 multinationales les plus puissantes fait presque 30 à 40 % du PIB
mondial soit 25 000 milliards de dollars et elles effectuent les 2/3 du commerce
international sous forme d’échanges internes avec leurs 27 000 filiales soigneusement
réparties dans l’espace mondial.

2
2°) La seconde interdépendance est relative aux échanges et le
commerce.
Le volume total des transactions quotidiennes sur les marchés des changes est
passé d’environ 10 à 20 milliards de dollars en 1998. Dans les années soixante dix à
1500 milliards de dollars en 1998. De 1983 à 1993, les achats et les ventes
transfrontaliers de bons du trésor américain sont passés de 30 à 500 milliards de
dollars par an. Les prêts bancaires internationaux ont progressé de 265 à 4200
milliards de dollars entre 1975 et 1994. On voyage également davantage.
Le tourisme a plus que doublé entre 1980 et 1996. Le nombre de voyageurs
passant de 260 à 590 millions par an. Malgré les restrictions sévères, les migrations
internationales se poursuivent, de même que les envois de fonds des émigrants. Ces
envois ont atteint 58 milliards de dollars en 1996. Le volume des appels
téléphoniques internationaux s’est envolé entre 1990 et 1996, passant de 33 à 70
milliards de minutes. Les voyages, internes et les médias stimulent la croissance
exponentielle des échanges d’idées et d’informations.
3°) La troisième interdépendance concerne les marchés
financiers.
Elle est rendue possible par la conjugaison de trois éléments :
La désintermédiation, elle permet aux entreprises, à l’Etat de
recourir directement sans passer par les intermédiaires
financiers et bancaires pour effectuer des opérations de
placement et d’emprunt
Le décloisonnement qui se traduit par la suppression de
certains compartiments des marchés.
La déréglementation celle-ci indique l’abolition des
réglementations des marchés des changes pour faciliter la
circulation du capital.
Au début du 20ème siècle, les mouvements internationaux de capitaux
participent au processus de mondialisation de l’économie. Mais le développement de
la finance mondiale atteste d’une déconnexion croissante entre les flux de capitaux et
les besoins de financement de l’économie réelle.
4°) La quatrième interdépendance est relative aux
Technologies de l’Information et de la Communication
Les technologies de l’information et de la communication sont entrain de modifier les
systèmes productifs et les perspectives de la croissance et de l’emploi. Elles
déclenchent une explosion des activités économiques, recomposent les territoires
industriels et interconnectent tous les marchés de la planète. Ce sont elles qui font
précisément du monde un village planétaire.

3
II- LES ASYMETRIES REMARQUABLES DE LA
MONDIALISATION.
Dans une évaluation du système mondial M. Beaud1 observe avec raison que
jamais l’humanité n’a disposé d’autant de techniques et n’a produit autant de
richesses mais également jamais elle n’a crée autant d’inégalités et de pauvreté
traduisant ainsi un monde assez fortement asymétrique. Le Produit mondial a connu
au cours du siècle une croissance exceptionnelle, en dollars de 1975, il est passé de
580 milliards en 1900 à 25000 milliards au milieu des années 90 ce qui représente en
moyenne 4500 dollars per capita. Cependant ce tableau idyllique est terni par une
succession de crises graves qui sont autant de périls économiques, financiers et
sociaux dont la dernière en date a failli mettre en faillite l’Asie des Nouveaux Pays
Industrialisés offerts comme le modèle de référence aux PVD.
Cette économie monde fonctionne dans un contexte de paradoxes et
d’inégalités. Elle est selon le Professeur K. Valaskakis sources de trois dualités aux
conséquences graves pour les PVD :2
la fracture sociale entre riches et pauvres ;
le fossé grandissant entre inclus et exclus (chômage
structurel) ;
et l’impuissance de l’Etat dans l’interdépendance qui se manifeste
dans le fait que les gouvernements, malgré les meilleures intentions
du monde, n’arrivent pas à gérer l’interdépendance planétaire.
III- L’AFRIQUE DANS LA MONDIALISATION : ENTRE
PAUVRETE, PRECARITE ET EXCLUSION.
La distribution des revenus à l’échelle mondiale laisse apparaître deux types
d’inégalités : celles qui existent d’abord entre les pays et celles observées au sein
même des pays, qu’ils soient du Nord ou du sud.
1°) Les inégalités marquantes de la mondialisation
Sur le premier type, les statistiques montrent que le monde est en phase de
polarisation, avec un fossé de plus en plus large entre les pays pauvres et les pays
riches. Concrètement, le revenu par habitant entre les pays industrialisés et les pays
en développement a ainsi triplé, passant de 5 700 dollars en 1960 à 15 400 dollars en
1993.
De plus sur les 23.000 milliards de dollars que représentait le PIB mondial en
1993, 18.000 milliards provenaient des pays industrialisés, contre seulement 5.000
milliards pour les pays en développement. Encore plus significativement, le
cinquième le plus riche de la population mondiale dispose de plus de 80% des
1 M.Beaud : Histoire du capitalisme de 15000 à nos jours, Edt. Seuil, 380p
2 K. Valaskakis : Mondialisation et gouvernance, Revue Futurible, Avril 1998

4
ressources et le cinquième le plus pauvre de 1%. Quelque 2,7 milliards d’individus
(sur 6 milliards) vivent avec moins de 2 euros par jour et ils seront environ 4
milliards en 2015.
2°) Marginalisation et déconnexion de l’Afrique du processus de
mondialisation
La participation de l’Afrique à l’économie mondiale a fortement diminué au
des cinq dernières décennies aussi bien du point de vue de son PIB, de ses
exportations que des IDE reçus. Selon l’OCDE, la part de l’Afrique dans le PIB
mondial mesuré en parité de pouvoir d’achat entre 1950-2000 a baissé d’un tiers alors
que sa part dans les exportations a été divisée par 3. Il en va de même pour les
investissements directs étrangers comme cela a été établi plus haut.
3°) pauvreté de masse et défaillance des systèmes de protection
sociale
Le continent est traversé par une crise sociale d’une très grande ampleur qui
se manifeste dans l’accroissement du couple pauvreté et chômage. Cela entraîne une
forte dégradation des conditions de vie : pénurie et insécurité alimentaires, diverses
épidémies, non-accès aux services de base. Ce processus de paupérisation de masse
s’accompagne paradoxalement d’un affaiblissement des formes modernes comme
traditionnelles de protection sociale. En effet, le continent africain administrait la
preuve d’une indiscutable « solidarité », découlant principalement d’un ensemble
d’obligations et de droits complexes destinés à préserver la cohésion du groupe et à
réduire l’incertitude économique.
La logique du « don et du contre don », sans doute latente dans ce tissu
d’obligations réciproques, instaure un contrat-social implicite. Or, ce contrat-social
est entrain de se déliter dangereusement. Dès lors, la protection sociale cesse de
s’appuyer sur les réseaux de la famille élargie qui n’est plus en mesure de répondre
aux sollicitations de ses membres les plus faibles et les plus démunis dans un
contexte de crise économique. Au niveau des structures formelles les choses ne vont
pas mieux suite à la crise profonde du système public de sécurité sociale, symbole de
« l’Etat-providence ».
IV- L’HYPOTHÈQUE DE LA DETTE AFRICAINE.
Depuis le début des années 1980, à la suite notamment des chocs pétroliers de
la décennie précédente, nombre de pays africains ont été confrontés à divers
problèmes d’ordre macro-économique : déficits budgétaires, déficits de la balance
des paiements, inflation. Ceci a conduit à l'élaboration de programmes d'ajustement
structurel avec les institutions de Bretton Woods. Ces programmes, qui avaient sans
doute sous-estimé l'amplitude du problème, partaient de l'idée que l'équilibre macro-
économique constituait un objectif structurel de base en dehors duquel aucune action
de développement n'était possible.
Par ailleurs, l'ampleur des déficits impliquait des actions vigoureuses : si les
partenaires financiers acceptaient de contribuer sur le court terme, ils souhaitaient en

5
contrepartie que des politiques économiques rigoureuses soient adoptées par les
Etats car le financement extérieur ne pouvait être assuré de manière durable. Cette
formule procurait aux pays pauvres une aide de trésorerie substantielle et des
financements pour leurs programmes de réforme, mais le stock de leur dette ne
cessait de croître. En conséquence, les paiements au titre du service de la dette des
pays pauvres très endettés sont passés en moyenne de l’équivalent d’environ 17%
des recettes d’exportation en 1980 à une pointe d’environ 30% en 1996 (R. Powell,
2000).
C'est dans ce contexte que la première initiative de réduction de la dette a été
prise en 1996 par les pays développés ; l'initiative devait ensuite prendre davantage
d'envergure en juin 1999 à la réunion du G7 de Cologne. En septembre de cette
même année, a pris corps et s'est structurée l'idée que les ressources dégagées
annuellement par les pays du fait de la réduction de leur dette devaient être investies
dans des actions et programmes visant à une réduction substantielle de la pauvreté
dans les pays concernés. Il a été décidé que le cadre stratégique pour la réduction de
la pauvreté serait le document de référence pour toutes les actions en faveur des pays
en voie de développement et que ce document serait un produit national élaboré par
les gouvernements de ces pays, mais en large concertation avec les acteurs concernés
et la société civile.
V- QUELLE STRATEGIE D’INSERTION DANS LA
MONDIALISATION ?
Le FMI, dans son rapport de 1996, montre qu’il sera illusoire de rejeter la
mondialisation car elle doit permettre aux pays, quel que soit leur niveau de
développement, de saisir des opportunités. Dans son sillage, certaines économistes
considèrent que la globalisation n’est pas un jeu à somme nulle et que les pays en
développement et les pays industrialisés en tirent des effets d’entraînement
réciproques conformément aux théories de l’échange international (Ricardo et HOS).
Celles-ci soulignent par ailleurs que le commerce sans entrave est favorable à
tous les partenaires quelle que soit leur taille pourvu simplement qu’ils se
spécialisent dans les productions où ils ont les meilleures dotations factorielles
naturelles.
Il n’existe dès lors aucun obstacle insurmontable sinon l’Etat au
développement des échanges. C’est cette logique qui préside à la création de l’OMC.
A l’appui, l’OMC montre que la valeur du commerce mondial de marchandises s’est
accrue en 1995 de 19%. Ainsi la valeur des Exportations mondiales passe de 164
milliards de dollars en 1960 à 4900 milliards en 1990. Le commerce mondial a été
multiplié par 39. Il n’en va pas de même pour l’Afrique dont la progression est
inférieure à la moyenne mondiale (5,4%).
Quel que soit l’indicateur considéré, on s’aperçoit que l’Afrique est
marginalisée tout aussi bien dans le processus de production, d’échanges et dans la
distribution des investissements directs étrangers. A cela viennent s’ajouter des
termes de l’échange complètement défavorables contribuant à la détérioration du
pouvoir d’achat des africains.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%